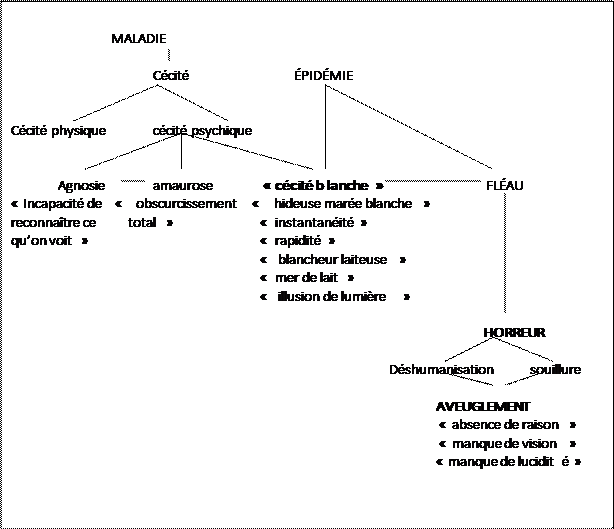L’Histoire est un des lieux privilégiés de la quête romanesque de Saramago et la toile de fond des récits qui ont précédé1 L’aveuglement (Ensaio Sobre a Cegueira2). Il s’agit de romans qui s’inscrivent dans la lignée du postmodernisme, en conflit et en rupture avec les canons classiques. L’Histoire est ici revisitée, réécrite à travers une construction originale de la narration et du choix des personnages qui hantent son imagination et sa conscience, avec au premier rang les vaincus, les persécutés, les exclus, mis en valeur, cependant, par leur capacité à rebondir.
Le questionnement sur les rapports entre l’Histoire et la fiction, sur la pensée et ses représentations discursives, sur la philosophie et la littérature, sur la science et l’idéologie sont autant de sujets de la déconstruction3. Chez Saramago il y a déconstruction des références auxquelles nous nous identifions naturellement, dans le but de produire de nouveaux sens avec lesquels le lecteur (citoyen du monde) pourra repenser son propre rôle dans l’avenir de l’humanité. Son œuvre, de portée universelle, semble donc échapper aux classifications et elle semble rétive à l’analyse. Au premier regard, chaque roman de Saramago donne à voir un monde réel infiltré et/ou subverti par le surnaturel et le fantastique. Le style balance avec bonheur entre une forme d’écriture historique à la manière de chroniqueurs tels que Fernão Lopes et le mimétisme baroque4 qui met en relief une écriture harmonieuse de la « parole5 ».
Dans cette perspective, dans les romans L’Aveuglement (Ensaio sobre a cegueira), Tous les noms (Todos os nomes), Caverne (Caverna) et La lucidité (Ensaio sobre a lucidez), à la question ontologique – Dans quel monde sommes-nous ? – Saramago répond par la mise en place de leur déconstruction ce que lui permet de renvoyer une image d’un monde aliéné, devenu chaotique, où la réalité y est plurielle et fragmentée, où les valeurs et les références s’estompent et où l’instabilité et l’incertitude s’installent.
Certes, dans ces univers fantastiques et kafkaïens, les discours de questionnement forment l’ossature de ces romans. L’aveuglement se penche sur la problématique de l’obscurcissement de la raison ou sur l’aliénation, tout court. Tous les noms est consacré au questionnement sur la recherche de l’Autre. La Caverne a pour objet l’immobilité de l’esprit et La lucidité les avatars de la démocratie et de sa légitimité.
André Bueno, dans une étude sur les différentes formes de crise, estime que la finalité de ces récits est de soulever un certain nombre de questions de fond sur la condition humaine et les attester par la description des situations limites vécues par les personnages. Il insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas simplement de jeux de signifiants mais également d’un profond malêtre face à l’aliénation qui caractérise notre déraisonnable société contemporaine. Or, c’est bien le cas de l’Aveuglement.
1. L’Aveuglement : un roman, un essai, une allégorie…
Les titres de certains de ces romans tels que Manuel de peinture et de calligraphie (Manual de pintura e caligrafia), Histoire du siège de Lisbonne (História do cerco de Lisboa), Le Dieu manchot (Memorial do convento), Évangile selon Jésus-Christ (O Evangelho segundo Jesus Cristo), L’Année de la mort de Ricardo Reis (O Ano da morte de Ricardo Reis) témoigent du goût de l’auteur pour l’hybridisme générique.
L’Aveuglement est lui aussi un roman au genre hybride : « roman – essai » et « roman – allégorie »6. Saramago7, lui-même, le définit comme étant un essai sans être un essai, peutêtre un roman, une allégorie, un conte philosophique si cela pouvait correspondre aux besoins de notre siècle. Il faut dire que ce roman a un thème conducteur assez provocant et qui pointe le doigt sur l’angoisse qui étreint notre société ; une histoire et une trame – un monde qui perd la raison et erre de folie en folie (autoritarisme, chantage, vol, viols…) ; des personnages sans nom – de simples voix dans une odyssée d’horreurs – un espace et un temps « non nommés ». Un roman, bref, qui raconte l’apocalypse, l’effondrement de toute une société.
Dans son titre original – Ensaio sobre a Cegueira –, le renvoi au genre essai est direct et, de surcroît, l’attention portée à la perspective sociologique est soulignée. D’après Eduardo Prado Coelho8 ce genre est une forme de pensée qui sert à pondérer la valeur des idées et qui surgit comme l’expérience nécessaire à l’éloignement du danger qui pourrait menacer l’individu physique ou la personne morale. Enfin, l’essai, discours de la démonstration et de l’argumentation, à l’aide aussi bien de contenus dialectiques que de formulations dichotomiques, analyse les faits, les vérités, les présomptions, les valeurs, les hiérarchies, etc., proposés par la trame du roman afin d’en retirer des enseignements sur le fonctionnement de la société postmoderne (ou contemporaine), ses dérives, ses écarts de valeurs et de principes humains.
Ce « roman – essai » répond ainsi à l’hypothèse posée par l’auteur : Et si nous devenions tous aveugles ? Par une méthode qu’on pourrait rapprocher de la démarche scientifique, l’expérience consiste à analyser et à vérifier cette hypothèse qui fait état de l’abjection à laquelle un être humain peut tomber au fur et à mesure qu’il se déshumanise. Allant plus loin, ce roman peut également être une anti-utopie9 car il montre une image d’un monde qui ne devrait pas exister, comme nous le signale si justement l’auteur au moment de son lancement : « une imago mundi, une image du monde dans lequel nous vivons ; un monde d’intolérance, d’exploitation, de cruauté, d’indifférence, de cynisme »10. Il s’agit de la représentation de l’image du monde réel et de ses dystopies, un monde instable et en dangereuse mutation où l’intolérance, la cruauté, l’indifférence et le cynisme règnent en maître.
L’allégorie11 est également présente dès le paratexte. D’abord dans le titre qui annonce les conclusions tirées de l’essai, puis dans l’épigraphe Si tu peux regarder, vois. Si tu peux voir, observe. Livre des Conseils12. Les hommes peuvent voir et s’ils voient, ils peuvent observer sans aliénation et donc réparer ce qui est mal. L’allégorie s’oppose au symbole (représentant la totalité), car elle est alimentée de métaphores de la fragmentation et des ruines13, comme le suggèrent les passages suivants :
nous avons descendu tous les degrés de l’indignité, tout autant que nous sommes, jusqu’à atteindre l’abjection, […] nous sommes tous égaux devant le mal et le bien…les notions de juste et d’erroné sont simplement une façon différente de comprendre notre relation à l’autre[…] il y a en chacun de nous une chose qui n’a pas de nom, et cette chose est ce que nous sommes […] Mon Dieu la lumière existe, et j’ai des yeux pour la voir, louée soit la lumière […] Je pense que nous ne sommes pas devenus aveugles, je pense que nous étions aveugles, Des aveugles qui voient, Des aveugles qui, voyant, ne voient pas14.
Il faut également remarquer que les catégories de la narration, ici le temps et l’espace non identifiés, sont au service de l’allégorie : nous voyons ce que nous avons seulement quand nous l’avons perdu15. À la fin du roman, en effet, une lueur d’espoir apparaît, comme l’amorce d’une rédemption, notamment, par les références à la pluie, à l’organisation sociétaire et à la « lucidité ».
Ainsi, à la souillure qui rend l’humain abject s’oppose la purification par l’eau. Deux exemples nous semblent éclairants. Si nous nous reportons d’abord au chapitre 15, le personnage « femme du médecin » dit ceci :
Quand l’aube parut il se mit à pleuvoir […] la pluie lui disait, Lève-toi […] il fallait laver, Laver […] cette insupportable saleté de l’âme. Du corps […] ça revient au même […] une nappe d’écume mousseuse tombe du balcon, comme j’aimerais pouvoir tomber avec elle, interminablement propre, purifié, nu16.
Puis dans le même chapitre, cette même pluie nettoie : « Emportés par l’eau, […] les ordures s’étaient amoncelées en petits monticules, laissant propres d’amples sections de la chaussée »17.
À la fin du récit, il est question de combattre l’état de barbarie. Le recours aux constructions discursives symétriques met en relief la dichotomie sacré / profane, ou tout simplement l’opposition entre un monde chaotique et un monde organisé. Ainsi, au chapitre 16, sur la « place des proclamations magiques » est proclamée la fin du monde dans les exemples : « des groupes d’aveugles écoutaient discourir d’autres aveugles […] Là on proclamait la fin du monde, le salut par la pénitence […] Ici personne ne parle d’organisation, dit la femme du médecin à son mari »18.
Et ainsi au chapitre 17 au discours apocalyptique s’oppose un discours de construction sociétal :
Ils traversèrent une place où des groupes d’aveugles s’amusaient à écouter les discours d’autres aveugles […] L’on proclamait les principes fondamentaux des grands systèmes organisés, la propriété privée, le libre-échange, le marché, la Bourse, la taxation fiscale, les intérêts, l’appropriation, la désappropriation…Ici on parle d’organisation, dit la femme du médecin à son mari19.
Tout ceci prépare la déclaration énigmatique du personnage de la femme du médecin : « elle ressurgira »20. Ce qui justifie l’allégorie. Au final, la thèse que le roman – essai – allégorie développe dans ce récit, c’est qu’il est urgent et impératif de réhabiliter les valeurs fondatrices de l’humanisme : le respect de l’autre, la solidarité et l’amour. En procédant à une déconstruction de la vision de ce monde mauvais c’est par le mal que l’auteur montre du doigt le Mal. L’éventail d’horreurs qui structurent la trame de ce roman en est la preuve.
Après ces considérations générales sur les spécificités structurelles et idéologiques de ce roman, il est temps de se référer à son histoire. L’action de L’aveuglement commence d’une manière assez insolite, quand arrêté au feu rouge, un conducteur assis dans sa voiture devient soudainement aveugle. C’est le début d’une épidémie qui s’étend à tout un pays. L’insolite cécité ou « mal-blanc » ou « blancheur lumineuse », ainsi dénommée par les instances du pouvoir, devient vite un véritable fléau qui n’épargnera personne à l’exception d’une femme, la seule à voir l’amour et la solidarité. Cette femme guidera le groupe d’aveugles dans les aventures qui se suivent à une vitesse fulgurante. D’abord on les verra en quarantaine dans un asile de fous désaffecté, ensuite en errance dans la ville, où des hordes d’aveugles sont livrés à eux-mêmes dans un monde qui a perdu toutes les valeurs d’humanité. Ce sont des personnages qui se déshumanisent, en quête de survie, convulsionnés par la peur, la violence, la haine, la vengeance, la cruauté, l’indifférence et l’égoïsme.
Nous partons du principe qu’il s’agit d’une histoire à deux intrigues ; une intrigue secondaire (la cécité) et une intrigue principale (le fléau ou l’histoire des horreurs). Ceci dit, pour comprendre la succession d’événements qui forment la trame de l’histoire il nous semble judicieux de commencer par l’analyse de la cécité.
2. La cécité
Le cadre conceptuel de l’œuvre s’établit à partir d’un fait générateur : l’épidémie de cécité. Les quatre premiers chapitres du roman sont consacrés à l’élaboration de ce concept. Nous rappelons que le concept est ici la chose observée, l’élément identifiable par les propriétés et les relations qu’il engendre, dans un processus sémiotique de construction de connaissances. Ainsi, l’auteur-narrateur agit avec logique et méthode, respectant les phases du processus de sémiotisation ou de la mise en signes21 : découpage du réel, construction des éléments de pensée, conceptualisations, lexemisation et mise en discours. La sémiotisation sert, in fine, à nommer les concepts. Or, on voit que dans le roman, si toutes les phases d’analyse sont accomplies, et même au-delà, dans la mise en circulation dans le discours par les relations d’équivalence, d’opposition, hiérarchiques et d’inclusion, le processus reste incomplet car cette maladie ne trouve pas d’étiquette. Elle est insolite, étrange, orpheline dirait la médecine aujourd’hui. Dans une perspective sémantique elle peut, cependant, être classée comme une isotopie générique thématique, qui met en scène plusieurs réseaux sémantiques et des ensembles lexicaux structurants de la cohérence du texte. Elle est, de la sorte, l’hyponyme de la maladie et de la cécité psychique, et une fois reconceptualisée, elle est l’hyponyme de fléau et le co-hyponyme de l’aveuglement, la deuxième isotopie générique.
L’histoire de la maladie est la suivante : tout d’abord, son apparition soudaine et insolite, suivie de sa propagation immédiate, puis l’incapacité du corps médical à donner un nom et donc une forme de traitement adéquat à son éradication. Cette maladie presque innommable et impossible à soigner, devient vite une épidémie ce qui sous-tend une action directe du gouvernement : établissement d’un cordon sanitaire et l’imposition d’une quarantaine.
Tenant compte du tableau proposé ci-dessous (fig. 1), ainsi que des premiers chapitres du roman consacrés à la définition de la cécité, il est intéressant d’illustrer par quelques exemples les différentes phases de lexicalisation de la maladie. Elle sert d’interface à la thématique de l’aveuglement et, donc, aux manifestations de l’horreur qui sont la trame des chapitres suivants.
Fig 1 : schéma conceptuel de la cécité dans L’aveuglement
Classes : L’aveuglement (dimension22 et sème macrogénérique) en position de superoordonnée ; la cécité (domaine de la médecine et sème mésogénérique) en position de subordination
Premièrement, la cécité apparaît soudainement, sans explication logique :
Je suis aveugle […] je suis aveugle, je suis aveugle […] je ne vois pas, je ne vois pas […] mon mari est devenu subitement aveugle […] la police a eu connaissance de deux cas de cécité subite […] L’un après l’autre, ils devinrent tous aveugles, les yeux soudain noyés dans la hideuse marée blanche […] pendant les premières vingt quatre heures […] il y avait eu des centaines de cas, tous pareils, tous se manifestant de la même façon, rapidité, instantanéité23.
Deuxièmement, elle se définit par un sème de la blancheur, indice d’une autre dimension :
c’est comme si j’étais en plein brouillard, comme si j’étais tombé dans une mer de lait […] Eh bien je vois tout blanc […] il m’est entré une mer de lait […] C’était comme s’il y avait eu un mur blanc de l’autre côté […] l’insondable blancheur couvrait tout […] il se trouvait plongé dans une blancheur si lumineuse et si totale qu’elle dévorait plutôt qu’elle n’absorbait les couleurs et aussi les objets et les êtres, les rendant ainsi doublement invisibles […] Comme une lumière qui s’éteint, Plutôt comme une lumière qui s’allume […] l’illusion de lumière […] les aveugles étaient toujours entourés d’une blancheur resplendissante, comme le soleil dans le brouillard. Pour eux, la cécité ne consistait pas à vivre banalement enveloppés de ténèbres mais à l’intérieur d’une gloire lumineuse24.
C’est en effet l’itérativité de la blancheur qui attribue à cette cécité étrange un sème qui dans son contexte normal devrait être un sème afférent et qui est ici un sème inhérent25. Dans sa signification symbolique le blanc est soit l’absence de couleur soit la synthèse de couleurs. Or, il symbolise ici la couleur du passage, impliquant la mutation de l’être vers la mort et la renaissance. Il renvoie à l’aveuglement.
Troisièmement, la maladie dépasse la science médicale car on voit qu’il y une tentative de soulever les caractères intrinsèques de la maladie et de lui attribuer une dénomination26 sans résultats concluants. Cette maladie est définie pas l’absence de symptômes. Ainsi, à titre d’exemple :
Il ne découvrit rien dans la cornée, rien dans la sclérotique, rien dans l’iris, rien dans la rétine, rien dans le cristallin, rien dans la tache jaune, rien dans le nerf optique, rien nulle part […] je ne lui trouve aucune lésion, ses yeux sont parfaits[…]c’est que si vous êtes effectivement aveugle, votre cécité est pour l’instant inexplicable27.
Au caractère anodin de l’absence de symptômes il s’ensuit une recherche de classification :
[…] l’agnosie, la cécité psychique…l’agnosie, on le sait, est l’incapacité de reconnaître ce qu’on voit… il s’agit peut-être d’une amaurose…cette cécité est blanche, précisément le contraire de l’amaurose qui est un obscurcissement total, sauf s’il existe aussi une amaurose blanche, un obscurcissement blanc […] il pourrait s’agir d’une variante de la cécité psychique ou d’une amaurose…le mystérieux territoire de la neurochirurgie […] Une amaurose blanche, outre qu’étymologiquement elle serait une contradiction, constituerait ainsi une impossibilité neurologique, puisque le cerveau, qui ne pourrait alors percevoir les images, les formes et les couleurs de la réalité, ne pourrait pas non plus…couvrir de blanc, d’un blanc uni, comme une peinture blanche sans tonalité, les couleurs, les formes et les images que cette même réalité présenterait à une vue normale […] l’étiologie du mal blanc, car c’est ainsi qu’avait été désigné la malsonnante cécité par un assesseur inspiré et débordant d’imagination28.
Finalement, au titre de l’action publique, le gouvernement met en œuvre les moyens habituels, à savoir : mise en quarantaine et cordon sanitaire qui se révèlent à leur tour inefficaces. Les quelques exemples ci-dessous en témoignent :
[…] toutes les personnes devenues aveugles… seraient rassemblées et isolées […] la cécité s’étendait, non pas comme une marée subite qui eût tout inondé et tout emporté devant elle, mais comme l’infiltration insidieuse de mille et un ruisselets turbulents qui, après s’être attachés à imbiber lentement la terre, la noient soudain complètement […] Le gouvernement lui-même donna la preuve de la détérioration progressive de l’état d’esprit général […] étaient convaincues que le mal blanc se propageait par contact visuel, comme le mauvais œil […]29.
Ainsi, au désespoir de donner un nom au phénomène, on fait appel à des métaphores et à des comparaisons pour lui donner du sens. Ce mal blanc, ainsi désigné, est par ailleurs le déclencheur d’une situation extrême, un fléau de l’humanité propice à l’horreur.
3. L’aveuglement : manifestation de l’horreur
Le roman, comportant dix sept chapitres, dont les treize derniers sont consacrés à la thématique de l’horreur, introduit un nouveau référentiel. Le mot horreur, d’ailleurs, est par excellence un signifiant qui interpelle la totalité des sens, il est donc très polysémique et par conséquent lié à des contenus tels que : l’effroi, l’épouvante, la peur, l’aversion, le dégoût, la cruauté et l’abjection.
Dans le cas de notre récit il se déploie vers l’abjection. C’est le champ sémantique de l’abjection qui servira à la déconstruction du monde pour encoder le sens du chaos. Les personnages seront jetés dans un monde d’extrême abaissement et avilissement. Espaces et sens constituent désormais les éléments des dichotomies humanité/animalité.
3.1. Les espaces de l’aliénation
Les espaces de cette abjection sont l’asile d’aliénés désigné tout d’abord comme un « labyrinthe rationnel » durant neuf chapitres, pour ensuite devenir le « labyrinthe dément de la ville » les cinq derniers chapitres.
L’asile où la quarantaine est qualifiée d’inhumaine, est décrit comme un endroit immonde aux lumières sales et jaunâtres. En effet tout y est immondice et sent l’abandon : les cabinets, la cuisine « qui n’avait pas encore perdu son odeur de mauvaise nourriture30 », la dégradation et la ruine de l’immeuble, jonché de débris. Au fur et à mesure des événements qui tissent la trame, ce lieu devient un espace de mort et d’indignité car ici et là on voit des cadavres tués par les soldats, à l’abandon, au milieu des ordures.
La ville, bien qu’un espace ouvert, est le réceptacle de la folie qui s’est installée dès l’asile de fous. Elle est nauséabonde. La pourriture, les excréments et les cadavres sont partout. Image liminaire du chaos, ce sont les champs lexicaux de la saleté, de la pourriture, de la mort et de l’eschatologique qui structure ce discours dur, sans truculence31.
Les passages suivants qui ont trait à la saleté, à la pourriture, aux excréments et aux cadavres, sont assez explicites :
[…] il y a des ordures partout. […] une pâtisserie d’où s’exhalaient des relents de crème surie et d’autres pourritures […] L’aspect des rues empirait d’heure en heure. Les ordures semblaient se multiplier pendant la nuit. […] Amollis par la pluie, des excréments jonchaient la chaussée ici et là […] Les détritus dans les rues, qui semblent avoir doublé depuis hier, les excréments humains, ceux d’avant à moitié liquéfiés par la pluie violente, pâteux ou diarrhéiques, ceux qui sont éliminés en ce moment même par des hommes et des femmes pendant que nous passons, saturent l’atmosphère de puanteur, comme un épais brouillard à travers lequel il est difficile d’avancer. Une meute de chiens dévore un homme…Un corbeau sautille …un vomissement monta. […] Pas une lumière pâle aux fenêtres, pas un reflet exsangue sur les façades, ce n’était pas une ville qui s’étendait là, c’était une immense masse de goudron qui en refroidissant s’était moulé elle-même sous la forme d’immeubles, de toits, de cheminées, tout était mort, tout était éteint32.
C’est en effet dans la ville que le processus de déshumanisation s’accomplit car « un être humain s’habitue à tout, surtout s’il a cessé d’être humain33 ».
3.2. L’absence de noms propres
En suivant cette logique, on rappellera que les malades n’ont pas de nom, ce sont des patients anonymes. Néanmoins, en dehors de ce contexte spécifique, les personnages continueront de vivre sans identité. À défaut de dénomination, ils sont classés soit par un ordre numérique, soit en référence à des spécificités physiques ou professionnelles : le premier aveugle, le voleur, le garçon louchon, la fille aux lunettes teintées, un vieillard avec un bandeau noir sur l’œil, l’agent de police, le chauffeur de taxi, la secrétaire dans un bureau, l’aveugle insomniaque, entre autres. Au fur et à mesure que le chaos et la déshumanisation s’aggravent, la classification se diversifie selon un nouvel ordre : les aveugles scélérats, les bons aveugles, les mauvais aveugles. L’absence de nom est effectivement le premier indice de la déshumanisation qui s’instaure : « Il ne dit pas comment il s’appelle, lui aussi doit savoir qu’ici ça n’a pas d’importance34 » ; « Quel est votre nom, Les aveugles n’ont pas besoin de nom35 ».
Une fois entamé le chemin de la déshumanisation, la barbarie prend le relais. Les aveugles pervertissent les principes de leur civilisation perdue qui dans le contexte de ce récit paraissent des actes barbares. Ainsi, leurs agissements s’appuient instinctivement sur les pouvoirs dont ils disposent : monopoliser la nourriture, répandre la terreur, pratiquer le viol systématique. Voici un exemple saisissant : « Pendant des heures elles étaient passées d’homme en homme, d’humiliation en humiliation, d’offense en offense, tout ce qu’il est possible de faire à une femme tout en la laissant encore en vie36 ».
Les comportements des aveugles, symbolisent les travers de notre société moderne. Ce n’est plus la raison (la lucidité) qui commande mais la place est laissée à la lubricité débridée.
3.3. L’univers des sens comme attestation de l’abjection
Les sens occupent dans le roman une place de choix. On fait, notamment, référence aux champs lexicaux de la vision, de l’odorat et de l’ouïe liés à la thématique de l’abjection. Si la vision est dans le roman le principal attribut d’un seul personnage, la femme du médecin, l’odorat et l’ouïe resteront les principaux traits spécifiques des personnages aveugles. En effet : « les aveugles discutent […] ils ne gesticulaient pas, ils ne bougeaient presque pas le corps, ils avaient vite appris que maintenant seules la voix et l’oreille étaient utiles37 ». Ils subissent une progressive déshumanisation attestée par des champs lexicaux relatifs au toucher, à l’ouïe et à l’odorat. Leur déshumanisation est largement attestée par des métaphores et des comparaisons qui ont trait à :
- leur moyen de locomotion : « […] certains aveugles avançaient à quatre pattes, le visage au ras du sol comme les porcs…ces imbéciles qui se déplaçaient sous leurs yeux comme des crabes boiteux agitant des pinces estropiées à la recherche […] ; la patte qui leur manquait […]la rage d’un chien mort […]38 ».
- leur façon de vivre : « […] un grand nombre sont comme des moutons qui vont à l’abattoir, bêlant à l’accoutumée, un peu serrés […] mais ce fut toujours là leur façon de vivre, poil contre poil, haleine contre haleine, odeurs entremêlées39 ».
- leur absence d’identité : « […] la fureur érotique de vingt mâles déchaînés devaient être aveugles par le rut. […] file grotesque de femelles malodorantes40 ».
- leur organisation :
chaque dortoir est comme une ruche peuplée uniquement de bourdons, insectes bourdonnants comme chacun sait, peu amis de l’ordre et de la méthode […] ils se cognaient continuellement les uns contre les autres comme les fourmis […] et humaient l’air pour sentir s’il en venait une quelconque odeur de nourriture41.
Ces innombrables métaphores et comparaisons servent à démontrer également que le chaos est installé. Les aveugles s’identifient aux animaux de tout genre et espèce comme l’avènement d’un nouvel ordre, celui de l’horde primitive : « Nous sommes retournés à l’horde primitive…dans un monde rétréci et épuisé42 ».
L’ouïe et l’odorat constituent également deux réseaux lexicaux qui jouent un rôle important dans la description de l’abjection. Leur acuité croissante témoigne de la mutation que l’humanité subit et de leurs nouveaux traits intrinsèques. Elle installe, comme le dit la femme du médecin « la réalité abjecte43 ». Ainsi, la souillure du corps avec la référence aux excréments est récurrente :
[…] certains sont des malappris qui se soulagent matinalement de leurs glaires et de leurs flatulences […] Il ne s’agit pas seulement de l’état auquel arrivèrent rapidement les latrines, antres aussi fétides qu’en enfer les déversoirs d’âmes damnées, il s’agit aussi du manque de respect des uns ou de l’urgence subite des autres […] Quand il devint impossible à tous égards d’arriver jusqu’aux latrines, les aveugles se mirent à utiliser la clôture pour y déposer toutes leurs excrétions et déjections corporelles[…]alors ils se mettaient en route… dans un tapis ininterrompu d’excréments mille fois piétinés […] Des aveugles se soulageaient de leurs gaz […] Il n’y avait pas que l’odeur fétide qui arrivait des latrines par bouffées, en exhalaisons qui donnaient envie de vomir, il y avait aussi les relents accumulés de deux cent cinquante personnes dont les corps macéraient dans leur propre sueur, et qui étaient vêtus de vêtements de plus en plus immondes car ils ne pouvaient ni n’auraient su se laver et qui dormaient dans des lits souvent souillés de déjections44.
L’ouïe, attachée aux voix ou au silence, connote cet univers de violence latente et souterraine. Au départ, la voix est celle qui rattache l’humanité à un système organisé, le gouvernement et son autoritarisme. Elle est essentiellement présente dans les interventions du haut-parleur : « la voix âpre du haut parleur retentit… » ; « La voix sèche du haut parleur retentit45 ».
Très vite, le bruit est le seul repère de l’aveugle car « la voix est la vue de celui qui ne voit pas46 ». D’autres extraits sont exemplaires :
Une confusion de cris venus de la rue éclata soudain, des ordres donnés en hurlant, un vacarme désordonné[…]C’était inévitable, l’enfer promis va commencer […] les cris avaient diminué, […]des bruits confus dans le vestibule […] les aveugles qui se cognaient en troupeau…se bousculant agglutinée en grappes …agitant les mains avec angoisse comme s’ils se noyaient, entra dans le dortoir en tourbillon, comme poussée de l’extérieur par un rouleau compresseur […]Des cris sortirent de l’intérieur, des hennissements, des éclats de rire […] les aveugles hennirent, envoyèrent des ruades ; les cris des aveugles sont terribles47.
Conclusion
Ces lieux de l’aveuglement ont, donc, servi à exalter les contradictions de la nature humaine. L’aveugle avec un bandeau noir le constate : « dans cet enfer où nous avons été plongés et que nous avons transformé en enfer de l’enfer48 ». Ce référentiel de l’abjection s’avère fondamental dans la structuration du roman chez Saramago car il sert la déconstruction du lieu anthropologique historique marqué par une identité, un espace et un temps. Il sert à construire l’isotopie de la barbarie qui est présente en tant que microcosme gouverné par les sens et par la réduction des codes sociaux aux simples instincts de survie. De cette façon, on comprend que le processus de l’abjection a un double sens : d’un côté la déconstruction de l’identité, de l’espace et du temps, et de l’autre côté, une rénovation, voire un rachat, sorte de nouvel apprentissage de la capacité de voir et d’établir des relations humaines. Après la souillure, une possible rédemption : « je te connais » disait la jeune fille aux lunettes teintées.
Aussi, dans la perspective de l’auteur ces aveugles pourraient vivre sans nom mais sûrement pas sans l’Humanité : « levei demasiado tempo a perceber que os meus cegos podiam passar sem nome, mas não podiam viver sem Humanidade »49. Chez Saramago, la difformité la plus accablante est celle qui rend l’humanité aveugle et dépourvue de sens. L’écrivain se donne ainsi la mission d’éveiller les consciences, conférant à l’écriture une véritable mission ontologique.