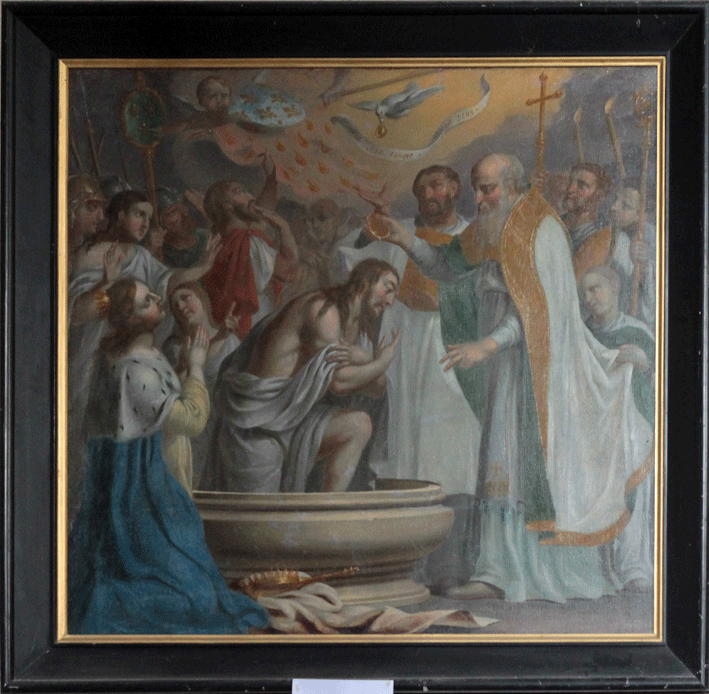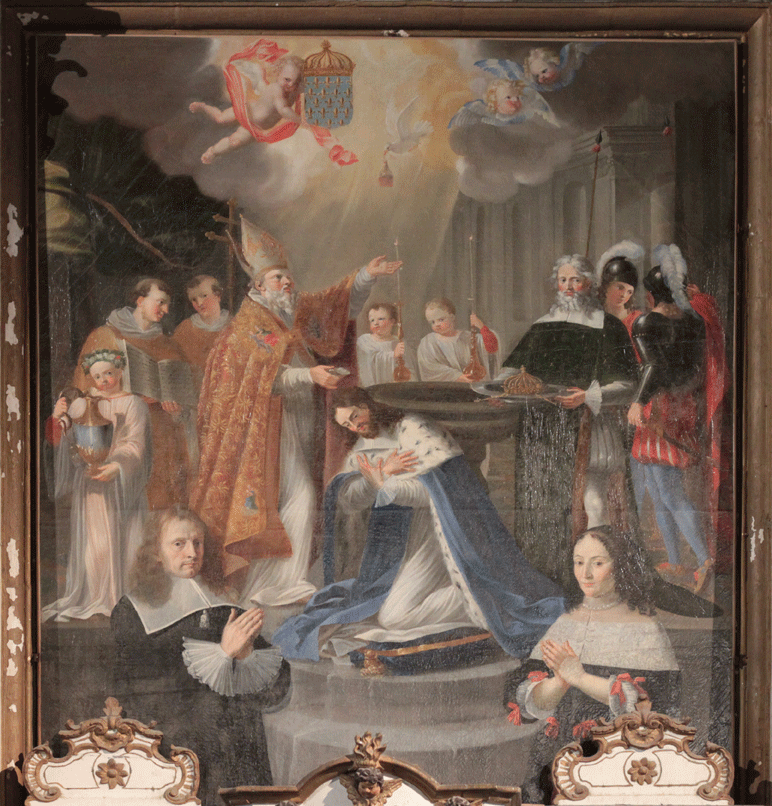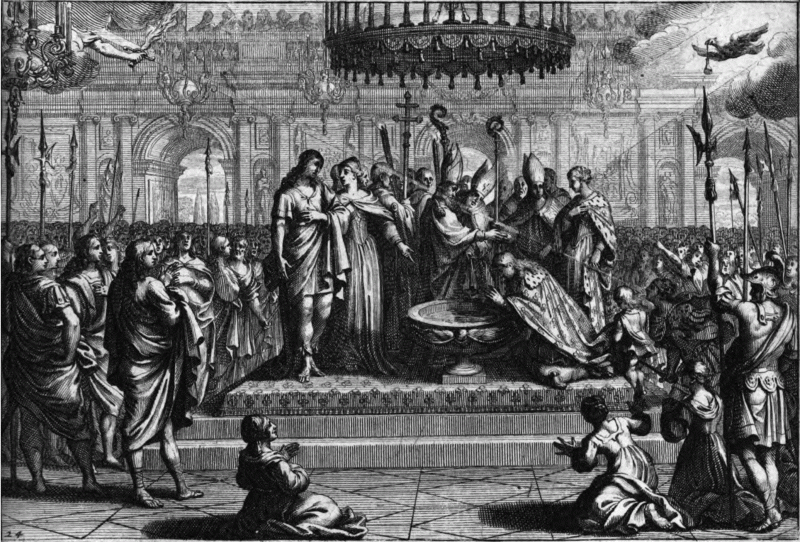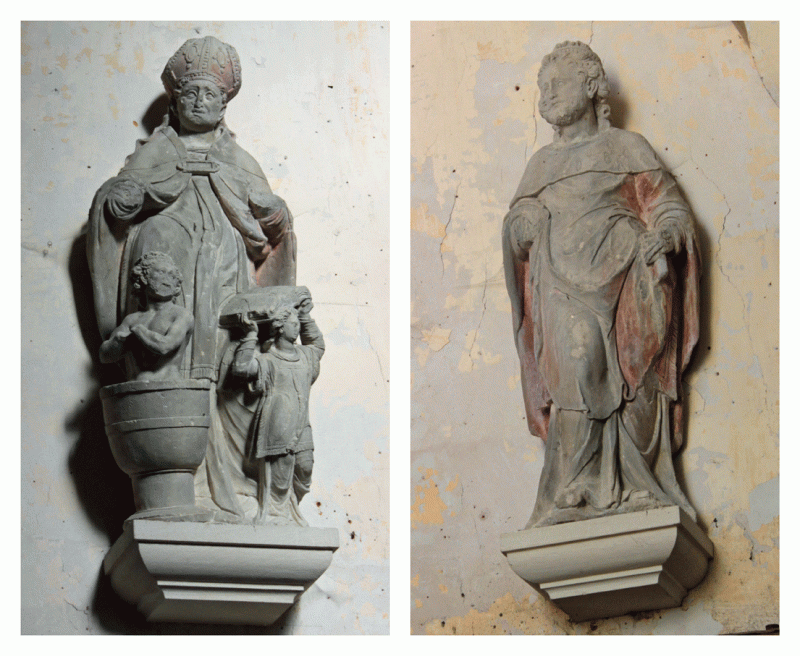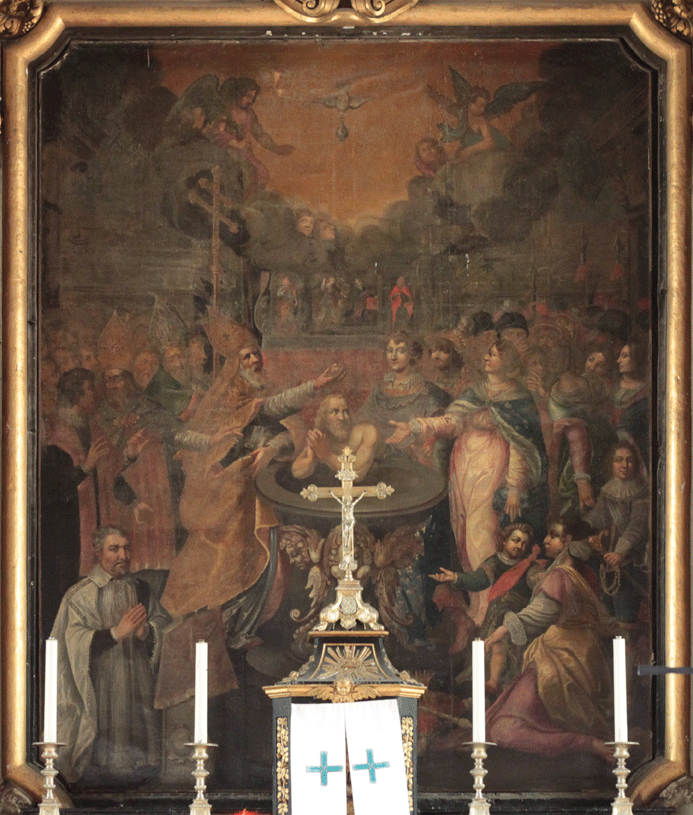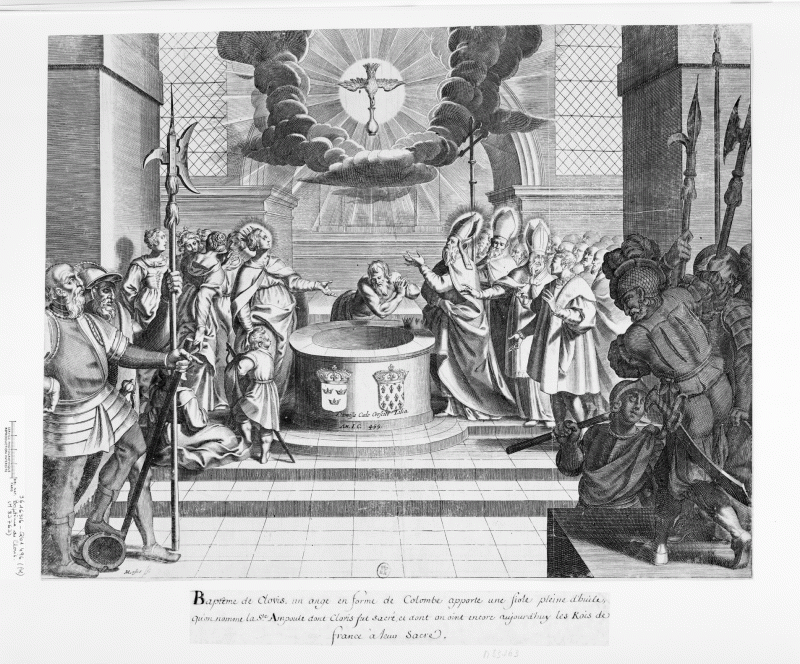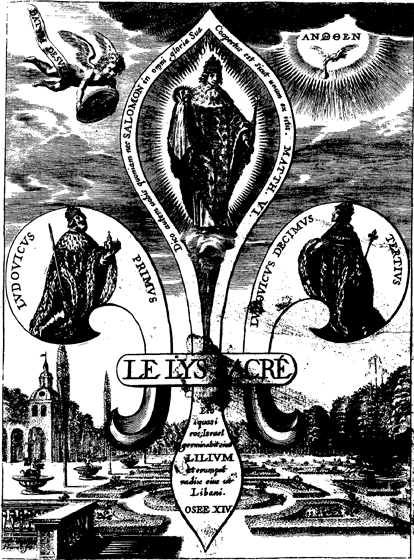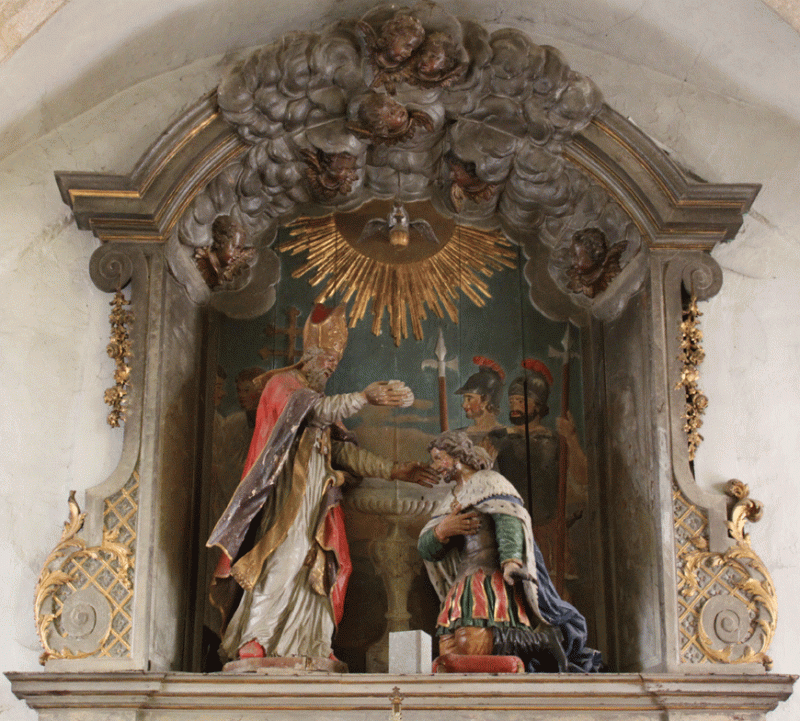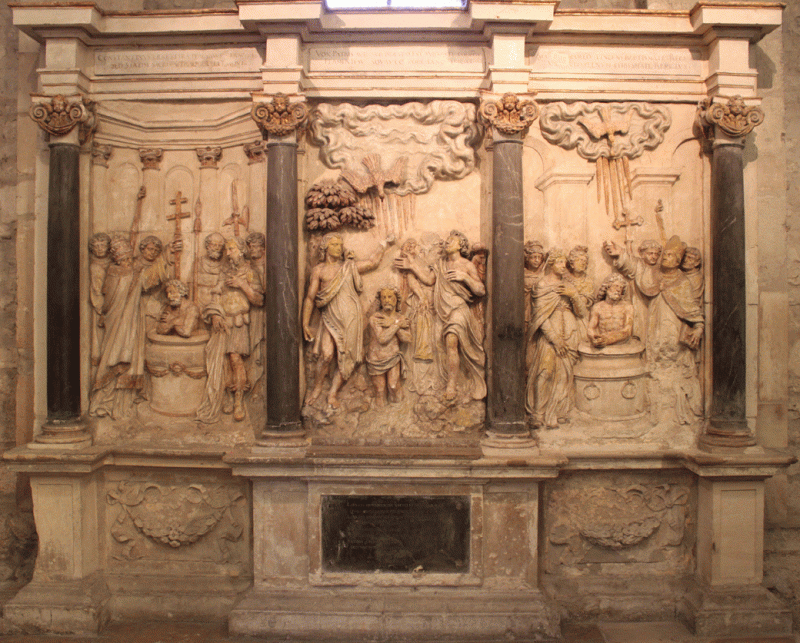À la fin du Moyen Âge se met en place un imaginaire foisonnant autour de la figure de Clovis, au point qu’un culte, officieux, apparaît : ainsi s’élabore l’image de « saint Clovis », étudiée par Colette Beaune1. La désacralisation partielle du roi entamée au xvie siècle et poursuivie tout au long de l’époque moderne empêche cependant la sanctification d’aboutir2. Pourtant au xviie siècle les références à Clovis se multiplient, en particulier sur des images d’autel3. La titulature des lieux de culte les abritant fournit une clé d’interprétation de ce contraste : ils sont généralement dédiés à saint Rémi, l’évêque qui baptisa Clovis, ou parfois à sainte Clotilde, l’épouse chrétienne qui suscita sa conversion. Le baptême du roi appartient en effet à l’hagiographie de ces deux saints, autorisant sa représentation au sein d’églises. Néanmoins, cette iconographie ne fait pas systématiquement valoir la figure de l’évêque de Reims ou de la reine, préférant insister sur le roi et surtout sur le caractère miraculeux de l’événement qui fait du roi franc le premier roi chrétien, suivant en cela la volonté divine : l’Esprit saint sous la forme d’une colombe apparaît pour procurer à Rémi l’ampoule contenant le chrême divin destiné à l’onction du roi4. Le baptême est alors analysé comme un événement fondateur, tant pour la monarchie que pour le royaume, car la conversion du roi, appuyée par la providence, instaure aussi l’union religieuse entre les Gaulois et les Francs.
L’idée même de la conversion d’un roi adhérant à la religion majoritaire au sein de son royaume avait d’ailleurs des résonances particulières à la fin du xvie siècle. Plus globalement, dans la lutte symbolique engagée avec le Roi Catholique, il n’était probablement pas anodin de rappeler que le roi très chrétien était le premier prince européen à avoir été baptisé, et qu’en outre ce baptême formait le signe manifeste d’une faveur divine, faisant du roi de France le « nouveau Constantin » successeur de l’Empire romain. Mais contrairement à la figure de saint Louis, celle de Clovis ne semble avoir été qu’occasionnellement mise en avant par la royauté elle-même. Ainsi l’imagerie du baptême de Clovis constitue-t-elle un phénomène majoritairement paroissial. Le baptême du roi est en effet à la fois exaltation de la monarchie élue et glorification du royaume, terre chrétienne par excellence. Il forme un mythe, qui mêle histoire et fiction pour imaginer la naissance simultanée d’une monarchie et d’une nation chrétiennes. L’imaginaire enveloppant l’événement et ses protagonistes – un roi, deux saints et un peuple – constitue alors l’un des supports d’une identité nationale catholique5. Il faut donc s’interroger sur les modalités et les enjeux de mise en image du mythe : les figurations du baptême de Clovis sont issues d’un imaginaire ancien qu’elles recomposent en lui donnant une dimension nouvelle par les pratiques auxquelles elles prennent part. Au moment où l’histoire se fait de plus en plus critique, dépouillant progressivement le baptême de ses éléments fictifs, le mythe semble survivre dans le domaine de la foi, particulièrement par le biais des images ornant surtout des églises du nord-est de la France. Cette géographie, qui traduit le rayonnement de Reims, souligne le rôle de Rémi, institué apôtre du Royaume. On peut dès lors se demander comment la mise en image du baptême de Clovis dessine-t-elle un mythe fondateur, support d’une identité gallicane qui ne se réduit pas à l’exaltation monarchique ?
L’événement se prête à des lectures hétérogènes, façonnant malgré tout un moment fondateur : l’alliance du trône et de la religion chrétienne. Une telle union se complète de celle qui est alors nouée entre le roi et son royaume, reposant sur une religion commune. Enfin, le mythe de Clovis est intégré dans le temps long de l’histoire sainte du royaume de France.
Clovis à l’épreuve des gallicanismes : une élection en partage
L’iconographie de Clovis ou le mythe fondateur du baptême
Avant d’analyser l’iconographie de Clovis au xviie siècle, il semble utile de revenir brièvement sur l’imaginaire qui avait enveloppé sa personne et son parcours. C. Beaune explique comment s’est élaborée au cours des xive et xve siècles l’image d’un saint, dont la vie fut marquée par une série de miracles témoignant de son élection divine ; la légende du premier roi chrétien s’enrichit considérablement, jusqu’à la création d’un culte officieux6. Cet imaginaire fut en grande partie ébranlé au xvie siècle, notamment du fait de captations concurrentes de la figure du roi : Myriam Yardeni souligne son ambivalence, entre le saint des Ligueurs et le fondateur de l’Église gallicane et « précurseur de la raison d’État » des Politiques7 ; même parmi ceux qui étaient convaincus de l’honnêteté religieuse de Clovis, les doutes se multiplient quant aux miracles l’entourant. Ainsi commença à décliner l’image du saint ; la plupart des auteurs se concentrèrent sur le seul baptême et l’ampoule, quand ils ne témoignaient pas d’un relatif scepticisme quant à l’origine du chrême de l’onction8. Les historiens du xviie siècle en firent donc avant tout le premier roi chrétien, mais pas le premier roi saint9. Enfin, Chantal Grell souligne que Clovis reste au xviie siècle le second fondateur de la monarchie, après Pharamond, en tant que premier roi chrétien, bien que ce rôle soit progressivement éclipsé cours des xviie et xviiie siècles, faisant de lui plus un grand législateur qu’un homme remarquable sur le plan religieux10.
Dans l’iconographie de Clovis au xviie siècle, le baptême constitue la thématique majoritaire. Le roi figure aussi sur des portraits, la plupart du temps gravés et intégrés à des histoires de France, illustrées d’une effigie de chaque roi11. D’autres scènes de la vie du roi furent représentées, en liaison avec un saint autre que Rémi12, ou dans le cadre de cycles de la vie de Clotilde et Clovis, où figure systématiquement le baptême, et souvent la bataille de Tolbiac13. Les représentations du baptême comptent une trentaine de peintures, et quelques sculptures, tapisseries, ornements liturgiques, ainsi que des estampes où il peut former le sujet principal14, ou simplement un élément secondaire ; quelques gravures figurent ainsi un portrait de saint Rémi ou de sainte Clotilde, avec en arrière-plan le baptême royal15.
Par ailleurs on repère dans l’iconographie le même phénomène d’épuration de la légende de Clovis que dans les textes : très rarement sont évoqués les miracles autres que celui de la sainte ampoule. À Selongey, la colombe porte en son bec une fleur de lys, allusion possible aux armes royales16 ; à Saint-Rémy-des-Monts, un angelot tient un écusson bleu semé de fleurs de lys dorées et couronné17. La peinture d’Adrien Sacquespée qui décorait autrefois l’église Saint-Maclou de Rouen contraste par la multiplication de ces références miraculeuses, saturant tout l’espace céleste : outre la colombe et son ampoule, on peut y voir une pluie de flammes, un ange tenant un écusson orné de trois fleurs de lys dorées sur fond d’azur, une main sortie des cieux tenant une verge, et une banderole évoquant la formule rituelle de guérison des écrouelles (ill. 1).
Ill. 1 : Les phases d’une enquête Adrien Sacquespée, Le Baptême de Clovis, milieu du xviie siècle, huile sur toile, 1,20 × 1,27 m, Seine-Maritime, Saint-Léger-du-Bourg-Denis, église Saint-Léger, chapelle des fonts baptismaux, Cliché auteur
Mais ce qui distingue l’imaginaire de Clovis dans l’iconographie par rapport aux textes, c’est la forte persistance du miracle de l’ampoule, y compris après les disputes du milieu du siècle à propos de son existence18 ; elle prend alors place en haut de l’image, souvent au centre, dans une lumière jaune témoignant de son caractère divin, parfois entourée d’une nuée qui sépare les espaces terrestre et céleste. Cette constance de la représentation du miracle s’explique par l’association entre le premier baptême royal et la célébration de la monarchie entière.
Célébrer la monarchie française
Les spécialistes de l’historiographie au xviie siècle ont montré comment pour les historiens modernes le passé éclaire et informe le présent19 ; de même il semble bien que dans la peinture d’histoire – figurant des sujets sacrés, historiques ou mythologiques – l’événement représenté n’importe pas tant en soi que pour les enseignements qu’il peut donner et parfois pour son écho au temps présent. Ainsi, en dépit des exigences tridentines et académiques, la véracité dans les Baptêmes de Clovis ne semble pas être nécessairement un critère valable pour planter le décor : si parfois quelques éléments tendent à évoquer l’époque des Francs (longs cheveux et barbe épaisse de Clovis, pierreries, épée…), souvent les costumes, les objets et les coiffures font plutôt penser soit à l’Antiquité romaine, soit à l’Ancien Régime20 ; par exemple à Saint-Rémy-des-Monts les soldats portent culottes bouffantes et collants (ill. 2). Sur plusieurs peintures, le portrait de Clovis tend à suivre la mode contemporaine (cheveux noirs et moustache fine comme Louis XIII à Saint-Rémy-des-Monts, Saint-Rémy-la-Vanne, Gandelu ; ou bien perruque bouclée comme le jeune Louis XIV à Meaux), quand il n’est pas franchement un portrait du roi régnant21. La figure de Clovis fait donc référence plus ou moins explicitement à la monarchie dans son ensemble et au roi régnant, et la célébration de son baptême forme une voie de célébration de la monarchie entière. Cependant la mise en valeur du roi dans l’iconographie ne va pas de soi, comme nous l’avons déjà dit ; malgré cela, les compositions de plusieurs images font du roi l’objet principal de la contemplation, en le plaçant au centre de l’image, et en le mettant en valeur par la lumière ou le jeu des couleurs, son corps nu ou vêtu d’une tunique blanche contrastant avec les autres personnages22.
Ill. 2 : Anonyme, Le Baptême de Clovis, xviie siècle, huile sur toile, 2,15 × 1,57 m, Sarthe, Saint-Rémy-des-Monts, église Saint-Rémy, retable du maître-autel, Cliché auteur
C’est surtout l’association du baptême au sacre qui en fait un élément de célébration monarchique. Peu d’auteurs rappellent que la pratique du baptême à l’époque de Clovis inclut une onction après le rite de l’eau, laquelle constitue le sacrement de confirmation23 : dans la majorité des histoires de France ou des hagiographies de Rémi, on associe le plus souvent l’onction au sacre, reprenant en cela les textes du Moyen Âge24. Par exemple, le père Ceriziers estime que le rite du sacre n’est parfaitement réglé qu’au règne de la troisième race, tout en précisant qu’« on ne peut douter que Clovis ne fut oint de ce baume miraculeux que le Ciel luy envoya, et par une action séparée de celle de son Baptesme »25 ; il ajoute que grâce à l’huile divine obtenue lors du baptême et réutilisée à chaque sacre « les seuls Roys de France peuvent se glorifier d’estre les Oints du Seigneur, puis qu’il n’y a qu’eux qui retiennent l’image du Sacerdoce conjoint à la Royauté, et qui par leur onction soient tirés du rang des personnes profanes »26 : par le premier baptême/sacre qui fait de lui le vicaire du Christ sur terre, le roi de France acquiert une supériorité sur les autres princes. Il semblerait que la monarchie elle-même ait été convaincue de la liaison entre le premier baptême et le sacre, ou du moins qu’elle ait cherché à associer les deux images : en 1714 le père Dorigny rappelle que Louis XIV offrit
à l’Église de Reims le jour de son Sacre un magnifique buste de vermeil, qui représente le saint Archevêque ; sur le pied de ce buste le jeune Monarque est à genoux revêtu des habits de son Sacre, comme pour remercier le saint des grâces reçues par son Ministre dans l’onction céleste, qui venoit de luy être appliquée27.
Ill. 3 : Jaspar Isac, Le rare et somptueux tombeau de S. Remy, s. d., E. Moreau, 349 × 435 mm, BnF, Estampes, Hennin, Réserve Qb 201 (18) fol. p. 9, © BnF
C’est donc sans surprise que l’on retrouve dans l’iconographie le rapprochement prestigieux entre le baptême et le sacre. Par exemple, une estampe reproduit de manière imaginaire le tombeau de saint Rémi de la basilique de Reims (ill. 3)28 : elle figure en effet un tombeau semblable au mausolée, observé du côté des statues des pairs ecclésiastiques qui symbolisent l’ensemble des « pares franciae », tous identifiés par une inscription et tenant chacun l’insigne qu’ils portent lors du sacre ; mais, contrairement à la réalité, ces statues sont encadrées à gauche par Clovis et à droite par saint Louis, tandis qu’au milieu se place le jeune Louis XIII, debout sur un piédestal. Les trois rois arborent le costume du sacre (manteau royal, couronne fermée, sceptre et main de justice) avec collier de l’ordre de Saint-Michel, ainsi que celui de l’ordre du Saint-Esprit pour le jeune Bourbon. Le roi adolescent est surmonté de ses armoiries, elles-mêmes surplombées de l’ange ayant doté la France des fleurs de lys, le tout dans la ligne directe de la colombe portant l’ampoule ; l’ange est encadré du côté de Clovis d’un ange portant les armoiries de France, et de celui de saint Louis des armoiries de Navarre. Le jeune Louis XIII tient donc sa légitimité de l’élection divine de la monarchie depuis le baptême miraculeux de Clovis, tandis que l’héritage de saint Louis a été revivifié par l’avènement d’Henri IV. Le rapprochement symbolique entre le sacre et le baptême peut aussi se lire dans la circulation du motif de la colombe portant en son bec l’ampoule entre les peintures, les estampes et les médailles frappées à l’occasion des sacres : ainsi retrouve-t-on le modèle graphique des jetons sur la gravure que nous venons d’étudier29, sur les estampes illustrant les ouvrages des pères Ceriziers et Dorigny30, sur celle de Michel Lasne31, ou encore sur les toiles conservées à Reims, Marolles-les-Braults ou Vecqueville32. Cette répétition du motif de la colombe à l’ampoule rappelle ainsi que le pouvoir du roi vient directement de Dieu.
Ces rapprochements entre le baptême et le sacre ne s’opèrent pas uniquement sur le mode symbolique ; des scènes du baptême semblent reprendre des éléments épars du sacre. Véronique Alemany-Dessaint précise que sur les peintures du xvie au xixe siècle le roi est bien plus souvent représenté en tenue de sacre qu’en catéchumène33. À Saint-Rémy-des-Monts, un personnage présente les insignes royaux sur un plateau, bien en évidence, tandis que la posture du roi peut faire écho aux figurations du sacre, de même que son grand manteau (ill. 2). Ailleurs, la suppression de la cuve baptismale tend à insister sur l’onction post-baptismale, qui elle-même est considérée comme le premier sacre34. Une autre peinture est emblématique de la confusion entre le baptême et le sacre : à Dinteville (ill. 4), le roi, vêtu de la tunique blanche et du manteau bleu fleurdelisé, est béni par l’évêque ; sa couronne est posée en évidence au second plan ; en haut la colombe apporte la sainte ampoule. En l’absence de cuve, on peut difficilement y voir un baptême ; en outre, Rémi ne lui verse pas d’eau sur la tête, ni ne l’oint.
Ill. 4 : Piazi, Le Vœu de Louis XIII, 1636, huile sur toile, 1,80 × 1,70 m, Haute-Marne, Dinteville, église Saint-Rémy, nef, Cliché auteur
Ce n’est pas non plus un sacre car on n’y trouve guère le cérémoniel, l’ensemble des regalia, les pairs ecclésiastiques et civils, etc. Et les traits du roi sont tels que le tableau est resté sous l’appellation de « Vœu de Louis XIII », alors que la Vierge de Pitié en est absente. La peinture, de facture très simple, illustre alors tous les croisements qui peuvent être faits entre les différentes thématiques de l’iconographie religieuse du roi, mêlant le baptême du premier roi au cérémoniel perpétué du sacre de la monarchie et à la dévotion du roi régnant ; elle condense les divers soutiens religieux du pouvoir royal. En faisant se rejoindre passé et présent de la monarchie, elle montre l’actualité de la faveur divine permise par l’intermédiaire du clergé qui dispose de la sainte ampoule. Car si l’iconographie du baptême de Clovis peut contribuer au prestige de la monarchie française, première à bénéficier d’un roi chrétien, et dont l’importance avait été soulignée par le don divin du chrême utilisé pour sacrer tous les descendants de Clovis, les images intègrent nécessairement la représentation d’au moins un évêque, Rémi : le roi ne peut être dans ce cadre seul face au monde divin ; l’évêque est le médiateur nécessaire.
Glorifier l’Église gallicane
Certaines peintures montrent ainsi un déséquilibre flagrant entre la monarchie et le clergé : à Lupersat, la toile figure le roi, l’évêque et deux de ses assistants (ill. 5). La division en registres horizontaux sépare le roi, en bas, des trois clercs. En outre Rémi occupe le centre de la toile, et le rayon de lumière qui émane de la colombe en direction du roi ne passe pas par la main de Rémi, comme souvent, mais par sa tête, faisant de l’évêque un intercesseur mais aussi un symbole de la place du clergé gallican dans l’élection de la monarchie. Plus rarement encore, un portrait de Rémi accapare l’image, tandis que le baptême et donc le roi est relégué au second plan : à Logny-lès-Aubenton, Rémi saisit d’une main l’ampoule que lui apporte le Saint-Esprit, et porte l’autre main sur son cœur ; le baptême est alors repoussé en arrière-plan où il forme une saynète, surplombée malgré tout par la colombe (ill. 6).
Ill. 5 : Anonyme, Le Baptême de Clovis, fin du XVIIe siècle, huile sur toile, 2,42 × 2,06 m, Creuse, Lupersat, église Saint-Oradour, © Région Limousin, Service de l’inventaire et du patrimoine culturel, Philippe Rivière, 2005
Ill. 6 : Anonyme, Saint Remi recevant le saint chrême du baptême de Clovis, troisième quart du XVIIe siècle, huile sur toile, 1,69 × 1,19 m, Aisne, Logny-lès-Aubenton, église Saint-Remi, retable secondaire Phot. Laurent Jumel, © Région Picardie - Inventaire général / Ministère de la Culture et de la Communication
À côté de ces images très déséquilibrées, au demeurant assez rares, d’autres représentations soulignent plus discrètement le rôle du clergé dans le baptême et la conversion du roi. Ainsi, Jean-Baptiste de Cany sépare sa peinture en plusieurs registres (ill. 7) : la royauté occupe la partie inférieure tandis que dans la partie supérieure les clercs sont distingués des laïcs. En outre, alors que les regards au sein du groupe des laïcs divergent, tous les ecclésiastiques regardent et penchent dans une même direction, dessinant un groupe particulièrement uni qui vient déborder sur le côté laïc par la crosse épiscopale.
Ill. 7 : Jean-Baptiste de Cany, Le Baptême de Clovis, 1671, huile sur toile, 2,63 × 1,75 m, Seine-et-Marne, Meaux, musée Bossuet, inv. 982.01.01, Phot. J. Bazière © Meaux, musée Bossuet
Cette toile semble inspirée d’une gravure d’illustration, où l’on retrouve à l’identique la cuve, la posture du roi, les habits de la reine, et les pages tenant le manteau fleurdelisé (ill. 8) ; néanmoins le peintre a largement transformé cette source d’inspiration, en particulier en faisant le choix de fragmenter l’assistance en groupes ; en outre, l’insistance sur le clergé n’est pas lisible dans l’estampe. La mise en valeur du clergé, subtile mais réelle, est donc bien le fruit d’une décision du peintre qui a resserré la scène. Ces quelques exemples soulignent l’importance variable accordée à l’évêque en particulier et au clergé de manière générale dans le plan divin d’élection du royaume.
Ill. 8 : Abraham Bosse, d’après François Chauveau et Sébastien Bourdon, Le Baptême de Clovis, 1657, pl. d’ill. : Jean Desmarets de Saint-Sorlin, Clovis ou la France chrestienne. Poeme heroïque, Paris, Augustin Courbé, Henry Le Gras et Jacques Roger, 1657, n. p.
Mais dans tous les cas l’iconographie du baptême multiplie le couple Rémi/Clovis, où l’un domine l’autre, où le roi se place sous la bannière du Saint-Esprit et, par là, sous celle de l’Église. Jacques Stella, par exemple, construit son image par paires, faisant ainsi de Clovis et Rémi un couple, dont les rapports sont renforcés par les effets de la lumière, ainsi que la série d’obliques qui contraste avec l’orientation verticale dominante (ill. 9) ; à la jonction entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel se situe l’arme du roi, au pied de la cuve, bien mise en valeur, témoin d’un pouvoir royal qui se soumet à la Foi, à son Église. On retrouve ici l’idée que le baptême est allégeance du pouvoir à l’Église que le père Ceriziers affirmait aussi : « si nos Roys servent l’Eglise par inclination, ils le font aussi par devoir, puis que le Saint-Esprit leur a donné la sacrée Fiole de leur onction que pour les engager à l’amour de sa chère Epouse »35. Le baptême de Clovis, associé au sacre, n’est donc pas seulement un élément du prestige du roi, mais aussi l’un des fondements de sa mission religieuse.
Ill. 9 : Jacques Stella, Le Baptême de Clovis, vers 1645-1650, huile sur toile, 1,90 × 1,40 m, Aisne, Gandelu, église Saint-Rémy, retable du maître-autel, Cliché auteur
La mise en valeur du rôle joué par le clergé s’explique peut-être aussi par l’importance de ce groupe au sein des commanditaires. Ainsi, le Baptême de Clovis de Jean Senelle fut donné par Gabriel Coquelet, religieux de Chaage et prieur de la paroisse de Saint-Rémy-la-Vanne, d’après le cartouche peint au bas de la toile (ill. 10). On y retrouve la séparation entre monde laïc et monde ecclésiastique, la tête du roi faisant la jonction, tandis qu’au bas de la peinture sont placés les regalia à droite et les armoiries du donateur à gauche. Le personnage qui regarde hors de la toile a toutes les chances d’être le donateur lui-même, lui qui lie la communauté des fidèles à la scène représentée et qui se place dans continuité du saint évêque. La peinture du baptême serait autant manifestation de loyalisme monarchique qu’insistance sur le prestige de l’évêque. Et en effet, il s’agissait peut-être pour G. Coquelet d’une discrète référence à son évêque, Dominique Séguier, premier aumônier du roi, qui avait baptisé le dauphin l’année précédente36.
En dépit de la diversité des ces Baptêmes de Clovis modernes, qui font varier l’équilibre entre le roi et l’Église dans un sens ou dans l’autre, tous dessinent un mythe gallican, moment de fondation de l’alliance entre le trône et la religion catholique marqué par l’intervention divine qui désigne la spécificité religieuse du royaume. Les enjeux d’une telle question se posaient avec une acuité nouvelle à la fin du xvie siècle : les débats autour de la possibilité d’un roi de France protestant et la finale abjuration d’Henri IV rendirent au baptême de Clovis toute son actualité. En effet, la question centrale posée par le premier baptême d’un monarque était celle de l’alliance fondée entre le roi et son royaume, alliance dont le socle était le partage d’une même religion.
Ill. 10 : Jean Senelle, Le Baptême de Clovis, 1644, huile sur toile, 2,16 × 1,83 m, Seine-et-Marne, Saint-Rémy-la-Vanne, église Saint-Rémy, retable, Cliché auteur
L’alliance entre un roi et son peuple : une identité chrétienne commune
Baptême royal et communauté des fidèles
M. Yardeni et C. Grell ont montré à quel point les textes des xvie et xviie siècles insistent sur le caractère fondamental de la conversion de Clovis dans la genèse de la nation, dans le sens où le roi adopte la religion la plus répandue dans son État et suscite la conversion des Francs, première étape de la fusion avec les Gaulois : « la naissance de la nation […] se place au moment du baptême de Clovis. […] Pour la plupart des historiens du xviie siècle, c’est le christianisme qui réunit indissolublement et définitivement vainqueurs et vaincus dans une même entité »37. Dans la majorité des peintures conservées, des laïcs sont présents pour assister au baptême. Si dans certains cas seuls quelques personnages évoquent le mouvement de conversion qu’aurait impulsé Clovis, d’autres images dessinent une foule compacte se pressant autour du roi, par exemple à Serez38. Ailleurs le cadre est resserré autour de quelques personnages centraux tandis que se multiplient au fond de la scène piques, cierges, crucifix et autres croix indiquant la foule de laïcs et de clercs, comme on peut l’observer sur l’estampe d’E. Moreau (ill. 11), et sur un tableau qui s’en est inspiré39. Le peintre a ajouté les soldats, absents de la gravure, et a introduit les éléments d’identification du pouvoir (à forte connotation militaire), tandis que la main de Rémi plane au-dessus de la couronne posée sur le rebord de la cuve, comme s’il allait s’en saisir : le baptême est ici aussi un sacre. La composition est en outre légèrement modifiée, de telle sorte qu’elle lie de façon indissociable le roi, son clergé et son peuple. En tournant la tête du garçon au premier plan vers le baptême, le peintre a renforcé l’effet des regards plongeants de Clotilde et Rémi : les regards convergents des principaux personnages poussent l’observateur à se focaliser lui-même sur le roi, dont le regard fuit dans le vide de la cuve : la peinture dit la piété que partagent le roi, le clergé et les laïcs, tout en amenant le fidèle qui l’observe à la contemplation.
Ill. 11 : Edmé Moreau, Le Baptême de Clovis, pl. d’ill. : René de Ceriziers, Les Heureux Commencements de la France chrétienne sous l’apôtre de nos rois saint Rémy, Reims, F. Bernard, 1633, n. p., Cliché auteur
Une autre peinture peut permettre d’approfondir l’idée d’une union du roi et son royaume dans la foi : sur sa toile J.-B. de Cany a figuré un personnage levant les bras au ciel, en signe d’exclamation ou d’étonnement, qui est probablement inspiré de l’estampe évoquée auparavant40. Néanmoins, contrairement à la gravure où la colombe miraculeuse perce les nuées, rien de surnaturel dans la peinture ne peut expliquer l’étonnement du personnage : soit la toile était prévue pour être insérée dans un retable avec le miracle de l’ampoule au niveau supérieur41, soit, comme les historiens commencent à le dire42, le don de Dieu vraiment important et admirable est la conversion à la foi chrétienne en soi. L’iconographie dessine l’alliance fondamentale conclue entre le roi et son peuple lors du baptême, comme si la conversion du roi au christianisme était précisément le moment clé de naissance de l’État et de la nation. La conversion d’Henri IV évoquée par certaines des représentations du baptême de Clovis tendrait alors à évoquer une refondation de l’alliance et de la nation à l’aube du xviie siècle.
Du baptême du roi franc à la conversion du Bourbon
Un parallèle peut en effet être dressé entre la conversion d’Henri IV, qui obtint grâce à elle le ralliement d’une partie des catholiques qui lui étaient hostiles43, et celle de Clovis, analysée par certains historiens modernes comme un acte hypocrite n’ayant pour but que de rassembler la population sous son égide et durablement conquérir la Gaule44. Étienne Pasquier, par exemple, expliquait que « dedans sa Religion il y avoit beaucoup du sage-mondain, et de l’homme d’Etat », car sa conversion pouvait avoir deux justifications : « soit qu’il fust à ce poussé par la volonté expresse de Dieu […], ou par un trait de prudence humaine, n’estant pas un petit secret aux Princes nouveaux conquereurs, ou qui projettent de conquerir, de symbolizer en religion avec leurs sujets »45. Qu’on y voie ou non une forme de pensée inspirée de l’idée de raison d’État ou un certain machiavélisme, le parallèle peut être dressé entre deux rois qui se font catholiques et, ce faisant, adhèrent à la religion majoritaire en France, permettant de l’unifier. Ce n’est probablement pas un hasard si l’on constate une multiplication iconographique du thème à partir de l’extrême fin du xvie siècle.
Les cas les plus évidents sont ceux où le roi franc constitue en réalité un portrait d’Henri IV, comme on peut l’observer sur une peinture conservée à Domats dans l’Yonne (ill. 12). Le roi barbu plongé dans la cuve est bien un portrait du roi : on reconnaît son long nez, ses yeux enfoncés dans les orbites, sa bouche fine, etc. De même à Boutigny, près de Meaux, un baptême sculpté semble avoir pris le nouveau roi pour modèle (ill. 13). L’église comprend en outre une sculpture de facture similaire, figurant un roi en tenue de sacre qui doit être saint Louis. Dans la mesure où les visages de Clovis et de saint Louis sont identiques, et tous les deux proches de celui d’Henri IV, cet ensemble de sculptures participe à la légitimation du roi, doublement élu de Dieu : en tant que monarque (il descend de Clovis) et en tant que Bourbon (sa dynastie est issue de saint Louis).
Ill. 12 : Anonyme, Le Baptême de Clovis, xviie siècle, huile sur toile, 1,23 × 1,75 m, Yonne, Domats, église Saint-Remi, nef, Cliché auteur
Ill. 13 : Anonyme, Le Baptême de Clovis (à gauche) et Saint Louis (à droite), fin xvie-début xviie siècle, pierre, baptême : 105 × 45 × 30 cm, saint Louis : 108 × 38 × 37 cm, Seine-et-Marne, Boutigny, église Saint-Médard, chœur, Cliché auteur
Une autre peinture, ornant le retable du maître-autel de l’église de Marolles-les-Braults dessine un parallèle beaucoup plus implicite (ill. 14) : les traits du roi penché derrière la cuve peuvent peut-être faire penser à Henri IV, sans que la ressemblance soit parfaite. En revanche, une inscription, aujourd’hui disparue, semble pouvoir relier le baptême du premier roi de France chrétien à la naissance d’une nouvelle dynastie avec la conversion et la reconnaissance du premier Bourbon. Dans un article consacré au décor mis en place dans l’église sous l’impulsion du curé François Engoulevent dans la première moitié du xviie siècle, Jürgen Klötgen rapporte l’existence de cette inscription « ANNO AETATIS XLI » qu’il traduit ainsi : « en la 41e année de son âge »46. Il écarte l’hypothèse d’une référence au curé, né avant 1570, et montre qu’en revanche l’âge évoqué correspond à celui d’Henri IV au moment de son sacre à Chartres en 1594. Une autre possibilité eut été que l’inscription se réfère à l’âge de Clovis, mais un rapide parcours des Histoires de France publiées à l’époque infirme l’hypothèse : la date de naissance habituellement donnée pour Clovis est celle de l’an 466, et l’on estime alors qu’il a été baptisé en 499. Le baptême de Clovis de Marolles est donc une image en creux de la conversion du roi Bourbon.
Ill. 14 : Anonyme, Le Baptême de Clovis, 1634, huile sur toile, 3,33 × 2,63 m, Sarthe, Marolles-les-Braults, église Saint-Rémy, retable du maître-autel Cliché auteur
Cependant, le parallèle qui est ici dressé ne l’est pas avec la conversion officielle du roi, en 1593, mais bien avec son sacre. Ce choix s’explique facilement par la confusion généralisée entre le baptême de Clovis et la cérémonie du sacre des rois analysée ci-dessus. En outre, le sacre d’Henri IV n’a pas été un sacre conforme aux traditions, dans la mesure où il n’a pu avoir lieu à Reims mais à Chartres (soit à une centaine de kilomètres de Marolles), et, qu’en conséquence, l’huile utilisée ne fut pas le saint chrême apporté par la colombe lors du baptême du roi franc, mais une huile de Marmoutier, réputée miraculeuse elle aussi47. La toile figurant le premier baptême royal et le miracle de la sainte ampoule signe de la faveur divine – particulièrement mis en valeur par une ample percée de lumière jaune cerclée d’une épaisse nuée – confirme la légitimité du sacre exceptionnel d’Henri IV, devenu un reflet de Clovis.
De plus, le tableau peut être mis en rapport avec une estampe de M. Lasne, dont les similitudes sont frappantes (ill. 15)48. Les deux représentations figurent le roi au centre, derrière une grande cuve baptismale au-dessus de laquelle il se penche, encadré d’un côté par Clotilde, de profil, couronne en tête, qui désigne son époux à Rémi qui lui fait face ; on retrouve derrière la reine un groupe de femmes, dont une qui se retourne pour parler, et derrière Rémi deux évêques, dont l’un converse avec un autre clerc, tandis que l’autre observe la scène et porte une croix de procession ; les postures des deux saints sont strictement identiques ; et dans les deux cas, la figuration de la colombe portant en son bec la sainte ampoule est inspirée des médailles de sacre. Si ces points communs montrent les rapports d’imitation entre les deux œuvres, l’étude des divergences souligne le passage du baptême de Clovis dans la gravure à l’allusion au sacre d’Henri IV dans la peinture. La toile insiste beaucoup plus sur les éléments du costume liés au sacre : le tissu bleu noué à la taille du roi est semé de fleurs de lys dorées, tandis que la couronne et le sceptre – absents sur l’estampe – sont placés en évidence au pied de la cuve ; un collier d’ordre y est aussi déposé, écho possible à l’intégration du roi dans l’ordre du Saint-Esprit le lendemain de son sacre.
Ill. 15 : Michel Lasne, Le Baptême de Clovis, s. d., gravure, 390 × 503 mm, BnF, Estampes, Qb1‑496 (fol), Cliché BnF
Enfin, l’attitude du roi marque une autre différence, importante et surtout très originale. J. Klötgen avait déjà noté le regard interrogateur et assez peu confiant posé par le roi sur Clotilde. Or, dans l’estampe, le roi contemple l’intérieur de la cuve, dégageant une impression de piété et de méditation que l’on retrouve dans toutes les figurations du baptême de Clovis ; la peinture de Marolles est à notre connaissance le seul cas au xviie siècle où le roi lève la tête, vers Clotilde qui plus est, et paraît taraudé par quelques interrogations… Serait-ce là l’écho des théories du pragmatisme politique et de l’hypocrisie d’Henri IV au moment de sa conversion ? En considération du reste du tableau, l’hypothèse semble peu probable. On doit certainement lui préférer l’idée que la communauté des fidèles peut conduire le roi à la conversion, et que pour être roi le descendant légitime doit imiter son ancêtre qui s’est converti, fondant une alliance entre la monarchie et le peuple, entre le royaume et Dieu49. Un autre élément de distinction entre l’estampe et la toile corrobore cette hypothèse : la peinture resserre le spectacle en plaçant les soldats derrière les femmes. Ainsi, les soldats qui se font chrétiens après le roi ne forment plus un troisième groupe distinct du clergé catholique et de la cour convertie, ils sont intégrés au monde des laïcs. Tout comme les Francs se sont unis aux Gaulois suite à la conversion royale pour donner naissance à une nation chrétienne, les français se sont réunis à l’aube du xviie siècle autour du roi légitime à partir du moment où il s’est converti. La peinture représente ainsi la nation sous la forme d’une communauté de fidèles, clercs et laïcs, qui s’associent autour du roi catholique, comme l’illustre le caractère parallèle des postures de Rémi et Clotilde. Le mythe de Clovis tend donc clairement à faire écho au temps présent, et en particulier à la conversion d’Henri IV ; plus encore, on peut voir comment les procédés d’exposition de l’image la font dialoguer avec un ici et maintenant, associant le premier baptême royal à la communauté des fidèles réunie au sein de l’église paroissiale.
Dispositifs d’exposition : l’image et le culte paroissial
Si quelques Baptêmes de Clovis furent destinés assez logiquement à orner des chapelles de fonts baptismaux50, d’autres furent exposés au maître-autel, ce qui pourrait sembler plus étonnant dans la mesure où il s’agit du lieu le plus important de la liturgie catholique en tant que théâtre de l’Eucharistie. Il est assez rare au xviie siècle de placer au maître-autel la figuration d’un miracle appartenant à l’hagiographie d’un saint : le plus souvent ce sont des scènes bibliques, appartenant surtout à la vie de Jésus et de la Vierge51. Pour expliquer cet emplacement apparemment étonnant pour le baptême de Clovis, revenons à Marolles-les-Braults, où la toile du Baptême de Clovis est restée en place au cœur du retable du maître-autel construit lui aussi dans les années 163052. L’analyse plus approfondie de la peinture en relation avec les pratiques cultuelles ayant pour décor ce tableau permet de mieux comprendre l’insertion d’une thématique religieuse a priori secondaire au lieu le plus important du culte paroissial.
Observons de plus près le fond de la scène : si l’estampe de M. Lasne présente un décor architecturé fermé et non identifiable, la peinture dessine une scène dans la scène : une Annonciation peinte orne un retable qui comprend aussi deux statues. Tout porte à croire qu’il ne s’agit pas uniquement d’un décor signifiant que la scène se déroule dans une église – la cuve baptismale y suffit –, mais bien d’une mise en abyme qui approfondit le sens de la scène de baptême. Le premier mystère joyeux annonce en effet la possibilité du salut et l’effacement du péché originel, réalisé par le baptême qui intègre le nouveau fidèle dans la communauté chrétienne. Placée au maître-autel, cette peinture formait en outre la toile de fond de la messe. Tout porte à croire que ce décor n’était pas dissocié du culte : en bas à gauche est figuré le donateur en prière, regardant en direction des paroissiens assemblés dans l’église. Ce fait banal devient intéressant lorsque l’on se remémore son identité : il s’agit de F. Engoulevent, curé de Marolles, dont la présence est donc redoublée : symboliquement, il invite les fidèles à se plonger dans la scène figurée par un procédé d’adresse traditionnel – le regard –, tout en l’associant rituellement au sacrement eucharistique. Si à certains moments du rite, comme l’élévation de l’hostie, l’officiant tourne le dos à ses paroissiens, son double pictural les invite à lier le culte à la scène peinte. Un trajet est donc symboliquement effectué depuis l’Annonciation jusqu’à l’Eucharistie et le Saint-Sacrement53, en passant par le baptême royal et son miracle : le culte associé à la peinture trace un circuit de la rédemption, qui soude la communauté des fidèles autour de la prière et de la communion dans le Christ, et qui implique l’union religieuse entre le roi et la France, seule à même de maintenir l’élection divine du royaume.
La construction des images corrobore cette interprétation : en comparaison avec l’estampe, on peut constater que le peintre a accentué la verticalité de l’image en changeant d’orientation générale, et en plaçant la main de l’évêque versant l’eau du baptême entre la colombe portant l’ampoule et la tête du roi. Le roi baptisé et sacré est alors encadré, verticalement d’une part entre l’officiant dans l’église et l’Esprit saint planant au-dessus de l’Annonciation, et horizontalement d’autre part entre les deux saints qui symbolisent les mondes ecclésiastique et laïc54. Le roi se révèle être alors le point d’union entre le monde profane et le monde sacré, et entre les diverses composantes de son peuple élu ; il forme aussi le creuset de l’identité nationale en assurant sa continuité à travers le temps, la nation française catholique du xviie siècle pouvant se reconnaître dans celle du vie siècle. Et en dépit de cette place à part, l’élection divine et le soutien populaire impliquent pour lui une mission : le roi doit être chrétien ; pour la rédemption de la nation, il faut un roi sacré et catholique. Si c’est le royaume, guidé et figuré par deux saints, qui a conduit le roi à la conversion, le soutien divin se focalise néanmoins sur le roi seul : l’identité catholique de la nation semble bel et bien se cristalliser sur la figure du roi, pierre angulaire des liens privilégiés entre le peuple élu et Dieu. C’est donc probablement parce que le baptême de Clovis symbolise l’union salutaire entre le roi, le peuple et Dieu qu’il peut figurer à l’emplacement le plus prestigieux de l’église : le sujet n’est finalement pas aussi secondaire qu’il paraissait de prime abord.
L’iconographie du baptême de Clovis souligne l’alliance fondamentale entre un roi et un peuple. Le mythe de l’élection du roi est aussi mythe de l’élection du royaume. L’événement historique ne compte que dans sa dimension symbolique, à la fois identitaire et mémorielle ; mais il n’est pas un simple moment de l’histoire, passé et révolu. Il est d’une part rejoué épisodiquement par le rite du sacre que l’on croit associé au premier baptême royal ; et d’autre part l’élection est perpétuellement transmise de roi en roi : le mythe de Clovis prend place dans une histoire qui n’est pas qu’une histoire de France mais une histoire salvifique.
Le mythe de Clovis ou l’histoire salvifique du roi très chrétien et du royaume des lys
Un panthéon très chrétien
Tout comme dans la littérature, le baptême de Clovis, ou plus largement sa vie, ou encore celle de Rémi sont rarement étudiés seuls, sans s’intégrer à une histoire longue, l’image de Clovis s’intègre parfois dans la représentation d’un temps long, dessinant une histoire de la monarchie et de son royaume marquée par ses grandes figures. Un certain nombre d’images associent plusieurs rois, choisis pour leurs qualités religieuses, et parfois mis en relation avec le roi en place ; ils forment ainsi des panthéons à la gloire du roi très chrétien qui synthétise toutes les valeurs de ces prédécesseurs. La plupart de ces images sont des gravures, mais cette iconographie a parfois aussi trouvé sa place au sein d’églises, ce qui ne semble pas avoir posé de problèmes d’inconvenance en dépit des exigences tridentines. Par exemple, l’église de la maison professe des Jésuites de Paris, protégée et en partie financée par Richelieu et Louis XIII, avait une coupole ornée de peintures de Clovis, Charlemagne, Robert le Pieux et saint Louis55, qui surplombait le maître-autel comprenant des statues de Charlemagne et saint Louis ainsi qu’une peinture de ce-dernier montant au Ciel ; la fresque témoignait alors de l’élection de la monarchie qui pouvait s’enorgueillir de compter parmi ses membres deux saints et deux rois associés à des miracles : Clovis et la sainte ampoule, Robert et le pouvoir thaumaturgique. À l’église royale des Invalides, ce furent douze rois que l’on fit représenter à la base du dôme sur un semis de fleurs de lys56. Si ces deux cas sont emblématiques de la glorification religieuse de la lignée royale par les Jésuites et par le pouvoir lui-même57, les panthéons ne furent pas exclusivement parisiens.
Ill. 16 : Étienne Doudieux, La Frise des rois, détail (partie gauche), fin du xviie siècle, bois doré, l. 6 m env., Sarthe, Sargé-lès-Le-Mans, église Saint-Aubin, retable de la chapelle de la Vierge, Cliché auteur
On peut repérer en province au moins un autre regroupement des rois pieux, voire saints, associés aux Bourbons dans une perspective encore plus dynastique qu’aux Invalides. À Sargé-lès-Le-Mans, un retable du xvie siècle est restauré à la fin du siècle suivant à l’initiative du curé Julien Morin ; on y ajoute alors une frise très élaborée et entièrement dorée, présentant une série de visages, scindée en trois groupes que l’on doit pouvoir identifier comme suit (ill. 16) : à gauche, Clovis, Charlemagne et Louis IX ; au centre Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, le Grand Dauphin et Philippe d’Orléans (?) ; et à droite le jeune duc de Bourgogne, la reine, et la Dauphine. L’exemple illustre à quel point les liens tissés entre l’élection de la monarchie et l’élection de la dynastie sont forts. Au-dessus, une autre frise fait alterner des fleurs de lys avec des soleils rayonnants, emblème bien connu de Louis XIV. Au centre, sous des palmes, une inscription tirée de l’Apocalypse (3, 12) explicite le projet : « Qui sera victorieux, je le feray une colonne dans le temple de mon Dieu ». Enfin, les chapiteaux au sommet des colonnes du retable, datant peut-être quant à eux du xvie siècle58, sont surmontés de la colombe portant la sainte ampoule, appuyée sur deux dauphins, reposant eux-mêmes sur une rangée de fleurs de lys. Si les dauphins peuvent être analysés comme un symbole christique, on peut lire dans ces motifs l’idée d’une monarchie dont la pleine légitimité provient de Dieu ; à moins que les chapiteaux ne datent eux aussi de la restauration à la fin du xviie siècle, ce qui permettrait d’y lire une référence à l’avenir assuré de la dynastie grâce à la naissance du fils du dauphin que représente la frise. Un tel panthéon forme la trace de la liaison très forte qui était alors faite entre ancêtres illustres et rois du temps présent, entre passé fondateur et présent glorieux, témoignant d’une élection perpétuée et se manifestant par les grandes victoires du roi soleil. Ces panthéons font donc du baptême de Clovis le premier jalon dans l’histoire longue de l’élection de la monarchie ; cependant ces quelques exemples insistent uniquement sur la dimension monarchique, écartant de facto l’élection du royaume. D’autres représentations vont au-delà de l’histoire dynastique pour intégrer l’élection de la monarchie dans la longue histoire du salut.
Une histoire téléologique
Dans la mesure où l’histoire au xviie siècle est en partie téléologique, tendant vers sa fin, c’est-à-dire le règne de Dieu, l’histoire de l’humanité peut se confondre avec l’histoire du salut. Dans ce cadre, le baptême de Clovis constitue une étape fondatrice, en faisant des Français un peuple élu. On comprend alors que certaines images dressent un parallèle plus ou moins explicite entre les Français et le peuple d’Israël, plaçant le baptême de Clovis dans une longue histoire sainte. Par exemple, le frontispice du Lys Sacré du père Georges-Étienne Rousselet figure dans un lys la monarchie élue (ill. 17) : Clovis, qui met son épée au service de l’Église, et Louis XIII agenouillés contemplent saint Louis dans une mandorle, alors que la colombe apporte la sainte ampoule « qui vient d’en haut » (« Anôthen »)59. Le saint semble ici confirmer l’élection survenue avec la conversion de Clovis, élection perpétuée par ses descendants : tant que le roi régnant, sceptre en main, prend le roi juste et dévot en modèle, celui-ci le protège en retour. C’est à ces conditions que l’Éden paradisiaque figuré en arrière-plan peut être la terre promise du nouveau peuple élu : la citation de l’Ancien Testament – « je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys et il enfoncera ses racines comme la forêt du Liban » (Osée 14, 6) – confirme l’idée que la piété perpétuée des rois est gage du maintien de l’élection du peuple français qui a supplanté Israël.
Ill. 17 : Grégoire Huret, Le Lys Sacré, frontispice : Georges-Étienne Rousselet, Le Lys Sacré, justifiant le bonheur de la piété par divers Parangons du Lys avec les vertus, & les miracles du Roy S. Louys, & des autres Monarques de France..., Lyon, L. Muguet, 1631, in-quarto, n. p., © BnF
Ill. 18 : Anonyme, Le Baptême de Clovis par saint Rémy, premier quart du xviiie siècle, bois polychrome, Rémi : 148 × 83 cm, Clovis : 90 × 65 cm, Haute-Marne, Is-en-Bassigny, église Saint-Rémy, retable du maître-autel, Cliché auteur
On peut aller plus loin en mettant en rapport le baptême de Clovis avec celui du Christ, point évidemment central dans l’histoire du salut. Le premier point commun entre les deux baptêmes est la présence de la colombe du Saint-Esprit ; le père Ceriziers explique ainsi que l’« auguste Baptesme […] est une parfaite image de celuy du Fils de Dieu, puis qu’on vit une Colombe descendre sur le Fils ainé de son Eglise »60. Si les textes soulignent ça et là ce rapport, la symbolique partagée de la colombe est bien plus frappante dans l’iconographie : à notre connaissance, seuls les baptêmes du Christ et de Clovis figurent la colombe. Cela constitue une explication supplémentaire à sa mise en valeur picturale que nous avions analysée plus haut. Sur les peintures d’autel, la colombe est encore très fréquente au xviie siècle ; elle figure même parfois dans le cas de groupes sculptés. Il est symptomatique de constater qu’à Is-en-Bassigny où le retable du maître-autel mêle sculpture et peinture, ce sont Clovis, Rémi et la colombe portant l’ampoule dans son bec qui forment les éléments en ronde bosse, tandis que la cuve, les soldats et les diacres sont relégués au rang de décor (ill. 18). Le parti-pris permet ainsi de placer réellement le couple fondateur sous les lueurs de l’Esprit saint qui émerge d’un soleil radiant parmi les nuées et les têtes d’angelots. Enfin, quelques images dessinent une mise en abyme en figurant par exemple sur la cuve baptismale où le roi est baptisé un bas-relief figurant celui du Christ, plaçant ainsi la conversion royale dans une continuité symbolique affirmée61.
Ill. 19 : Jacques Nicolas (attribué à), Les Trois baptêmes (retable), 1610, calcaire polychrome et marbre noir, 3,33 × 4,09 m, Reims, basilique Saint-Rémi, chapelle des fonts baptismaux, Cliché auteur
La thématique des trois baptêmes va plus loin, en faisant de Clovis le « nouveau Constantin », et en élaborant une histoire qui se veut lecture chrétienne des succès de la foi, liant profondément ces progrès à la conversion du pouvoir politique. Le parallèle avec Constantin est très flatteur, puisqu’il fait de Clovis le successeur de l’empereur, et donc de la France le véritable Empire chrétien, tandis que l’archevêque de Reims succède au pape Sylvestre. C’est le cas d’un retable sculpté à Reims en 1610, destiné à la basilique où étaient conservés le tombeau de saint Rémi et l’huile du sacre (ill. 19). Les scènes figurant Constantin et Clovis encadrent celle du Christ, et se répondent comme dans un miroir : le roi plongé dans la cuve, entouré de deux groupes de trois personnes, tourne la tête vers l’extérieur, tandis que le pape ou l’évêque tend le bras au-dessus de sa tête. En plaçant la conversion de Constantin et de Clovis dans la continuité de l’histoire du Christ, la thématique des trois baptêmes montre que dans l’histoire de la rédemption, les princes, appuyés et éclairés par l’intervention divine, peuvent former de grands exemples à imiter ; ils ont une vocation dans l’histoire salvifique. Cependant un élément empêche de mettre les deux baptêmes politiques sur un plan d’égalité, tout en rapprochant celui de Clovis du baptême du Christ : la colombe émergeant des nuées. La répétition de l’apparition miraculeuse montre alors la faveur accordée à la France face à l’Empire romain : grâce à son roi très chrétien et son saint évêque, la France est terre d’élection, justifiant sa place singulière au sein de la chrétienté. En effet, si Clovis est le successeur de Constantin, Rémi est celui du pape Sylvestre : il devient l’ « apôtre » du royaume et peut faire office de saint gallican62. La France est ainsi très chrétienne grâce à son épiscopat et sa monarchie63.
Conclusion
L’iconographie du roi franc dit donc plus que l’élection du roi : si dans quelques cas la figure de Clovis forme un élément de célébration monarchique uniquement, la majorité des représentations se concentre sur le baptême, qui nécessite de figurer le roi et l’évêque. Souvent la colombe et la communauté s’ajoutent aux deux personnages, faisant du baptême un mythe de l’alliance entre le roi et le royaume, qui, certes participe de la légitimation royale, mais laisse par ailleurs supposer des contreparties à l’élection divine (telles que la soumission du roi à la foi du royaume et le respect du médiateur qu’est le clergé gallican), et qui surtout contrarie la captation de l’identité nationale catholique par la seule figure du roi. Mythe de l’alliance entre le roi très chrétien, le clergé gallican et le peuple français, le baptême de Clovis est en outre le mythe fondateur de l’élection de la nation française : prenant place dans le dessein divin, l’élection royale est la voie du salut du royaume. L’histoire transformée par la fiction se fait le support d’une identité religieuse gallicane qui se veut nationale, bien qu’elle soit pour l’essentiel régionale. Le support iconographique, qui permet le maintien du mythe après son ébranlement dans les textes historiques, semble avoir joué un rôle majeur dans la persistance de cette identité : via l’image placée au sein d’un lieu de culte, le baptême intègre le statut de croyance officielle reconnue par l’Église ; par son effet de présence, le lien entre le roi, la nation et la foi est actualisé ; et par les pratiques communautaires qui lui sont associées, le mythe de l’identité nationale est relié à l’appartenance locale.