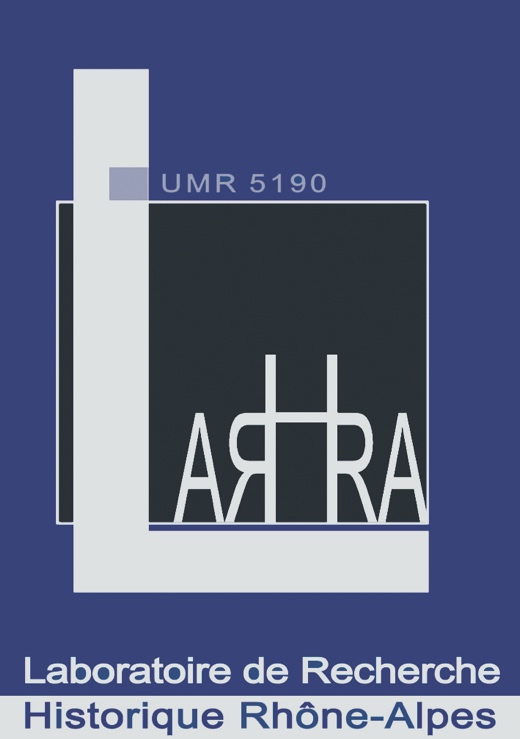Premier logo du LARHRA
À la fin de l’année 2002, j’avais été contacté par la direction de l’institut SHS du CNRS pour évoquer la situation de la recherche en histoire moderne et contemporaine de Lyon et Grenoble. La direction de l’InSHS avait été saisie de quatre projets différents de constitution d’UMR émanant d’équipes de Lyon 2, Lyon III, l’ENS Lyon, l’université de Grenoble, symptomatique des tensions qui régnaient chez les collègues.
Le CNRS ne souhaitait pas cet éparpillement et envisageait un regroupement des quatre projets en une seule unité. Il ne pouvait, cependant, être envisagé de confier cette tâche à l’une des porteuses ou à l’un des porteurs de projets tant les relations entre les différentes équipes n’étaient pas, disons, des plus sereines. Une telle solution aurait attisé les tensions… D’où l’idée de confier cette tâche à un tiers.
Ayant quitté Lyon plus de dix ans auparavant, ayant été invité récemment par les diverses équipes à siéger dans différents jurys de thèses ou à participer à des séminaires, je connaissais presque tout le monde – un peu moins les historiennes et les historiennes de l’art. La direction de l’institut voulait donc me sonder pour savoir si j’accepterais de retourner à Lyon afin de créer une UMR regroupant les différentes équipes. Dans ce cas, un poste de professeur pourrait être créé pour m’accueillir à l’université Lyon 2.
À la suite de cette première prise de contact, je me suis retrouvé avec les représentantes et les représentants des différentes équipes dans le bureau du directeur de l’ISH (la MSH d’aujourd’hui), en compagnie du DSA de la section 33 du CNRS. L’ambiance était quelque peu électrique. Il fut décidé de construire un nouveau projet fédérant les diverses équipes. Pendant tout le premier semestre 2003, je suis retourné à Lyon, et à Grenoble, pour affiner les choses et rassurer sur les moyens du futur laboratoire. J’ai aussi rencontré les différentes tutelles universitaires pour les assurer du fait que le nouveau projet n’avantagerait pas un établissement au détriment d’un autre et qu’il en irait de même pour les équipes initiales. J’avais suggéré de construire le nouveau projet sur l’importance des méthodes et j’avais obtenu qu’un pôle méthodes soit créé avec la création d’un poste d’ingénieur cartographe.
En septembre 2003, s’est tenu le premier conseil de laboratoire où siégeaient, de droit, les responsables d’équipes et des élues et élus des différents corps. Je crois me souvenir d’avoir très tôt ouvert le conseil à des doctorantes et doctorants. L’ambiance n’était pas des plus sereines et je crois avoir dit en conseil de laboratoire – pas lors du premier – que j’envisageais une note de service stipulant : « Quand on est dans le même laboratoire, on a le droit de se dire bonjour… ». Je ne l’ai jamais fait. Dans cette ambiance, le rôle des collègues de Grenoble a été très important pour diminuer les tensions. Je suis quasiment sûr que le sigle LARHRA a été trouvé par René Favier, directeur délégué à Grenoble.
En novembre ou décembre 2003, nous avions fait une assemblée générale pour présenter les différents projets dans les locaux des archives municipales, derrière la gare de Perrache. Les différentes tutelles étaient venues et des anciens professeurs de Lyon, comme mon ami Maurice Garden, avaient participé à cette première manifestation publique du laboratoire.
Pour autant, les tensions et la méfiance subsistaient entre les équipes. Chacune et chacun craignant d’être lésé dans la répartition des moyens. En ce sens, l’année 2004 fut décisive car c’était la première avec un financement LARHRA. En effet, au dernier trimestre 2003, le fonctionnement s’était fait sur les crédits des anciennes équipes. L’aide de la délégation régionale du CNRS, et en particulier, de ses services financiers comme de ceux des différents établissements avait été fondamentale. Mais 2004 devait être décisive.
Les choses globalement avançaient et des formations avaient été mises en place par les services centraux de l’UMR. Par ailleurs aucun responsable d’équipe ne se sentait lésé par les choix et les orientations du conseil de laboratoire.
Pourtant c’est un événement extérieur qui devait souder le laboratoire. La situation lyonnaise était telle dans le domaine de l’histoire qu’un rapport avait été demandé à Henry Rousso sur le racisme et le négationnisme. Il fut publié début octobre 2004. Un professeur de Lyon III, alors délégué général du Front National et député européen, Bruno Gollnisch, mit ce rapport en cause en affirmant : « M. Rousso est par ailleurs juge et partie puisqu’il est engagé contre les historiens hétérodoxes. De plus, c’est une personnalité juive, certes estimable. Mais sa neutralité n’est pas garantie. » (20 minutes, 12 octobre 2004 ; Le Figaro, 13 octobre 2004)
Devant l’impact médiatique de ces propos, où il était aussi question de méthodes historiques, j’avais envoyé, sans prendre le temps d’en référer au conseil de laboratoire mais en consultant par téléphone plusieurs responsables d’équipes, un communiqué à l’AFP soulignant l’importance de la recherche historique à Lyon et le fait que nous n’avions pas à recevoir de leçons de Bruno Gollnisch. Ce premier communiqué fut suivi d’un texte plus développé rédigé par plusieurs collègues du laboratoire avec la direction du laboratoire. Cela me valut par la suite, comme à Bernard Hours, d’être convoqué par le CNESER pour être confronté à Bruno Gollnisch…
Différents collègues qui, jusque-là, regardaient un peu en spectateurs la construction du LARHRA s’impliquèrent bien davantage après cet épisode.