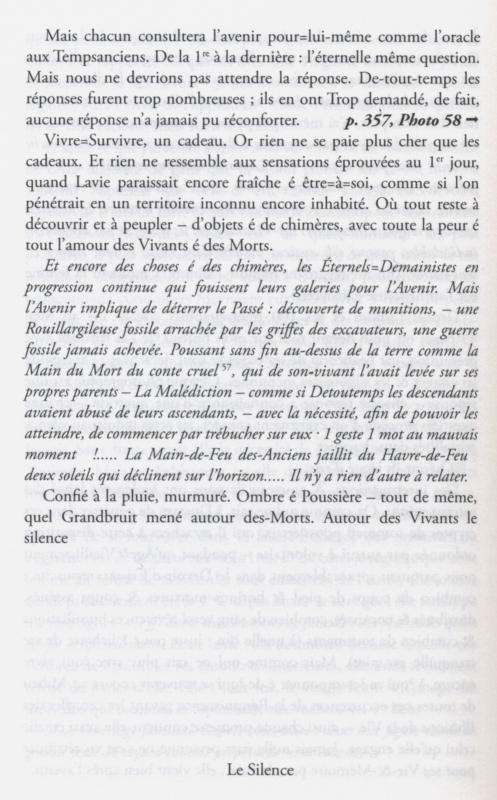La leçon pour notre époque est qu’il convient de résister au désenchantement de ceux qui sous-estiment systématiquement la portée de ce qui s’est développé depuis deux décennies, et plus encore à l’ivresse de ceux qui tirent parti de ces avancées pour prophétiser l’avènement d’une nouvelle humanité1.
***
Dans l’appel à proposition de ce colloque était mentionné notamment le beau livre de Jacques Rancière, intitulé Le Destin des images. Je souhaiterais réfléchir aux voies que pourraient emprunter à présent les études photolittéraires, dans la continuité des travaux que ce philosophe a consacrés à la notion même d’image, auxquels j’emprunterai trois éléments principiels. D’abord, posons avec lui que « les mots et les formes, le dicible et le visible, le visible et l’invisible se rapportent les uns aux autres » et qu’en conséquence ce sont les circularités, les « jeux des échanges2 » qu’il faut considérer. Ce que j’ai pour ma part dénommé les diagonales photolittéraires, les trajectoires allers-retours d’un territoire à l’autre, les emprunts symboliques marquant les transactions allant du photographique au littéraire et inversement – la figure des diagonales s’opposant à celle des parallèles, qui comparent sans jamais pouvoir disposer les espaces d’interactions, les convergences ni les rencontres3.
Ensuite, concernant au moins les images visuelles matériellement présentes en effet dans les sites ou les blogs à vocation littéraire, il paraît très utile de recourir à la distinction opérée encore par Jacques Rancière entre trois régimes iconiques : les images nues, qui ressortissent en gros de la catégorie du document, à valeur référentielle mais sans visée artistique ; les images ostensives, qui au contraire doivent leur puissance assertive à leur relation avec le monde de l’art et au régime axiologique qui lui est associé ; et enfin les images métaphoriques, qui relèvent en gros de ce que Philippe Hamon de son côté avait dénommé, reprenant un terme de Champfleury, les Imageries4, soit un très vaste ensemble d’images partagées par une société, possédant une valeur sinon péjorative du moins faiblement appréciée – cartes postales, timbres, gravures d’Épinal, objets décoratifs, etc. –, et ayant trois caractéristiques : d’être dotées d’un pouvoir de diffusion très rapide, et surtout d’être innervées de discours sociaux, d’être « bavardes » si l’on veut, en tout cas d’être imprégnées de l’imaginaire de la quotidienneté et de la mémoire collective, comme les journaux ou les magazines où on les retrouve à foison. Ces « images métaphoriques », tout en étant non pas des figures de style mais de véritables images, opèrent le pont ou la liaison entre les dimensions discursives et visuelles – puisqu’il est évident que le langage lui-même comporte autant de capacités d’être porteur d’images que les images proprement dites ont d’aptitude à dire, suggérer ou raconter.
Enfin, dès lors qu’il est question d’images et de littérature mêlées, de « lire » un objet iconotextuel, quel qu’en soit le médium, l’on ne saurait faire l’économie de la question du pouvoir conféré aux images et aux mots, bref de cette préoccupation tant métaphysique que politique qui est si présente chez Jacques Rancière, lequel conçoit ces trois types d’images comme les « trois formes d’imagéité qui sont trois manières de lier ou de délier le pouvoir de montrer et celui de signifier »5. Cette « imagéité », chez Jacques Rancière, constitue en somme le « territoire » sur lequel se déploie le pouvoir des images, territoire comportant des frontières, des tensions, des conflits, car comme l’énonce de son côté Philippe Hamon « […] les batailles d’icônes sont aussi des batailles d’idées et d’idoles »6.
Il convient de conserver à l’esprit que ces conflits, ces questions de pouvoir, où politique et métaphysique sont étroitement imbriquées, ces oscillations entre iconophobie et iconophilie sont aussi anciennes que la tradition mimétique elle-même, et que, bien avant de concerner l’image photographique, ils ont affecté les relations entre la peinture et l’écriture7 : autant d’interférences étudiées par la critique « intermédiale », et que Liliane Louvel, pour sa part, proposait de penser sous l’égide de « l’événement entre-deux », se focalisant sur ce qu’elle dénomme un Tiers pictural, situé à l’intersection des capacités d’énonciation particulières aux discours et des aptitudes de monstration propres aux images peintes8.
Mon souci sera d’éviter deux écueils contraires, celui de la technophilie béate qui s’enthousiasme envers ce qu’elle croit entièrement inédit, quand ce sont parfois des questions déjà posées qui ne sont que reformulées ou redéployées ; et celui de la technophobie qui s’effraie à l’approche de tous les « nouveaux mondes » en criant à la décadence, comme Régis Debray, vitupérant contre « un nouvel âge du technocosme, avec un renouvellement stratégique dans l’équipement des esprits »9, et citant à l’appui de son propos Paul Valéry : « La vie moderne tend à nous épargner l’effort intellectuel comme elle le fait de l’effort physique. Elle remplace par exemple l’imagination par les images, les raisonnements par les symboles et les écritures, ou par des mécaniques, et souvent par rien. » Or, ce rien, ou ce vide, auquel on a pu réduire la modernité10, en quoi consistent-ils pourtant ? Et si nous ne sommes pas contraints d’adopter le point de vue pessimiste de Paul Valéry relayé par Régis Debray, n’ont-ils cependant pas raison de poser la question principielle : en termes d’intelligence du monde, quelles pertes et quels gains nous permettent les redéploiements des relations entre textes et images, telles que nos nouvelles technologies les donnent à concevoir et permettent de les réaliser ?
Le problème qui se pose est donc double : l’intervention de la photographie dans la tradition mimétique se situe-t-elle dans la lignée des « interférences » picturales avec l’ordre discursif ? Nous pensons pouvoir y répondre négativement, dans la mesure où cette image technologique introduit une césure avec l’ordre mimétique ancien, dans lequel, tout en rivalisant l’un avec l’autre, le pictural et le discursif s’étayaient plus souvent qu’ils ne se phagocytaient11. L’autre problème consistera à discerner si, du livre à l’écran, depuis l’ère des « chaînons de la gourmette » (Jacques le fataliste) discursive jusqu’à celle des branchements instantanés opérables sur la « toile », il y a rupture ou bien continuité, dans quels secteurs et avec quels effets.
Mais peut-être ne sera-t-il pas nécessaire de demeurer dans le carcan d’une alternative binaire : avec un roman de Reinhardt Jirgl, Le Silence, nous verrons un exemple de remédiation ou d’adaptation de l’aire du livre traditionnel face aux propositions originales – le sont-elles toutes, et tout à fait ? – du médium numérique.
La césure photographique
Le terme « photolittérature » est apparu voilà une trentaine d’années, sur la proposition de Charles Grivel12. Loin d’être un concept vain ou un néologisme cosmétique, il tint sa nécessité d’une ambition pleinement cohérente, qui ne consistait ni à ouvrir un nouveau volet dans la discipline des littératures comparées, ni à reverser les problèmes spécifiques liés à cette image dans le confus domaine des études visuelles, mais à prendre à bras-le-corps toute une série de phénomènes tenant précisément au caractère non-soluble de la photographie dans la tradition mimétique littéraire, au point qu’en fut rendue nécessaire une relecture au moins partielle de notre histoire littéraire, comme l’ont démontré notamment Philippe Ortel, Jérôme Thélot ou Paul Edwards13.
La photographie fut bien sûr perçue comme concurrente des autres pratiques visuelles, mais si elle y fit irruption comme un chien dans un jeu de quilles, c’est qu’elle vint perturber les interconnexions liant tous les arts les uns aux autres, redistribuer leurs relations, affectant commercialement l’art des peintres et des portraitistes, mais percutant les poétiques proprement littéraires plus profondément encore – raison pour laquelle Philippe Ortel sous-titre son ouvrage : « Enquête sur une révolution invisible ». Nous pensons, avec Jérôme Thélot en particulier, qu’il existe bel et bien un « âge de la photographie » qui se confond pratiquement avec notre modernité, définie comme « surdéterminée par les traits fondamentaux dont la photographie est faite » 14, c’est-à-dire un profond changement de paradigme qui, du reste, n’est pas exclusivement esthétique, ayant été parfaitement décrit sur le plan social et politique par Alexis de Tocqueville dans sa Démocratie en Amérique. Il s’agit, pour être concis, de la substitution de la dimension horizontale à l’ancienne verticalité15 : aussi bien, la photographie signifie-t-elle notre modernité, en tant qu’elle concentre tous les symptômes ou les effets de ce changement paradigmatique, étant « la vraie image républicaine »16, mais aussi une image « plate », sur laquelle les signes tournent « comme le lait »17, peu apte à la transcendance, simple trace, empreinte reproductible, une « image précaire »18, réalisable tant par des artistes que de simples amateurs, destinée tant à des albums de famille qu’à des magazines, dont l’usage littéraire est souvent in absentia, tandis qu’utilisée in præsentia elle gauchit singulièrement la tradition de l’illustration. De cela, l’on trouvera maints exemples, tantôt euphoriques tantôt dysphoriques : songeons à Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach avec des clichés de C.-G. Petit (1892), à L’Élixir du Révérend Père Gaucher d’Alphonse Daudet avec des clichés signés Henri Magron (1894), à Nadja d’André Breton (1928), avec 44 photographies mêlées à des dessins dans un dispositif déniant toute pertinence à la notion classique d’illustration : une constante en photolittérature, dont un récent avatar est, par exemple, la position de Françoise Dolto fustigeant Le Petit Chaperon rouge accompagné de photographies de Sarah Moon (1985), au motif que ces dernières inhibent le processus de sublimation par excès de capacité référentielle19.
Il existe donc bien une césure dans la tradition de l’activité mimétique dès lors que l’on passe à l’ère de la photographie, avec ce jeu d’aller-retour où sont prises toutes les inventions technologiques majeures, qui sont à la fois causes et conséquences des mutations. Après tout, l’adoption par les grecs anciens d’un alphabet antinomique avec les hiéroglyphes et leurs images n’était-elle pas déjà une manière de « brancher » l’écriture sur un espace intellectuel et politique nouveau dans lequel chacun devait savoir lire la loi commune inscrite sur le marbre ? Quant aux historiens du livre, tous ont noté que l’imprimerie a permis de réaliser l’opération d’indexation des savoirs et des informations, laquelle a engendré un « homme typographique »20, doté d’une nouvelle forme d’intelligence du monde – mais pourvu aussi de nouvelles capacités de nuisance, avec les pamphlets orduriers qui firent dire à Montaigne que sa propre œuvre avait germé sur du fumier (Essais, III, 9). Plus généralement, ce sont tous les changements de régimes discursifs et iconiques, et tous les réglages de discursivité et d’imagicité qu’ils engendrent, qui impulsent des formes renouvelées du « commerce des regards »21, c’est-à-dire – selon l’étymologie du mot commerce – des relations, des liaisons, mais aussi des conflits, à l’occasion de la mise en place de nouveaux inputs et outputs entre les modèles discursifs et iconiques dont les membres d’une société disposent pour ancrer leurs représentations mentales collectives et ordonner leur monde selon telle nouvelle logique, sachant que ce que nous dénommions « intelligence du monde » ne va jamais sans de nouvelles formes de « mésentente », un autre terme cher à Jacques Rancière22.
Comme l’on a pu évoquer un « homme typographique », l’on peut donc parler d’un « homme photographique », auquel doit désormais être associé un nouveau « partage du sensible »23, ou ce que Michel Thouillot nommait, à propos de Claude Simon, un « régime de polémicité »24 particulier entre texte et image.
Mais est-il vraiment pertinent de poser l’existence d’un « homme numérique », donc d’une autre césure ? Ou bien cet « homme numérique » n’était-il pas déjà contenu en germe dans l’homme photographique ? C’est du moins la puissante intuition de Villiers de l’Isle-Adam, en 1886, dans son Ève future, inventant une androïde, c’est-à-dire un robot humain, généré par des processus électro-photographiques : comme le démontre magistralement Jérôme Thélot, Villiers condense dans cette œuvre, bien plus visionnaire que science-fictionnelle, tous les problèmes qu’à présent nous rencontrons – esthétiques, politiques et métaphysiques – à l’ère de nouvelles technologies, tant le procédé photographique ne concerna pas exclusivement la « reproductibilité technique » (Walter Benjamin) des seules images, mais plus largement celle de la Vie elle-même, car comme l’écrit Jérôme Thélot :
Quelle haine de la naissance et des enfants ont-ils rendu possible l’Idée de l’Ève future, cette Idée qu’on voit aujourd’hui, semble-t-il, passer du symbole littéraire aux manipulations dans les éprouvettes lucratives des nouveaux Edison ?25
Loin qu’il s’agisse de nier les évolutions auxquelles l’ère numérique, entrevue par Villiers, donnera accès, il faut en circonscrire l’ampleur aussi exactement que possible. Roger Chartier, lors d’une conférence prononcée à Aix-en-Provence en 2005, posait très clairement ce qu’elles sont, et quelles en sont les conséquences pragmatiques :
Les écrans du présent ne sont pas des écrans d’images qu’il faudrait opposer à la culture de l’écrit. Ce sont des écrans d’écrits. Certes, ils accueillent les images, fixes ou mobiles, les sons, les paroles, les musiques, mais en même temps ils transmettent, multiplient, peut-être jusqu’à un excès incontrôlable, la culture écrite. […] Il ne faut pas considérer l’écran comme une page, mais comme un espace à trois dimensions, largeur, hauteur, profondeur, comme si les textes atteignaient la surface de l’écran à partir du fond de l’appareil. En conséquence, dans l’espace numérique, ce n’est pas l’objet qui est plié, comme dans le cas de la feuille d’imprimerie, mais le texte lui-même. La lecture consiste donc à “déplier” cette textualité mobile et infinie26.
Lorsque Roger Chartier conclut son propos par : « Un des grands enjeux de l’avenir réside dans la possibilité ou non de la textualité digitale à surmonter la tendance à la fragmentation qui caractérise, à la fois, le support électronique et les modes de lecture qu’il propose », il pose les questions de la vérification des discours et des images, conséquences de l’effacement de la figure de l’auteur (sa responsabilité discursive ou créatrice), tout en pointant aussi bien les apports potentiels de l’encyclopédisme coopératif que les risques ou les périls, largement aussi réalistes, de la falsification généralisée et de l’épuisement ou l’appauvrissement de l’idée même de fiction, minée ou laminée par le délitement de « l’ordre des raisons », lié à « l’articulation ouverte, éclatée, relationnelle du raisonnement, rendue possible par la multiplication des liens hypertextuels. »27.
Mais l’on retrouve bien là l’une des questions fondamentales qui s’étaient posées avec l’invention de la photographie : qui, au juste, en est l’auteur ? Quelle main a réalisé cette image, ou alors quelle « collaboration avec le soleil »28 ? Que dit-elle, que prouve-t-elle, que valide-t-elle ? Ces « écrans d’écrits », qu’évoque Roger Chartier, dans lesquels la graphie est comme « pliée » en une matière tant écrite qu’iconique ou sonore, manifestent que s’il y a effectivement une rupture, elle se situe au regard de la tradition du codex, tandis qu’en revanche il y a bien continuité entre le photographique et le numérique. Par rapport à « l’ordre des raisons » jadis établi par le codex, « les trois dispositifs classiques de la preuve (la note, la référence et la citation) se trouvent profondément modifiés dans le monde de la textualité numérique »29. Avec l’homme photo-numérique, c’est un nouvel ordre des raisons, des discours, de leurs références et de leurs origines qui s’impose, ayant pour corollaire « une nouvelle manière de lire, segmentée, fragmentée, discontinue », dans un espace mobile et sans autre « fond » que celui, illusoire, de l’écran. Ce sera finalement aussi un autre « ordre des illusions » qui s’inventera, de nouveaux régimes de fictionnalités, ainsi que le démontrent amplement les travaux récents en narratologie autour de la fiction autobiographique, l’évolution de l’auto- à la biofiction30, autant de Mythologies post photographiques dont Servanne Monjour démontre qu’elles sont en profondeur liées à L’Invention littéraire de l’image numérique31.
Il semble donc bien que, dans cette mutation, le changement de support soit d’une moindre importance que l’évolution du régime de l’image, ou du concept même d’image. Et ce serait logique, puisque ce dernier est précisément à l’interface de l’ordre du discours et de l’ordre de la représentation. C’est du reste ce que l’on enregistre tant chez Philippe Hamon – évoquant l’apparition, chez Baudelaire ou Flaubert, de ce que Jules Laforgue dénommait des « images américaines » inspirées du modèle photographique32 –, que chez Jacques Rancière, proposant d’enrichir son imagicité de la notion d’image « pensive », sur laquelle nous reviendrons.
Mais disons-le tout de suite : si la véritable mutation de l’Ut Pictura est non pas de la photographie au numérique, mais du codex à « l’écran d’écrits », et plus précisément si, à l’intérieur ou de l’intérieur même de ces deux types de textualités, ce changement s’avère causé moins par la substitution du support technologique que par la mue du concept d’image, alors cela voudra dire que nous pourrons valider l’ensemble de ces thèses en prenant un seul exemple, celui d’un texte de fiction utilisant le support du livre tout en y greffant un dispositif fonctionnant selon une syntaxe numérique.
Au péril de la métaphore
Avant d’aller plus avant, remarquons qu’en amont des problèmes énoncés, il y a celui-ci : pour parler des images, l’on ne dispose d’autre outil conceptuel que… d’images. Or, chacun sait grâce à Gaston Bachelard et son célèbre exemple de l’éponge, que les images constituent souvent des obstacles épistémologiques33. Nous citions plus haut Jacques Rancière, posant « trois formes d’imagéité qui sont trois manières de lier ou de délier le pouvoir de montrer et celui de signifier. » Cette métaphore du nœud – ce qui noue ou lie, dénoue ou délie, serre ou desserre – ne peut manquer de faire écho à celle de l’input, avec son corollaire l’output. Mais le réseau métaphorique choisi n’est évidemment pas sans conséquences : un lien ou un nœud ne renvoient pas tout à fait au même type de technologie ni de lecture qu’une entrée ou un branchement.
Incidemment, nous citions aussi Diderot, ses « chaînons de la gourmette » : encore une image, ou plutôt deux images pour dire qu’au-delà des effets de brouillage de la lecture, de la polyphonie des voix narratives, des interférences entre diction et fiction, dans Jacques le fataliste tout se tient d’une nécessité organique, tout est fondu dans « le feu de la conversation »34. Le codex n’ignore en rien cette possibilité de lier et délier, nouer et dénouer, d’être à la fois dans un système tout en y faisant pénétrer des éléments hors système.
Un autre exemple serait celui de Voltaire, posant la question de la sociabilité, de ce qui lie les hommes entre eux ou les délie les uns des autres, de ce qui les relie au monde dont ils font l’expérience, ou qui les dissocie d’avec lui. Voltaire posait un ensemble de forces tant centrifuges que centripètes, qui attirent ou repoussent les hommes et les femmes vivant (tant bien que mal) en société. Bien entendu, il songeait, d’après le modèle de Newton, à des forces inscrites dans la nature et le cosmos, mais il pensait aussi aux productions intellectuelles et techniques, à l’acte de la lecture et à ce mécanisme conceptuel que constituait de son temps le livre, si bien qu’il conçut son Dictionnaire philosophique comme une machine utilisant la rationalité de l’ordre alphabétique pour mieux défaire polémiquement le dogmatisme de la tradition théologique, grâce à des entrées (des inputs ?) dont la succession même générait la critique (par exemple à la lettre M : Martyr, Matière, Méchant, Messie…) et des sorties (des outputs ?) renvoyant à d’autres articles, ou à des sources savantes fantaisistes, ou encore à d’autres de ses œuvres, traités ou contes. Le couple entrée/sortie, sans se superposer tout à fait aux fonctions numériques input/output, fait écho au couple lier/délier, car entrer une donnée dans un système c’est opérer un branchement qui aura des effets quantitatifs et qualitatifs, procéder à de nouvelles liaisons, qui généreront aussi des déliaisons en retour35.
Pour être classique, on le voit, le problème n’en est pas moins complexe : il s’agit de savoir comment l’on peut envisager un ensemble clos, ou un système, tout en posant son aptitude à englober et ouvrir, plutôt que d’enfermer. C’est en effet chez Leibniz que l’on trouve à la fois la théorie des « monades » et celle des « mondes possibles », qui croisent à l’évidence le postulat de l’autonomie des textes littéraires envers l’univers des images, et le constat que cette dernière ne vaut qu’autant que ces textes déploient les pouvoirs de la fiction : « déconnectés » (output) du réel, ils s’y raccordent (input) grâce à ce détour représentationnel, c’est-à-dire en « faisant image » à leur tour36.
Autrement dit, si les phénomènes qu’on dénomme à présent connexion et déconnexion sont apparus avec les dispositifs numériques, il est probablement naïf de croire qu’ils seraient exclusivement dus aux avancées technologiques qui ont suscité leur émergence dans notre vocabulaire, tant la création verbale aussi bien qu’iconique ne vit que sous le régime de la métaphore, et que d’être en perpétuel mouvement ou déplacement.
Toutefois, ces précautions historiques posées, il serait vain de considérer comme négligeables les différences matérielles menant des liens, des chaînons, des entrées ou des interférences entre le verbal et le visuel, tels que la tradition de l’Ut Pictura Poesis les a pratiqués, avec le potentiel ou les effets des inputs et outputs, qui requièrent incontestablement de formuler les nouveaux problèmes en interrogeant le concept d’image, dans la mesure où l’arborescence du net, de la « toile », ne prédispose pas exactement au même type de représentation et de rapport au monde que l’espace à tous égards plus clos du codex.
Quoi de neuf ?
Dans Le Spectateur émancipé, soit cinq ans après son Destin des images, Jacques Rancière introduisit la notion d’image pensive, afin d’aborder les questions spécifiques à l’ère – ou l’aire – numérique37. L’on est désormais très loin de l’opposition entre le linéaire et le tabulaire proposée en 1976 par Pierre Fresnault-Deruelle dans un article sur « La bande dessinée et son discours » afin de penser les liens entre la figuration narrative et l’espace de la planche où elle se déploie38. Car la notion de « discours » a disparu : il s’agit désormais de penser la « pensivité » de l’image, concept qui est à présent désolidarisé de la seule rhétorique. Trente ans après, l’on est passé « du codex à l’écran »39, et en quelque sorte de la logique du lien de coprésence spatiale dans la BD à celle des branchements potentiels depuis un espace textuel susceptible de trouées, d’une pensée de l’illustration du récit grâce à l’image associée en marge à une pensée de l’intervention de l’image depuis l’intérieur de ce texte interconnecté, ou encore à une modalité discursive telle que le texte s’ouvre à une autre pensivité que la sienne, celle justement des images. Qu’est-ce alors, selon Jacques Rancière, qu’une « image pensive » ? Un paradoxe :
Une image n’est pas censée penser. Elle est censée être seulement un objet de pensée. Une image pensive, c’est alors une image qui recèle de la pensée non pensée, une pensée qui n’est pas assignable à l’intention de celui qui la produit et qui fait effet sur celui qui la voit sans qu’il la lie à un objet déterminé. La pensivité désignerait ainsi un état indéterminé entre l’actif et le passif40.
Sur la base empirique d’un constat historique, il s’agit pour Jacques Rancière d’envisager l’existence d’une mue du régime de l’image, une mue aux dimensions tant conceptuelles – certaines images à présent ne sont ni « les doubles d’une chose » ni ne résultent des « opérations d’un art » : c’est donc le concept qui aurait changé –, que cognitives – ces images renégocient les frontières qui jusqu’alors les tenaient en lisière du territoire de la pensée. Or, cette mue dont les effets traversent aujourd’hui tous les dispositifs relationnels entre images et textes (cinéma, vidéo, arts plastiques, numériques) prend son origine dans la photographie, en tant qu’elle inaugure une alternative indécidable entre l’art et le non-art, pointée par Baudelaire dès la fin des années 1850. La querelle sur le caractère artistique ou non de la photographie est ici hors de propos ; Rancière pointe autre chose, un phénomène dont on constate qu’il est commun par exemple à Gustave Flaubert et à Walker Evans, tendant l’un comme l’autre à faire converger le caractère banal des objets décrits et le caractère impersonnel du sujet qui réalise la description, tendant aussi à découpler le factuel et le narratif. Au-delà du « passage du régime de la représentation à un régime de la présence »41, écrit Rancière, il faut concevoir « une troisième manière de penser la rupture esthétique moderne » où « la pensivité de l’image est le produit de ce nouveau statut de la figure qui conjoint sans les homogénéiser deux régimes d’expression [de sorte que] la logique de la visualité ne vient plus suppléer l’action. Elle vient la suspendre ou plutôt la doubler. » 42. L’emploi du terme de « figure » montre bien qu’il ne s’agit pas de mettre d’un côté la rhétorique, de l’autre les images visuelles, ni d’un côté l’art, de l’autre le non-art, mais de penser les jeux d’écarts et de compénétration élaborés dans les constructions artistiques, tous médias confondus, dans « l’entrelacement de plusieurs régimes d’expression de plusieurs arts et plusieurs médias », concluant ainsi :
Nombre de commentateurs ont voulu voir dans les nouveaux médias électroniques et informatiques la fin de l’altérité des images, sinon celle des inventions de l’art. Mais l’ordinateur, le synthétiseur et les technologies nouvelles dans leur ensemble n’ont pas plus signifié la fin de l’image et de l’art que la photographie ou le cinéma en leur temps43.
Des conclusions qui nous paraissent d’autant plus convaincantes qu’elles sont corroborées par Jacques Morizot, lequel, empruntant un tout autre cheminement, n’en parvient pas moins à des constatations tout à fait similaires :
Le virtuel apparaît comme un corollaire fondamental de la révolution numérique, aboutissement d’une longue série d’innovations dont la photographie a été sans aucun doute le point de basculement. […] Comme le langage, l’image s’est trouvée emportée dans une mutation sans précédent et dont nous ne savons peut-être pas évaluer la portée. Il ne s’agit pas en l’occurrence de la simple émergence de nouvelles images et de nouvelles technologies d’images […]. L’image n’est plus pensée seulement comme surface destinée à réfléchir le visible mais de plus en plus comme une mécanique de vision, mieux de visualisation, c’est-à-dire un dispositif qui organise et dans une certaine mesure invente la perception de la réalité. L’essor des recherches en psychologie cognitive a considérablement renforcé l’importance qu’on peut reconnaître à ce processus de réélaboration. Au terme, la perception "naturelle" ne constitue plus qu’une dimension, certes indispensable mais partielle, de notre relation à la réalité44.
Jacques Morizot confirme en particulier que s’il existe bien ce que Jacques Rancière dénomme quant à lui une « pensivité » de l’image, cette mutation – qui est à la fois, répétons-le, conceptuelle et cognitive – est liée à « une pensée devenue ouvertement transactionnelle » qui s’actualise « à travers une forme d’action qui, comme toute action, renvoie en dernier ressort à l’engagement de l’homme dans le monde. »45.
Deux conclusions à ce stade : si ce qui est primordial n’est pas le médium mais bien la mue du concept d’image même, un exemple pris non pas dans le corpus des créations numériques stricto sensu mais dans la production livresque pourra suffire à valider cette hypothèse. En outre, si c’est bien sur le terrain des conséquences cognitives qu’il faut aller en rechercher la portée, alors il faudra examiner cet exemple d’une part sous l’angle de ce qui fonde le dispositif « transactionnel » entre le texte et ses images – à savoir une syntaxe –, et d’autre part dans la perspective de ce que produit cette syntaxe en termes d’« engagement de l’homme dans le monde », à savoir la perspective de la fiction, qui est le territoire où se jouent les représentations, leurs valeurs sociales et leurs enjeux de tous ordres.
La question de la syntaxe : Le Silence de Reinhardt Jirgl
L’ère numérique n’implique nullement une nouvelle photolittérature, d’abord parce que la nécessité de ce concept, à l’instar de bien d’autres concepts esthétiques, fut posée largement après les effets de cette invention dans le domaine littéraire. Et pour cette autre raison qu’à cette ère (époque) ou sur cette aire (espace, support, médium) dite numérique – et que l’on devrait dénommer « photonumérique » –, ce sont plutôt les prémices contenues d’emblée dans l’image photographique – ou dans le photographique46 – qui trouvent à se déployer selon toutes leurs potentialités. L’enjeu véritable – dès lors que l’on s’accorde à constater avec Jacques Rancière qu’il existe un régime de l’image « pensif », ou avec Jacques Morizot que « la perception “naturelle” ne constitue plus qu’une dimension, certes indispensable mais partielle, de notre relation à la réalité » –, doit consister à se demander pourquoi et de quelles manières la photographie – ou le photographique – continue d’affecter en profondeur le déploiement de la mimésis littéraire. C’est nécessairement qu’il y a bel et bien un fonds commun entre elles, quelle que soit la définition que l’on se donne de la mimésis, de la représentation, sans quoi leur commerce même serait devenu impossible – suivant l’adage baudelairien selon lequel poésie et progrès se haïssent d’une haine instinctive. Ce fonds, c’est la fiction, de cette activité consistant à modéliser sur le mode ludique – ce qui ne veut pas dire gratuitement – notre rapport au monde. Si la mue conceptuelle et cognitive de l’image, plus haut évoquée, a quelque importance, ce ne peut être finalement qu’autant que l’on peut constater les conséquences qu’elle a sur l’activité fondamentale dont elle relève, la « fictionnalité », cette activité cérébrale consistant à produire des modèles ou des schèmes de représentation qui ne se dissocient ni de la vie collective, ni de l’histoire des idées, des valeurs, des sciences et des techniques. Dans tous les cas, il s’agit de penser avec les mots et de « penser avec les yeux », selon l’expression du sociologue Sylvain Maresca47 : lorsque nous produisons des représentations (pictura) obéissant à des dispositifs ou des structures créatives (poésis) imputés ou débranchés (input/output) sur des faits ou des phénomènes que nous pouvons ainsi projeter, penser et comprendre, quelles que soient les techniques de ligature ou de « liens » auxquelles nous recourons, quelles que soient les techniques que nous inventons pour modéliser notre relation avec ce monde, pour jouer avec elles et avec lui.
Quelle est la forme et quelle est l’ambition de l’intelligence du monde à laquelle on prétend dès lors que l’on connecte le verbal avec l’imagicité ? Et comment les relie-t-on, en vertu ou en fonction d’un bénéfice espéré en termes de meilleure intelligence ? Cette liaison ou ce lien-là porte un nom commun et connu : c’est une syntaxe, mot qui englobe à la fois un classement, une taxinomie fonctionnelle, et la manière de construire des modalités relationnelles entre des entités distinctes susceptibles d’être articulées en un même ensemble.
Le terme de syntaxe convient évidemment aussi bien à la grammaire conventionnelle qu’à la manière de concevoir un tableau classique (la syntaxe des formes et des couleurs chez Poussin par exemple) et qu’au langage des informaticiens.
De quoi est fait le fond des écrans sur lesquels trop souvent l’on semble fixer son attention ? D’une syntaxe, précisément, c’est-à-dire d’un corset, d’une structure contraignante capable de faire tenir ensemble du textuel avec de l’iconique – sachant que le texte n’est jamais lui-même sans offrir une forme visuelle ni l’iconique sans pouvoir discursif. La question de la syntaxe est centrale parce que c’est là que se joue et que se localise empiriquement la constitution de ce que Philippe Ortel ou Bernard Vouilloux appellent des « dispositifs »48, c’est-à-dire des constructions à la fois techniques, sociales et symboliques.
Si, à nos yeux, la photolittérature présente un intérêt majeur pour envisager l’évolution de la littérature même, c’est qu’elle doit permettre de penser tout un ensemble d’évolutions techniques, sociales et symboliques qui reposent sur des dispositifs permettant des liaisons et des déliaisons, des connexions et des déconnexions, viser à constituer une intelligence individuelle et collective de notre monde, une visée politique, dans l’acception de Rancière.
Pourquoi, à présent, s’intéresser à ce roman de Reinhardt Jirgl, Le Silence ?
D’abord parce qu’il s’agit d’une fiction. De la modélisation de notre commerce avec le monde qui nous entoure, et dont les bénéfices se mesurent à l’accroissement possible de notre intelligence de nous-mêmes et d’autrui : c’est la définition même de l’activité mimétique, telle que la pose notamment Jean-Marie Schaeffer : toute représentation est un mensonge de principe, mais dans le cadre concerté d’une feintise partagée, ludique et productrice d’un modèle d’intellection, de pénétration du monde, et finalement d’action sur lui49.
Ensuite, parce que ce roman met au premier plan les questions de syntaxe ; si bien que, quoique conçu sous la forme traditionnelle du codex, il propose des configurations syntaxiques qui ont le double avantage de faire le pont entre l’écriture conventionnelle et le régime numérique, et de neutraliser les effets d’« ivresse » de la nouveauté envers le support électronique – voir la citation de Jacques Morizot en exergue de cet article.
La fiction intitulée Le Silence repose sur la relation d’un voyage qu'effectue en Allemagne, en 2003, un vieux médecin retraité, Georg Adam, souhaitant remettre à son fils Henry un album de photographies anciennes, agencé par sa belle-mère de manière désordonnée, et que lui a remis sa sœur, Felicitas Adam. Affaire donc de legs, d’héritage familial, de proposition de lecture ou de décryptage d’une histoire tant privée que collective : l’on est tout à fait dans la logique générique instaurée par l’album de photos de famille, telle que magistralement décrite par Anne-Marie Garat :
Sous son dehors normé et ses récits rituels, l’album cèle un récit violent, d’amour et de mort : l’album familial s’écrit en chambre noire. Car la photo de famille […] convoque l’origine, la filiation, l’appartenance et l’identité. Hantée par le secret, l’absence et la présence – leur puissance imaginaire –, elle établit un des liens les plus intenses avec l’histoire privée et l’histoire collective, dont le souvenir mué en fiction se construit à travers ces images, investies du pouvoir d’invoquer les fantômes 50.
Illustration 1 : chapitre 45, incipit, photo 100
(avec l’aimable autorisation des éditions Quidam)
Aucune photographie n'est reproduite matériellement, pas même en couverture, mais c'est l'organisation même de ce roman qui mime ou calque la forme-sens de l'album, puisque tous les sous-chapitres portent le numéro et le titre d'une photographie, décrite mais jamais représentée. Des renvois à d'autres numéros de photographies, antérieures ou postérieures, permettent de respecter dans les grandes lignes la visée d'une reconstitution chronologique, tout en projetant l’imaginaire d’un réseau interne et invisible, interconnectant les cent images de ce corpus. En face de chaque numéro de photographie, soit à l’entame d’un nouveau chapitre soit in texte, l’on trouve une ekphrasis en italiques, transposant en texte la scène et les personnages représentés (voir illustration 1).
La chronique dont il est question, c'est celle de l'Allemagne du xx au xxie siècle, de la première guerre mondiale à l’après réunification, au prisme de l'histoire croisée de deux familles, la lignée prussienne Baeske et la lignée Schneidereit, de Lusace, près de l’actuelle République tchèque. Un arbre généalogique est en toute fin d'ouvrage : c’est important, bien entendu, car les filiations et les alliances sont en un sens un diagramme, une image projetée des liens, des liaisons – ne convient-il pas d’écrire : des inputs et des outputs ? – entre des personnages noués les uns aux autres, et dont des instants de vie épars sont figurés sur les photographies de l’album. Mais à la différence de l’arbre figurant chez Zola les Rougon noués aux Macquart – qui modélise la croissance d’une lignée et le développement de ses potentialités psychologiques, positives ou négatives – chez Jirgl, il projette plutôt les connexions biologiques et historiques d’une famille qui, en dépit des liens ainsi objectivés entre ses membres, ne parvient pas à former un sujet collectif homogène ni à faire sens. Chez Zola l’on avait le portrait d’une famille montrant la vie sous le Second Empire ; ici l’on aura formellement un album de famille – c’est la fonction des 100 photographies qui scandent les 45 chapitres – qui non seulement ne sont pas montrées, mais qui dissimulent une multitude de secrets de famille, de non-dits, de micro-récits éparpillés entre l’intime et l’historique. Les traits reliant, sur l’arbre, les noms de personnes devraient formaliser une nécessité historique ; or, ces traits opèrent plutôt comme des déconnexions que comme des signes d’implication.
Dès le début s’énonce une situation biaisée : Henry – à qui est destiné l’album énigmatique et lacunaire que lui apporte son père Georg – est en réalité le fils incestueux que ce dernier a eu avec sa sœur, Felicitas. Georg a fait passer Henry pour le jumeau de Corinna, la fille que sa femme Henriette et lui ont eue par ailleurs. Tel est le biais fondateur : l’inceste interdit, mais accompli. Aussi bien, le mot « fils » sera-t-il constamment typographié entre guillemets lorsqu’il s’agira d’Henry. Ce dernier sera donc un fils entre guillemets, façon de relativiser bien entendu la filiation officielle.
Le roman ne repose donc pas sur le modèle dramatique de l’intrigue : si le récit consiste pour l’essentiel en une longue conversation nocturne et avinée entre père et fils, il ne s’agit même pas de se dire enfin la vérité, ni de parvenir à une forme de pardon, car le dialogue est en permanence gangréné par des sortes de sous-conversations, des monologues intérieurs transcrits en italiques et émis par des consciences dont les discours sont inextricablement un moyen de communiquer vers l’extérieur et une façon de se réfléchir eux-mêmes, sans véritablement pouvoir énoncer ce qui serait le « fin mot » de l’histoire. La typographie – dont le lecteur courant a oublié depuis longtemps qu’à sa manière elle institue le texte même en image51, elle instaure son imagéité – est traitée dans l’ensemble du roman comme un moyen, au niveau de l’énonciation, de matérialiser les connexions et déconnexions de ces voix narratives emmêlées, et, pour le lecteur, de formaliser les interrelations, les liaisons et déliaisons qu’il doit poser face à un texte qui est lui-même devenu en quelque sorte une image de texte.
En principe, l’album de famille devrait permettre au moins de restituer une unité, fût-elle basée sur les images des seuls moments heureux ; or au milieu de l’album de cette famille dont toute la vie fut « construite sur la haine52 » figure symboliquement une photographie arrachée, datant de la première guerre mondiale, qui est matérialisée dans le roman par une page noire sur laquelle s’inscrit en blanc la litanie de toutes les « inaptitudes53 » (à la vie, à l’amour, à la joie…) qui ont marqué ces générations successives.
Pourquoi n’avoir fait figurer aucune photographie ? L’obstacle n’était nullement matériel, car même si l’album est évidemment imaginaire, le recours à une photothèque historique eût aisément résolu cette difficulté. C’est, d’une part, parce que la forme générique de l’album de photos, loin de susciter vraiment le souvenir, met au contraire en avant l’idée d’absence, de fantôme, de disparition ; et c’est d’autre part une manière de contraindre le lecteur à faire appel à son propre album, de l’inviter à connecter son acte de lecture avec sa propre photothèque imaginaire, tant il est vrai que désormais chacun d’entre nous dispose d’une gigantesque iconothèque mentale dans laquelle documents et clichés nourrissent des identités personnelles et collectives où sont emmêlés les vrais et les faux souvenirs constituant nos mémoires. Ces images absentes sont exemplairement des « images pensives », en ce qu’elles en appellent conjointement à divers régimes différents, voire peu compatibles, esthétiques et référentiels, documentaires et symboliques.
À la fin du tout dernier chapitre, numéroté 45 (voir illustration 2), qui est intitulé par contrepied « Pas d’épilogue », on est renvoyé par une flèche [–>] à la photographie 58, qui datait d’avant 1916 et représentait l’inauguration d’un monument militaire en plein champ tandis que l’ultime mot du texte est disposé comme s’il avait une valeur lexicale mais celle d’une signature : « Le Silence ». C’est dans le Silence majuscule du blanc terminal que se confondent le titre du livre et la fin d’émission de la voix narrative chargée de porter le récit familial, dans la parfaite logique d’une double entreprise de déconstruction, celle du lyrisme et celle du récit épique.
Illustration 2 : chapitre 45, dernière page
(avec l’aimable autorisation des éditions Quidam).
L’ultime photographie du dernier chapitre – elle est censée représenter les supposés « “jumeaux” Corinna é: Henry », assis sur une luge lors de vacances d’hiver en 1970 – est numérotée « 100 », c’est-à-dire un nombre clôturant la numérotation décimale standard, ce qui marque évidemment le caractère formel et arbitraire de la relation entre le nombre des images figurant dans l’album et est probablement un indice du caractère symbolique de l’ensemble de ce récit, puisque celui-ci est certes porté par une intentionnalité, mais est en quelque sorte sans fin ni terme : cette mémoire est aussi chaotique que le sens global est informulable. Les images absentes – le recours à un régime iconique in abstentia – ne font qu’obscurcir et dramatiser l’énigme initiale du non-dit, de ce « Silence » qui est l’origine et l’horizon du roman, circulairement.
Au-delà de ce dispositif singulier, littéralement sidérant est le travail linguistique et stylistique accompli par l'auteur (et sa traductrice, Martine Rémon) de cette fiction, qui génériquement s’inspire du modèle romanesque visant à restituer la saga d’une famille dont l’existence coïnciderait avec l'histoire collective. Mais Reinhardt Jirgl, prenant à rebrousse-poil les grands modèles littéraires germaniques (Mann, Musil, Broch…), invente quasiment une syntaxe qu'on pourrait dénommer « numérique », ou cybernétique : il prend acte de l’impossibilité de construire une mémoire tabulaire commune, il casse et recompose tous les éléments standards du discours, de la phonétique à l'orthographe.
Ce sont :
- Des expressions combinées grâce à des signes : « entre=les=mains »
- Des majuscules à valeur singulative : « Autre Homme » ; « Cette Personne »
- Des tirets entre un nom et un adjectif, un article ou un adverbe : « l’homme-sauvé » ; « après-la-guerre » ; « la-Guerre »
- L’agglutination : « Desmortsenpagaille » ; « Myriadesdecombattants=Sanstravail »
- Des points d’exclamations avant un mot : « !idiote »
- Des conjonctions de coordination « et » remplacées par « é », « è » ou l’esperluette « & »
- Des changements de police, onciale ou gothique Baeske continuent de servir
- L’insert de flèche → en début de paragraphe pour indiquer un renvoi à une photo ou une reprise du récit.
Il ne s’agit là que de quelques exemples, dont les deux pages reproduites dans cet article ne donnent qu’une idée approximative. Une telle écriture ne relève absolument pas, en termes de méthodologie critique, des visual studies, ni de l’intermédialité sur laquelle travaille par exemple Liliane Louvel54. En réalité, l’on n’a pas affaire à un plan du texte au sein duquel viendraient interférer des références à un plan de l’image, et encore moins à des illustrations véritables en marge du texte bien entendu, mais bien davantage à ce phénomène évoqué plus haut par Roger Chartier, à une sorte d’équivalent d’écran dans lequel – car ce texte, tel qu’il est matériellement écrit, est lui-même perçu comme une quasi image, il fait lui-même image – le lecteur serait confronté à une sorte de pliure permanente du texte sur l’image et réciproquement. L’on pourrait dire que Reinhardt Jirgl travaille la syntaxe selon un modèle neurologique, à la fois au niveau global de sa fable, tout entière faite de liens tantôt imputés tantôt débranchés, et au niveau le plus fin du lexique, de la ponctuation aussi bien que de toute la prosodie.
Dans le contexte actuel, il est tentant de faire le rapprochement avec l’écriture dite « inclusive », à cause de cette prolifération de signes parasites. Sa promotion relève du reste de ce qu’il est convenu d’appeler le « féminisme 2.0 », en référence précisément à l’outil numérique. Par-delà le désir de féminiser les noms de métiers, lequel ne porte en soi nulle vindicte envers la langue elle-même, il s’agit de faire disparaître toute marque de genre grammatical (confondu avec le sexe) voire de nombre (le singulier étant suspect de singularisme) : ainsi Sam Bourcier, militant queer, propose-t-il de remplacer l’S ou le X du pluriel par des astérisques : « fabuleu*, étudiant*, militant*55 ». L’écriture inclusive comprend en son acception la plus platement littérale un axiome imprudemment formulé par Roland Barthes – « La langue est fasciste »56 –, et réinvente en toute bonne conscience une novlangue, au sens exact où Orwell la définit : un outil de domination, toujours pour une « bonne cause » selon ses séides. Bien entendu, qu’un grammairien du siècle des Lumières ait donné à l’accord prédominant masculin une justification idéologique (la prévalence de l’homme sur la femme) est à strictement parler une bêtise ; mais le contraire d’une bêtise est rarement une vérité, et plus souvent une autre sottise. De fait, la pratique de l’écriture inclusive tend à ne servir que de gimmick de reconnaissance entre militants, s’inversant en signe d’exclusion de toutes et tous les non-conformes…
Reinhardt Jirgl fait exactement le contraire de la novlangue inclusive ; du reste, il perçoit l’histoire de l’Allemagne comme engluée dans une série de couches de novlangues successives, celle du militarisme impérial, celle du nazisme, celle de la ErDéa (RDA) et du « saucialisme ». La métaphore de la « sauce » ainsi connectée au concept de « socialisme » montre assez clairement en quoi son entreprise littéraire va à contre-courant des idéologies, dont Barthes disait que par définition elles étaient toutes « dominantes ». Ses propositions de re-segmentations conceptuelles fonctionnent comme des inputs et des outputs. Jirgl ne se repaît pas de la bêtise : il est dans une entreprise de remédiation par la fiction, écrivant par exemple :
La voix de mon « fils » a le ton objectif d’1 mécanicien tenu de consigner l’ensemble des dégâts sur une machine, la machine-Famille. L’album de photographies posé sur la table à côté de la réplique d’une petite lampe à huile antique en terre cuite, les regards d’Henry s’en emparent à nouveau, puis enfin ses mains, avec précaution, comme si sous leur prise les photographies collées menaçaient de tomber en poussières de particules scintillantes, faible lueur de gènes-é-rations –.– 57
Loin de recharger ce que la langue a de normalisant, de contraignant, d’une part Reinhardt Jirgl la nettoie des sens figés – il me semble par exemple que la substitution du chiffre 1 à l’article « un » a valeur de question posée envers la notion d’individu dans le contexte d’une lignée ou d’un groupe – ; et, d’autre part, il redéploie le paradigme sémantique et axiologique en objectivant la composition étymologique d’un mot valise comme « gènes-é-rations », dans lequel les rations des soldats des diverses guerres font écho à la lourdeur d’un héritage génétique impossible à porter.
Il ne s’agit pas de dénoncer bêtement l’arbitraire orthographique ou grammatical, mais de s’en servir, tel qu’il est, pour réaliser une sorte de pliure du plan de l’énonciation avec celui des représentations. Cela s’appelle de l’ironie. C’est à la fois un nettoyage résolu des clichés et une manière de revigorer l’envie même de recourir aux mots et à la langue pour vivre, comme le fit par exemple Francis Ponge, dans Les Écuries d’Augias ou La Fin de l’automne. Ponge avait en ligne de mire la rhétorique et ses conventions figées, qui brouillent notre intelligence des choses élémentaires, et que seule une immersion dans les mécanismes de la langue peut contrecarrer. Reinhardt Jirgl quant à lui confère aux automatismes de langage, et aux images qui l’innervent sans que nous les contrôlions, une dimension proprement technologique – il évoque le « monde comme système cybernétique58 » –, et il situe ces automatismes à l’intersection du biologique et du social, c’est-à-dire précisément là où se jouent depuis une trentaine d’années déjà les questions relatives à l’ère numérique en tant qu’elle est aussi celle de l’intelligence artificielle.
Il serait possible, après tout, de proposer une approche freudienne de la fable intitulée Le Silence, reposant sur la prohibition de l’inceste : la mise entre guillemets du « “fils” » serait en somme la scène fondatrice de tous les autres dérèglements des signes. Mais en tout état de cause, il n’y a nul formalisme dans la syntaxe en apparence ténébreuse et chaotique de ce roman, et la mise entre guillemets de cet « input » originel qu’est la filiation paternelle ne représente qu’un élément parmi bien d’autres justifiant, pour en faire des « images pensives », de recourir à l’ensemble des signes diacritiques dont nous disposons sur le clavier (=, +, -, /, :, ; =>, &, @, …). C’est en réalité la totalité de la chronique de cette Allemagne (ou ces Allemagnes) qui s’avère fondée sur un écheveau gordien de non-dits et d’indicibles, nécessitant de retramer l’ensemble des liens, des chaînons, des connexions. Car au bout du compte, et comme l’avait écrit – voir plus haut – Jérôme Thélot à propos de L’Ève future de Villiers, les inputs et outputs dont nous parlons selon un point de vue, malgré tout, quelque peu formaliste ou abstrait, doivent aussi être compris comme autant d’éléments appartenant à la Vie même. Nos ADN sont des écritures ; nous sommes en un sens les « images » de nos parents, et au-delà dans la chaîne généalogique. Dans sa Chambre claire, Barthes évoquait le singulier trouble vers lequel incline la contemplation d’une photo de famille : la confusion entre le réel et le vivant. Avec l’ère numérique, dont les applications ne sont pas exclusivement photographiques et littéraires, ce sont aussi, et peut-être surtout, ces questions de pouvoir sur le vivant qui se posent selon une nouvelle donne et avec d’autres soucis.
Dans les tout derniers chapitres du Silence, on apprend qu’après la mort d’Henry, en 2006, son père Georg, le médecin retraité, devenu aphasique à la suite d’une blessure à la tête, s’adonne à la photographie, mais de la « photographie non organique59 », sans représentation humaine ni animale, même lorsqu’il fait des « portraits » (grâce à un long temps de pose, les personnages vivants disparaissent) :
?Comment Georg était-il parvenu à obtenir avec ses photographies ce que même Leseigneur=Dieu n’avait su accomplir avec Son déluge : la terre de nouveau indemne d’hommes&bêtes60.
Il s’agit de photographies des alentours de la maison familiale de Thalov, en Lusace, que la compagnie minière de lignite est en train de faire disparaître. Ce sont cette fois de « vraies » photographies, dans le style du photographe japonais Naoya Hakateyama, est-il précisé dans les notes terminales.
Nous disions plus haut que l’ambition littéraire de Reinhardt Jirgl relevait de l’ironie, non de l’idéologie ; cela ne signifie pas qu’elle ne soit nullement teintée de représentations connexes ni de propositions de contre-valeurs. En l’occurrence, ce sont probablement ces photographies de Naoya Hakateyama, mentionnées par la note 55, page 611, qui nous donnent la tonalité éthique et esthétique de ces contre-valeurs : entre le sublime des ruines et le tragique apocalyptique, auquel il faudrait résister comme à la pire des tentations.
Finalement, il semble que ce soit à l’œuvre de ce photographe japonais qu’il faille se référer pour accomplir jusqu’à son terme le processus de mimésis de l’histoire allemande tel que ce roman, Le Silence, l’a institué… Il est vrai qu’à la différence des 100 photos de l’album de famille sur lequel il est construit, les admirables photographies que Naoya Hakateyama a prises des houillères de Westphalie sont disponibles en librairie61. Ultime forme de pliure, de pensivité ; ultime output…
***
Finalement, Le Silence de Reinhardt Jirgl, pour n’être qu’un livre sans illustration photographique, n’en est pas moins pleinement une œuvre photolittéraire de l’ère numérique, et ce sur un mode d’autant plus intéressant qu’il est celui de la mise en abyme, à deux niveaux.
D’une part, quoiqu’elle utilise le support classique du livre, cette œuvre fait fonctionner la syntaxe verbale comme un écran, en ce sens qu’elle met à distance, au sens brechtien, le caractère radicalement arbitraire des signes de nos langues, et qu’elle souligne en permanence l’écart irrémédiable entre les mots et les choses qui fonde la possibilité même d’une pensée symbolique. Car sauf pour les activistes de l’Empire du Bien, il n’y a pas de « bonne syntaxe », qui serait conçue pour générer de « bonnes » relations entre les êtres humains : c’est à un silence de mort que conduit l’idée – chimérique ou totalitaire – que nos systèmes symboliques pourraient coïncider avec notre expérience du monde et ainsi la rendre heureuse. Le Silence de Reinhardt Jirgl est, quant à lui, du côté de la vie, y compris bien entendu en soulignant presque à chaque page son caractère éminemment tragique.
Mais œuvre numérique d’autre part, parce que, sans se contenter de disposer objectivement cette configuration syntaxique en forme d’écran, elle nous invite, nous lecteurs, à nous connecter à nos autres systèmes symboliques, non seulement à nos albums mentaux et imaginaires où sont collectées désormais toutes nos photographies familiales et historiques, mais encore, à nous « brancher » sur nos ordinateurs pour y consulter les photographies prises par Naoya Hakateyama, qui, contrairement aux photographies de nos albums, ne regardent pas vers la passé mais en direction de l’avenir, selon une forme de reportage prémonitoire que nombre de photographes pratiquent à présent, en particulier face aux paysages industriels62. Il ne s’agit pas du tout de laisser entendre que les photographies d’un japonais contemporain représenteraient un système dénué d’arbitraire ni de convention – il n’y en a pas –, ni que la dimension visuelle serait en quelque sorte la référence ultime et seule « vraie » de notre expérience du monde, mais de rebondir d’un mode de fiction sur un autre, de faire jouer l’un avec l’autre le verbal et le visuel en tant qu’ils sont deux modalités de l’activité fictionnelle, celle grâce à laquelle nous construisons notre réalité, par tâtonnements successifs et corrections infinies.
Ce qui a changé, probablement, avec le numérique, c’est l’accentuation de l’hésitation entre fiction et non-fiction, la fragilisation du vrai, la prolifération des contrevérités, soit ludiques soit fantasmatiques, qui dès la fin des années 1960 n’ont pas échappé notamment à Elsa Triolet, dans ce roman intitulé Écoutez-voir63, qui selon moi est déjà une réflexion sur la confusion entre le réel et le vrai (notée aussi par Roland Barthes) telle qu’elle pointait déjà avant même l’ère numérique. Mais ce qui ne change pas, ce sont deux faits majeurs. D’une part, que la matrice fictionnelle demeure la forme canonique de la modélisation et du partage de nos expériences du monde ; et d’autre part que l’activité consistant à nettoyer nos représentations et nos langues des clichés qu’elles charrient ne s’appelle pas la « communication », mais la littérature, laquelle est l’absolu contraire d’une novlangue, la langue littéraire étant celle grâce à laquelle les sujets parlants prennent à bras-le-corps le caractère « radicalement arbitraire » (Saussure) des signes dont ils usent, grâce à l’humour, à l’ironie, à l’usage du second degré, fût-ce pour mieux souligner que ces jeux ont pour fond d’écran une image tragique.