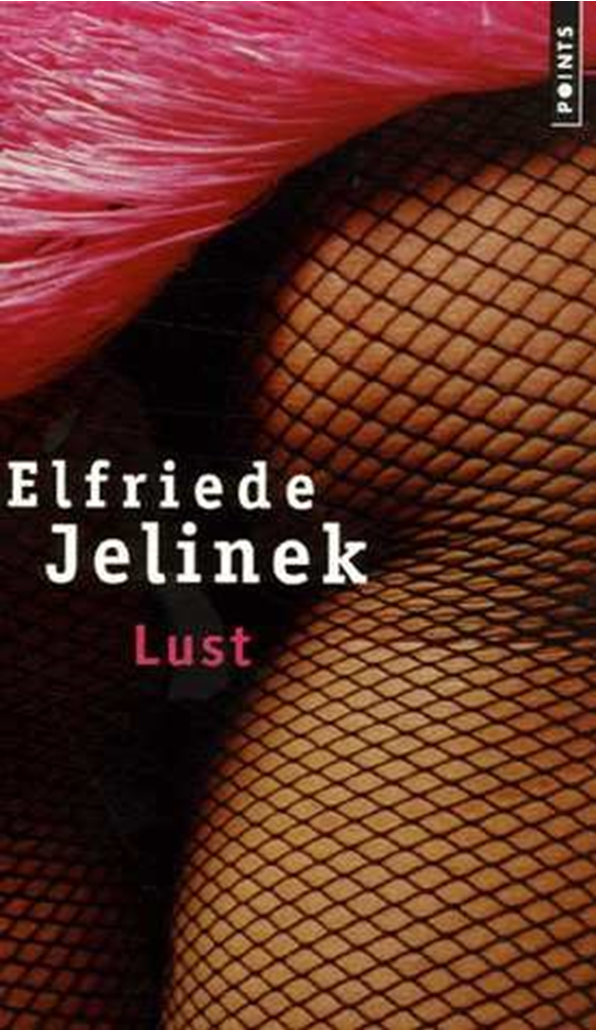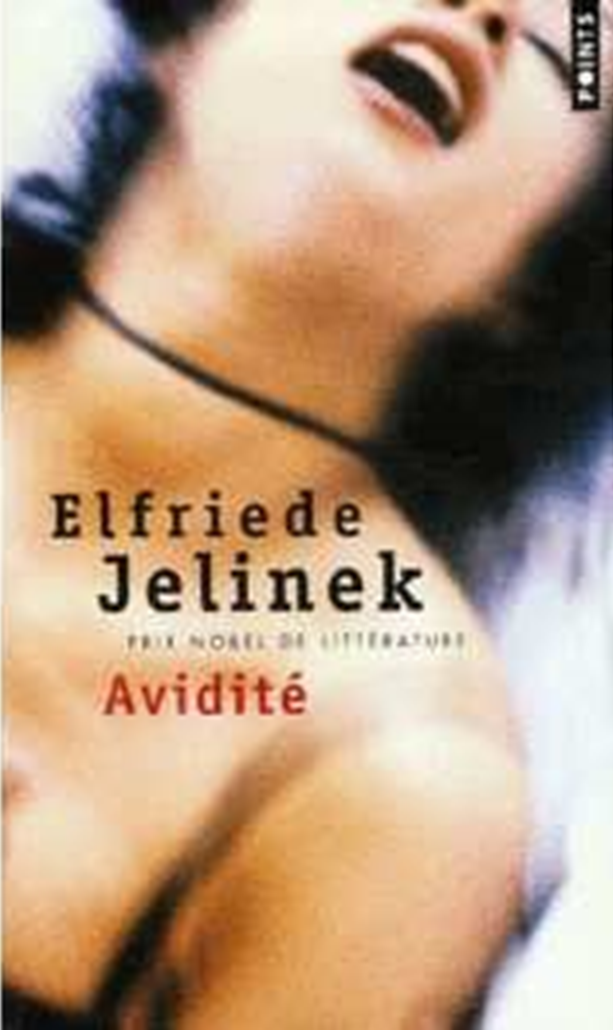La relation d’Elfriede Jelinek à la France est ambiguë et pleine de contradictions. Son premier contact avec le français a eu lieu lors de sa quatrième année, alors qu’elle est placée dans un jardin d’enfants viennois de la congrégation Notre Dame de Sion, où elle apprend à parler et à prier en langue française. Son rapport au français ne se présente pas sous les meilleurs auspices dans cet établissement, où elle subit une discipline de fer qu’elle qualifiera, plus tard, d’épouvantable et de moyenâgeuse1. Elle continue pourtant à entretenir une relation particulière avec le français en faisant des traductions vers l’allemand ou encore en prenant régulièrement position dans le débat public français. En 1999, l’auteure dénonce la décision de l’Opéra de Strasbourg d’annuler cinq représentations de La fête de l’agneau bêlant, conçu avec Olga Neuwirth, alors même que l’institution avait investi quatre millions de schilling autrichiens dans ce projet2. En 2006, elle réagit à « l’affaire Handke » en se prononçant contre la censure de son œuvre à la Comédie Française à cause de ses positions proserbes. De même qu’elle avait attaqué le sombre passé du Burgtheater à Vienne, haut-lieu du théâtre de langue allemande, Jelinek reproche à l’institution française de s’inscrire « dans la pire tradition de ces institutions culturelles qui, au temps des dictatures, mettent au rancart les artistes gênants et les condamnent au silence3 ». Peut-on y lire un appel direct de la prix Nobel de littérature (2004) à réviser le répertoire de la Comédie Française ?
L’intérêt de l’auteure viennoise pour certains intellectuels et écrivains français, dont la lecture a pu marquer sa formation intellectuelle, se manifeste à l’intérieur de son œuvre où les allusions à Barthes, Bataille, Baudrillard, Artaud, Camus ou Sartre foisonnent – un héritage qui n’est pas dénué de signification, et dont elle ne se cache pas. On notera que les écrits du structuralisme et du poststructuralisme jouent un rôle non négligeable. Quels sont les enjeux principaux de la réception par Elfriede Jelinek des intellectuels français et, inversement, comment appréhender la réception de l’auteure viennoise en France ? Dans notre étude, qui se situe au carrefour de l’esthétique de la réception et de la sociologie de la littérature, nous présenterons la réception des auteurs français dans l’œuvre d’Elfriede Jelinek ainsi que de son implication en termes de modèle d’importation, avant d’interroger la réception de l’auteure viennoise en France.
Le dialogue avec les auteurs français
À maintes reprises, Elfriede Jelinek exprime, en sa qualité d’artiste engagée contre la société de consommation, son admiration pour certains intellectuels français tels que Roland Barthes, Pierre Bourdieu ou Guy Debord, dont elle questionne, reprend ou contrecarre des concepts littéraires, sociologiques et politiques. Son œuvre romanesque et dramatique est également nourrie de lectures d’écrivains français que nous sommes tentées de subsumer sous la catégorie d’« enfants terribles » de la littérature française : il s’agit notamment du Marquis de Sade, de Georges Bataille ou encore d’Antonin Artaud. De même, la recherche universitaire française et germanophone tend à lire l’œuvre d’Elfriede Jelinek à la lumière de quelques penseurs notoires qui ont marqué la France du XXe siècle, comme Derrida, Greimas, Lacan ou encore Barthes. Il nous semble donc opportun d’interroger à partir de quelques exemples la nature et les limites de ce dialogue entre l’intelligentsia française et l’auteure autrichienne. Que révèle-t-il de l’auctoritas4 d’une auteure contestée en sa patrie et dont l’œuvre est principalement interprétée et lue à l’étranger ?
Elfriede Jelinek traductrice du théâtre de boulevard
Avant d’évoquer les auteurs français qu’elle cite, on peut mentionner ceux qu’elle traduit. Entre 1983 et 1997, elle s’intéresse à deux auteurs incontournables du théâtre de boulevard français : Georges Feydeau, dont elle traduit quatre pièces : Monsieur chasse ! (1983), Le dindon (1986), La puce à l’oreille (1986), La dame de chez Maxim (1990) et la nouvelle La mi-carême (1997), ainsi qu’Eugène Labiche, dont elle traduit L’affaire de la rue de Lourcine et La poudre aux yeux en 1988. N’étant, au début des années 1980, qu’une écrivaine en marge du champ littéraire, Jelinek décide, avec son éditrice Ute Nyssen, de traduire des pièces françaises dont la tonalité et la thématique rejoignent sa propre conception esthétique du théâtre. Ces traductions lui ont finalement permis de se faire connaître sur les grandes scènes allemandes, tout en gagnant sa vie, « puisqu’on joue toujours les pièces de Feydeau dans les grandes salles de spectacle5 ». Ce n’est pourtant pas la seule motivation de l’auteure car, selon elle, « [i]l faut prendre un peu de plaisir […] à ce que l’on traduit !6 ». Sa pratique de « sur-traduction » (« Über-Setzung ») – renvoyant à la fois à la traduction et à la trans-position au sens d’une refiguration du texte original – lui permet notamment de faire avouer aux mots les non-dits et sujets tabous d’une société sclérosée, une pratique d’écriture qui lui est propre. En ce sens, c’est bel et bien la transposition d’une langue vers une autre qui l’intrigue. « Traduire », dit-elle, « est comme remuer dans l’eau : ce qui semblait d’abord couler de source devient soudain trouble et limoneux7 ». À l’époque, la critique souligne d’ailleurs le caractère caustique et hypertrophique de sa langue. Plus tard, Jelinek concède avoir été interpelée par la représentation schématique de la femme, notamment celle de l’épouse, dans la société foncièrement patriarcale et bourgeoise dépeinte dans ces vaudevilles8. Par ailleurs, le genre du vaudeville va influencer sa propre écriture, notamment pour la conception de la pièce Restoroute ou l’École des amants, récemment traduite en français9, dans laquelle Jelinek revisite le libretto éponyme de Mozart Così fan tutte tout en le persiflant. Depuis quelque temps, on s’intéresse davantage à Elfriede Jelinek en tant que traductrice d’œuvres françaises10. Dans sa thèse, Béatrice Costa analyse l’influence du vaudeville français sur l’écriture de Jelinek par-delà la postmodernité de ses textes qui semble a priori l’en éloigner, tandis que l’étude de Birgit Oberger est centrée sur la traduction du Juif de Malta (2001)11. Cette dernière met également en lumière les procédés de transposition linguistique mis en place par Jelinek, tout en élaborant une théorie plus générale sur la traduction des textes de théâtre et de leur transposition sur scène. Les théâtres germanophones montrent un engouement pour certaines traductions de Jelinek, parmi lesquelles L’affaire de la rue de Lourcine, une commande de la Schaubühne à Berlin, qui demeure aujourd’hui encore l’une des traductions les plus jouées dans les théâtres de langue allemande.
Elfriede Jelinek et le poststructuralisme
La réception de la littérature française par Elfriede Jelinek ne se réduit pas à la traduction des comédies légères. Bien au contraire, ses œuvres, qui recèlent de nombreuses citations d’hypotextes français, entrent en dialogue avec une multitude d’auteurs de l’Hexagone qui ont marqué la théorie et l’histoire littéraire, ou bien encore la pensée philosophique12. Dès les années 1970, Jelinek s’intéresse au structuralisme et la sémiologie française. C’est notamment l’avènement du concept de l’intertextualité et des théories sur la productivité du texte qui a influencé son écriture. Pour mieux comprendre comment Elfriede Jelinek travaille sa langue et son écriture, il semble en effet judicieux de se référer aux travaux du sémiologue français Roland Barthes, qui a eu une influence décisive sur notre auteure, comme l’ont souligné de nombreux travaux13. À la fin des années soixante, la lecture de l’essai Mythologies (1957) constitue une césure dans le parcours artistique d’Elfriede Jelinek. Roland Barthes y expose sa conception du « mythe » et propose une grille d’analyse. Sa compréhension du mythe est avant tout issue d’une démarche sémiologique qui « s’assume comme une sémioclastie14 ». Elfriede Jelinek reprend à son compte le combat contre le mythe en tant qu’« outil idéologique qui empêche l’accès à la connaissance » et qu’« instrument de pouvoir pour la classe dominante15 ». Dans son essai l’Innocence sans fin16, elle revisite les thèses marxistes de Roland Barthes au sujet de la société de consommation et de spectacle qui fabrique ses propres mythes par le biais de la télévision et de la publicité. L’impact des nouveaux médias et des moyens de communication dans la vie quotidienne, thème récurrent dans les textes de Jelinek, contribue à forger un nouveau programme esthétique, formulé dans son essai Je voudrais être légère17. Si la recherche se focalise d’abord sur le potentiel démythifiant des premiers textes de prose comme Michael (1972) ou Les amantes (1975), on s’accorde aujourd’hui sur le fait que l’œuvre de la prix Nobel peut être lue dans son ensemble à l’aune du programme barthésien de la déconstruction des mythes. L’auteure insiste d’ailleurs elle-même sur cet héritage qui la distingue de son compatriote Thomas Bernhard ou encore de Robert Walser18.
Répondre et relire. L’exemple des Exclus et de Lust
Le dialogue de la prix Nobel avec ses homologues français peut prendre différentes formes dans son œuvre, comme nous souhaitons le montrer à l’aune de deux exemples particulièrement significatifs. Le titre allemand du roman Les Exclus (Die Ausgesperrten, 1985), propose un jeu de mot avec celui de la pièce de Sartre Les Séquestrés d’Altona, traduit par Die Eingesperrten. Un « écho déformé », comme l’écrit Yasmin Hoffmann19, non seulement à la pièce française, puisque Jelinek écrit un roman, mais aussi aux concepts philosophiques qui y sont en jeu. Le roman met en scène un existentialisme mal interprété, utilitariste et intéressé, en vogue dans les années d’après-guerre, allant de pair avec la mode zazou20. Ainsi Jelinek aborde la question du détournement et de la falsification de la pensée sartrienne résultant des pratiques de vulgarisation des médias et d’une lecture superficielle par le grand public. Elle dénonce également le travail des traducteurs, au service, selon elle, d’une politique culturelle réactionnaire21. Au-delà de la relecture des œuvres philosophiques et dramatiques de Jean-Paul Sartre22, le roman comporte de nombreuses allusions aux œuvres majeures d’Albert Camus, du Marquis de Sade et de Georges Bataille. C’est justement en réponse à l’Histoire de l’œil de Georges Bataille qu’Elfriede Jelinek construit son antiroman pornographique Lust23. Elle souligne d’ailleurs à diverses reprises avoir voulu écrire « une sorte de contre-histoire24 » à cette œuvre. Un autre hypotexte du roman de Jelinek, non moins sujet à scandale, est le récit sadomasochiste Histoire d’O. de la Française Anne Desclos, publié sous le pseudonyme de Pauline Réage25. Ce texte pose les jalons d’une littérature érotique où la soumission inconditionnée de la femme est au cœur des intrigues. Notons que ces trois œuvres, celles de Bataille, celle de Desclos et celle de Jelinek, ont connu une réception journalistique marquée du sceau du scandale. La lecture des intellectuels français, de préférence transgressifs, s’inscrit chez Elfriede Jelinek dans le cadre d’une critique virulente de la condition féminine, non seulement dans le quotidien, mais aussi dans le domaine professionnel, littéraire et éditorial : « Mon projet n’était pas d’écrire un simple porno », commente l’écrivaine, « mais de produire une critique sociale comme l’ont fait Georges Bataille et le marquis de Sade. […] Je voulais tenter d’écrire une sorte de pornographie sociale […cependant] je n’ai pas pu écrire ce livre parce que c’est un livre impossible, parce qu’il n’y a pas de langue féminine pour dire l’obscénité.26 » D’après Françoise Rétif, le texte de Bataille traduit la dimension transgressive et paroxystique d’une langue et d’un art qui font de l’œil et, partant, du regard et du voyeurisme, un médium de la cognition (Erkenntnis) et d’une « transcendance négative27 ». Si l’œil, métaphore de la transgression par excellence, est, dans le roman de Bataille, au service d’une esthétique de l’obscénité, Jelinek prive l’organe visuel de ses attributs essentiels : pas plus qu’il n’accroît le potentiel érotique d’une situation, il n’apparaît comme l’organe de la transgression ; il devient au contraire source d’un dégoût froid et lucide. Reproduisant, renversant et dénonçant « la conception mythique de la sexualité » de Bataille, l’auteure montre que cette dernière reste prisonnière d’un système de valeurs traditionnelles28. Pour Jelinek, il n’y a pas de langue pornographique propre à la femme parce qu’elle ne dispose librement ni de son corps, ni de son désir. Son projet initial d’opposer une « contre-langue », une esthétique de l’obscène au féminin, à l’écriture pornographique de Bataille s’annule de fait pour s’incarner dans une anti-pornographie29.
Jelinek et Artaud
Dans le contexte de la lecture et de l’appropriation par Elfriede Jelinek d’un certain nombre d’œuvres et de théories françaises, on ne s’étonnera pas que la recherche universitaire franco-germanophone tende à lire l’œuvre d’Elfriede Jelinek à la lumière des penseurs et théoriciens français. Ainsi le travail monumental de Bärbel Lücke30 décortique les textes de Jelinek en s’appuyant sur la théorie du discours de Greimas et la méthode de déconstruction de Derrida. Sa thèse de doctorat, qui demeure une référence incontournable quant à la lecture (post-)structuraliste de l’œuvre de Jelinek, démontre l’impossible fixation du sens et le processus tripartite de construction, déconstruction et reconstruction d’une signification, moyennant le concept derridien de la « différance ». Sur le plan dramatique, on rapproche souvent l’esthétique de Jelinek du théâtre de la cruauté d’Antonin Artaud31. Bien qu’elle ne partage pas ses idées utopiques d’un théâtre capable d’éveiller chez son public les forces vitales et les valeurs humaines, ses nombreux essais théoriques ainsi que ses textes dramatiques ne cessent de remettre en question les mécanismes traditionnels du théâtre. « Je ne voudrais pas voir sur les visages des acteurs le reflet d’une fausse unité : celle de la vie », annonce l’auteure dans Je voudrais être légère, « [j]e ne veux pas animer des inconnus devant les spectateurs ». Sa devise est claire : « Je ne veux pas de théâtre32 ». En refusant catégoriquement tout théâtre mimétique, reproduisant la vie (sur scène) grâce aux artifices de l’art, Jelinek cherche à mettre en mots et en images les non-dits et les tabous d’une société sclérosée, bercée par ses illusions et douillettement installée dans son confort. À l’instar de la conception théâtrale d’Antonin Artaud de « l’irreprésentable33 », le théâtre de dénonciation d’Elfriede Jelinek abolit les frontières entre la scène et la salle, entre la réalité représentée et la réalité vécue, afin d’ouvrir et d’encroiser les espaces d’action et de réception. Dieter Hornig replace ce rejet du « dispositif mimétique du théâtre traditionnel » chez Artaud et Jelinek dans le contexte de « l’émergence de la modernité et [de] ses moyens mécaniques de reproduction du réel ». « La modernité », écrit-il, « voit le passage d’une esthétique classique de la mimésis, de l’analogie et de la ressemblance (qui relève de l’ordre de la métaphore) à une esthétique de la trace, du contact, de la contiguïté référentielle (qui relève de l’ordre de la métonymie)34 ». Elfriede Jelinek rejoint l’objectif du théâtre de la cruauté en ce qu’elle cherche à suspendre le voyeurisme passif, auparavant assuré par la présence du « quatrième mur ». Comme le souligne Susanne Böhmisch, « le spectateur d’une pièce d’Elfriede Jelinek « est aussi sollicité physiquement35 ». Ainsi Une pièce de sport36, mis en scène par Einar Schleef au Burgtheater à Vienne, se mue en une véritable expérience théâtrale, qui marquera durablement l’histoire du théâtre germanophone en mettant à l’épreuve aussi bien l’horizon d’attente du public que la patience du directeur de l’établissement37. Malgré l’apparente parenté des deux dramaturges, il y a des « différences fondamentales qui compromettent l’idée d’un théâtre de la cruauté fidèle à A. Artaud38 ». Böhmisch considère en ce sens l’esthétique jelinekienne comme « un prolongement » et « une sorte de réinvention de ce théâtre, sous l’effet du demi-siècle qui les sépare39 ». Elle constate trois convergences entre ces deux esthétiques : « la recherche d’un autre théâtre qui brise les catégories de la représentation et “chasse Dieu de la scène” ; la recherche d’un théâtre qui renoue avec la dimension physique du spectacle ; l’analogie entre la peste et le théâtre de la cruauté.40 » Cependant, le goût de l’humour noir, du sarcasme lucide, « l’alliance intime du rire et de l’effroi41 », l’emportent dans l’écriture (dramatique) de Jelinek qui, encore une fois, propose une relecture personnelle du projet théâtral d’Artaud et renonce à toute dimension sacrée du théâtre. Ses mises en pratique des théorisations de l’avant-garde française ne sont jamais pure reprise, id est une application stérile, mais des remises en question qui en approfondissent la teneur critique et le pouvoir subversif. En ce sens, l’œuvre de Jelinek dialogue avec ses homologues français plus qu’elle ne les répète ou commente.
Jelinek et Kristeva
Une référence également incontournable pour aborder l’esthétique d’Elfriede Jelinek est l’œuvre de Julia Kristeva qui, dès 1966, affirme en se référant au dialogisme défini par Bakhtine que « tout texte se construit comme mosaïque de citations », qu’il est, en quelque sorte, « absorption et transformation d’un autre texte ». La femme de lettres française remplace la notion d’intersubjectivité par celle d’intertextualité, puisque, selon elle, « le langage poétique se lit, au moins, comme double42. » Même s’il n’est pas certain que Jelinek ait découvert l’intertextualité par la lecture des œuvres de Kristeva ; son écriture, qui s’avère hautement intertextuelle, exploite jusqu’à la lie la citation et les renvois littéraires ou philosophiques. Elle réalise ainsi le programme poststructuraliste, appelant à rompre avec les conventions discursives et à libérer le potentiel subversif de la langue. Par ailleurs, la notion d’abject, développée par Kristeva dans Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection (1980)43, s’avère tout à fait productive pour la lecture des textes de Jelinek44 en ce que l’analyse de Kristeva « propose un cadre, un modèle ou plutôt une structuration psychique, voire un type de socialisation qui […] fournit des outils importants pour l’analyse des textes abjects et de la langue obscène45 ». C’est aussi sur la base de cette approche psychanalytique et littéraire de l’abject que Susanne Böhmisch a introduit dans la recherche jelinekienne le mot-valise de « l’abjeu » (composé des termes « abject » et « jeu »), à l’aune duquel elle analyse la pièce Maladie et femmes modernes d’Elfriede Jelinek46. Si l’abject représentait pendant des siècles la catégorie scandaleuse des beaux-arts et des belles lettres, à proscrire à tout prix, il devient pour la modernité une forme d’expression à part entière. En radicalisant et hypertrophiant la laideur, l’immonde et l’ignoble, l’abject parvient à provoquer chez le récepteur un nouveau sentiment esthétique, celui du « choc ». Aussi l’œuvre d’Elfriede Jelinek, marquée par l’omniprésence des liquides et textures molles de l’organisme humain, confronte sans cesse le lecteur à un univers malsain et répugnant. L’auteure fait ainsi une relecture lucide, subversive d’un Baudelaire ou d’un Céline, en déconstruisant la fascination illusoire qui émerge de cette esthétique du laid. Au cœur de l’écriture de Jelinek se trouve, en effet, l’aspect enjoué et subversif d’une esthétique « qui déplace la focalisation sur l’abject vers une logique du rejet [« Verwerfung »], qui découvre les structures du pouvoir tout en critiquant les représentations féministes47 ». En ramenant la notion à son étymon latin ab-jicere (littéralement rejeter, repousser, pousser en dehors ou loin de soi), Jelinek interroge la catégorie de l’abject tout en rendant problématique la lecture que Kristeva en propose. Son analyse (et sa pratique) de l’abject dépasse donc l’interprétation psychanalytique du concept (selon Kristeva, la dynamique de l’abjection se rapporterait au corps maternel), en ce que la prix Nobel l’investit dans un projet plus vaste de déconstruction des mythes, de relecture critique de l’austro-fascisme et de remise en question des associations courantes entre le corps féminin et la catégorie de l’abject48. Son opus magnum, Enfants des morts (1995) recourt ainsi au registre de l’abject pour mieux dénoncer les faux-semblants d’une société amorphe et amnésique.
À l’issue de cette brève présentation, on pourrait supposer que la réception des auteurs français par Elfriede Jelinek et la réception érudite de son œuvre à l’aune de concepts et de théories esthétiques françaises favorisent son accueil en France. Nous verrons, cependant, que la réception française de l’auteure reste ambivalente et pleine de contradictions.
La réception française d’Elfriede Jelinek
Lorsque paraît en 1988 la première traduction française de La Pianiste, la France fait alors partie des tout premiers pays où sont publiées des traductions intégrales de textes de Jelinek, bien que cette auteure ait commencé à écrire dès la fin des années 196049. Comment la France, ce pays décrit comme l’un des plus ouverts à la littérature étrangère et participant à la consécration d’auteurs étrangers50, accueille-t-il aujourd’hui l’œuvre d’Elfriede Jelinek ? La position et l’autorité d’Elfriede Jelinek en France se mesure à l’aune de sa réception par un ensemble d’instances de légitimation. Nous avons constaté une réception très inégale, intense dans certains milieux, mais lacunaire, hésitante51, voire quasiment inexistante selon qu’on l’observe au niveau éditorial, journalistique, théâtral, et universitaire, ou bien encore au niveau du grand public.
Traductions et politiques éditoriales
Depuis 2004, de nombreux ouvrages de présentation de l’œuvre d’Elfriede Jelinek et plusieurs portraits de l’auteure ont été publiés en France, ce qui la distingue dans la réception internationale. Roland Koberg, auteur d’une biographie en allemand52, nous faisait part à juste titre de son étonnement lorsqu’il avait constaté que les biographies préexistantes à son travail étaient toutes deux françaises53, de même que le livre d’entretiens avec l’auteure le plus récent à l’époque54. Ce regain d’intérêt pour l’auteure et la stratégie éditoriale qui l’accompagne fait suite à l’attribution du prix Nobel et s’inscrit dans le prolongement d’une politique de traduction de son œuvre. Ses romans sont presque tous disponibles en français, et c’est d’ailleurs dans notre langue que Jelinek a le plus été traduite quantitativement parlant55. Ses romans ainsi qu’une pièce de théâtre ont été réédités en livre de proche avant même le prix Nobel, et dès 1993 pour La Pianiste, une réédition rapide censée lui assurer une certaine longévité en librairie56. Peut-on pour autant aller jusqu’à dire, comme le fait la germaniste Valérie de Daran en 2010, que « [d]epuis plus de deux décennies, les grands Bernhard et Jelinek obstruent le paysage éditorial français » et « éclipse[nt] encore des pans entiers de la création littéraire autrichienne », tout en érigeant « la veine du négativisme (ou “néantisme”) » en canon57 ? Il est intéressant de se pencher sur la façon dont les éditeurs français transforment les romans de Jelinek en produits de consommation. On ne saurait passer sous silence les nombreuses couvertures de Points Seuil qui jouent avec l’image scandaleuse et érotique qui colle à la peau de l’« imprécatrice couronnée58 » et qui semblerait être l’argument de vente la concernant. Cette stratégie éditoriale59 correspond à l’image provocatrice et presque pornographique que les médias ont longtemps véhiculée sur le compte de l’artiste autrichienne, en France comme ailleurs. La parade visuelle, qui promet au curieux une lecture érotique, lui évoquant peut-être la littérature à l’eau de rose ou de gare, peut aussi l’égarer ; depuis 2004 cette fausse promesse est contrebalancée par la mention péri-textuelle « PRIX NOBEL DE LITTERATURE », placée sous le nom de l’auteur, qui fait office de garant de l’excellence littéraire. En même temps, cette stratégie reproduit le jeu constant d’Elfriede Jelinek avec les attentes de ses lecteurs.
Fig. 1 : Couverture du roman Lust (éditions Points Seuil, 2003)
Fig. 2 : Couverture du roman Avidité (éditions Points Seuil, 2006)
Signalons par ailleurs que Seuil ne se contente pas de publier dans sa collection de poche les textes qui avaient été publiés auparavant chez Jacqueline Chambon, la première éditrice. Il publie ainsi en format broché de nouvelles traductions (comme Gier ou Enfants des morts), une biographie et des entretiens avec l’auteure. Depuis qu’Elfriede Jelinek a quitté L’Arche Éditeur, Verdier et même Seuil (qui d’ordinaire n’édite pas de théâtre) ont édité pour la première fois des textes de théâtre de la dramaturge60.
La traduction française de l’œuvre de Jelinek témoigne pourtant de nombreuses lacunes61. L’absence de traductions de son œuvre de jeunesse, que l’ensemble de la réception internationale tend à passer sous silence, sera bientôt compensée par la publication prochaine de l’œuvre poétique intégrale de l’auteure62 – une première mondiale en matière de traduction. Jelinek apparaît en France d’abord comme une romancière. Un grand nombre de pièces de cette dramaturge prolixe n’a encore jamais été publié en français, bien qu’un certain nombre de tapuscrits existent chez L’Arche Éditeur. Certes, l’édition théâtrale représente moins de 0,5 % du marché de l’édition en France. On peut néanmoins s’étonner de l’absence de publication de certaines pièces, même après qu’elles ont été mises en scène en France, comme c’est souvent le cas pour les textes contemporains.
Images médiatiques
Avant même que ne paraisse la première traduction française de Jelinek, la presse citait déjà régulièrement son nom dans des articles concernant la politique autrichienne, et notamment dans le contexte de « l’affaire Waldheim » (1986), lorsque le passé du président autrichien dans la Wehrmacht avait été révélé. Depuis cette époque, la presse française nationale quotidienne est très sensible aux prises de position politiques de cette intellectuelle engagée – on sait combien les Français tiennent à la figure de l’écrivain engagé qui avait connu son apogée avec Sartre, Beauvoir et Malraux. En 2004, Christine Lecerf constate : « on a été d’autant plus enclin à valoriser son engagement politique qu’il se faisait de plus en plus rare dans le paysage littéraire français. Mais Elfriede Jelinek est encore trop rarement considérée comme l’auteur d’une œuvre63 ». L’année dernière, Libération publie avec un gros titre sur sa une la traduction du texte de soutien de Jelinek au groupe russe des Pussy Riot, et ce, quelques jours seulement après sa parution sur le site personnel de l’auteure et avant même que la traduction anglaise ne paraisse64. Le même journal soulignait dans un autre article le mutisme d’alors du milieu culturel français, face à l’affaire65.
Mais c’est avant tout l’engagement politique critique de Jelinek contre son propre pays qui domine dans la réception journalistique française. À l’instar de Thomas Bernhard, dans l’héritage duquel elle est systématiquement placée, elle incarne la mauvaise conscience de l’Autriche, celle qui déterre le passé nazi de l’Autriche, qui combat la montée de l’extrême-droite dans son pays66. Valérie De Daran reprend l’hypothèse émise par Ute Weinmann à propos de l’image française de l’Autriche comme locus terribilis et de l’intérêt pour l’écrivain Thomas Bernhard67, auquel elle adjoint Elfriede Jelinek. Pour elle, cette réception accrue « reflèt[e] indirectement l’incapacité française à revenir sur les étapes douloureuses de son propre passé (le “vichysme”, la guerre d’Algérie) ou à affronter de nouvelles réalités politiques proprement nationales (montée de l’extrême-droite)68 ».
Comme partout ailleurs, la presse française recasse une image de Jelinek également marquée par sa réputation sulfureuse, nihiliste et parfois perverse, qui ont quelque peu éclipsé l’œuvre et la dimension avant-gardiste de son travail sur la langue69. D’ailleurs, on peut souligner le nombre impressionnant d’interviews de l’auteure, publiées dans la presse française depuis les années 1980. Depuis le prix Nobel, Elisabeth Kargl observe avec un certain optimisme une « réorientation très nette de la réception » qui « s’émancipe des clichés qui ont accompagné sa première réception » pour se concentrer sur le travail sur la langue. Selon elle, ce changement s’est notamment opéré suite à la sortie, en langue française, du roman Enfants des morts en 200770. La traduction de cette œuvre monumentale (de par sa densité formelle et sa complexité linguistique ?), réputée intraduisible, par Olivier Le Lay fut unanimement saluée, et récompensée par le Prix André-Gide. Une nouvelle consécration de l’auteure par le biais de son traducteur, qui tient lieu de « consacrant consacré », pour reprendre une formule de Pascale Casanova71 : le transfert de capital littéraire est alors double.
Si nous ne pouvons analyser ici plus avant la réception journalistique des dernières traductions et mises en scène françaises de Jelinek, attardons-nous un instant sur celle de Winterreise, récemment traduit par Sophie Andrée Herr72. L’accueil en France a été globalement mitigé, très favorable dans certains médias73, très mauvais dans certains organes de presse plutôt de droite74. Dans beaucoup de critiques, même parmi les plus sérieuses, on retrouve une insistance particulière sur l’auteure, sur des biographèmes75 auctoriaux (l’artiste qui « obtint, sans même daigner se déplacer, le prix Nobel de littérature en 200476 »), la reprise inexorable de l’image d’une artiste scandaleuse, mais aussi et surtout celle d’une « professeure de désespoir77 », « sœur en haine du confrère Thomas Bernhard78 ». Prenant le contrepied de cette vision réductrice, Lire publie un entretien avec l’auteure, repris dans L’Express, qu’il intitule « Je le revendique : oui, je suis un auteur comique79 ». Si Le Temps, Le Magazine Littéraire et La Quinzaine Littéraire proposent une véritable analyse du texte80, à l’inverse, les attaques personnelles, les condamnations virulentes et sexistes de Paris Match rappellent par bien des aspects celles du Kronen-Zeitung, journal autrichien particulièrement hostile à Jelinek. Outre l’idée d’un acharnement politique contre l’Autriche (« Pauvre Autriche ! […] Jelinek cherche des raisons de haïr son pays avec la soif d’une feuille pour la rosée81 »), la « souilleuse de nid82 » est assimilée à une déséquilibrée, dans la tradition du discours hystérique auquel la littérature des femmes a souvent été assimilée83. Selon le tabloïde, « on tombe presque dans la pathologie […] ce n’est même plus du raisonnement obsessionnel, cela tourne au déraisonnement maladif », dénué de toute ironie. La condamnation psychiatrique culmine lorsque le (la ?) critique anonyme indique qu’« [e]lle agace ses paragraphes comme une anorexique sa salade, déplace les mots sur le papier comme l’autre ses feuilles sur l’assiette et, finalement, ne donne aucun goût au plat que l’autre ne touche pas84 ».
Une réception grand public ?
Quand on explique à son entourage que l’on travaille sur l’œuvre d’Elfriede Jelinek, le nom n’évoque généralement pas grand-chose, parfois, il suffit de prononcer le nom à la française pour qu’il provoque un effet de reconnaissance, mais bien souvent, c’est seulement par le biais de l’adaptation cinématographique de son roman La Pianiste que notre interlocuteur se sent en terre connue. Après avoir reçu trois prix au festival de Cannes en 2001, le film franco-autrichien du réalisateur Michael Haneke a en quelque sorte relancé la réception de Jelinek en France, tout en accentuant malheureusement l’image quelque peu stéréotypée d’une auteure scandaleuse et même perverse, dont le film ferait le portrait. La presse française relira alors le roman de Jelinek par le prisme de l’adaptation cinématographique de Haneke. Si le film a fait connaître au grand public le nom de Jelinek, le prix Nobel avait fait espérer à certains voir la réception de Jelinek s’amplifier en France. Force est de constater qu’aujourd’hui encore, son œuvre reste largement inconnue du grand public et, curieusement, sous-représentée dans les rayons des libraires qui ne sont pas dites « de création » qui pour leur part, prennent le risque de proposer aussi des auteurs moins connus ou bien dont l’audience n’est pas proportionnelle à la reconnaissance institutionnelle de leur œuvre, comme c’est le cas ici. Cela rejoint par ailleurs l’hypothèse de nombreux chercheurs germanophones selon laquelle Jelinek est lue dans le cercle restreint de lecteurs érudits, et notamment d’universitaires85. On sait que les prix littéraires sont des accélérateurs de consécration et de vente, un effet largement ressenti en France comme ailleurs dans les semaines qui ont suivi l’obtention du prix Nobel en 200486. Le critère du succès commercial des « bestsellers », si relatif soit-il, n’est pas décisif dans le sens où notre auteure appartient à la « sphère de production restreinte » du champ littéraire que Bourdieu oppose à celle de la grande production et que dans cette sphère, la logique de la reconnaissance symbolique par les pairs prime sur celle du succès commercial et financier87. Il faut préciser cependant qu’Elfriede Jelinek n’a jamais reçu de prix littéraire français, contrairement, par exemple, à Thomas Bernhard (1988) ou à Doris Lessing, qui reçut le prix Médicis étranger en 1976, 31 ans avant d’obtenir le prix Nobel. Cela tiendrait-il à ce que nos prix littéraires, pris depuis les années 1970 dans les intérêts économiques et commerciaux de l’industrie du livre, n’aient « jamais su consacrer – sinon dans un après-coup tenant toujours du rachat – les formes les plus modernes de la création littéraire », perpétuant « une certaine idée de la littérature, plus accessible et démocratique, plus populaire et commerciale parfois88 » ?
Sur les planches françaises
Elfriede Jelinek n’est pas plus reconnue par le champ théâtral : la frilosité des théâtres français pour monter des textes de la dramaturge a déjà été soulignée dans de précédents articles89. Toutes les mises en scène françaises n’ont pas été enregistrées par le CnT90, car beaucoup restent informelles et sans visibilité aucune, d’où la difficulté d’ailleurs d’en retrouver trace, ne serait-ce qu’avec quelques années de recul. Ainsi, Nicole Colin-Otto qui en propose un recensement jusqu’en 2000 / 2001 dénombre six créations françaises, omettant deux mises en scène mineures de 199991. Suite au prix Nobel, on a observé un pic des mises en scène françaises, avec quatre créations en France en 2007-200892 et trois la saison suivante93. Mais ces deux saisons font bel et bien figure d’exception : il n’y a jamais eu plus de deux nouvelles mises en scène par saison en France depuis 2004, auxquelles viennent souvent s’ajouter des reprises (et parfois des spectacles allemands invités). Les quatorze nouvelles créations, recensées entre janvier 2005 et mars 201394, à l’exception de la mise en scène de Marcel Bozonnet95, sont souvent le fruit de petites compagnies, de productions plutôt modestes, de metteurs en scène moins connus et souvent jeunes, dont l’indépendance artistique permet de monter des textes contemporains qui seraient moins facilement exploitables dans les gros théâtres. Ce sont surtout les adaptations des romans Les Exclus et Les Amantes par Joël Jouanneau, qui ont rencontré un certain succès auprès du public français96 bien que, selon certains, « elles ne reflètent nullement l’écriture dramaturgique de Jelinek97 ». Il est tout aussi étonnant de constater que l’œuvre de Jelinek n’est jamais entrée dans le répertoire de la Comédie Française, et que sa présence au festival d’Avignon s’est limitée à l’invitation de spectacles germanophones. La première fois en 1983, alors que Jelinek n’était encore pas traduite en français98, puis il fallut attendre 29 ans pour que son œuvre fasse son retour au festival, lors de la dernière édition99, avec d’ailleurs un certain succès. Alors même qu’elle apparaît comme la dramaturge la plus importante du théâtre germanophone depuis la mort de Thomas Bernhard et celle de Heiner Müller, son confrère Peter Handke est bien plus représenté en France et Thomas Bernhard reste, malgré la réception tardive de son théâtre, l’auteur de langue allemande le plus joué en France après Brecht100.
Jusqu’à présent, la recherche a expliqué la marginalité de Jelinek sur les planches françaises en se référant à l’écriture complexe de Jelinek, dont les textes ne sont certes pas faciles d’accès, même pour les professionnels du théâtre et les habitués du théâtre contemporain101. Pour Elisabeth Kargl, cela s’explique aussi par des premières traductions de théâtre « falsifiantes102 ». Comme le souligne Nicole Colin-Otto, ce n’est certainement pas la dimension politique qui fait peur aux metteurs en scène, ni même les problèmes de transfert linguistique ou d’ancrages culturels spécifiques à l’Autriche. Selon elle, il s’agirait bien plus du caractère radical de son esthétique qui semble effrayer les metteurs en scène et directeurs de théâtre103 – absence de fable, de personnages, énormes blocs de texte qui exposent et déconstruisent des discours hétérogènes sous forme de montage. En Allemagne, où ce type de théâtre a une certaine tradition, les metteurs en scène, qui ont l’habitude d’avoir plus d’originalité et de distance dans leur rapport au texte, sont ainsi plus nombreux à redécouper, récrire ses blocs de textes monumentaux, et à se confronter aux défis que la dramaturge autrichienne leur lance :
L’idée que puisse exister une sorte de coauteur quasiment anonyme disposant d’une liberté radicale, comme le demande la dramaturge autrichienne, ne fait pas partie des habitudes chez les metteurs en scène français. Contrairement au « théâtre de metteur en scène » en Allemagne, le théâtre français reste un « théâtre d’auteur » où les metteurs en scène, à de rares exceptions près, suivent et respectent traditionnellement le texte. […] [C]omment un auteur qui travaille sérieusement la forme artistique de ses textes pourrait-il accepter que les metteurs en scène maltraitent ses textes104 ?
Pourtant, il convient de nuancer le constat plutôt décevant de la réception de Jelinek dans les théâtres de France, puisqu’on constate par ailleurs la même marginalité de Jelinek en Autriche, où l’auteure avait même interdit la représentation de ses pièces. Seule la réception allemande de son œuvre est très intense et les mises en scène y sont régulièrement récompensées ou invitées au prestigieux festival de théâtre de Müllheim. Les données du centre de recherche sur Elfriede Jelinek à Vienne (Elfriede Jelinek-Forschungszentrum) permettent aussi de constater qu’au niveau international, la France reste de très loin le pays non germanophone dans lequel il y a eu le plus de mises en scène de textes de Jelinek105. Suite à la présentation du texte Jackie par l’actrice et la metteure en scène Bérangère Bonvoisin au festival « La Mousson d’été » à Pont-à-Mousson en 2004106, on a observé en France (comme ailleurs), un certain « engouement » des metteurs en scène pour cette pièce, qui dresse un portrait critique de Jackie Kennedy, avec sept créations107, suivie des Drames de princesses dont le texte est issu. Ces pièces ont sans doute l’avantage d’être plus courtes et plus accessibles au grand public : la traduction a été pensée pour la scène et privilégie une certaine « parlabilité » dans une langue épurée108.
En 2006, Elisabeth Kargl exprimait l’espoir qu’un grand metteur en scène français se confronte à l’œuvre dramatique de Jelinek, et déclenche ainsi sa consécration théâtrale comme ce fut le cas en Allemagne après que Claus Peymann et Einar Schleef se sont confrontés à un texte de Jelinek – mais quid de la mise en scène de Joël Jouanneau109, de celle de Marcel Bozonnet ? À l’époque, elle plaçait tous ses espoirs en Claude Régy qui, selon ses sources, s’intéressait alors à In den Alpen et Das Werk : il pourrait, écrivait-elle, « être la clé de la réception théâtrale de l’œuvre jelinekienne et lui conférer enfin une présence sur les scènes françaises digne d’un auteur nobelisé110 ». Une chance avortée, ce projet n’ayant jamais vu le jour.
Réception scolaire, universitaire et académique
Si les éditeurs de manuels scolaires n’ont pas encore osé intégrer des extraits des textes de Jelinek dans les manuels d’allemand au lycée, on constate cependant qu’au moins depuis 2009, La Pianiste figure parmi les quelques dix œuvres que le bulletin officiel du ministère de l’Education Nationale recense et parmi lesquels les enseignants d’allemand peuvent puiser pour construire leurs séquences d’apprentissage111. Or, à notre connaissance, seul le manuel Welten pour les premières et terminales intègre un extrait et un portrait de Jelinek112. La réception de l’œuvre de Jelinek par les éditeurs français pose certainement des problèmes à la fois de par la complexité de son écriture et des jeux sur la langue du texte original, mais aussi de par la sensibilité des thèmes abordés. Néanmoins, on peut noter que plusieurs grandes écoles conseillent à leurs étudiants la lecture de La Pianiste, entrée dans le corpus des livres canoniques à connaître113. Contrairement à la réception scolaire, la réception universitaire est très intense depuis quelques années, notamment parmi les germanistes. L’université ne se situe pas « [à] l’extrême fin de la chaîne de la réception », même si nous choisissons de l’aborder ici en dernier. Elle ne vient pas seulement « parachever la reconnaissance d’un auteur à laquelle ont contribué » critiques, maisons d’éditions et prix littéraires114, comme l’affirme Valérie de Daran, mais se situe dans le cas d’Elfriede Jelinek en amont du processus de réception qu’elle accompagne. En effet, Yasmin Hoffmann fait partie des tout premiers chercheurs en France à s’intéresser à l’œuvre de Jelinek dès les années 1980 et à en proposer avec une autre universitaire, Maryvonne Litaize, les premières traductions, qui vont permettre la circulation des textes dans le champ littéraire francophone. La plupart des traducteurs d’Elfriede Jelinek sont d’ailleurs issus de la sphère académique, ce qui du reste n’est pas propre à la France115. En 1993, Yasmin Hoffmann soutient la première thèse française sur Jelinek116. À l’heure actuelle, cinq thèses sont en cours dont trois en Études Germaniques, une en Études Théâtrales et une en Littérature Comparée. Les germanistes, qui ont mis deux de ses œuvres au programme des concours d’enseignement en 2007, et avaient déjà proposé un extrait de roman pour une épreuve de traduction, lui consacrent de plus en plus d’articles et de séminaires. En mars 2014, sept ans après la dernière journée d’étude en France consacrée à Elfriede Jelinek117, se tiendra à Saint-Étienne et Lyon un colloque international et transdisciplinaire qui a pour ambition de réfléchir précisément aux notions d’autorité, d’auctorialité et de réception autour de l’œuvre de Jelinek. C’est encore et enfin du milieu universitaire qu’a été récemment lancée l’initiative d’un carnet de recherche hypotheses.org dédié à la réception française de Jelinek et à la mise en réseau des différents acteurs de cette réception118.
En guise de conclusion
La réception croisée entre Elfriede Jelinek et la France nous a conduits à aborder l’œuvre de cette auteure hors normes sous divers angles. D’une part, son œuvre témoigne d’une relecture attentive des textes canoniques de l’avant-garde française ; d’autre part, l’accueil qui lui est réservé en France s’avère partiel et partial. En quoi cette relation déséquilibrée nous renseigne-t-elle sur l’auctoritas d’une auteure dont l’œuvre suscite surtout l’intérêt des lecteurs et spectateurs non-autrichiens ? En citant, paraphrasant et réécrivant les textes de ses auteurs fétiches, Elfriede Jelinek fait d’eux ses « co-auteurs », si bien que l’auctorialité semble en quelque sorte « partagée ». Elle renvoie non seulement à elle-même, mais aussi à la responsabilité de ses prédécesseurs. Ce transfert partiel de l’auctoritas ne lui confère-t-il pas le statut d’un « auteur au second degré » ? De même, nous pourrions nous demander si l’ambiguïté de son image publique, influant sur la réception de son œuvre, ne participe pas non plus de ce processus de désacralisation de la figure auctoriale. L’auteure n’est alors plus prise au sérieux, c’est-à-dire « au premier degré », et peut même être l’objet des plus vives invectives. Mais c’est aussi l’ironie de Jelinek, omniprésente dans ses textes tout comme dans ses interventions publiques et médiatiques, qui n’est pas toujours comprise au second degré. Ultime retournement, les médias nourrissent l’idée d’une auteure « au second degré », puisque l’intérêt pour la personne de l’auteure l’emporte très souvent sur l’analyse stylistique et critique de son œuvre, et que sa technique de montage de citations d’autrui y est régulièrement débattue. S’il y a donc une réception croisée entre Elfriede Jelinek et la France, il y a aussi une réception croisée entre l’auteure et ses productions littéraires. Dans les deux cas, la réception interne et externe, personnelle et collective, lui confère le statut d’une « auteure au second degré ».