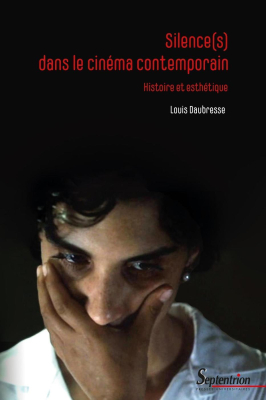Situant son enquête dans une trajectoire personnelle liée à la surdité sévère et à l’écoute appareillée, le livre de Louis Daubresse Silence(s) dans le cinéma contemporain. Histoire et esthétique invite à « entendre véritablement le silence » (11) dans des films qui en font un ressort narratif, un objet de représentation, un vecteur émotionnel ou une modalité critique. Tiré d’une thèse en études cinématographiques, l’ouvrage propose une approche transversale et plurielle de ce qui fait (le) silence au cinéma, sans éluder la difficulté définitoire autour de cet objet complexe.
Puisant à la philosophie et à l’anthropologie, l’introduction souligne la tension entre une définition ordinaire du silence comme absence ou suppression du bruit, et la nature réelle de ce phénomène qui résulte en réalité de « modalités restrictives » toujours partielles (23) – atténuation, raréfaction, évidement. Au cinéma, le silence naît d’une confrontation à l’ensemble des sons manipulés par le média (parole, bruit, musique), même s’il touche particulièrement la parole. Ce « travail du négatif » (27) conserve bien au silence la valeur d’un son (c’est un « silence qu’on peut entendre », 26), perceptible par contraste avec les habitudes d’écoute ou les attentes instituées par le film. À cet égard, le terme silence peut désigner aussi bien l’état particulier de tranquillité du monde (sileo) que l’acte de mutisme consistant, pour un protagoniste humain, à choisir de se taire (taceo). C’est en traquant ces deux options que Louis Daubresse propose d’étudier les « figures cinématographiques du silence » (25), pour en dégager modes de construction et effets narratifs, esthétiques et affectifs.
Se concentrant sur le cinéma parlant, dans lequel le silence devient une véritable possibilité formelle, l’auteur mobilise un large corpus de films fictionnels, issus de différentes périodes et aires géographiques, mais majoritairement auteuriste et contemporain, comme le titre de l’ouvrage l’indique. C’est depuis le cinéma contemporain, en effet, que Louis Daubresse propose en première partie de remonter les généalogies du silence filmique, dans un parcours rétrospectif plus esthétique qu’historique, et c’est au cinéma contemporain dit « soustractif » qu’il consacre ensuite toute sa seconde partie, cherchant à dégager les significations philosophiques et sociopolitiques de films plaçant l’état du monde sous le signe du silence et du désastre.
Fructueuse, la démarche entreprend ainsi de montrer des continuités et des ruptures esthétiques, sous la forme de « constellations » d’images et de sons s’éclairant mutuellement (12), et s’appuie pour ce faire sur de nombreuses études de cas. Le « dépouillement par l’oreille » (31) et « l’ekphrasis des instants de silence » (29) fournissent de riches descriptions de séquences, très détaillées, mais parfois un peu longues, parce qu’elles repoussent souvent les moments d’articulation théorique. Toutefois, cette herméneutique du silence, étayée par les photogrammes, parvient à mettre en mots l’expérience sensorielle des spectateur·rices, puisant aussi aux études existantes sur les films analysés, ainsi qu’à un grand nombre de textes philosophiques dont les citations ont parfois le défaut de s’accumuler en notes et de produire un propos allusif plutôt qu’une démonstration explicite.
La première partie (« Passages du silence ») retrace une généalogie du silence dans le cinéma de genre, le cinéma narratif et le cinéma de la modernité à partir des années 1960, pour montrer une diversité d’usages fonctionnels, et saisir à la fois ce dont héritent et ce dont se démarquent les cinémas contemporains.
Le chapitre 1 analyse trois films emblématiques – Il était une fois dans l’Ouest (Sergio Leone, 1968), 2001 : L’Odyssée de l’espace (Stanley Kubrick, 1968) et Le cercle rouge (Jean-Pierre Melville, 1970) – choisis pour leur ancrage générique autant que pour leur manière de détourner les conventions du western, de la science-fiction, et du policier ou du film de gangsters. Malgré quelques flottements sur l’approche des genres médiatiques (qui oscille entre liste de thèmes ou de codes plastiques, et appréhension culturelle), et si l’on peut être dérouté par le choix de traiter le « cinéma de genre » à partir de films qui, d’emblée, entendent se détacher des productions industrielles par un positionnement distinctif que les formulations de l’auteur naturalisent (évoquant par exemple des « œuvres à part entière, et non des produits de série », 66), l’analyse dégage de manière fine et convaincante comment les séquences quasi muettes contribuent dans ces trois films à activer les attentes génériques, à orienter la lisibilité de l’intrigue, à accentuer la tension narrative et à produire les effets de danger. Le silence exacerbe ainsi une « écoute causale » dramatisée où tout bruit devient hautement signifiant. Mais ces films feraient aussi du silence le moyen de rendre la présence au monde de personnages solitaires et ouvriraient ainsi, au-delà des codes du genre, à des enjeux humains et existentiels.
Le chapitre 2 étudie les formes de silence liées à la surdité, au mutisme ou à la surdi-mutité à travers les fabriques de la subjectivité auditive dans le cinéma désigné comme « narratif-représentatif-industriel » (87). S’appuyant de manière stimulante sur les apports de la psychoacoustique et la description des expériences perceptives réelles, Daubresse examine comment des films comme Il faut sauver le soldat Ryan (Steven Spielberg, 1998), Raging Bull (Martin Scorsese, 1981) ou Requiem pour un massacre (Elem Klimov, 1985) peuvent faire éprouver l’écoute intériorisée de protagonistes atteints de défaillance auditive, à travers des procédés de rupture, d’atténuation, de submersion ou de distorsion sonores, et la manipulation du point d’écoute (l’auricularisation) – même s’il ne s’agit jamais que d’approximations. Les personnages muets par défaillance vocale ou refus de parler voient quant à eux leur silence rejaillir sur l’environnement sonore diégétique et engagent des effets dramatiques propres, liés à l’énigme du personnage, à l’indécidabilité de sa pensée et aux difficultés d’interprétation dans un espace où la communication verbale échoue. Le chapitre parvient à dégager comment ces figures du silence sont canalisées par des usages spécifiques de l’image (comme la place accordée au corps, les cadrages serrés sur les visages, les champs-contre-champs entre sourd·es et entendant·es), et induisent davantage qu’une mutation sonore : une incertitude cognitive et une autre forme de relation au monde, à rebours de la « normo-écoute » verbo-centrée.
Le chapitre 3 décale le regard vers un cinéma de la modernité présenté, dans une perspective philosophique, comme espace de « révolution esthétique » et de « conscience du monde contemporain après la Catastrophe » (104-105). Les pratiques du silence y répondraient aux désastres historiques, dans une sensibilité exacerbée au présent. Daubresse montre ainsi comment, chez des réalisateur·rices comme Michelangelo Antonioni, Robert Bresson, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, ou Marguerite Duras, le silence rompt avec les usages narratifs antérieurs, en particulier ceux du dialogue classique, pour recouvrir des significations plus symboliques. La dispersion oiseuse de la parole jusqu’à la surcommunication stérile, la voix blanche ou la diction recto tono antidramatiques, l’autonomie du son (la voix) désynchronisé de l’image (le corps), ou encore la recherche d’une écriture filmique sans cesse trouée de silence sont autant de figures qui produisent des formes de silence habité et perturbant, où la parole est mise en crise et le récit déréglé, et où se disent l’effondrement du sens et la déréalisation du monde.
C’est ce silence comme « état du monde » qu’envisage la deuxième partie de l’ouvrage dans le cinéma contemporain dit « soustractif1 » ou « contemplatif ». Daubresse s’appuie ici sur l’étude des films de Andreï Tarkovski, Theo Angelopoulos, Alexandre Sokourov, Šarūnas Bartas, Béla Tarr et Tsai Ming-liang, entre beaucoup d’autres. Ce cinéma de la raréfaction « minimise l’apport du scénario, du récit, de la parole, des décors, des personnages, du montage et du nombre de plans » (163), et construit ainsi un regard poétique et politique sur un monde désenchanté après la fin des grands récits progressistes. Le contemporain est ici pris, avec Giorgio Agamben, dans une acception philosophique située dans la continuité des positions critiques de la modernité.
Le chapitre 4 prolonge certaines observations du chapitre 2 en étudiant les silences humains et leurs formes d’« (im)puissance muette ». Les films d’Angelopoulos (Alexandre le Grand, 1980), de Tarkovski (Andreï Roublev, 1969 ; Stalker, 1979), de Bartas (Few of Us, 1996) ou de Pedro Costa (Ossos, 1997) construisent en effet, par leur silence, des positions morales et existentielles contrastées : mise au ban subie ou marque d’exclusion choisie, statut de supériorité ou réclusion sans raison, la disparition de la parole confère toujours au silence une valeur désocialisante. Il marque le repli, le renoncement ou la résistance passive des individus et des communautés face aux violences de l’histoire, aux dérives du capitalisme, à la misère sociale. Ces figures mutiques tendent à délier la narration, laissant le récit à l’état de fragments ou de pointillés, et produisant un effet descriptif où le silence fonctionne comme estompe et donne place aux vestiges de monde et d’êtres en voie de disparition.
En contrepoint de ces mutismes humains, le chapitre 5 étudie les « silences du dedans et du dehors » – les présences sonores discrètes et presque inaudibles d’un monde en désagrégation, qui au cinéma, dépendent étroitement du traitement des lieux à travers lesquels le silence peut « habiter le monde » (212). Lieux clos (le cinéma de quartier de Goodbye, Dragon Inn de Ming-liang, 2003), lieux ouverts sans frontières réelles (la Zone de Stalker), lieux intermédiaires et transitoires (la chaumière du Cheval de Turin de Tarr, 2011) : tous modèlent une écoute, un silence et une sensation de durée spécifiques. Surtout, les sons résiduels, au sein de ce silere du monde, deviennent des matières brutes du lieu, purement phénoménales, sans causalité ni chronologie. Donnant forme aux crises réelles (menace nucléaire, extinction culturelle, cataclysmes…), ces silences ambiants expriment en même temps une « expérience du désastre » universelle, latente, toujours en cours, à la fois « muette et incommunicable » (227), dans une temporalité suspendue.
Ces figures cinématographiques (mutisme, silence) confèrent par ailleurs aux gestes, aux pratiques et aux rites faits en silence une valeur singulière, comme l’explore le chapitre 6. Vœux de silence chez Tarkovski (Andreï Roublev et Le Sacrifice, 1986), cérémonies collectives rituelles chez Angelopoulos (Eleni : La Terre qui pleure, 2004 ; Le pas suspendu de la cigogne, 1991), étirement démesuré des plans chez Ming-liang (Les Chiens errants, 2013) sont quelques-uns des exemples permettant d’envisager une écriture filmique où le silence exacerbe l’ampleur et la puissance expressive du geste à l’écran. Dans le silence ainsi déployé, les gestes des marginaux focalisent l’attention sur les corps ordinaires et la vacuité du quotidien (Lisandro Alonso, Los Muertos, 2004), tandis que les gestes incohérents, ambigus ou confus n’ont plus de sens qu’en eux-mêmes, sans mobile ni efficience (Šarūnas Bartas, The House, 1997). Cette poétique de l’évidement sonore tend à produire une « atemporalité radicale » (269) et déroute l’intérêt narratif. Daubresse souligne ainsi comment le cinéma soustractif travaille à produire par l’audition des « blocs de durée » (265) et vise une perception brute de l’espace-temps en-dehors de toute événementialité.
En recadrant l’ensemble des pistes de réflexion du livre non au sein d’une « théorie globale » mais à travers différents « régimes de discours possible » du silence au cinéma (283-284), la conclusion générale parvient à rassembler des résultats féconds, qui auraient pu toutefois être nettement moins disséminés au fil des chapitres, et plus systématiquement soulignés dans les transitions et les conclusions partielles. À travers cette étude, le silence cinématographique apparaît premièrement, et avec évidence, comme la construction d’une « matière sonore à part entière » (285), qui requiert d’être entendue et sollicite l’écoute parce qu’elle crée un désir de son. En somme, ce silence fonctionne comme un mode d’exacerbation de la vigilance auditive, donnant paradoxalement au son une puissance inédite. Deuxièmement, rappelant en cela combien au cinéma « le son dicte à l’image une certaine conduite » (284), les figures silencieuses configurent les attentes visuelles et cognitives, modifient la manière de voir, et peuvent même produire un « réapprentissage de la vision » (292).
Troisièmement, parce qu’il active nos hypothèses sur son origine, ses raisons, sa nature, le silence modèle la signification des lieux et des personnages qu’il affecte, selon des procédés variables : l’auteur suggère ainsi que le cinéma radical, qui forme le cœur de son corpus, recourt davantage au silence objectif par mutisme humain ou atténuation sonore du monde, qu’au silence subjectif par partage d’un point d’écoute altéré, qui serait associé aux usages plus balisés, ponctuels et dramatiques du cinéma narratif ou industriel. D’interprétation moins évidente et plus déroutante sans doute, les silences du cinéma contemplatif toucheraient en particulier des lieux en déshérence et des êtres marginalisés, se donnant essentiellement comme une matière phénoménologique engageant un rapport renouvelé aux regards, aux corps et aux lieux, pour traiter de ruptures historiques, sociales et anthropologiques.
Si l’on peut regretter certaines distinctions sommaires entre cinéma de genre (où le silence aurait toujours une fonction utilitaire) et cinéma de recherche (où il s’émanciperait de ses attaches narratives), et si les rapports entre silence et musique auraient pu faire l’objet de développements plus conséquents, l’ouvrage permet bien de dégager en synchronie une diversité de potentialités expressives du silence au cinéma, de repérer des continuités entre différentes expressions cinématographiques, et de mettre en lumière de manière plus générale la singularité du son et de l’écoute filmiques. Les articulations qu’il propose entre silence, mutisme et écoute constituent une contribution précieuse à l’esthétique sonore du cinéma dans son ensemble.