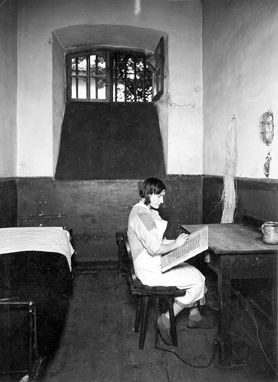La naissance de la photographie apparaît à l’acmé de la théorie pénitentiaire. La rencontre des deux disciplines n’est donc pas fortuite. L’invention est « rarement due au hasard : elle répond à un besoin profond et général, à la fois économique et intellectuel »1. Si l’on considère les bouleversements induits par la révolution industrielle tels que les progrès de l’agriculture, des transports, de l’industrie, et les mutations démographiques, on admet que l’invention de la photographie n’est pas seulement, comme le dit Claude Niepce à son frère Nicéphore en 1825, « une curieuse et sublime découverte »2, mais aussi et surtout un medium nécessaire pour accompagner le renouvellement des modes de communication et d’information qu’appelait l’époque. Le xixe siècle soucieux de concilier art et industrie a d’emblée placé la photographie au centre d’un faisceau de paradoxes, utilisant et comprenant ce nouveau medium tantôt comme document utilitaire, tantôt comme artefact.
Photographie et architecture carcérale se rencontrent à la toute fin du xixe siècle, autour de préoccupations patrimoniales, la prison ayant tardé à rentrer dans la catégorie des édifices présentant un quelconque intérêt d’un point de vue architectural. Il a fallu l’imminence des destructions des prisons de Mazas, Sainte-Pélagie et la Grande Roquette pour que des expéditions héliographiques soient diligentées par les pouvoirs publics. Depuis lors, la photographie carcérale n’a cessé d’être questionnée sous le prisme de l’histoire de l’art, de la justice, ou encore de la sémiologie, en tant que source aussi bien que pour sa valeur intrinsèque. Constituant un fonds dispersé dans différents lieux de conservation, dont les occurrences ne peuvent prétendre à l’homogénéité, la photographie carcérale constitue une archive d’autant plus difficile à appréhender pour l’historien que son objectif est de montrer ce qui, par définition, cache et isole, à savoir le lieu de réclusion. La présente contribution, dont la vocation synthétique sacrifie aux raccourcis, se propose d’interroger la photographie carcérale comme source à l’usage de l’historien, en tentant de conjuguer approche documentaire et artistique.
Les débuts de la photographie carcérale : naissance d’un genre et construction d’un imaginaire
C’est d’ailleurs dans cette configuration bifide que la première Exposition universelle, qui se tient en 1851 à Londres, place la photographie. La première exposition internationale de photographie, qui se tient à cette occasion au Crystal Palace, trouve sa place parmi des machines et autres produits industriels. Les tenants du pouvoir, aussi bien en Grande-Bretagne qu’en France, ne vont pas ignorer l’usage raisonné qu’ils peuvent faire de ce nouveau medium, et on voit se développer, principalement entre 1850 et 1870, des rapports étroits entre la photographie et le pouvoir d’État. Les gouvernants ont rapidement eu l’intuition des usages politiques possibles du procédé. On les voit exploiter le nouvel outil pour les portraits, afin de garder une trace visuelle et relativement rapide d’exécution des événements importants de leur règne, et pour contribuer à la promotion, l’archivage et indirectement la conservation du patrimoine architectural3. C’est ainsi qu’au cours de l’été 1851, à la demande de la commission des Monuments historiques, les photographes Édouard Baldus, Henri Le Secq, Gustave le Gray, Auguste Mestral4 et Hippolyte Bayard parcourent la France, dans le cadre de la « Mission Héliographique ». Leur itinéraire est fixé par la commission en fonction de son programme de restauration architecturale : il s’agit de 120 sites dans 47 départements. La volonté de la commission était de montrer l’ensemble du patrimoine architectural français et d’en renouveler l’appréhension par le public grâce à la photographie. Le medium est déjà considéré de manière ambivalente : la photographie « instrument » n’occulte qu’en partie le caractère intrinsèquement artistique du medium. La photographie archéologique et architecturale révolutionne aussi la notion de temps dans le rapport à l’histoire. Les monuments menacés de ruine, la photographie « les réunit et les rend immortels. Le temps, les révolutions, les convulsions terrestres peuvent en détruire jusqu’à la dernière pierre, ils vivent désormais dans l’album de nos photographes »5, dit Ernest Lacan. Au-delà de l’histoire et de ses considérations patrimoniales, la science s’empare aussi du nouveau medium et va apporter ses arguments. L’astronome Jules Janssen dit de la plaque photographique qu’elle est « la vraie rétine du savant »6, et la littérature naturaliste surenchérit. Notons cette célèbre sentence attribuée à Émile Zola : « On ne peut prétendre réellement avoir vu quelque chose avant de l’avoir photographié »7.
Considérant certaines des préoccupations de la seconde moitié du xixe siècle que sont l’industrie, le rationalisme dans l’art et dans l’architecture, la conservation du patrimoine et les progrès de la science, il n’est pas surprenant que photographie et histoire carcérale se rejoignent à plus d’un titre, outrepassant l’utilisation de la première pour illustrer la seconde. L’État a acquis les inventions de Niepce et de Daguerre en 1839 pour les verser dans le domaine public. La décennie 1840-1850 voit donc les balbutiements de l’outil photographique. Dans le même temps, on assiste en ce qui concerne la prison, à la faillite de l’« utopie carcérale »8. Dès après 1791, et durant la Restauration et les premiers temps de la Monarchie de Juillet, la philanthropie était comprise, dans ses manifestations nombreuses et diverses, comme s’intéressant à la condition du détenu, reprenant là les préoccupations de l’hygiéniste anglais John Howard9. L’échec de la Société Royale pour l’amélioration des prisons ne coupe pas court aux velléités philanthropiques10. D’un point de vue bibliographique, la période en question fut très riche en publications, notamment celles de Benjamin Appert, qualifié alors d’« Howard français »11, qui reflètent bien la vitalité, les ambitions et les limites de la philanthropie libérale. Appert est le fondateur du Journal des prisons, hospices, écoles primaires et établissements de bienfaisance12, qui paraît jusqu’au début de la Monarchie de Juillet, mais a subi la censure en 1827. Les trois volumes de Bagnes, prisons et criminels13, publiés en 1836, reprennent les mêmes idées, en fournissant en sus des descriptions précises et critiques des prisons en France. Benjamin Appert partage avec Charles Lucas le souci de l’éducation du détenu, et met en avant le problème de la surveillance, abordé par Jeremy Bentham dans le Panoptique, en insistant sur les qualités morales et désintéressées des surveillants14. Mais cette conception de la philanthropie n’a pas réellement de succès dans le temps.
En effet, dès 1830, les paradigmes changent. Une nouvelle rationalité pénitentiaire se construit autour des hygiénistes, qui ont fondé en 1829 les Annales d’hygiène publique et de médecine légale, et des statisticiens qui publient dès 1827 le Compte général de l’administration et de la justice criminelle. Le premier numéro des Annales donne le ton :
Les fautes et les crimes sont des maladies de la société qu’il faut travailler à guérir ou, tout au moins, à diminuer ; et jamais les moyens de curation ne seront plus puissants que lorsqu’ils puiseront leur mode d’action dans les révélations de l’homme physique et intellectuel et que la physiologie et l’hygiène prêteront leurs lumières à la science du gouvernement15.
Il y a en outre un mouvement analytique d’observation des systèmes pénitentiaires étrangers, européens et américains, qui va avoir un certain retentissement sur le développement de la science pénitentiaire. Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont vont d’ailleurs inaugurer les grands voyages d’enquête en 183116, en en rapportant la description subjective de deux systèmes : ceux d’Auburn et de Philadelphie, aux États-Unis17. Sous la Monarchie de Juillet, en parallèle à ce mouvement de classification et d’analyse statistique, se dégage une volonté de rationalisation à partir d’une observation aussi complète que possible, dans le nombre et la diversité des spécialistes, d’où la naissance d’un premier congrès pénitentiaire international à Francfort-sur-le-Main en 1846. Ce congrès est orienté autour de deux viatiques : études historiques et théoriques (Charles Lucas18 et Louis-Mathurin Moreau-Christophe19), et travaux d’enquête (prémices à la sociologie) privilégiant entretiens, travail quantitatif, statistiques et problématique. Le Système pénitentiaire aux États-Unis et son application en France, de Tocqueville et Beaumont20, publié en 1833 et réédité en 1836 et 1845 est un remarquable exemple de ce deuxième courant.
Entre 1840 et 1850 s’exprime donc un troisième type de philanthropie, ou philanthropie gouvernementale, qui n’a objectivement de philanthrope que le nom qu’il se donne. Sous la Monarchie de Juillet, ce sera néanmoins celle qui aura le plus fort impact sur l’architecture des lieux de détention, dans la mesure où elle convergera avec une vraie volonté bâtisseuse. Pour ces philanthropes, la prison doit d’abord apprendre au détenu à obéir et doit l’intimider : on assiste à une révocation de la philanthropie qualifiée d’utopiste ou d’illusoire des périodes précédentes. On rejette donc les vues humanistes des Lumières pour privilégier un certain pragmatisme né de l’étude scientifique des détenus: « Il ne s’agit pas de faire de la philanthropie mais de l’ordre social », nous dit Charles Lucas21. Priorité est donnée à la défense de la société, thèse propagée par Tocqueville, Moreau-Christophe et Lucas lui-même, même si ce dernier reste assez soucieux du sort des détenus.
La prison qui s’offre donc aux photographes n’est plus celle de Le Peletier de Saint-Fargeau, c’est une institution qui « a cessé de croire à sa mission de réhabilitation »22. Puisque l’enfermement doit désormais réprimer le détenu et effrayer la population libre tout en assurant sa protection, les débuts de la photographie carcérale servent ce programme : pas de volonté esthétique affirmée ni d’émotion, mais un réel souci de pragmatisme et d’efficacité. Les clichés laissent en effet percevoir la façon dont l’architecture constitue la matérialisation de l’évolution de la politique pénale et de l’inscription dans la pierre des différentes réformes mises en œuvre au cours du siècle23. Deux axes sont à dissocier dans la représentation photographique des bâtiments carcéraux. D’une part, étant donné que la Ville de Paris réutilise des constructions de l’Ancien Régime, pour la plupart des structures conventuelles, les clichés témoignent des aménagements qu’ont nécessités de tels réemplois. Les exemples de Saint-Lazare, des Madelonnettes, de Sainte-Pélagie ou même de la Conciergerie sont assez éloquents. D’autre part, dans le même temps, le département de la Seine met en œuvre une politique d’édification de bâtiments neufs comme la Petite Roquette, d’Hippolyte Lebas, inaugurée en 1836, ou encore l’immense maison d’arrêt et de correction de Mazas, sur les plans d’Émile Gilbert et de Jean-François Lecointe. La première, construite selon un plan rayonnant et traduisant les nouvelles conceptions du système cellulaire, s’inspire formellement du panoptique de Bentham en ne permettant toutefois pas une surveillance centralisée. La seconde a été pensée en fonction des circulaires de 1836 et 1841, afin de permettre la réclusion cellulaire de jour et de nuit. Dans les deux cas, les photographies rendent compte de manière fidèle de la vocation des programmes, tout en choisissant des partis qui n’offrent que des vues lacunaires ou fragmentées des édifices.
L’évolution de l’architecture carcérale et de la technique photographique ne vont cesser de dialoguer. Depuis 1851, de nombreuses campagnes photographiques ont été menées, à chaque fois à des temps forts de l’histoire des bâtiments24. Tous les paramètres sont à interroger de manière diachronique. D’abord, la nature des images : la manière dont les contraintes techniques ont biaisé à la fois le regard du photographe et l’image elle-même. De l’image naît, chez qui la regarde, un imaginaire de l’objet photographié, qui ensuite se diffuse, et l’on observe dans de nombreuses occurrences littéraires qu’imaginaire et réalité carcérale ne coïncident pas souvent. Sont à considérer ensuite les contraintes administratives imposées au photographe, et la nature de la commande qui lui est faite. Les photographies patrimoniales commandées par des institutions extérieures à l’administration pénitentiaire25 ne délivrent pas le même message que celles réalisées pour l’administration26, les photographies d’amateurs27, de militants28, les photographies à usage de propagande29, ou encore commandées par les journaux30. Il est évident que les catégories ne sont pas figées ni cloisonnées. En outre, les archives ne nous renseignent pas toujours sur la nature exacte du message que la prise de vue doit délivrer à l’observateur, et même lorsque c’est le cas, la diffusion de la photographie et son interprétation dans le temps nous démontrent que le spectateur s’empare de l’image de manière personnelle et lui confère de ce fait un faisceau de significations évolutif qui s’éloigne souvent de la volonté initiale du commanditaire.
Le deuxième xxe siècle présente des particularités en ce qui concerne la photographie carcérale. D’une part, cette dernière est encore très peu étudiée pour la période, et les sources sont très dispersées ; d’autre part, le statut de la photographie d’art a évolué en même temps que sa vocation figurative a été discutée. L’étude de la photographie de presse après 1945 est en outre un champ à explorer plus avant. Un travail autour des archives Michel Foucault permettrait par ailleurs de dégager les spécificités de l’« après-Foucault » dans le domaine des représentations31. Cependant, il ne faudrait pas ignorer la vocation uniquement esthétisante de certaines photographies contemporaines. Des artistes internationaux s’emparent en effet de la structure de détention pour sa valeur plastique32. La prison est alors prétexte à la création, et devient objet après avoir été sujet à part entière.
Si la photographie carcérale du second xxe siècle est à considérer avec une grille d’analyse qui associe l’étude des médias, le travail militant, et les considérations plastiques des artistes contemporains, initialement, la rencontre entre photographie et architecture carcérale se fait de manière quasi exclusive autour de préoccupations patrimoniales. Il existe un lien étroit qui unit photographie et sauvegarde du patrimoine en ce qui concerne les prisons de Paris33. Le rôle de la Commission municipale du Vieux Paris (CVP) dans la commande et la promotion des clichés, qui viennent éclairer les procès-verbaux de ladite Commission, est tout à fait déterminant. Ce type d’images contraintes et conditionnées par un cahier des charges précis doit être complété par des travaux émanant de l’initiative individuelle du photographe. Henri Le Secq s’est intéressé à la Force, de même qu’Eugène Atget, dont on conserve aussi des clichés du Cherche-Midi, de Saint-Lazare et de Sainte-Pélagie. Albert Brichaut a livré quant à lui quantité d’images de la Conciergerie et de Saint-Lazare, et Henri Godefroy du Cherche-Midi, de Mazas, de la Grande Roquette et de Sainte-Pélagie.
Les prisons sont donc véritablement entrées dans la catégorie des bâtiments dignes d’intérêt d’un point de vue architectural et patrimonial au tournant du xxe siècle, en 1898, sous l’impulsion de la Commission du Vieux Paris, qui est à l’origine des campagnes de prises de vues diligentées à Mazas, Sainte-Pélagie et la Grande Roquette, peu de temps avant leur démolition. C’est d’ailleurs la série consacrée à Mazas qui ouvre le registre d’entrée au musée Carnavalet des Photographies provenant de la Commission du Vieux Paris34.
La première préoccupation de la photographie carcérale est donc d’ordre patrimonial, et offre des vues avant destruction qui observent des codes idoines : le bâtiment est mis en valeur par les truchements du cadrage, les détenus sont absents des représentations, même lorsque les prisons photographiées étaient encore en activité, et le résultat proposé est volontiers esthétisant, dépossédant le prison de son histoire en tant qu’institution, précisément pour la faire entrer dans un autre type d’histoire : celle qui fige un monument dans cette catégorie qu’est le patrimoine. Le début du xxe siècle va en outre voir la diffusion d’un certain type de cartes postales plus pittoresques que descriptives, rompant avec toute volonté démonstrative, s’éloignant là des clichés voulus par l’administration pénitentiaire, mais les rejoignant sur le caractère symbolique du message qu’elles véhiculent.
On peut alors se poser une question qui va perdurer pour l’historien : celle de l’objectivité de la source argentique. Pour l’exprimer plus prosaïquement : quelle histoire écrit-on, et avec quelles photographies ? La photographie, même quand elle tend à l’objectivité, n’est pas, comme l’espérait Zola, l’empreinte immédiate et matérielle de la réalité dans le respect fidèle des faits. « Il n’y a pas d’archives sans trace, mais toute trace n’est pas une archive, dit Jacques Derrida, dans la mesure où l’archive suppose non seulement une trace, mais que la trace soit appropriée, contrôlée, organisée »35. La photographie carcérale est effectivement une archive, mais de quoi est-elle véritablement la trace ? Indéniablement, l’archive photographique est le témoin de l’entrée de la prison dans l’histoire patrimoniale de la France, et de la construction d’un certain imaginaire, que la littérature diffuse de concert. Ces deux aspects peuvent être questionnés en priorité par l’historien de la justice, comme par l’historien de l’art. Mais pour bien utiliser les images, il faut bénéficier d’un minimum d’informations liées à leur contexte. Sans ce préalable, elles perdent alors leur signification et peuvent même devenir des documents abstraits. En aucun cas elles ne doivent être prises pour des copies conformes de la réalité, mais soumises à la même critique, interne et externe, que n’importe quelle autre source36. L’analyse d’Arlette Farge est éclairante sur ce point : « Le réel a beau sembler être là, visible, il ne dit en fait rien d’autre que lui-même, et c’est naïveté de croire qu’il est ici rendu à son essence »37. Laurent Véray, historien du cinéma, parle en ce qui concerne les archives photographiques de « rhétorique de l’objectivité » : « Une photographie, quelle qu’elle soit, est toujours contemporaine de l’objet, de l’événement, des personnes dont elle est saisie. Par conséquent, elle retient forcément quelque chose du passé, dans le sens où ce qu’elle nous montre a vraiment existé devant l’objectif. Cette part de réalité est à chercher du côté de l’antériorité temporelle, du référent, de la présence concrète du sujet »38.
La prison : un objet qui se dérobe au photographe
Si la photographie, en tant que simple expérience visuelle, échoue en partie à montrer ce qui fait l’essence même de la prison comme institution, et propose de son architecture des vues principalement esthétisantes, quel enseignement peut-on tirer de la photographie carcérale ?
Catherine Tambrun, dans L’Impossible Photographie, propose un avis assez tranché à ce sujet :
La photographie en prison est impossible, à la fois au sens strict (il est difficile voire impossible de photographier en prison et de photographier la prison) et au sens esthétique (la photographie échoue en partie à montrer ce qui relève d’une sensation, d’une pratique et d’une expérience de l’enfermement qui sont bien différentes d’une simple expérience visuelle). On ne photographie pas le sentiment d’enfermement, les odeurs, les bruits39.
Si l’on peut relativiser cette affirmation pour la deuxième moitié du xxe siècle, notamment par les travaux d’artistes plasticiens contemporains et les témoignages de vidéastes et cinéastes40, elle n’en reste pas moins vraie en ce qui concerne les archives publiques, et les sondages effectués dans les archives de presse après 1945 ne la contredisent pas41. Pourtant, il reste des clichés.
L’expression du « ça a été » de Barthes ne peut pas être le seul vecteur d’analyse de l’image photographique. Ce qui n’est pas montré a autant d’importance pour l’historien dans l’étude du fait carcéral que ce qui l’est. Ce qui oblige à déborder du cadre strict de l’histoire ou de l’histoire de l’art pour analyser ce type d’archives. Chris Younès a livré son analyse de psychosociologue à ce sujet, en s’intéressant à l’« exclusion des extrêmes »42 pratiquée par la plupart des photographes, citant pour exemple la une du Police Magazine du 12 avril 1931, la « cellule d’un condamné à mort »43, cliché qui ne donne à voir ni le condamné, ni sa cellule, ni la scène de son exécution, pas même le gardien, dont on ne voit que l’ombre projetée sur le mur, flanquée d’une porte blindée.
Tout se passe comme si, sacrifiant au respect de la vie humaine et à la pudeur qu’on doit à la mort, la photo a plutôt fixé l’attention sur la “sécurité” et la rigueur qui caractérisent les conditions de détention de ces dangereux criminels, qui sont selon toute apparence, la pointe la plus avancée en direction de l’insupportable44.
Pour Ch. Younès, il existe un lien entre l’impossibilité technique de représenter la privation de liberté et l’absence de représentation du détenu en situation de détention. Pour venir étayer cette conjecture, il n’est qu’à considérer le lien évident et ininterrompu qui existe entre les descriptions que proposaient Jacques-François Blondel ou Claude-Nicolas Ledoux concernant cette prison prédicante, toute conforme aux théories sensualistes de l’époque, qui se devait d’effrayer et de dissuader l’homme libre. Nul besoin de représenter le détenu pour accomplir la mission froide et politique de l’architecture carcérale auprès de la population. Le traitement des façades et l’intelligente distribution de l’édifice, dans un second temps, devaient suffire. Rappelons les préconisations spatiales énoncées par Blondel lorsqu’il établit les codes de l’architecture parlante, décrivant l’architecture barbare, terrible45, qui sied selon lui aux édifices carcéraux :
On peut entendre par une Architecture terrible, celle dont l’expression forte semble annoncer par son ordonnance extérieure, la sûreté des dedans de l’édifice, parce qu’elle offre, à son premier aspect, une solidité réelle et apparente, non seulement par la fermeté de ses membres, mais encore par le choix des matières qu’on y a employées46.
Blondel ajoute qu’en ce qui concerne spécifiquement les prisons, une décoration théâtrale est souhaitable, parce qu’elle permet d’« annoncer dès les dehors le désordre de la vie des hommes détenus dans l’intérieur et tout ensemble la férocité nécessaire à ceux préposés pour les tenir aux fers »47. La plupart des vues photographiques carcérales ramène en effet à Blondel, pour qui « un édifice doit, au premier regard, s’annoncer pour ce qu’il est »48. Et c’est précisément ce qui prédomine, même si l’architecture des lieux de détention a connu une réelle évolution, dans ce que la photographie carcérale livre d’informations sur les conditions de détention : des murs et des bâtiments froids et effrayants, des parloirs austères et des kilomètres de barreaux, un vide pesant et terrifiant.
Le détenu est néanmoins présent, dans la première moitié du xxe siècle, mais de manière très peu caractérisable et dans de rares occurrences. Ce n’est pas sa détention qui est mise en scène, mais des scènes de vie quotidienne, comme lorsqu’on photographie les femmes de Saint-Lazare près d’un lavoir dans un décor extérieur qui gomme toute référence tangible à un contexte de réclusion49. Les photographies issues du Studio Henri Manuel, dans les années 1920-1930, instrumentalisent les détenus – principalement des femmes – pour illustrer des aspects éventuellement valorisants de l’institution (les structures médicales notamment), ou des scènes de vie qui ne sont pas immédiatement liées, dans l’inconscient collectif, à la réalité de la détention (détenues dans des ateliers ou au réfectoire). En outre, le caractère « posé » des personnages représentés est si remarquable que le doute quant à la mise en scène des clichés n’est pas permis. Avant les années 1960, le détenu n’est donc pas le sujet d’une représentation, il en est l’instrument, et biaise de ce fait l’imaginaire qui se construit sur la base de ces prises de vue.
Parce que la photographie carcérale est aussi – et ce n’est pas la moindre de ses caractéristiques – un artefact en proie à une véritable volonté esthétique de la part des photographes. Certains édifices, comme la Conciergerie, s’y prêtent tout particulièrement. Ses tours, ses voûtes et ses ogives ramènent à cette nostalgie du « vieux Paris » gothique, alors même que l’haussmannisation transformait la ville sous le Second Empire. À cela vient s’ajouter l’attrait du pittoresque et de l’exotisme que recèlent les bagnes, prisons, et autres lieux dont la réalité est mal connue. Dominique Kalifa distingue « trois figures principales qui régissent de surplomb le cadre des représentations » : « l’empire de la ligne droite », « les configurations du vide », et « les Ombres de l’Histoire »50. Ce dernier viatique, faisant référence aux détenus, a déjà été abordé. La première figure relevée par Dominique Kalifa fait quant à elle référence aux choix des prises de vues des édifices carcéraux, mais aussi à leur conformation même. En effet, la plupart des clichés présentent l’espace carcéral comme droit et rectiligne. Les couloirs, galeries, murs, grilles et autres parloirs photographiés sont d’autant plus froidement linéaires que l’architecture carcérale n’a cessé d’évoluer vers un rationalisme strict, contrastant avec les sinuosités toutes gothiques d’édifices plus anciens comme la Conciergerie ou les Madelonnettes. Le vide, quant à lui, est consubstantiel à l’absence volontaire d’humains dans la représentation. L’architecture y est montrée sous un jour particulièrement plastique, que met souvent en valeur un noir et blanc lumineux, ou un sépia suggérant la profondeur. Sans repère visuel autre que le monument lui-même, l’observateur est en face d’une sculpture monumentale dont il ne cerne pas les proportions, et à peine les contours. Le message que délivre l’image déborde le cadre de l’architecture elle-même, au profit de la question de la représentation de l’espace. Une fois encore, pour l’historien, le medium photographique présente plus de difficultés d’interprétation qu’il n’offre de perspectives heuristiques. Dans les photographies carcérales, ce n’est plus l’architecte qui est crédité de l’espace représenté, mais le photographe, qui a toute autorité sur les possibilités techniques du medium qu’il utilise. Jean-Claude Lemagny, ancien conservateur général du département des Estampes de la Photographie de la Bibliothèque nationale de France, s’est intéressé à la relation entre espace et photographie51, de même qu’au concept de créativité en matière de photographie d’architecture52. L’espace perçu et travaillé par le photographe contemporain n’est pour lui pas plus fatalement objectif que celui transcrit par des procédés strictement graphiques :
Longtemps on crut, plus ou moins vaguement, que l’exactitude des dispositifs optiques dispensait le photographe des lentes méthodes du dessinateur perspectiviste comme des recherches hasardeuses du peintre d’avant-garde. Or les photographes d’aujourd’hui savent que, pour eux aussi, l’espace ne peut être l’objet que d’une difficile reconquête. Le monde des possibilités optiques a aussi ses infinies richesses. L’accepter, l’explorer, inlassablement le manipuler est aussi un espace de liberté intérieure qui peut déboucher sur des espaces réels librement inventés53.
Avant même que les artistes s’approprient la prison comme objet de création plastique et/ou militante, inflexion que connaît le dernier tiers du xxe siècle, la photographie d’architecture en général, carcérale en particulier, peut donc être considérée comme un artefact à part entière, et questionnée pour sa valeur intrinsèque, au-delà de toute volonté interprétative. Le fait d’exposer, comme cela fut le cas au musée Carnavalet, des photographies ayant pour principal objet les édifices carcéraux et leurs émanations mettait l’observateur dans une situation ambivalente : la photographie carcérale, sous-tendue par une scénographie chrono-thématique et des cartels explicites, donnait à voir les clichés comme des documents. Mais ils pouvaient tout aussi bien, par leurs qualités plastiques et leur bon état de conservation, être admirés pour eux-mêmes, même s’il s’agit là d’un medium qui peut difficilement échapper à sa nature d’empreinte du visible. « La photographie n’est exposable qu’en dépit d’elle-même, explique Lemagny, à moins de passer outre quatre données contraires : sa nature comme image, sa situation historique, son origine, sa destination »54.
Une source d’un genre particulier, à interroger pour sa valeur documentaire autant qu’artistique
La photographie carcérale n’a cessé d’être un artefact, et en ce sens, une source questionnée pour sa valeur testimoniale autant qu’intrinsèque. La photographie carcérale n’est en effet pas exempte de considérations esthétiques ou de créativité de la part de son auteur, comme toute photographie d’architecture55. Les clichés conservés de l’agence Henri Manuel témoignent de la convergence d’un travail de commande et d’une vision artistique et médiatique plus globale de l’édifice carcéral56. Du fait d’une politique de grands travaux destinée à endiguer le chômage généré par la crise de 1929 et du caractère vétuste du parc de prisons parisiennes, qui est à l’origine de plusieurs fermetures et destructions d’établissements, une campagne photographique est commandée par le ministère de la Justice à l’agence Henri Manuel entre 1928 et 193457. La collection complète est conservée à l’École Nationale d’Administration Pénitentiaire (ÉNAP) ; l’École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ÉNPJJ) à Roubaix possédant quant à elle les photos des neuf établissements pour mineurs. Forte de 788 clichés recensés par édifices58, la collection conservée à l’ÉNAP propose un échantillon représentatif des édifices photographiés et des partis pris de l’agence quant aux normes des prises de vues. La campagne menée par l’agence Manuel est particulièrement intéressante, dans la mesure où les clichés conservés sont nombreux et couvrent la plupart des institutions : l’École d’Administration Pénitentiaire, dix-sept maisons d’arrêt, six centrales, et neuf établissements pour mineurs. Comme pour les premières campagnes héliographiques, le contexte est déterminant pour comprendre la véritable nature des clichés. D’une part, comme il s’agit d’une commande de la justice, le travail des opérateurs s’en est trouvé facilité, ce qui permet une plus grande variété des sujets de prises de vue, même si des motifs reviennent de manière récurrente, comme la permanence des barreaux, la blancheur des cellules (vides, la plupart du temps), et la mise en scène des détenus en situation de travail. D’autre part, l’époque voit se développer le marché florissant de l’image de presse, et les agences se multiplient. Manuel a donc sur son objet le regard d’un directeur d’agence influencé par le contexte concurrentiel de sa profession, plus friande d’images à sensation que véritablement documentaires. La méthode de Manuel est celle du reportage : il opère par séries de photographies sur un même lieu, réitère les prises de vues à des moments différents de l’année, et suit le détenu et le personnel pénitentiaire dans les différentes phases de l’incarcération. Contrairement aux photographies carcérales antérieures, mues par un objectif principalement patrimonial, la photographie de presse de l’Entre-deux-guerres épouse déjà les méthodes du reportage, même si certaines contraintes, notamment liées à la représentation du détenu, donnent lieu à des scènes posées.
La série consacrée à la prison Saint-Marguerite à Strasbourg, réalisée en 1930 et conservée à l’ÉNAP comporte vingt-trois occurrences caractéristiques du processus de l’agence Manuel. Plusieurs vues sont consacrées à la prison en tant qu’édifice, et mettent en valeur la spécificité de ce dernier, ancienne structure conventuelle transformée successivement en commanderie, hôpital, puis maison de Force en 1734. L’agence Manuel a en effet toujours le souci du sensationnel, et insiste sur le caractère pittoresque de chaque édifice : ainsi, le chemin de ronde de la Petite Roquette, ou l’escalier en vis de la Conciergerie59. Une autre constante est l’omniprésence de l’humain, qu’il s’agisse du gardien ou du détenu – ils sont d’ailleurs très souvent mis en scène concomitamment. Les prisonniers sont montrés au travail, et le choix du cadrage, ainsi que de la lumière – toujours artificielle pour les vues intérieures – témoignent d’un réel souci esthétique. La photo devait plaire, et était pensée dans ce but. Des magazines comme Police Magazine, Vu et Détective multiplient la diffusion des clichés de l’agence Manuel. Cet engouement peut être attribué à l’abondante présence des acteurs au sein des photographies, et à la systématique légende qui les accompagne.
Ill. 1 : Henri Manuel, Prison Sainte-Marguerite de Strasbourg, quartier des femmes, détenue travaillant dans sa cellule, 1930, ÉNAP-CHRCP, cote M‑06‑044, © Henri Manuel / Fonds Manuel / ÉNAP-CHRCP
Le lecteur peut ainsi se sentir voyeur et/ou empathique avec le détenu, dont il a l’impression de connaître le quotidien et l’intimité. Ce qui est évidemment une erreur. La photographie intitulée « quartier des femmes : détenue travaillant dans sa cellule »60 (ill. 1) est typique des vues au cadrage léché entièrement mises en scènes. Les détenus hommes et femmes sont présentés dans une attitude de soumission, et le personnel, comme dans la photographie présentant un « surveillant chef dans son bureau »61 (ill. 2), en situation de domination. D’une manière générale, la prison photographiée par l’agence Manuel sert la cause de la photographie de presse, même si missionnée initialement par le ministère de la Justice. Les intérêts ne sont pas forcément divergents. Manuel photographie une prison ordonnée, laborieuse, saine, et laisse à penser qu’il s’agit plutôt, en fait d’incarcération, d’une forme de rééducation par le travail.
Ill. 2 : Henri Manuel, Prison Sainte-Marguerite de Strasbourg, surveillant chef dans son bureau, 1930, ÉNAP-CHRCP, cote M‑08‑006, © Henri Manuel / Fonds Manuel / ÉNAP-CHRCP
L’imaginaire véhiculé par la photographie carcérale est fait de ruptures et de continuité. Les clichés commandés par l’administration présentent inlassablement les mêmes caractéristiques, quelle que soit l’époque : des couloirs, coursives, et autres murs dans le prolongement de barreaux. Toutes les photographies délivrent en substance le même message, du couloir sordide et vide de la maison d’arrêt d’Aix-en-Provence photographié en 198862 (ill. 3), au « Bureau du greffe après mutinerie et incendie » (ill. 4) photographié en 1974 à la Maison centrale de Nîmes63. Les photographies après mutinerie ou dégradations volontaires sont nombreuses dans les années 1970, et on constate que d’un point de vue strictement plastique, elles présentent les mêmes caractéristiques que les clichés du début du siècle pris pendant la destruction des édifices condamnés. Elles mettent en valeur les qualités plastiques d’un monument réduit à l’état de ruine, et écrivent sont histoire tout en la figeant.
Ill. 3 : Maison d’arrêt d’Aix-en-Provence, couloir, premier étage, 1988, ÉNAP-CHRCP, cote E‑43, © Fonds CHRCP / ÉNAP-CHRCP
Ill. 4 : Maison centrale de Nîmes, bureau du greffe après mutinerie et incendie, 1974, ÉNAP-CHRCP, cote E‑482, © Fonds CHRCP / ÉNAP-CHRCP
La photographie de presse montre en revanche de vraies inflexions concernant la représentation des détenus, qui varie aussi en fonction des dispositions légales afférentes au droit à l’image. D’une part, les visages tendent à disparaître sous le masque de l’anonymat, comme dans les clichés d’Olivier Aubert qui, même en 1990, préfère le monochrome à la couleur. D’autre part, les artistes s’emparent du sujet et l’instrumentalisent de manière plastique et/ou militante. Les travaux de Jacqueline Salmon utilisent la couleur pour illustrer une architecture de désolation et dans le même temps les tentatives d’appropriation de l’espace par le détenu dans sa cellule. Ceux de Michel Séméniako, qui réalise à la Santé une série de « portraits négociés » en 2009, vont plus loin dans la tentative de synthèse entre le détenu et l’identification à son espace cellulaire en photographiant l’intérieur d’une cellule mise en scène par son occupant à l’aide d’objets personnels, réalisant ainsi un autoportrait livré au photographe. La présence du détenu est absolument éclatante, et la mise en scène personnelle du cadre de l’image occulte complètement son absence physique.
On peut enfin se demander si la photographie carcérale telle qu’elle a évolué hors de la commande institutionnelle est encore de la photographie d’architecture, si tant est que les photographies à vocation patrimoniale qui marquent les débuts du genre en soient véritablement. Si l’on considère que la photographie est un art à part entière, on ne peut lui dénier sa vocation créatrice : l’objet est alors subordonné à l’initiative de l’auteur. Il est de ce fait possible de considérer que l’architecte et le photographe sont complémentaires, aussi bien dans une perspective patrimoniale qu’artistique. « Là où le créateur architecte doit s’effacer devant “la vie qui reprend ses droits”, le créateur photographe doit être plus que jamais présent pour accueillir le devenir d’un édifice, toujours le même et pourtant déjà autre. Il est le témoin de l’humain qui reconquiert à petits pas ce que le totalitarisme inhérent à tout programme architectural avait d’un seul coup imposé à la vie. Ainsi, la photographie créatrice arrive avant ou après l’architecture strictement dite. Avant, elle enregistre la texture de ces matériaux et l’espace délimité par ces lignes qui vont déterminer l’être d’un édifice. Après, quand l’organisation des plans et des épures commence à se brouiller, « dérangée par l’imprévisible, et la poésie de l’inattendu, au fil des jours »64.