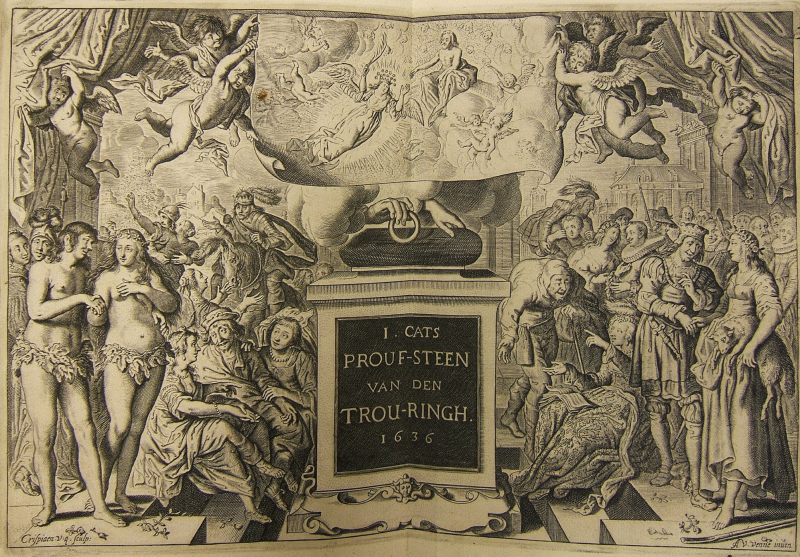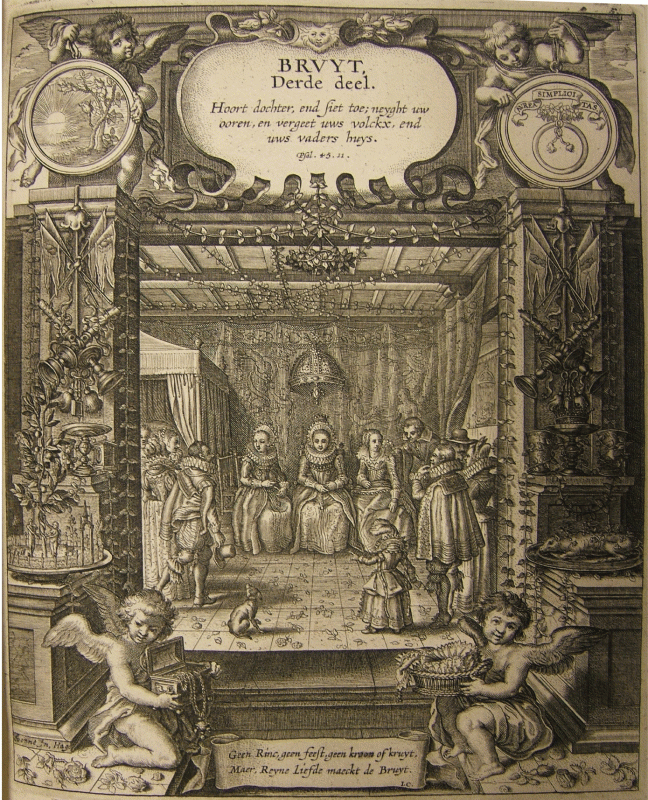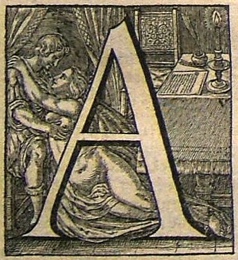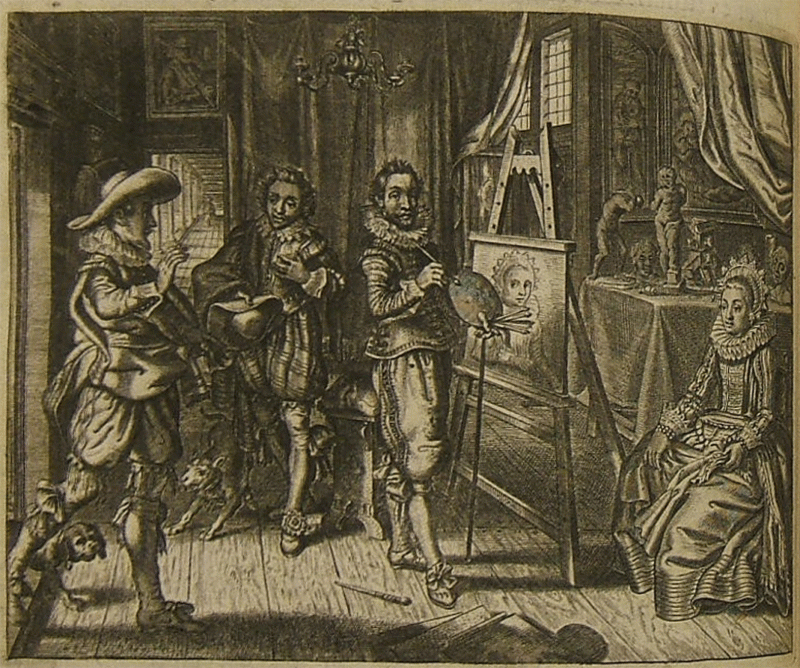Aucun ouvrage de morale matrimoniale n’a connu une diffusion plus importante, dans les Provinces-Unies du xviie siècle, que les deux livres illustrés de Jacob Cats (1577-1660) : Houwelick (« Mariage », 1ère édition 1625) et Trou-Ringh (« Anneau de mariage », 1ère édition 1637). Il s’agit même de deux succès majeurs dans le champ éditorial, Houwelick atteignant 50 000 exemplaires vendus dès 1655, ce qui en faisait un des ouvrages les plus diffusés dans le pays1. L’ensemble que forment ces deux livres dans leurs déclinaisons éditoriales successives tout au long du siècle, avec des dispositifs iconiques abondants et souvent renouvelés, représente une source exceptionnelle pour l’étude du fonctionnement des images dans la littérature prescriptive du mariage dans les Provinces-Unies.
Dans sa préface à Houwelick, en 1625, Cats insiste sur l’importance de l’institution matrimoniale : « un creuset pour les êtres, une pierre de fondation pour les villes, une pépinière de hauts dirigeants ». Or, cette institution au fondement de la société religieuse et civile est menacée puisque « […] beaucoup de sympathisants [liefhebbers] à la fois de l’Église de Dieu et de la Patrie [ont] remarqué différents défauts à ce sujet présents parmi nous, [et] nous avons pensé que quelque chose pouvait être apporté pour le bien de nos concitoyens […] »2. Quand il cherche à moraliser les conduites de ses compatriotes pour le bien de l’Église, de la Patrie et de la cité, c’est d’abord le juriste et homme public de Zélande qui parle : Jacob Cats (1577-1661), après avoir fréquenté l’école latine, puis étudié dans les facultés de droit de Leyde et Orléans, prend en 1621 des fonctions municipales importantes à Middelburg. En 1623, deux ans avant la publication de Houwelick, il part à Dordrecht où le Magistrat lui offre un poste similaire3. C’est également un homme de lettres, dont l’ambition littéraire s’est déjà fait jour par le passé à travers divers écrits4, et un homme proche des premiers zélateurs d’une Seconde Réformation (« Nadere Reformatie »), qui – tels un Willem Teellinck, lui aussi habitant de Middelburg – prônent l’affermissement de la foi et l’application de la doctrine réformée dans les attitudes quotidiennes. Ce sont à la fois ce contexte religieux et la tradition littéraire de réhabilitation de l’institution matrimoniale depuis Érasme et Vivès qui expliquent l’entreprise du Zélandais.
Si l’auteur a pu faire l’objet de l’adulation la plus béate comme des attaques les plus féroces depuis le xviie siècle, un élément reste en tout cas invariable depuis le xixe siècle au moins : chacun se plaît à expliquer le succès de ses ouvrages par la présence d’illustrations et souligne le rôle de son collaborateur régulier, l’artiste Adriaen Pietersz van de Venne, qui a dessiné une grande partie d’entre elles5. Pour autant, il s’agit presque d’un angle mort des études « catsiennes » puisque, sauf exception, ni les historiens de Cats, ni ceux d’Adriaen van de Venne n’entrent dans une analyse détaillée de ces images ni de leur(s) rôle(s) dans les ouvrages du moraliste6.
Il n’est pas question ici de chercher à expliquer le succès de Cats au xviie siècle, que seules des sources restituant la fortune critique de ses ouvrages seraient à même d’informer. En revanche, on voudrait se placer du point de vue de la production de la littérature prescriptive et examiner « au ras de la page », pour paraphraser Jacques Revel7, la façon dont les images, seules ou en lien avec le texte, participent de la pédagogie matrimoniale. Si l’on attribue une quelconque valeur pédagogique à ces ouvrages, et alors qu’on sait l’ampleur extraordinaire des moyens visuels utilisés par les jésuites de l’autre côté de la frontière confessionnelle pour « éduquer », on ne peut pas ignorer la question du lien entre texte et images, de l’incidence de ces illustrations sur la lecture du texte, et de leur effet sur un lecteur-spectateur auquel l’auteur chercherait à inculquer une morale du mariage et de l’état conjugal8.
Mais l’image dans les ouvrages de Cats n’a pas nécessairement le même statut que les images jésuites : quel est le point de vue de Cats à ce sujet ? celui de l’artiste ? Il s’agit également d’examiner la place des illustrations dans les dispositifs de bibliographie matérielle des premières éditions, avant d’en venir aux aspects proprement iconographiques, puis à l’évolution de l’ensemble de ces caractéristiques au fil des éditions, qui échappent rapidement aux premiers acteurs.
Ill. 1 : Adriaen van de Venne, frontispice : Jacob Cats, Houwelick, Middelburg, J. P. van de Venne, 1625, Cliché auteur
Statut et fonctions des images
Dans Houwelick, un épais volume in‑4°, Cats s’adresse avant tout aux femmes néerlandaises. La structure de l’ouvrage semble synthétisée par le frontispice général (ill. 1), que l’illustrateur van de Venne commente dans sa propre préface : il représente une colline sur laquelle progressent six couples – les six âges de la vie – correspondant à chacune des six parties de l’ouvrage. L’iconographie reprend, tout en la modifiant, celle des escaliers de vie, où l’on voit en général des individus ou des couples montant puis descendant une dizaine de marches, chacune symbolisant un « âge »9. Mais cette annonce n’est pas entièrement fidèle à l’ouvrage. Les six parties – « Maeght » (jeune fille), « Vryster » (jeune fille courtisée), « Bruyt » (fiancée), « Vrouw » (épouse), « Moeder » (mère), « Weduwe » (veuve) – correspondent moins aux âges qu’aux statuts successifs connus par une femme néerlandaise, et que décrit l’auteur. Pour chacun, Cats dispense un certain nombre de conseils au style direct et illustre son propos par de nombreux exemples, eux-mêmes accompagnés d’images.
Ill. 2 : Adriaen van de Venne, frontispice : Jacob Cats, Trou-ringh, Dordrecht, M. Havius, 1637, Cliché auteur
Dans les années 1630, c’est visiblement devant le succès obtenu par Houwelick que Cats entreprend, toujours avec la collaboration d’Adriaen van de Venne, la publication de Trou-ringh (1637) (ill. 2) : il s’agit cette fois, sur le modèle du Decameron, d’une série d’historiettes sur le thème du mariage. Chacune est accompagnée d’illustrations et suivie d’un dialogue entre deux philosophes qui explicitent les principales questions de morale matrimoniale soulevées par l’historiette. Ici aussi, le frontispice général est une sorte de synthèse de l’ouvrage : l’illustrateur van de Venne a représenté un certain nombre de couples que leur apparence, leurs vêtements, leur attitude, permet de reconnaître et d’identifier avec ceux dont il est question dans l’ouvrage. Ces frontispices ont tout de taxinomies sociales appliquées à la femme chrétienne, en fonction de son statut juridique (jeune fille, épouse, veuve), ou de son occupation. Houwelick et Trou-Ringh pourraient être considérés comme les deux volets d’un diptyque « défense et illustration » de l’état conjugal : Houwelick serait alors le manuel de préceptes théoriques tandis que Trou-ringh jouerait le rôle de recueil d’exempla.
Au-delà des seuls frontispices, ce sont l’ensemble des images qui participent d’une pédagogie visuelle du mariage : il s’agit d’abord d’en élucider le statut.
Un statut pluriel
Houwelick et ses éditions successives forment une source exceptionnelle dans le sens où l’auteur aussi bien que l’illustrateur se sont exprimés dans des préfaces. L’étude des premières éditions de Houwelick et Trou-ringh montre que Cats et van de Venne ont chacun leur propre conception du statut des images : « des images pour le plaisir », pour l’illustrateur, qui sont aussi des images « pour la clarté du propos » selon l’auteur.
En effet, Adriaen van de Venne raisonne essentiellement en artiste. Dans sa préface à la réédition de 1632, il s’adresse au lecteur en le priant « de recevoir avec faveur notre travail, fait pour votre avantage à nouvel art et nouveaux frais ; et si nous avons affaire ici à un Mariage légitime, ne pas accepter de bâtards illégitimes dans vos honorables maisons d’amateurs d’art »10. Au-delà du calembour sur le titre Mariage/Houwelick et de la métaphore désignant les copies contrefaites – en référence à une édition pirate de 1628 – comme des bâtards illégitimes, cette citation montre qu’il conçoit l’ouvrage comme un objet faisant partie des preciosa que tout cabinet d’amateur d’art doit receler. Il place sa contribution à parité avec le texte poétique, en soulignant, au passage, « le plaisir de la poésie et des gravures utilisées ici », brodant donc sur le thème classique de l’Ut pictura poesis11. Si le livre a un contenu moral, pour autant, ses qualités artistiques et littéraires en font un petit bijou, que le nouveau marié offrira, en plus des joyaux, à son épouse.
Jacob Cats a, pour sa part, un point de vue multiple. Il reconnaît aux images le pouvoir d’amuser et de plaire, notamment « par leur nouveauté même » (« Door de nieuwicheyt selfs te mogen behagen »), et rappelle, comme van de Venne, qu’elles ont toujours eu une parenté avec la poésie12. Mais, dans ses deux ouvrages, il semble bien que le plus important soit, à ses yeux, leur rôle pédagogique. Dans la préface à Houwelick, Cats consacre un court paragraphe pour expliquer pourquoi il a eu recours à l’art du peintre. Les images ont en effet la capacité de
susciter par moments chez le Lecteur une représentation mentale [inbeeldinge] plus profonde pour une disposition particulière ; ce pour quoi nous avons veillé, entre autres, à ne pas porter sur les planches ce que nous avions vu auparavant et que quelqu’un aurait déjà peint ; afin de plaire à nos Lecteurs délicats par la nouveauté même.13
L’image est donc un support de l’imagination, qui doit permettre au lecteur-spectateur d’atteindre une disposition d’esprit telle qu’il sera plus intime avec la matière du texte.
Dans Trou-ringh, Cats insiste sur la compréhension et le plaisir : après avoir expliqué qu’il avait à dessein brodé sur les histoires bibliques, antiques ou historiques, telles qu’on les trouve dans les sources, il justifie sa démarche en soulignant qu’il a agi « […] pour un plus grand éclat de la matière et un plus grand plaisir du lecteur […]. Et à cette fin j’ai voulu montrer au lecteur, non seulement par les planches de cuivre, mais également par les capitales historiées elles-mêmes, ce qu’il y a de plus singulier dans les histoires »14. Les images incarnent donc l’idée-force de chaque parabole et permettent au lecteur de s’en approprier la morale.
Dans ces conceptions de l’image, on retrouve l’adage d’Horace – « profit et plaisir » – en vogue au début du xviie siècle dans le milieu des graveurs néerlandais15. Si les images de van de Venne sont censées, par leurs qualités esthétiques, « délecter » le lecteur-spectateur, l’auteur leur assigne pour tâche également de lui faire mieux comprendre le texte. Cela renvoie au moins en partie à la maxime « docere, delectare, movere » (enseigner, délecter, inciter à l’action) de la rhétorique cicéronienne, que les jésuites ont appliqué au xviie siècle à leurs images de dévotion16.
Le statut et la fonction des images, dans ces ouvrages de littérature prescriptive, ne sont donc ni des évidences, ni même des donnés dont l’univocité pourrait être énoncée : leur valeur change en fonction du locuteur qui les décrit, selon son propre statut social, le profit qu’il souhaite voir en tirer le lecteur-spectateur, en fonction aussi de ses attentes personnelles. Ainsi Adriaen van de Venne y voit plutôt des objets se suffisant à eux-mêmes, devant procurer de la jouissance au lecteur et, par ricochet, de la gloire à sa propre personne. Jacob Cats y trouve le moyen de faire entrer plus intensément le lecteur dans la matière du discours, et d’arriver au projet initial : réhabiliter l’institution matrimoniale.
Ill. 3 : Adriaen van de Venne, pl. : J. Cats, Houwelick, op. cit., 1625, chap. « Bruyt », Cliché auteur
Ornements, emblèmes, planches
Si l’on s’intéresse maintenant à la nature des images, elle peut être caractérisée par une typologie qui comprend leur localisation dans l’ouvrage, leur forme et leur genre17. Quelle que soit cette nature, elle sert le propos pédagogique de l’auteur.
Il en va ainsi de la localisation des images. Dans Houwelick, l’exemple de la page de titre de la partie « Bruyt » (fiancée), qui a tous les traits d’un frontispice, quoique placé au cœur de l’ouvrage, est révélateur (ill. 3). Il s’agit de la première des quatre dernières parties qui portent un titre commun : Christelijk-huiswijf (épouse chrétienne). Contrairement au frontispice général, celui-ci revêt la forme (classique) d’un arc triomphal, mais un arc qui débouche sur l’intérieur du domicile conjugal18. Au sommet de cette architecture, la devise : « écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; oublie ton peuple et la maison de ton père » tirée du Psaume 45, souligne la signification fondamentale du mariage : le passage de la fille de la tutelle de son père à celle de son nouvel époux. Par sa localisation, par sa structure et par son contenu, ce frontispice est donc un seuil pour les quatre parties qui forment le propos central, comme si le frontispice du chapitre « Bruyt » (la fiancée) était en réalité le frontispice général de l’ouvrage Christelijk-huiswijf. Cependant, cette image ne parle que de la noce. Analysée dans le tout cohérent que forme l’ensemble de l’ouvrage Houwelick, cette image est à la fois une césure et un passage entre les parties « Vryster » et « Bruyt », et correspond à un moment – le mariage – qui est un rite de passage dans l’existence de la lectrice ; le dispositif de bibliographie matérielle renforce donc la leçon matrimoniale : il oblige le lecteur-spectateur à marquer une pause au moment où l’auteur décrit le changement de statut social19.
Ill. 4 : Anonyme, xylogravure, lettrine : J. Cats, Trou-ringh, op. cit., 1637, historiette « Onlust midden in de lust... », p. 254, Cliché auteur
La forme peut être celle d’un ornement, d’un emblème ou d’une illustration-tableau. Conformément à son étymologie (ornatum, ornare), l’ornement permet de décorer, mais aussi d’ordonner et de structurer le texte et plus globalement l’ouvrage20. Dans Houwelick (in‑4°) et Trou-ringh (in‑4°), il est omniprésent : marques typographiques en têtes de chapitres, lettrines qui peuvent être de véritables capitales historiées, culs-de-lampe, etc. (ill. 4 et 5). Mais ces éléments n’ont pas qu’un propos décoratif ou structurant. Dans Trou-Ringh, on l’a vu, Cats a l’intention de « montrer au lecteur, non seulement par les planches de cuivre, mais également par les capitales historiées elles-mêmes, le plus singulier dans les histoires »21. Ces capitales historiées ou lettrines, placées au commencement de chaque histoire, ont en effet un rôle complémentaire des illustrations-tableaux. Elles restituent en général, de manière très simplifiée, l’idée principale de l’histoire, ou bien plantent le décor de la scène. Dans Trou-ringh, le propos généraliste et introductif des lettrines contraste avec le caractère anecdotique et moraliste des illustrations, dont la localisation est « progressive » – en cours de texte. Il existe donc bien une différence de statut entre ces « formes » d’images : vignette-lettrine d’un côté et illustration-tableau ou emblème de l’autre. Avant d’examiner ces deux dernières formes, il faut étudier le rapport entre texte et images dans les deux ouvrages.
Ill. 5 : Anonyme, cul-de-lampe, pl. : J. Cats, Trou-ringh, op. cit., 1637, trois premières parties, Cliché auteur
L’image comme « traduction » du texte ? La relation texte-image
Dans Houwelick, pour chaque idée importante, redite, répétée, reformulée, l’auteur donne un ou plusieurs exempla, eux-mêmes (parfois) mis en image par van de Venne. Ces images s’adaptent par leur « forme » et leur « genre » au texte auquel ils se rattachent : emblème ou illustration-tableau. Dans ce dernier cas, on a affaire à une scène narrative (biblique, antique, contemporaine). Dans Trou-Ringh, l’usage de l’exemplum est inverse de celui de Houwelick. Le texte argumentatif et prescriptif était illustré par des exemples, désormais, l’auteur part des exempla pour en discuter les tenants et les aboutissants. De manière générale, Cats choisit ses intrigues de manière à aborder le plus de sujets possible. Il l’explique dans la préface générale :
Entre autres ma pratique a été, de représenter chaque nouveau cas avec une issue particulière : afin, par la diversité de la matière, de susciter constamment de nouvelles réflexions chez le lecteur ; afin aussi que chacun puisse trouver ici ce qui convient à sa propre situation. En quoi je pense avoir tant fait, qu’on ne trouvera presque personne qui ne puisse jauger la sienne à l’aune de l’un ou l’autre des cas de mariage et la mettre à l’épreuve22.
Le tableau 1 montre, à propos de deux des historiettes de la première partie (biblique) de Trou-ringh, la stratégie adoptée par Cats pour utiliser les images à des fins didactiques. Les deux illustrations qui accompagnent l’exemplum d’Adam et Ève peuvent ainsi être interprétées comme un éloge du mariage et correspondent à la première des trois questions discutées dans le dialogue des philosophes. Pour le récit du mariage de Jacob avec Léa et Rachel, les deux images renvoient à deux questions distinctes.
Dans ce schéma, l’image joue un rôle de filtre pour attirer l’attention du lecteur-spectateur sur l’un des problèmes matrimoniaux soulevés par l’exemplum. Elle vient orienter la lecture en concentrant l’attention du lecteur-spectateur sur le ou les argument(s) le(s) plus important(s) du propos moral.
Tableau 1 : Stratégies didactiques dans Trou-ringh : le cas de deux historiettes de la première partie
|
Titre de l’historiette |
Résumé |
Principales questions matrimoniales développées dans le dialogue |
Analyse des illustrations [correspondance avec les questions] |
|
Mariage d’Adam et Ève |
Au paradis terrestre, Dieu crée l’homme et la femme. Voyant que tous les animaux s’apparient, Adam cherche à convaincre Ève de faire pareil. Elle commence par se refuser à lui : il faut apprendre à se connaître avec le mariage, à rendre gloire à Dieu. Finalement convaincue, ils se marient, et leurs noces sont célébrées par toute la Création. |
a) S’il vaut mieux vivre marié ou célibataire ; b) si la prière aide avant le mariage ; c) s’il faut un contrat de mariage. |
1) Les noces d’Adam et Ève, entourés par tous les animaux en couple. [cf. a)] 2) Adam et Ève contemplant la Création. [idem] |
|
Mariage de Jacob avec Léa et Rachel |
Jacob se rend chez son parent Laban. En route il rencontre la fille de Laban, Rachel, jeune bergère dont il s’éprend. Il travaille sept ans pour Laban avec la promesse d’épouser sa fille ; mais le moment des noces venu, Laban fait entrer Léa dans la chambre nuptiale, à la place de sa sœur Rachel. Il travaille encore sept ans et prend Rachel comme seconde épouse. |
a) Si la beauté doit entrer en compte dans le choix d’un conjoint ; b) si l’on est vraiment marié lorsqu’on a été trompé sur l’identité de son conjoint ; c) si la polygamie est acceptable. |
1) Rencontre de Jacob et Rachel, cadre pastoral. [cf. a)] 2) Après la première nuit avec Léa, encore dans le lit, Jacob se plaint à Laban au deuxième plan. [cf. b)] |
Les images à caractère emblématique dans Houwelick
Ill. 6 : Adriaen van de Venne, image emblématique : J. Cats, Houwelick, op. cit., 1625, chap. « Vrouwe », p. 6 r°, Cliché auteur
Outre les ornements, les deux grands « genres » iconiques dont tire parti Adriaen van de Venne sont les emblèmes (ill. 6) et les illustrations-tableaux (ill. 7).
Ill. 7 : Adriaen van de Venne, pl. : J. Cats, Houwelick, op. cit., 1625, chap. « Bruyt », p. 24 v°, Cliché auteur
Les premiers sont un type d’image caractéristique de la culture visuelle de la première modernité qui associe d’ordinaire une devise (titulus), une image (pictura) et un texte explicatif (subscriptio). Si Houwelick ne contient pas d’emblème au sens propre – il manquerait un titulus – on repère cependant des images à caractère emblématique : certaines d’entre elles empruntent, on va le voir, des types iconographiques que l’illustrateur a repris dans des recueils d’emblèmes. Surtout, le critère de distinction est la forme ronde de l’image à l’intérieur d’un cadre carré, là où les illustrations-tableaux sont rectangulaires et sans cadre. Ce dispositif de bibliographie matérielle est utilisé par Adriaen van de Venne dans d’autres ouvrages de Cats, cette fois d’authentiques recueils d’emblèmes. Ce détail montre, comme le rappelle Roger Chartier, que les « “textes” (ici pris au sens large) sont inscrits dans une matérialité qui joue un rôle essentiel dans le processus de production du sens »23. Le tableau 2 restitue trois de ces planches à caractère emblématique, dans la partie « Vrouwe » (« Épouse ») de Houwelick.
Tableau 2 : Planches à caractère emblématique dans Houwelick, « Vrouwe » (« Épouse »)
|
Partie et pagination |
Description de l’image |
Résumé du propos moral de Cats |
|
Vrouwe, p. 15 |
Des gens dans une barque longue et étroite. |
L’épouse doit veiller à l’équilibre du couple comme l’on doit veiller à l’équilibre d’une barque pour qu’elle aille vite. |
|
Vrouwe, p. 19 |
Une baleine est guidée par un petit poisson. |
L’épouse, faible par nature (le petit poisson), peut malgré tout être d’une grande utilité pour son mari. |
|
Vrouwe, p. 34 |
Une pierre vient d’être cassée par un marteau, sur un coussin. |
L’épouse pourra d’autant mieux combattre les humeurs chagrines de son mari (la pierre dure) qu’elle sera douce avec lui (comme un coussin). |
Qu’il s’agisse de l’équilibre d’une barque, du comportement des animaux marins ou de la mécanique des roches, ces images renvoient toutes au monde physique : il faut y voir chez l’auteur l’interprétation assez classique de la phusis, la nature, appréhendée comme un grand livre24. La démarche intellectuelle se résume souvent à un rapport d’opposition ou de complémentarité/dépendance entre les choses ou les êtres représentés. L’originalité de la didactique de Cats consiste en une répétition inlassable des mêmes arguments, déclinés sous toutes les formes. Dans son système de pensée, qui fonctionne par correspondance entre ce qu’il observe du monde naturel et ce qui est bon pour le monde social, la phusis est un réservoir jamais tari dans lequel il va puiser pour démontrer la justesse de sa vision de la société : si la nature est aussi prolixe pour exprimer tel type de relation, c’est forcément ce type-là qui doit s’appliquer aussi aux interactions entre les acteurs sociaux
Les questions matrimoniales au prisme des scènes narratives dans Houwelick et Trou-Ringh
En réalité, les emblemata ne sont qu’un des éléments du système didactique de répétition, qui comprend aussi les récits bibliques ou historiques. Les autres images de Houwelick et de Trou-ringh, les illustrations-tableaux, accompagnent sur le mode visuel les exempla. Leur efficacité pédagogique relève de plusieurs dimensions : leur rapport à l’argumentation textuelle, les procédés sémiotiques mis en œuvre, et leur iconographie qui joue à la fois sur la captation éventuelle de types utilisés dans d’autres contextes, comme les illustrations du Décalogue, et sur la mise en scène du monde social.
Quelles questions matrimoniales ?
Quelles sont les questions matrimoniales abordées dans ces images ? Comment s’articulent-elles aux questions soulevées dans les exempla textuels ? L’analyse des thèmes abordés dans Trou-Ringh mène au tableau 3, qui tâche de reprendre les catégories définies par Cats lui-même25. Par exemple, le bien-fondé de l’institution du mariage est une question soulevée à propos de deux historiettes, mais seules les images de l’une d’elles (en l’occurrence « Adam et Ève ») doivent être interprétées ainsi.
On constate que les questions concernant le choix du conjoint et ses modalités dominent largement. Mais ce problème est très vaste et se scinde lui-même en plusieurs catégories. De façon remarquable, les images se répartissent assez bien entre toutes ces questions : il y a un véritable effort des illustrateurs pour traduire visuellement chacune d’elles. Aussi bien dans Houwelick que dans Trou-Ringh, les « illustrations » des exempla textuels jouent elles-mêmes le rôle d’exempla visuels. Leur propos n’est pas de montrer une scène quelconque de l’historiette. Même si leur iconographie dépend fortement de l’histoire qu’elles accompagnent, elles parviennent à diriger l’esprit du lecteur-spectateur vers l’essence morale de cette histoire, et la rendent explicite.
Tableau 3 : Comparaison des thèmes abordés entre le texte et les images des historiettes de Trou-Ringh
|
Thème abordé… |
…dans le texte et le dialogue des historiettes |
…dans les images des historiettes |
|
|
Bien-fondé de l’institution du mariage |
- Adam et Ève - Twee verkracht en beide getrout (deux violées et toutes les deux mariées) |
- Adam et Ève |
|
|
Choix du conjoint et formation du couple |
Différence de statut social |
- Cratès et Hipparchia - Spaens Heydinnetje (petite bohémienne espagnole) - Ulrich et Bocena |
- Cratès et Hipparchia - Spaens Heydinnetje - Ulrich et Bocena |
|
Choix sur des critères physiques |
- Jacob et Rachel - Atniel et Ascha - Ulrich et Bocena |
- Jacob et Rachel |
|
|
Différence d’âge |
- aveugle - Rhodope |
- aveugle |
|
|
Différence de religion |
- Spaens Heydinnetje |
||
|
Qualités de la femme |
- David et Abigail |
- David et Abigail |
|
|
Rôle des parents |
- Atniel et Ascha - Emma et Eginhart - Cratès et Hipparchia |
- Atniel et Ascha - Emma et Eginhart |
|
|
Relations prénuptiales (Byslapen) |
- Emma et Eginhart |
- Emma et Eginhart |
|
|
L’enlèvement et ses conséquences |
- Benjaminites |
- Benjaminites |
|
|
Le viol et ses conséquences |
- Twee verkracht |
- Twee verkracht |
|
|
Circonstances de la rencontre |
- Liefde brant (feu d’amour) - Massinissa |
- Liefde brant - Massinissa |
|
|
Vie conjugale |
Adultère |
- Onlust midden in de lust ontstaen (déplaisir survenu au milieu des plaisirs) - Fransche trou-geval (mariage français) |
- Onlust… |
|
Vie domestique |
- Philetas et Psyche |
- Philetas et Psyche |
|
|
Veuvage |
- David et Abigail |
Dispositifs visuels pour une pédagogie du mariage : une lecture dirigée
L’illustrateur met en œuvre plusieurs stratégies pour mener le lecteur vers la leçon didactique. Parmi celles-ci, le recours au comique répond exactement à l’adage horatien « profit et plaisir ». Arrêtons-nous sur une autre, l’utilisation récurrente d’un procédé sémiotique qui dirige le regard du lecteur-spectateur vers l’élément-clé de la scène, et l’aide à l’interpréter : le motif du chien et ses postures (ill. 8)26. Dans l’édition in‑4° de Houwelick, le chien est présent dans les images-tableaux de manière presque systématique.
Ill. 8 : Adriaen van de Venne, pl. : J. Cats, Houwelick, op. cit., 1625, chap. « Vrouwe », p. 41 v°, Cliché auteur
L’animal prend deux postures différentes selon la situation : un maintien nerveux, croupe redressée, lorsque l’un des éléments de la scène doit être réprouvé moralement. Le chien est alors placé à proximité ou joue explicitement le rôle d’admoniteur interne en regardant lui-même l’action blâmable : la mauvaise épouse qui s’apprête à décapiter son mari est ainsi menacée par un chien aboyant27. À l’inverse les deux jeunes mariés qui ont péri noyés mais sont considérés comme des époux légitimes, puisqu’ils ont scellé leur union religieusement, sont contemplés par un chien droit et placide28. On le verra, les costumes des personnages ont également un rôle sémiotique très fort dans la mise en image du texte et la représentation du monde social.
Mettre en images le discours matrimonial : l’iconographie entre remplois traditionnels et invention
Les historiettes narrées dans Houwelick et Trou-ringh proviennent, pour certaines d’entre elles, de l’Ancien Testament, même si Cats brode largement à partir du texte biblique. Dans l’édition in‑4° de Houwelick, deux exempla vétérotestamentaires sont illustrés : l’histoire du viol de Dina par Sichem (Genèse 30, 21) dans la partie « Maeght », celle du viol de Tamar par son demi-frère Amnon (2 Samuel 13). Ces épisodes ne sont pas très fréquemment représentés par les artistes au xviie siècle. Pourtant, Cats n’est pas le premier à y faire référence. Le viol de Tamar par Amnon sert d’illustration au sixième commandement dans la série réalisée par Maarten van Heemskerck en 156529. Dans ce cas, le sixième commandement, habituellement formulé en « Tu ne commettras point d’adultère », a un sens élargi en « Tu ne seras pas impur » : c’est déjà le cas au xve siècle dans le Zielentroost30. En 1569, le même Maarten van Heemskerck illustre la luxure (illicita voluptas) par une gravure représentant le viol de Dina par Sichem. Le même sens prévaut donc, et – chose remarquable – l’iconographie d’Adriaen van de Venne a des points communs avec la gravure de van Heemskerck. Le choix de Cats et van de Venne de narrer ces récits et de les illustrer n’est sans doute pas dû au hasard. Les deux renvoient, dans la culture visuelle du début du xviie siècle, à l’iconographie du Décalogue31. Les images ont donc une fonction tropologique : les jeunes filles – le public visé explicitement (mais sans doute pas exclusivement) – doivent être incitées non seulement à se prémunir des hommes qui se rendraient coupables du péché condamné par le sixième commandement, mais à s’en garder elles-mêmes.
Ill. 9 : Adriaen van de Venne, pl. : J. Cats, Trou-ringh, op. cit., 1637, « Onlust midden in de lust ontstaen », p. 258, Cliché auteur
Outre les usages explicites de l’iconographie vétérotestamentaire, les illustrateurs y ont recours pour illustrer des histoires profanes. La relation adultérine racontée dans l’historiette « Déplaisir survenu au milieu des plaisirs » (« Onlust midden in de lust ontstaen ») met en scène un jeune Joncker de bonnes mœurs qui s’éprend d’une femme mariée et la courtise sans succès32. L’époux, sans rien savoir, rencontre le gentilhomme à la chasse, le trouve très honorable et en fait la louange à sa femme. Désormais sous le charme, elle profite d’une absence de son mari pour attirer le jeune homme dans son lit. L’image montre l’instant où, en apprenant que le mari a fait son éloge, le Joncker refuse de le déshonorer et quitte précipitamment le lit conjugal (ill. 9). On retrouve l’iconographie traditionnelle de « Joseph et la femme de Putiphar », à un détail près – le manteau arraché – qui est ici absent. Même si les deux histoires diffèrent sensiblement, la captation du modèle vétérotestamentaire par l’artiste vient souligner l’interprétation légitime de l’histoire que doit en faire le lecteur-spectateur : ici encore la condamnation du péché d’adultère – le sixième commandement est illustré, surtout à partir de Cranach, par l’iconographie de « Joseph et la femme de Putiphar » – et de l’épouse tentatrice, sur qui l’intégralité de la faute est finalement rejetée.
Par les liens intertextuels (ou plutôt intericoniques), les correspondances qu’elles établissent de manière plus ou moins explicite, les illustrations stimulent la mémoire du lecteur-spectateur. Suivant le principe de l’exemplum, ces images du singulier ramènent à la leçon générale à en retenir33.
Rites du mariage et représentation du monde social
Jacob Cats ne fait à peu près jamais référence au statut social de ses lecteurs34. Lorsqu’il les apostrophe, seul leur statut familial semble compter : jeune fille, épouse, veuve, mari, père, etc. Le parti pris généraliste de l’auteur, perceptible dans les deux ouvrages35, tient probablement à trois déterminations. D’abord, ses ouvrages s’inscrivent dans une tradition littéraire avec des conventions propres : l’ouvrage de Juan Luis Vivès, L’institution de la femme chrétienne, est une de ses sources d’inspiration principales. Or Vivès dispensait des conseils sans jamais, lui non plus, faire allusion au statut social de l’homme ou de la femme. Ensuite, il y a chez Cats comme chez tous les auteurs du temps, la conviction que la nature de la femme et les relations qu’elle entretient avec le sexe fort ont été établies au moment de la Création, et ne dépendent pas du milieu social dans lequel elle a été élevée. La plupart des exemples utilisés par l’auteur sont empruntés à la nature, à la Bible ou à l’Histoire, et évitent ainsi toute référence explicite au monde social contemporain. Enfin, pour les autres exemples, il y a certainement un « élito-centrisme » qui incite l’auteur à s’inspirer de son propre groupe social – le patriciat urbain – pour élaborer son modèle, par définition unique et idéal, des relations conjugales, et faire de l’élite un étalon de référence : pas de place ici pour les contraintes des femmes dont l’horizon dépasse leur propre intérieur domestique – paysannes, femmes des métiers, domestiques, etc. Lorsqu’elles apparaissent, elles ne valent pas en tant que femmes, mais comme symboles d’une vérité sous-jacente36. Cats et Adriaen van de Venne adoptent donc les codes culturels et visuels des milieux aisés, notamment par la représentation du vêtement37. Ils ancrent le propos visuel, dans les images du monde contemporain, dans un milieu social bien défini, dans lequel l’élite, par définition, se reconnaît, et qui sert de modèle aux autres groupes sociaux.
Ill. 10 : Adriaen van de Venne, pl. : J. Cats, Trou-ringh, op. cit., 1637, « La petite bohémienne espagnole », p. 487, Cliché auteur
Mais la leçon catsienne qui vise à mettre en ordre la société matrimoniale s’appuie également sur la représentation du monde social que se fait l’illustrateur et qu’il exprime dans les images. Une des caractéristiques visuelles des scènes qu’il dessine est le recours au plan rapproché. Par ce moyen, il rend le plus visible possible les protagonistes, leurs expressions, leurs vêtements, leurs attitudes. Le rôle de chacun, le caractère moral ou répréhensible de son action ou simplement sa relation avec les autres sont explicités par ces dispositifs qui ont une fonction sémiotique et prescriptive.
Le thème du choix du conjoint est révélateur. Au xviie siècle, les moralistes du mariage, de part et d’autre de la frontière confessionnelle, insistent en général sur l’adaequatio entre les partenaires : similitude du statut social, de la richesse, proximité des âges (les jeunes avec les jeunes, les vieux avec les vieux), identité de la confession38. Le problème de la différence sociale entre les deux partenaires est traité par van de Venne par une sémiotique des vêtements et des postures (ill. 10). Roi et bergère, gentilhomme et bohémienne, ou encore jeune fille « bourgeoise » et philosophe gyrovague : l’un est habillé richement, l’autre est affublé de tenues pauvres, quelquefois ridicules39. Le gentilhomme prend une pose typique des portraits d’apparat italiens ou espagnols, la main sur la hanche et les pieds à angle droit dans des souliers à rubans, lorsqu’il s’adresse à la jeune bohémienne assise à terre, affalée contre un arbre et les pieds presque nus. Le trait de Adriaen van de Venne peut aller jusqu’à la caricature : le philosophe Cratès est un bossu dont l’habit tranche avec toutes les autres illustrations, trop simple pour s’accorder avec la riche parure d’Hipparchia. Il est debout devant la jeune fille, dignement assise sur une chaise.
En revanche, chez Cats, la question de la différence confessionnelle – et donc des mariages mixtes – est à peu près passée sous silence dans le texte, et jamais envisagée par l’image. Dans leurs études, Donald Haks d’une part, pour les Provinces-Unies à partir de la fin du xviie siècle, et Hans Storme d’autre part, pour les Pays-Bas espagnols, ont constaté une forte condamnation des mariages mixtes de la part des pasteurs et moralistes (des clercs dans le cas des Pays-Bas espagnols). Cela doit être nuancé dans le cadre des Provinces-Unies de la première moitié du xviie siècle40. Or la voix de Cats, l’une des plus diffusées, ne s’intéresse pas au problème. Même si, ailleurs, il est visible que la culture religieuse de Cats est profondément calviniste, il ne réagit pas dans ce cas en tant que défenseur de la confession calviniste. Son message a une portée plus générale, valable pour toutes les composantes de la société encore peu confessionnalisée des Provinces-Unies, même dans les années 163041.
Les images de Houwelick au fil des éditions
Entre 1625 et 1664 – dernière édition du xviie siècle – Houwelick est imprimé vingt-cinq fois42. Le nombre, tout à fait exceptionnel à cette époque, des éditions successives (toutes illustrées) de ce best-seller, autorise une analyse de bibliographie matérielle pour aborder le problème de l’usage des images à l’intérieur du champ éditorial et du rapport des manieurs d’images à l’institution matrimoniale.
Au début, on suit l’itinéraire d’Adriaen van de Venne qui, après la mort de son frère Jan, prend des collaborateurs pour publier à nouveau l’ouvrage. Dès 1628, on l’a vu, il fait rééditer l’ouvrage au format in‑12° à La Haye où il réside, peut-être déjà par Joost Ockersz qui, deux ans plus tard, en 1630, réimprime sans modification ni du texte ni de l’image, la version originelle de 1625. C’est encore Ockersz qui imprime en 1632, dans un format plus grand (in‑8°), la version in‑12° de 1628 : la reprise des cuivres de petite taille se manifeste par l’existence de marges assez importantes.
Au contraire en 1634, Adriaen van de Venne change de collaborateur, et avec van Esch (imprimeur) et Havius (éditeur), réalise une édition in‑12° mais au format encore plus petit que celle de 1628. La typographie très serrée permet de réduire de 20 % le nombre de pages, et donc le coût de fabrication. La diminution de la taille des pages impose également à l’artiste de faire réaliser de nouveaux cuivres. Il en profite pour changer une fois de plus l’iconographie de plusieurs illustrations. Au final, sur cinq impressions ou éditions « officielles » – c’est-à-dire dans le cadre du privilège de van de Venne – trois corpus d’images ont été utilisés. Cette fois, le nombre de gravures redescend à trente-huit, permettant là encore de baisser le coût de production. Le frontispice est simplifié par rapport à l’édition in‑12° : aux six couples qui apparaissaient, Adriaen van de Venne substitue l’unique couple nuptial. La fiancée est à gauche de l’image : « reine d’un jour »43, mais aussi destinataire principal de l’ouvrage, il est logique qu’elle occupe la place prééminente. En 1628, l’illustrateur lui avait aussi accordé cette position : le frontispice, une version simplifiée de celui de 1625, montrait six couples. Pour chacun, la femme se trouvait à la droite de l’homme jusqu’au statut de femme mariée ; après, le mari comme tête du couple prenait la place d’honneur. En 1634, les deux époux tiennent désormais un « blason » sur lequel sont représentés deux mains jointes et, au-dessus, deux cœurs enflammés et liés par un ruban. Captant les codes des portraits nobiliaires du Moyen Âge et de la Renaissance, où l’on voyait un chevalier tenir son écu armorié – l’individu et son lignage44 –, cette façon de montrer le couple, d’une part ennoblit l’état matrimonial, d’autre part rassemble symboliquement les couples mariés dans une même parenté (spirituelle). Parmi les images incluses dans le texte, certaines iconographies proviennent de l’édition princeps in‑4°, d’autres de l’édition in‑12°. Une troisième catégorie comprend des images hybrides. Ainsi, dans le chapitre « Maeght » (jeune fille), une compagnie galante copiée dans l’édition de 1628 est juxtaposée, par un processus d’image dans l’image – une fenêtre ouverte – avec un des emblèmes de 1625. Tous ces cuivres sont des imitations simplifiées. Les scènes sont retravaillées pour que les personnages apparaissent en gros, en plan rapproché. La volonté didactique de van de Venne est donc toujours aussi manifeste. Mais les costumes changent : hommes et femmes, qui étaient six ans auparavant revêtus de vêtements luxueux, portent maintenant des habits plus simples, correspondant à une couche sociale plus modeste. Enfin, des gravures totalement nouvelles viennent accompagner des passages du texte jusque-là non-illustrés45. Si, dans le passage du format in‑4° au format in‑12° (1628), les images narratives prenaient le pas sur les images emblématiques, dans l’édition de 1634, l’artiste accentue cette tendance. Le corpus d’images résultant s’adresse plus aux sens, moins à l’esprit dont il exigerait une réflexion ou une méditation.
Le début des années 1640 coïncide avec la fin du privilège de quinze ans d’Adriaen van de Venne. Dès lors, d’autres éditeurs entrent en scène. L’ouvrage est imprimé essentiellement à Amsterdam, secondairement dans des centres comme Haarlem ou Dordrecht. De manière générale, le texte principal de Cats demeure là aussi, sauf exception, inchangé. Pour ce qui concerne les images, il ne s’agit plus seulement de copies conformes des illustrations originales : la plupart du temps, elles subissent une adaptation. Plusieurs modèles apparaissent.
Jan Jacobsz Schipper est le plus important des éditeurs de Cats à partir de 1642. Fort de plus de 170 éditions en trente ans, cet amstellodamois dirige un atelier de taille intermédiaire, d’où sortent assez rapidement des ouvrages en latin, et qui imprime des grands formats46. Il publie Houwelick pour la première fois en 1642, en format in‑8°, avec des illustrations inspirées de l’édition originelle de 1625 (in‑4°) : l’iconographie est identique, mais les personnages n’apparaissent plus en plan rapproché. L’accent est mis plutôt sur le décor, accentuant l’aspect récréatif de l’image. De prime abord donc, on a l’impression que la représentation du monde social compte moins. Et pourtant, pour toutes les scènes « contemporaines », l’artiste a pris soin d’adapter les costumes au monde dans lequel il vit. En 1664, l’imprimeur emploie d’autres planches, qui reviennent à un dessin proche de l’édition de 1642. À nouveau, les costumes des personnages contemporains sont modifiés pour s’adapter au style vestimentaire patricien des années 1660. Il s’agit pour l’artiste de rendre actuelle la scène, ce qui a une conséquence importante sur l’efficacité de l’image : la représentation actualisée des costumes neutralise l’effet d’exotisme engendré par l’insertion de planches déjà anciennes. Le regard, indifférent au cadre temporel, se concentre sur la signification sociale de l’image, en termes de codes culturels. Prenons l’exemple de la page de titre de la partie « Bruyt », spécialement réalisée au format in‑2° pour l’édition de 1664 : la scène est désormais dépourvue de références morales, emblématiques (comme celles qui ornaient le cadre en 1625) ou religieuses (sur la tapisserie derrière la mariée). Le décor domestique où la femme restait dans une attitude figée est remplacé ici par un espace d’apparat qui ressemble plus à une salle du trône. La mariée et ses deux demoiselles d’honneur sont debout sur une estrade, d’où elles dominent les hommes qui viennent les saluer sur le mode curial. À part l’inscription « Aucun anneau, aucune fête, aucune couronne de métal ou d’herbes ne fait la mariée, sinon un amour pur », à peine visible sur un phylactère qui disparaît en haut de la scène, le message moral a totalement disparu. Si Schipper est conscient du rôle édifiant de l’ouvrage, comme il le déclare lui-même dans sa préface47, son propos semble donc bien, en premier lieu, de fabriquer un bel objet, où l’élite puisse se retrouver par la référence à des codes visuels auxquels elle est habituée.
D’autres – petits – imprimeurs ont une relation beaucoup plus ambiguë à l’image, qui semble réduite au rôle de pure illustration dans leurs éditions. Nous avons affaire ici à des artisans modestes, qui ne procèdent chacun qu’à une seule (au plus deux) édition(s) du Houwelick et à chaque fois dans un petit format (in‑12°). La qualité matérielle de leurs ouvrages est faible48. Ils sont sensibles à l’économie de place et de papier, choisissent en conséquence des polices serrées. Ensuite, le travail qu’ils demandent aux graveurs est, sauf exception49, minimaliste : les planches utilisées, qu’il s’agisse de cuivres ou de xylogravures assez frustres, sont des copies serviles de planches antérieures. Elles sont reconnaissables par la symétrie miroir que l’opération de copie par le graveur implique. Dans le processus, le sens des images s’en trouve parfois dénaturé. La lecture du frontispice de Roeck (1650), copie du frontispice de 163450, est totalement bouleversée : la fiancée se retrouve à la gauche de l’homme. Chez Smient, dont l’ouvrage est la copie d’une copie, on retrouve donc la disposition originelle. Seul le frontispice n’est pas copié servilement : le graveur, Ian Iegers51, a intelligemment inversé la place du couple au premier plan afin, certainement, de respecter ce qu’il croyait être l’ordre héraldique. Ce dernier exemple est particulièrement révélateur. Iegers a copié sur ses bois l’iconographie de toutes les planches du texte, dont la lecture ne lui semblait pas modifiée par une symétrie miroir. En revanche il a bien vu que le frontispice nécessitait une lecture symbolique, où la place de la femme et celle de l’homme n’étaient pas indifférentes. Mais, en l’absence de l’édition originelle de van de Venne, il n’a pas pu se rendre compte que celui-ci avait cassé à dessein le code héraldique traditionnel.
Enfin, le rapport à l’image de ces artisans se manifeste dans le corpus qu’ils reprennent, et dans la manière dont ils lient illustrations et texte. Un cas extrême de cette relation à l’image se voit dans l’une des dernières éditions du xviie siècle, sortie des presses de Michiel de Groot à Amsterdam. L’imprimeur utilise à la fois des cuivres du Houwelick, mais également trois planches qu’il a utilisées l’année antérieure dans une édition du Minne-spieghel ter deughden de Jan Harmensz Krul. Même si la pratique du réemploi de planches est un phénomène connu chez les imprimeurs, cette attitude est particulièrement révélatrice du statut accordé aux images pour un ouvrage comme Houwelick, par un homme de l’art : il joue aux dominos avec son stock de planches, mais prend garde à puiser dans un réservoir iconographique qui a des résonances avec un discours sur le mariage et l’état conjugal, ou plus généralement les relations entre les sexes.
La restitution de ces parcours de l’objet Houwelick révèle plusieurs attitudes. D’abord, dans le cas de l’édition par Roeck, la logique du geste l’emporte sur la lecture. Les images sont retranscrites dans une symétrie miroir sans s’interroger sur une éventuelle perte de sens. D’autre part, il y a une dépendance au livre de départ. Un Iegers en revanche, qui a les compétences d’un artiste et connaît les codes de son milieu, recopie le frontispice dans une symétrie miroir, en prenant garde au respect de ce qu’il croit être une juste convention. L’image est adaptée, simplifiée, déformée, éliminée, parfois remplacée. Au fond, toutes ces rééditions renvoient à la notion de « traduction » : le corpus d’images est interprété et « traduit » par les imprimeurs, qui ont un rôle d’intermédiaires. Certains le reproduisent tel quel, dans un but commémoratif sans doute, d’autres l’adaptent, d’autres l’appauvrissent et le dénaturent, enfin de Groot le restitue de manière créative. Ces actions aboutissent à des résultats très variés d’accompagnement par l’image du discours matrimonial. Mais lorsque les éditeurs prennent le temps de réfléchir aux transformations qu’ils lui font subir, ils restent dans un contexte général d’un discours sur le couple.
Conclusion
Les traités matrimoniaux de Cats, par le nombre d’illustrations qu’ils contiennent et la complexité des procédés d’impression qu’implique l’usage de planches de cuivre, sont particulièrement chers. Or ces images n’ont pas qu’un but récréatif ou ludique : par la place qu’elles occupent dans les ouvrages, par leur nature et ce qu’elles montrent, elles condensent les idées importantes pour aider le lecteur-spectateur à saisir l’essence morale de chaque historiette, elles le renvoient à sa culture visuelle, et disent sur le monde social autant que le texte qu’elles accompagnent. Les images à caractère emblématique lient les institutions et la morale chrétienne à la nature et enseignent ainsi à lire et interpréter les éléments de la vie quotidienne en autant de leçons morales. Les illustrations-tableaux, aussi naturalistes qu’elles paraissent, mettent la société en ordre, assignent à chacun une place et définissent le type de relation entre les êtres.
Elles sont sans doute moins consubstantielles aux ouvrages que peuvent l’être les planches accompagnant certains livres jésuites illustrés produits à la même époque à Anvers – bibles en images, livres de dévotion, etc. En témoignent les réappropriations variées des éditions successives, à commencer par celles dues à l’illustrateur lui-même, qui montrent que certaines planches sont, à ses yeux, interchangeables, dans le droit fil de pratiques à la fois intellectuelles et éditoriales qui mêlaient confiance dans la topique et préoccupations économiques. Elles aident non pas tant à la compréhension du texte, qui ne recèle rien d’abscons, qu’à faire prendre conscience au lecteur-spectateur des préceptes les plus importants. Surtout, elles sont le résultat d’un vrai projet intellectuel qui, exprimé de manière vague par Cats sous une forme proche de l’adage horatien – pour le profit et le plaisir – comme peuvent l’être les images jésuites répondant au précepte cicéronien – docere, delectare, movere – est transcrit par Adriaen van de Venne de manière très concrète et très précise en une pédagogie visuelle du mariage.