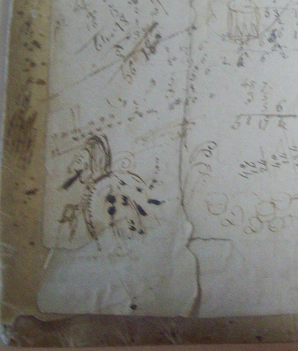Au terme de l’enquête menée dans le cadre du GDR « Les écrits du for privé en France de la fin du Moyen Age à 1914 », la somme de livres de raisons et de compte recueillis pour le Dauphiné est dense. L’Isère et, dans une moindre mesure, les Hautes Alpes ont été ciblés. Sous la direction de René Favier, deux doctorants de l’Université Pierre Mendès France, Nicolas Krautberger et Anne-Sophie Gallo1, ont dépouillé, entre 2008 et 2010, 198 livres où étaient susceptibles d’apparaître une prise de parole personnelle, conservés aux Archives Départementales de l’Isère, dans les séries H et J (181 livres) et aux Archives Départementales des Hautes-Alpes, séries F et J (17 livres). La moisson a ensuite été rentrée sous forme de fiches individuelles sur le site du GDR et est aujourd’hui consultable en ligne (www.ecritsduforprive.fr). Les livres de raison font l’objet de notices particulièrement détaillées, avec transcription de l’incipit et de plusieurs paragraphes. Certains livres étaient déjà connus, ainsi de ceux de Pierre-Philippe Candy, publiés et étudiés par René Favier2, ou encore du libraire grenoblois Jean Nicolas (1645-1668), analysés par Henri-Jean Martin et Micheline Lecocq3, mais la grande majorité n’a pas encore été étudiée. On peut ici en donner une présentation succinte, dans leur dimension chronologique, matérielle et thématique.
Temporalités, genres, auteurs
Les livres dépouillés s’échelonnent sur cinq siècles, de 1495 (livre de raison de François de Monteynard, seigneur de Marcieu, tenu en langue vulgaire entre 1495 et 1503) à 1917. Mais la plupart appartiennent aux XVIIe et XVIIIe siècles (respectivement 37 % et 45 %), ce qui reflète à la fois les conditions de la conservation, l’apogée de la pratique du livre de raison (la seconde modernité) et la préférence accordée lors des dépouillements au livre de raison plutôt qu’au journal. Il faut en effet distinguer plusieurs types d’écrits du for privé, qui se déclinent en livres de raison, livres de comptes, journaux ou diaires, livres de voyage et mémoires. Les plus nombreux dans le corpus du Dauphiné sont d’abord les livres de compte (ceux qui, a priori, ne contiennent pas d’écart extra-comptable, comme le sont les notes de naissance, de mort, les généalogies, ou les réflexions personnelles), ensuite les livres de raison. On décompte 119 livres de compte et 73 livres de raison, le reste étant disséminé entre voyages et mémoires. Ils émanent de scripteurs venus d’horizons divers. S’il y a 21 Grenoblois parmi les rédacteurs dont le lieu de résidence est connu, le reste est plus dilué : trois à Gap, deux à Briançon, La Côte-Saint-André, Bourgoin, un à La Mure, à Saint-Marcellin. Une trentaine de ruraux est précisément localisée, dans les environs de Grenoble (Le Sappey, Bresson), mais aussi au-delà (Beaurepaire, Roybon, La Tour du Pin…). Enfin, le spectre social est large : si les élites dominent, nobles et ecclésiastiques en premier lieu, hommes du droit ensuite, on repère également des artisans, ce qui rappelle que les gens de métier ont aussi eu une entrée en écriture précoce et parfois prolifique (cordonniers, maréchal ferrand, menuisier et vitrier, maître gantier, charpentiers, maçon, imprimeur). Il faut également faire une place aux femmes qui, bien que minoritaires, sont néanmoins présentes : 11 femmes [ayant tenu 15 livres] émergent du corpus, certaines ayant tenu conjointement le livre avec leur mari, ou l’ayant repris à la mort de ce dernier, telle la veuve d’un ancien militaire et commerçant de vin de Vourey en 1852.
| Statut social | Auteurs de livres de raison | Auteurs de livres de comptes |
| Noblesse | 10 | 10 |
| Clergé | 6 | 4 |
| Notaires | 6 | 1 |
| Procureurs | 3 | 2 |
| Avocats | 4 | 2 |
| Greffiers | 1 | |
| Médecins, chirurgiens | 3 | 2 |
| Marchands | 7 | |
| Artisans | 6 | 4 |
Matérialité et usages du livre
L’aspect matériel des livres de raison est extrêmement variable, ce qui retrouve les conclusions de Michel Cassan4 lors du colloque de Limoges. La taille oscille entre le petit format, qui tient en poche (12 × 7 cm pour le plus petit livre de raison), et le grand in-folio (41 × 27 pour le livre d’un anonyme de Beaurepaire, dans les années 1830). La dominante reste celle du grand livre : une moitié est comprise entre 26 et 30 cm de hauteur. La plupart des livres de raison dépouillés pour le Dauphiné sont reliés, manifestant parfois bricolage et réemploi, au temps du papier rare et des reliures coûteuses : la couverture d’un des livres de comptes de Jacques Maximy (1617-1619) est prise dans un contrat qui porte la date de 1610. Sur la couverture ou la première page peut figurer quelque sentence morale. Le même Jacques Maximy, seigneur d’Imbault de Moras, trace ainsi ce proverbe, sur la page de couverture :
Du temps passé en laage d’or
Crosse de boye evesque d’or
Maintenant sont changées les loye
Crosse d’or evesque de boye
On peut encore citer l’exemple de Louis Rancurel, qui note en première page, fin XVIIe siècle :
Souvienne toy pecheur que Dieu te regarde faict bien & lesse dire & ne blame personne & sui les commandement de Dieu disant Dieu soit loye & Marie Joseph & Saint Louis mon patron de quy je porte le nom Louis Rancurel.
Cela induit-il pour autant un usage sacralisé du livre de raison ? Dans une économie de la rareté, le livre peut être utilisé à des fins diverses et les scripteurs tracer de belles épigraphes liminaires puis ne pas hésiter à raturer, crayonner, faire des essais de signature et des dessins sur le même livre. Claude-Ignace de Trivio, président du parlement de Grenoble, inscrit sur la première page de son livre le titre adéquat, « Livre de Raison commencé le 15 juin 1779 […] ». En face, sur le contreplat de la couverture, figurent des comptes raturés, des additions, des essais de plume, des dessins : profils de visage d’hommes et de femmes et, ailleurs, un chien, des oies, un cheval, une miniature d’une promenade en campagne, des soldats. Athénée de Salvaing, qui prend la peine de donner la description de ses armes sous le titre de son livre de raison de 1667, note sur le dos de la couverture d’un autre une simple adresse.
Diversité des usages souvent attestée : le livre est inscription des dettes et des créances, de la mémoire familiale. Il a aussi une valeur probatoire, comme en témoignent les signatures qu’il porte souvent. Certains scripteurs le mentionnent d’ailleurs explicitement, comme le chanoine Pierre Dufour dans son incipit : « voulant que le tout soit aussi valable et authentique que si c’etoient des actes [remis] et signés par personnes publiques », ou le prêtre Bathazar Perrin en 1708 :
Livre de compte et de raison auquel ie veux estre aiouté foy comme a ce que iaurois stipulé et promis par acte public, ie declare qu’il contient verité et ie veux qu’on y ait tout legard qu’on doit à la probité d’un honnete homme en foy de quoi iay signé à Grenoble ce onzième novembre mil sept cent huict. Perrin prêtre.
La proximité des livres de raison avec les actes notariés et la ténuité de la frontière entre écrits publics et écrits privés sont encore marquées par le fait que le livre de raison contient parfois copie d’actes notariés, voire se présente comme leur succédané : ainsi, au XVIIIe siècle, pour Anne Le Camus de l’Estrade, de Gap, pour laquelle il fait office de testament : « Mesmoire de la disposition des meuble de ma personne lequel je prie mes heritiers d’executer comme sil estoit dans mon testament Je donne a lesglise des cordeillier de gap ma toilette […] ». Dans un cas, il est même tenu pour supérieur à l’acte passé devant notaire, puisque devant lui prévaloir : Salvaing de Boissieu note en deux endroits de son livre la déclaration suivante,
Je declare de rechef que quoique jay legué par un codicille a St Denys de Rivolle la somme de trois mille livres je revoque ledit legat et nentends pas que mes heritiers le lui paye […] telle est ainsi ma volonté fai au boissieu ce quinze avril mil sept cent et neuf. de salvain de Boissieu.
Richesse des thèmes et des recherches possibles
La diversité des thèmes abordés dans ces livres autorise des recherches en plusieurs directions. Quelques pistes peuvent être évoquées :
Famille et enfance : transmission du livre du père au fils, au gendre, aux héritiers, à la femme… ; progression de l’affect et de l’expression des sentiments : Jean-Jacques de La Bastie par exemple, fin XVIIIe siècle, mentionne le « soin de ma famille que j’aime » et parle de son épouse comme d’une
jeune femme dont les agremens personnels ne le cedent qu’a l’excellence de son cœur et au plus riche naturel ; vous qui voulés etre heureux, choisissés une femme honnete, agréable, aimante, sensible, imités notre union ; ayés si vous l’osés, notre confiance réciproque et sans restriction ; vivés, si vous le pouvés, dans un parfait accord de sentimens, de gouts, de volonté, de desir, et dans un oubli de vous meme pour ne vous penetrer que de ce qui peut plaire à ce que vous adorés ; sachés que le bonheur est dans l’amour et l’union ;
pratiques éducatives à travers la mise en nourrice, les dépenses faites pour les enfants
Pratiques d’écriture, pratique de lecture : raisons qui président à l’entrée en écriture (naissance, mort, prise de fonction, événement perturbateur comme la soudaine perte d’argent et l’avancée vers la vieillesse pour le président de Trivio par exemple, aspiration spirituelle peut-être, comme pour Madeleine de Franc étudiée par Marjorie Dennequin5), rythmes d’écriture, modèles d’écriture pris dans les lectures de livres de littérature (les livres contenant parfois des inventaires de bibliothèque, voire les achats livresques au fil de l’eau : « ledit jour j’ai acheté la collection in 8° en 24 volumes des œuvres de j.j. Rousseau de brette libraire » écrit de Trivio, en 1782), mais pris aussi dans les textes administratifs et notariés (avec cette tension – complémentarité ou concurrence ? – entre actes publics et écrits privés) ; évolutions des genres textuels entre XVe et XIXe siècle
Activités et professions : pistes particulièrement riches pour l’artisanat, la médecine (plusieurs livres de comptes de médecins, chirurgiens et vétérinaires des XVIIIe et XIXe s. : on trouve chez un médecin des environs d’Allevard, entre 1791 et 1799, la date de la consultation, le nom, le prénom du patient, le détail de l’acte et le prix à payer), ou encore le clergé : du curé de montagne Leyraud-Badel, on conserve ainsi plusieurs livres entre 1730 et 1753. Dans celui de 1734, sont détaillées minutieusement toutes les vexations qu’il subit et la cabale qui se monte contre lui, animée par deux de ses paroissiens, qui jouent de leur pouvoir de répartir l’impôt pour couper le curé de tous ses soutiens. Exagérations, voire affabulations ? Mais le curé se retrouve bel et bien engagé dans un procès avec ses deux paroissiens, et est finalement « muté » par sa hiérarchie dans la cure peu reluisante de Bresson, qu’il décrit dans un autre livre comme la pire des cures : l’église est un « cloaque & amas d’eau des qu’il pleut », « la cuvette [des fonds baptismaux] couverte d’ordure en dehors & en dedans », « il exhale du tabernacle quand on l’ouvre une puanteur extraordinaire ». Dans les livres de Leyraud-Badel, on saisit les rivalités au sein d’une petite paroisse (Le Sappey en Chartreuse), entre curé et collecteurs d’impôt, entre curé et maître d’école, ainsi que la difficulté d’asseoir son pouvoir, ou, plus prosaïquement, d’exercer son ministère. Voici des extraits du livre de 1734-1750, dont on peut penser qu’il a constitué un solide répertoire de preuves au moment du procès :
[décembre 1734] le curé avoit oui dire que le bruit couroit qu’on ne lui donneroit pas la passion en bled comme à l’ordinaire qu’on vouloit réserver ce qu’on lui auroit donné en bled pour le maître d’école les chefs du complot en effet leverent le masque […]
le 16e mars suivant on assura le curé que le greffier et pierre Mollard avoient dit plusieurs fois et en plusieurs endroits que ceux qui donneroient la passion en bled au curé seroient augmenter à la capitation l’année suivante
le 15e may 1735 Cathelin M s’est plaint au curé qu’on l’avoit augmenté de vingt sols à la capitation parce qu’il continuoit d’envoyer ses enfants chez le curé [et non chez le maître d’école]
le 29 mai […] toutes les fois qu’il [Pierre Mollard] chantoit [à la messe] il affectoit d’arrester tous les autres en allant beaucoup plus vite dans des endroids, traisnant beaucoup dans d’autres et ne finissant que longtemps apres tous les autres ce fut un scandale
Economie rurale, météorologie : possibilité de confronter les livres dauphinois aux journaux déjà étudiés, comme celui de Pierre Bordier par Jean Vassort6. Le propriétaire terrien Gabriel Jacoz note ainsi dans un petit cahier (aujourd’hui en très mauvais état) les vendanges, moissons, orages, grêles, gelées, chenilles, tremblements de terre, comètes… à la fin de chaque année, entre 1628 et 1685.
Gestion de biens, gestion des siens : ménage, gages, mobilier, linge, livres, aumônes, blanchissage, enfants, réparations, cheval-bâtiments, culture, placements-virements sont quelques-unes des catégories qu’établit par exemple Gustave de Linage (1867-1875).
Territoire / mobilité : déplacements très souvent notés par les scripteurs, parfois le tarif des douanes, l’aménagement routier (un arpenteur des Ponts et chaussées décrit dans ses Mémoires les toutes premières mesures d’aménagement des routes dans les Alpes au début du XIXe siècle)
Santé / corps : maladies propres au scripteur et à ses proches notées, surtout, pour ces derniers, lorsqu’elles leur sont fatales ; recettes (médicinales et culinaires). La saignée est, au milieu du XVIIIe s. encore, préconisée comme remède infaillible par Jacques Second :
Remède contre la folie même contre la rage pourvu qu’elle ne soit pas de naissance.
Faites saigner abondammant et ensuite purger abondamment le malade, après vous faites saigner aux cotes un âne, si c’est pour une femme, et si c’est pour un homme il faut une anesse, vous faites tiédir de l’eau environ un pot dans une marmitte plat ou casserole, que vous avez préparé avant la saignée.
Comme le sang sort de la veine, vous le faites couler sur un mouchoir de toile bien blanche et l’essuyez et le tordez et lorsque ce mouchoir sera ternit de sang vous le tremperez dans cette eau tiède et vous retirerez promptement et laisserez couler le sang dans une écuelle après quoi vous continuerez de faire couler le sang de la veine sur le mouchoir que vous tremperez de même dans l’eau tiède, le retirerez promptement et laisserez découler dans l’écuelle jusqu’à ce qu’il y en ait une grande demi écuelle. A la fin vous pourrez presser un peu le mouchoir mais très légèrement pour faire plus facilement découler le sang dans l’écuelle, vous donnerez à boire le sang à jeun, laisserez ensuite le malade quatre heures sans lui rien donner.
Et l’on continuera ce remède de 2 en 2 jours ou de trois en trois jours selon que le mal diminuera.
Remède qui a été éprouvé on s’en est très bien trouvé
Politique, religion (missions d’un prêtre dans tout le Dauphiné dans les premières années du XVIIIe siècle)
Si les investigations menées dans le cadre du GDR n’ont pas permis de découverte aussi exceptionnelle que celle du Journal de Pierre-Philippe Candy, ce notaire de Crémieu qui, à la veille de la Révolution, tient une double comptabilité, l’une de ses recettes et dépenses, l’autre, sous forme codée, de ses pratiques sexuelles, elles ouvrent néanmoins de vastes possibilités d’études sur les écrits du for privé. Des écrits qui, même réduits à des listes de comptes, restent intimement liés à leur scripteur, comme l’enseigne ce maître cordonnier du XVIIe siècle : « Le présent livre appartient à moi Denis Bérenger, qui le trouveras me le rende. »