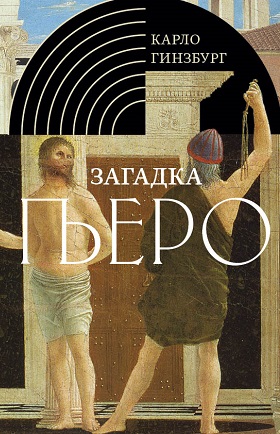Couverture de la traduction de Carlo Ginzburg, Indagini su PIero della Francesca
Il n’est pas trop difficile de décrire le travail d’un traducteur professionnel qui est aussi un historien professionnel. En voici un exemple. L’un des meilleurs traducteurs russes du français, Mark Grinberg, est décédé le 14 juillet 2023. Il a fait connaître Yves Bonnefoy et Louis-René des Forêts aux lecteurs russes. Il a aussi traduit d’autres auteurs connus comme Philippe Jaccottet, Paul Celan ou Jean Starobinsky. Véra Milchina, autre traductrice célèbre du français vers le russe, raconte dans sa notice nécrologique une anecdote révélatrice1. Le livre Histoires de peintures du fameux historien de l’art Daniel Arasse, a été traduit par Grinberg, et doit bientôt être publié en Russie. Le livre est composé à partir de conférences radiophoniques qu’Arasse a données avant sa mort et qui ont été transcrites et publiées. Milchina écrit :
« Il semblerait qu’il s’agisse d’une chose simple – il suffit de prendre le texte français et de le traduire. Mais Grinberg ne s’est pas contenté de traduire, il a réfléchi ». Dans le livre d’Arasse on peut notamment lire que “l’une des Annonciations attribuées à Fra Beato Angelico avait été vue par ‘son ami Machiavel’”. Mais Machiavel est né une décennie et demie après la mort de Fra Angelico et n’a donc pas pu être son ami. Comme les conférences d’Arasse sont disponibles sur YouTube, Grinberg a commencé à les écouter pour comprendre ce qui s’y disait et a ainsi deviné qu’au lieu de ‘son ami’, Arasse prononçait ‘Zanobi’, avec l’accent français porté sur la dernière syllabe. Il s’agissait, bien sûr, non pas du grand penseur politique Machiavel, mais de son homonyme-artiste peu connu – Zanobi Machiavelli (ce qu’il fallait d’abord entendre, puis rechercher dans une encyclopédie pour en avoir la confirmation) ».
C’est ainsi, à mon avis, que travaille un traducteur – en véritable historien.
Je dois avouer que je ne suis pas vraiment un traducteur. En fait, je ne traduis qu’un seul auteur, l’historien italien Carlo Ginzburg. J’ai traduit son Enquête sur Piero della Francesca (Indagini su Piero) (dont la deuxième édition russe vient de paraître), son livre sur le procès Sofri Le Juge et l’historien (Il giudice e lo storico) et le livre À distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire (Gli occhiacci di legno) (en collaboration avec le traducteur Sergei Kozlov). J’ai tous juste fini de traduire Les rapports de force (I rapporti di forza), l’année prochaine j’espère traduire Le fil et les traces (Il filo e le tracce). En outre, j’ai traduit quelques articles de Giovanni Levi (en particulier, son texte « La microhistoire et la global history2 »). J’ai aussi été le rédacteur de l’édition russe du livre de Ginzburg Mythes, emblèmes, traces ; morphologie et histoire (Miti, emblemi, spie) et du livre de Roger Chartier Culture écrite et société, traduit par Irina Staf. En même temps je suis slaviste et je m’intéresse à l’histoire intellectuelle russe et européenne du XIXe siècle et surtout à l’histoire de la pensée politique. C’est pourquoi les raisons pour lesquelles j’ai choisi de traduire les œuvres de Ginzburg ne sont pas évidentes. Je crois le faire pour trois raisons principales :
-
J’aimerais que les lecteurs russes puissent partager mon enthousiasme pour les écrits de Ginzburg. Il est toujours très intéressant de suivre l’évolution de sa pensée, d’assister à une sorte d’enquête académique qui, à certains égards, ressemble aux investigations d’un détective privé comme Sherlock Holmes.
-
Mon désir de traduire Ginzburg découle de mon intérêt pour la méthodologie des sciences humaines.
-
Les livres et les articles de Ginzburg sont, non seulement brillants du point de vue scientifique, mais aussi extrêmement captivants. Ils se sont aussi avérés très utiles pour mes recherches scientifiques personnelles.
Mon article sera structuré suivant ces trois perspectives. D’abord, je voudrais ouvrir une réflexion sur le message épistémologique et intellectuel que peuvent transmettre les traductions de cet auteur. Ensuite, je parlerai des influences que pourrait avoir la traduction des œuvres de Ginzburg dans le domaine des sciences humaines (plus précisément – en Russie). Et finalement, je voudrais me concentrer sur les effets de la traduction dans mon parcours intellectuel en tant qu’historien.
Pour commencer, voyons comment ont été traduits en russe les livres des plus grands auteurs italiens dans le domaine historiographique de la microhistoire. Commençons par Ginzburg. Le premier livre traduit en russe a été la monographie Le fromage et les vers, publiée tardivement en 2000, 24 ans après sa publication en langue originale. En 2004, la traduction du recueil d’essais Mythes–emblèmes–traces a été publié, puis, en 2019, la traduction de l’Enquête sur Piero della Francesca, en 2021, Le juge et l’historien et À distance, sans compter quelques articles dans diverses revues d’histoire. Il manque donc encore en Russie des traductions de livres importants tels que Les batailles nocturnes (I benandanti), Le sabbat des sorcières (La storia notturna), et Néanmoins. Machiavel, Pascal (Nondimanco. Machiavelli, Pascal). Si on observe les traductions de Giovanni Levi, on doit constater qu’en Russie en ce moment il existe seulement une traduction de son étude désormais classique Le pouvoir au village (L’eredità immateriale). Seuls quelques articles de Edoardo Grendi et Simona Cerutti ont été traduits. Entre-temps, Ginzburg s’est souvent rendu en Russie avant la pandémie et la guerre, pour donner des conférences qui ont toujours attiré l’attention d’un grand nombre de personnes. Cerutti et d’autres représentants de la microhistoire sont également venus à Moscou, par exemple le spécialiste hongrois Istvan Szijarto et le microhistorien islandais Sigurdur Gylfi Magnusson. On peut conclure que, malgré un nombre relativement restreint de traductions, l’intérêt pour les études microhistoriques en Russie existe et augmente au fil du temps, même si aujourd’hui il est bien difficile de comprendre quel sera le destin des sciences humaines en Russie, car il est probable que nous sommes à la veille d’une crise profonde liée à la politique isolationniste de Poutine.
Un autre événement témoigne de la persistante vivacité de l’intérêt pour la microhistoire en Russie : l’une des plus prestigieuses maisons d’édition dans le domaine des sciences humaines, “Novoe literaturnoe obozrenie” (“Nouvel observateur littéraire”), a ouvert une nouvelle série qui s’appelle “Microhistoire” dont je suis l’un des quatre rédacteurs en chef. Le premier livre de cette série est une anthologie composée d’articles publiés dans les années 1990 dans l’almanach “Kazus” (c’est-à-dire “un cas”) édité par le spécialiste russe de l’histoire médiévale européenne Yuri Bessmertnyj. Nous avons aussi publié la traduction russe du livre de Natalie Zemon Davis Léon l’Africain. Un voyageur entre deux mondes (Trickster Travels). Ensuite, à la fin de cette année nous espérons publier la traduction d’une autre étude microhistorique célèbre : Love and Death in Renaissance Italy de Thomas Cohen.
Pourquoi les lecteurs, surtout les lecteurs professionnels, lisent-ils les œuvres de Ginzburg ? L’intérêt pour la microhistoire en Russie fait partie d’un processus plus large de diffusion de la méthode microhistorique dans le monde. Lors d’un entretien en 2015, Ginzburg a souligné que « la microhistoire se répand dans le monde en différentes vagues : initialement, elle a été développée en Italie, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis ; ensuite, la méthode a été reprise dans des pays tels que la Corée du Sud, l’Islande, la Hongrie, le Mexique »3 et, récemment, le Brésil. Ginzburg note que la popularité de la microhistoire dans les pays périphériques est due à son potentiel critique : la microhistoire est souvent utilisée comme un » outil pour renverser les hiérarchies académiques », pour démontrer qu’« un livre sur l’histoire d’un village de pêcheurs islandais peut être aussi important qu’un autre ouvrage sur la Révolution française ». Grâce à la microhistoire, il est devenu possible d’approfondir l’étude de cas ou d’événements particuliers, en évitant à la fois l’abstraction de l’histoire sociale basée sur l’approche statistique et les limites des “études de cas” qui ne parlent souvent que d’elles-mêmes. La microhistoire cherche à établir une relation claire et compréhensible entre les différents niveaux d’analyse afin de parvenir à des généralisations méthodologiquement correctes et convaincantes. Grâce à cette capacité, la microhistoire reste « un projet très prometteur » sans prétendre devenir une sorte d’orthodoxie. Comme le dit Ginzburg dans le même entretien, « l’histoire peut et doit être étudiée à partir de différents points de vue ».
Une autre valeur importante de la méthode microhistorique est soudainement et tristement devenue d’actualité dans le contexte de la terrible catastrophe qui se produit actuellement. Il y a deux ans, Ginzburg a rédigé la postface de l’édition russe de son livre Le juge et l’historien, dans laquelle il décrit comment la microhistoire peut servir d’arme contre la propagation des fake news. Là, Ginzburg s’appuie sur l’expérience d’une conférence qu’il avait donnée il y a quelques années à Moscou au “Mémorial” russe, une organisation qui s’occupait de l’histoire de la répression de masse à l’ère soviétique. Ses collègues du “Mémorial” lui avaient demandé si la méthode qu’il utilisait pour interpréter le matériel des procès inquisitoires fonctionnerait également pour l’analyse des processus politiques des années 1930. Ginzburg avait répondu par l’affirmative. Dans sa postface, il ajoute que la microhistoire repose sur une critique philologique des sources, ponctuelle et rigoureuse. L’esprit critique permet de lutter contre les fakes news mais aussi contre les prophéties autoréalisatrices définies par le sociologue américain Robert Merton : « La prophétie auto-réalisatrice est une définition erronée de la situation qui suscite un nouveau comportement permettant à la conception erronée à l’origine de se réaliser comme vrai »4. Comme le dit le théorème de Thomas, qui a servi de référence à Merton : « Si les hommes définissent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences »5.
Comme le disait encore Ernest Renan en 1882 lors de sa conférence Qu’est-ce qu’une nation ?, l’histoire est le pire ennemi du nationalisme. Il écrivait ainsi : « L’oubli, et je dirai même l’erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d’une nation, et c’est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. L’investigation historique, en effet, remet en lumière les faits de violence qui se sont passés à l’origine de toutes les formations politiques, même de celles dont les conséquences ont été le plus bienfaisantes. L’unité se fait toujours brutalement »6. Le même principe peut être appliqué aux régimes autoritaires. Ce n’est donc pas une coïncidence si, en décembre 2021, juste avant le début de la guerre, le tribunal a rejeté le “Mémorial” comme étant idéologiquement dangereux. Le “Mémorial”, avec ses recherches historiques sur le stalinisme, empêche Poutine et ses collaborateurs de créer une fausse image des années 1930. Depuis longtemps la population russe vit exclusivement dans un monde composé de milliers de fake news et de prophéties autoréalisatrices, dans lesquelles les Ukrainiens ont attaqué la Russie en premier et continuent de se bombarder eux-mêmes (il est nécessaire de souligner que cela ne justifie pas les personnes qui soutiennent la guerre, mais peut nous aider à comprendre mieux ce phénomène actuel). Dans ces circonstances tragiques, la microhistoire assume une fonction politique d’une importance non négligeable.
À mon avis, il y a encore une autre raison pour laquelle le projet scientifique de la microhistoire italienne mérite une attention particulière. Ginzburg, Levi, Gribaudi et les autres spécialistes soulignent l’importance du concept de « preuve » pour la recherche historique. Il ne s’agit pas seulement du « paradigme indiciaire » de Ginzburg. Pratiquement chaque livre de la série “Microstorie” (“Microhistoires” au pluriel) de la maison d’édition Einaudi publié dans les années 1980 contenait une réflexion sur les arguments, ou les « preuves », valables et ceux plutôt infondés. À la lumière de cette stratégie, le livre susmentionné de Ginzburg, Enquête sur Piero della Francesca, premier livre de la série “Microhistoires”, est particulièrement intéressant. Ginzburg tente de résoudre un problème technique, pour ainsi dire : comment dater les tableaux en l’absence d’informations précises sur les circonstances de leur création. L’historien renonce à dater les œuvres d’art en se fondant sur des arguments purement stylistiques et soutient que les peintures doivent être interprétées dans leur contexte historique à partir de la figure du commanditaire. Ginzburg parle d’une sorte d’incursion de l’historien dans le domaine de l’histoire de l’art qui est en fait très utile car elle permet aux chercheurs des deux disciplines d’améliorer leurs outils d’analyse. L’interprétation que Ginzburg présente dans son livre en est une autre illustration, lorsqu’il étudie le mécène de Piero della Francesca, un noble d’Arezzo, Giovanni Bacci, et son rôle dans le processus de la création de la célèbre Flagellation du Christ à Urbin.
Ginzburg parle non seulement de la datation des peintures de Piero, mais aussi de la méthode scientifique en tant que telle. Les étapes de son analyse s’accompagnent presque toujours d’une réflexion sur les preuves et la véracité de ses conclusions : certaines conclusions lui semblent sûres, d’autres, au contraire, restent plus hypothétiques. Il est donc important de savoir non seulement ce que l’historien dit exactement, mais aussi comment il parvient à son hypothèse. Ginzburg propose à ses collègues une sorte de métalangage méthodologique qui peut être utilisé pour critiquer les hypothèses scientifiques. L’historien peut se tromper, mais la réflexion sur la qualité de ses hypothèses rend son erreur fructueuse car elle lui permet de poser les bases épistémologiques de ses affirmations. D’ailleurs, dans la réédition de sa monographie en 1994, Ginzburg a ajouté quatre annexes. L’une d’entre elles est consacrée à son interprétation erronée de l’écharpe rouge, appelée « il becchetto », portée par l’un des personnages au premier plan de la Flagellation du Christ. Ginzburg l’interprétait comme un signe cardinalice, alors qu’il s’agissait en réalité d’un simple élément vestimentaire de la Renaissance. Paradoxalement, aucun de ses critiques n’a prêté attention à ce fait. C’est Ginzburg lui-même qui, dans ce livre, réfléchit aux conséquences de cette erreur sur ses conclusions finales.
En outre, en 1994, un numéro spécial de la revue Quaderni storici a été consacré à la discussion du problème de la preuve dans les sciences humaines. Cinq chercheurs – Carlo Ginzburg, Giovanni Manetti, Paolo Desideri, Giuseppe Pucci et Paolo Vineis – ont discuté du développement de différents modèles d’argumentation dans divers domaines disciplinaires, de l’histoire à la jurisprudence. L’idée générale qui unit toutes ces contributions est que des preuves relativement faibles font néanmoins partie de la recherche historique. Le passé contient inévitablement des lacunes qu’il est impossible de combler à l’aide de preuves solides. C’est pourquoi il est souvent tout aussi indispensable d’émettre des conjectures, mais il est nécessaire de réfléchir à quel point elles peuvent ou non s’avérer exactes. L’histoire des sciences, d’Aristote à Arnaldo Momigliano, montre clairement qu’une telle procédure est plus qu’autorisée. Comme l’affirme Ginzburg, il ne faut pas avoir peur de faire des conjectures audacieuses, mais elles doivent être vérifiées de manière stricte, adéquate et sans compromis.
Un article publié dans le numéro spécial de Quaderni storici a été écrit par un chercheur d’un autre domaine disciplinaire. Il s’agit du texte intitulé « La preuve en médecine » (« La prova in medicina »7) de Vineis, épidémiologiste et historien des sciences. Sa contribution est particulièrement intéressante parce qu’elle concerne un champ disciplinaire différent et permet d’établir un lien entre l’histoire, la jurisprudence et la médecine. Vineis distingue les preuves « fortes » des preuves « faibles ». La preuve forte se réfère aux lois de la nature vérifiées au cours de toute une série d’expériences. Les preuves faibles sont fondées sur des conclusions non expérimentales et sont souvent utilisées dans des sciences telles que l’histoire, l’histoire de l’art, l’histoire littéraire et la médecine. Les preuves fortes sont déductives, les preuves faibles sont inductives, mais n’en deviennent pas moins scientifiques. En épidémiologie, comme en histoire, l’argument est basé sur l’observation. Vineis écrit : « L’épidémiologie, tout en reconnaissant que l’expérience clinique contrôlée joue un rôle crucial dans les circonstances où elle peut être appliquée, retrouve une partie de la tradition “herméneutique” dans la mesure où elle considère l’observation médicale comme un processus cyclique de conjectures et de réfutations de nature non expérimentale ». Le chercheur conclut : « la médecine est avant tout un récit historique, synthétisant la capacité d’écoute, l’habileté d’observation et la reconnaissance lucide de ses erreurs ».
Prêter attention à la qualité des preuves permettrait non seulement de rendre le récit historique plus convaincant, mais aussi d’atteindre un autre objectif. Je fais ici principalement référence au contexte scientifique russe. Dans mon domaine disciplinaire – l’histoire intellectuelle et l’histoire de la pensée politique – la majorité des études (je dirais même 90 %) ont un caractère purement descriptif. Cela signifie que les chercheurs essaient moins de répondre à une question scientifique claire et précise ou de combler une lacune historiographique existante que de créer une image cohérente de la pensée d’un philosophe politique et des actions d’un intellectuel. La lecture de ces contributions représente toujours un grand effort, car on ne sait souvent pas très bien quel est leur objectif scientifique. La microhistoire dispose d’un excellent outil d’analyse qui évite l’extension de la méthode descriptive et invite les chercheurs à émettre des hypothèses audacieuses et à tenter de les vérifier rigoureusement sans craindre de se tromper. Dans cette perspective, la traduction des œuvres de Ginzburg est essentielle et pourrait aider les chercheurs à mieux définir leurs objets de recherche et leurs instruments analytiques. Il est vraiment difficile d’établir un pronostic pour l’avenir parce qu’en ce moment en Russie les sciences humaines font l’objet d’une saturation idéologique souvent très agressive. Mais, malgré tout, dans le contexte actuel, la présence des traductions russes des livres de Ginzburg dans les librairies peut avoir des conséquences positives pour les sciences humaines.
L’un des problèmes méthodologiques les plus compliqués associé à la méthode microhistorique est la généralisation, c’est-à-dire le passage du niveau d’un cas particulier ou d’un groupe de cas à des conclusions plus globales sur des phénomènes dépassant le contexte historique spécifique initial. La solution de ce problème a fait couler beaucoup d’encre, y compris chez les chercheurs français (voir, par exemple, le recueil Penser par cas édité par Jacques Revel et Jean-Claude Passeron ou un autre recueil Les jeux d’échelle sous la direction de Jacques Revel). Dans mes propres recherches, j’ai été confronté à un problème similaire. Au cours des 15 dernières années, j’ai rassemblé des documents sur l’histoire de ce que l’on appelle « l’affaire Chaadaev ». Il y a un an, j’ai publié une monographie en russe portant le titre : L’affaire Chaadaev. L’idéologie, la rhétorique et le pouvoir en Russie sous Nicolas Ier (donc dans la première moitié du XIXe siècle), consacrée à l’un des moments cruciaux de l’histoire intellectuelle russe, la publication en 1836 de l’article intitulé la première « Lettre philosophique » écrit par Petr Chaadaev en français puis traduit en russe, et le scandale qui a éclaté peu après. Dans cet article, Chaadaev, un noble moscovite, déclare que la Russie n’a ni passé ni avenir et qu’elle est destinée à rester à jamais inférieure à l’Occident. L’extrême scepticisme de Chaadaev était lié à son interprétation de l’histoire du christianisme : il était convaincu que la seule église chrétienne à être restée fidèle à l’ancienne tradition religieuse était l’église catholique. L’orthodoxie et le protestantisme, en revanche étaient, selon lui, des mouvements schismatiques et ne pouvaient donc pas être considérés comme les héritiers légitimes de l’Église chrétienne primitive de Saint-Pierre. De là seraient nés tous les problèmes des Russes, et en premier lieu le fossé tragique et infranchissable entre la Russie et l’Occident. Chaadaev a également nié l’existence du caractère national russe et a écrit que la Russie, dépourvue de tradition historique, n’apportait aucune contribution à l’humanité. Je citerai un exemple de son raisonnement dans la version originale de son texte :
« Nous autres, venus au monde comme des enfants illégitimes, sans héritage, sans lien avec les hommes qui nous ont précédés sur la terre, nous n’avons rien dans nos cœurs des enseignements antérieurs à notre propre existence. […] Ce qui est habitude, instinct, chez les autres peuples, il faut que nous le fassions entrer dans nos têtes à coups de marteau. Nos souvenirs ne datent pas au-delà de la journée d’hier ; nous sommes, pour ainsi dire, étrangers à nous-mêmes. Nous marchons si singulièrement dans le temps qu’à mesure que nous avançons la veille nous échappe sans retour. C’est une conséquence naturelle d’une culture toute d’importation et d’imitation. Il n’y a point chez nous de développement intime, de progrès naturel […] Nous grandissons, mais nous ne mûrissons pas ; nous avançons, mais dans la ligne oblique, c’est-à-dire dans celle qui ne conduit pas au but. Nous sommes comme des enfants que l’on n’a pas fait réfléchir sur eux-mêmes ; devenus hommes, ils n’ont rien de propre ; tout leur savoir est sur la surface de leur être, toute leur âme est hors d’eux. Voilà précisément notre cas. ».
Immédiatement après la publication de la première « Lettre philosophique », le tsar Nicolas Ier décrète la fermeture de la revue Teleskop, dans laquelle la lettre a été publiée, l’exil de son rédacteur en chef dans une lointaine ville du Nord, et le relèvement de toutes les fonctions du censeur de la revue qui était en même temps le recteur de l’université impériale de Moscou. Chaadaev, qui critique sévèrement les fondements de la doctrine impériale « orthodoxie, autocratie, nationalité », est officiellement déclaré fou et brièvement soumis à des contrôles médicaux. La publication de la première « Lettre philosophique » et la répression qui s’en est suivie sont généralement analysées dans le cadre traditionnel de l’histoire des idées et de l’histoire des doctrines politiques qui ne me satisfont pas du tout.
Comme je l’ai déjà mentionné, j’ai rassemblé un grand nombre de documents d’archives sur l’histoire de la publication et de la réception de la première « Lettre philosophique » et j’ai pu en reconstituer le contexte, le déroulement et les conséquences. Cependant, cela ne me semblait pas suffisant pour une monographie. Bien sûr, un livre sur l’aspect factuel de l’épisode central de l’histoire politique russe a également le droit d’exister, mais dans ce cas, les explications que je proposais ne concernaient qu’une période très limitée dans le temps. Cependant, en suivant la méthode microhistorique, je me suis rendu compte que ce cas, même s’il est très célèbre, devrait nous apprendre quelque chose sur des phénomènes plus vastes. Mais dans quel domaine ? Comment pourrait-on conceptualiser cet épisode ? Comment résoudre le problème de la généralisation ? Et c’est là que mon expérience de traducteur de Ginzburg m’a aidé.
Les deux premiers livres que j’ai traduits sont Enquête sur Piero della Francesca et Le juge et l’historien. J’ai choisi de les traduire moi-même, parce qu’ils me semblaient très intéressants. Mais en fait il s’agit de deux monographies extrêmement différentes. L’une raconte l’histoire des peintures et des commanditaires de Piero della Francesca, et concerne donc des événements du XVe siècle. La seconde est consacrée aux détails d’un procès qui s’est déroulé en Italie en 1990, lorsque Adriano Sofri a été condamné à de nombreuses années de prison sous prétexte d’avoir participé à la préparation d’un acte terroriste. Parmi toutes les études de Ginzburg, il n’y a peut-être pas de livres plus opposés en termes de corpus. Il y a cependant quelque chose qui unit ces livres. Tout d’abord, ils traitent tous deux du problème de la preuve que j’ai mentionné plus haut. Mais ce n’est pas tout. Dans ces deux livres, peut-être plus que dans n’importe quel autre, Ginzburg s’occupe des matières éloignées de l’histoire et de la philologie. Je rappelle que dans le cas d’Enquête sur Piero della Francesca, l’auteur a “envahi” le territoire de l’histoire de l’art, offrant des solutions alternatives aux pratiques acceptées par cette discipline. Le juge et l’historien, quant à lui, s’intéresse largement aux subtilités juridiques et à leur interprétation. Ginzburg est convaincu que l’accusation n’a jamais réussi à prouver la culpabilité de Sofri, alors qu’il a été condamné par le tribunal. Les deux livres sont des “incursions” particulières dans d’autres disciplines, visant à perfectionner les outils analytiques des sciences humaines.
Il s’ensuit que la tâche particulière du traducteur consiste dans ce cas à maîtriser toute une strate de vocabulaire appartenant à un domaine qui m’est “étranger”, c’est-à-dire à l’histoire de l’art et la jurisprudence. Bien sûr, chacune des traductions a été rédigée par un curateur scientifique, par deux spécialistes des domaines de connaissance susmentionnés, mais cela n’annulait pas ma propre tâche. Ainsi, en travaillant sur les traductions, je me suis plongé dans l’apprentissage de la terminologie associée aux objets d’étude spécifiques des deux disciplines avec lesquelles je n’avais moi-même que très peu de liens, même si elles suscitaient vivement mon intérêt. Cette expérience m’a permis de me familiariser avec l’histoire de l’art et la science juridique (bien qu’à un niveau amateur). Le cours même des arguments de Ginzburg a encouragé chez moi l’idée de franchir les frontières disciplinaires traditionnelles, tout comme la série “Microhistoires” de Einaudi était devenue une sorte de laboratoire où l’approche microhistorique était appliquée à différentes disciplines.
C’est à ce moment-là, pendant la traduction des livres de microhistoire, qu’il m’est venu à l’esprit d’examiner l’affaire Chaadaev différement. J’ai essayé d’utiliser le matériel de l’histoire de 1836 comme un prisme à travers lequel je pouvais voir des phénomènes plus larges qui n’étaient pas directement liés à l’histoire de la pensée politique et à l’histoire des idées. Cette situation m’a permis, d’une part, d’analyser en détail l’épisode clé de l’histoire intellectuelle russe, de voir comment les événements se sont déroulés au niveau micro et, d’autre part, d’utiliser le procès contre l’éditeur et l’auteur de la première « Lettre philosophique » comme un prisme par lequel discerner la logique interne de phénomènes plus globaux. En conséquence, chaque chapitre de mon livre est construit autour d’une des quatre disciplines :
-
l’histoire du système gouvernemental et judiciaire, c’est-à-dire le mécanisme de prise de décisions au niveau gouvernemental, la cour impériale et ses liens avec la sphère bureaucratique, la formation des pratiques d’application de la loi ;
-
l’histoire de la sphère publique, c’est-à-dire la cristallisation de la structure de la sphère publique et l’évolution de la société civile, les mécanismes de répression politique contre la liberté de parole ;
-
l’histoire des langages politiques, c’est-à-dire la cristallisation des langages politiques en Russie, les controverses idéologiques et les débats politiques sous Nicolas Ier (période où se forme l’idéologie officielle du nationalisme impérial), en particulier le catholicisme russe dans la première moitié du XIXe siècle ;
-
l’histoire et la sociologie de la vie intellectuelle, c’est-à-dire les trajectoires sociales des hommes de lettres, l’influence de la vie privée des philosophes sur leurs stratégies professionelles.
En somme, grâce à mon expérience de traducteur, je pense que j’ai pu porter un regard inédit et nouveau sur l’histoire de l’affaire Chaadaev.
Il en découle une conclusion apparemment paradoxale. Traditionnellement, on considère qu’un traducteur doit travailler avec des textes relevant de sa compétence professionnelle. En d’autres termes, un historien doit traduire des ouvrages historiographiques, un spécialiste de l’histoire de l’art des ouvrages d’histoire de l’art et un philologue des ouvrages philologiques. Dans l’ensemble, cette répartition des tâches est logique et se justifie absolument. En même temps, mon expérience personnelle suggère une autre voie : un traducteur, qui est en même temps engagé dans sa propre recherche scientifique, peut parfois prendre en charge des textes qui sont quelque peu éloignés de sa propre discipline, pour traduire le “lointain” plutôt que le “proche”. Bien sûr, il s’agit d’une tâche plus difficile, mais, comme le montre mon expérience, elle n’est pas impossible. Les avantages d’une telle stratégie sont clairs : la maîtrise de nouvelles couches lexicales et celle de la logique même des autres sciences aide l’historien à trouver des solutions à ses propres problèmes, des solutions qui ne sont pas évidentes et qui ne proviennent pas toujours de son domaine scientifique. Ainsi, la traduction peut inspirer à l’historien des transferts méthodologiques qu’il n’envisageait pas au début de ses propres recherches.