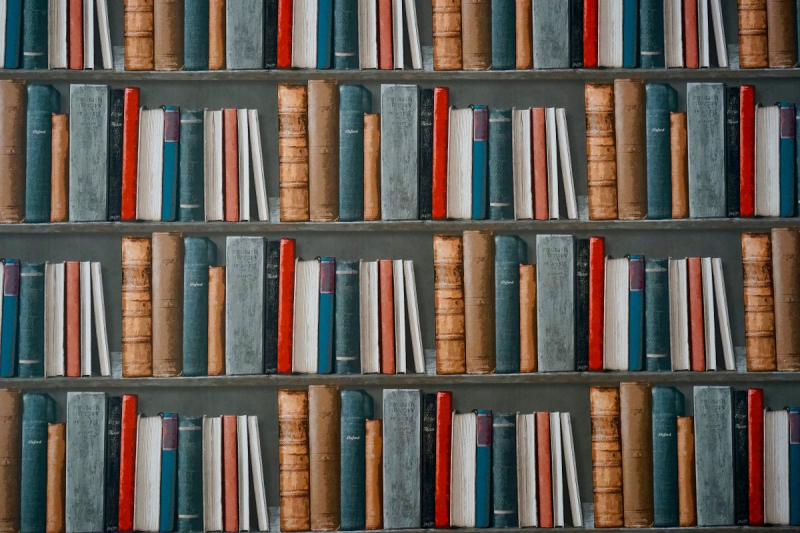Rayonnage de bibliothèque
https://pxhere.com/en/photo/1562569, Creative Commons CC0
Avant que le LARHRA ne devienne le LARHRA, au 3e étage du 14 avenue Berthelot, le couloir affecté à l’ancien Centre Pierre Léon se terminait par une bibliothèque au centre de laquelle se trouvait une grande table. La documentariste de l’époque veillait aux volumes posés sur les étagères qui entouraient la pièce et à ceux qui étaient déposés dans les bureaux des chercheurs, à l’archivage et au catalogage des thèses et des mémoires soutenus ainsi qu’à la commande et à l’achat des volumes pour les chercheurs. Ces derniers se réunissaient au centre de la pièce, observés par les livres qui les entouraient. La création du LARHRA a déterminé, petit à petit, la fermeture de cet espace de proximité, la dévolution de l’ensemble du fond à la Bibliothèque Diderot où une « salle du LARHRA » encore gérée par une documentariste dédiée a vu le jour, avant d’être finalement intégrée dans la Bibliothèque universitaire, avec le fond propre du laboratoire. Sur le site lyonnais, seul l’ancien Institut d’histoire du christianisme, situé dans les locaux de Lyon 3 et reconfiguré comme équipe au sein du laboratoire, a maintenu une bibliothèque indépendante.
La disparition des bibliothèques spécifiques à proximité de nos lieux de travail, voire même intégrées dans ces lieux, a coïncidé avec la réorientation virtuelle de notre travail : de plus en plus de matériaux sont accessibles via nos ordinateurs, les abonnements aux revues sont accessibles en ligne. Et les livres ? De manière presque inconsciente, ils ont cessé de constituer l’essentiel de notre rapport au savoir. Un symbole lyonnais de cette transition : le remplacement de la bibliothèque brûlée sous la coupole du Palais Hirsch, au centre de l’Université, par la présidence et les services administratifs de Lyon2. Les volumes qui ont pu être sauvés ont été intégrés à la nouvelle bibliothèque construite à Gerland, loin des lieux universitaires traditionnels et à proximité immédiate du nouveau site de l’ENS.
Cette ‘subalternité’ des livres fait partie d’un processus global, lié aussi aux dispositifs d’évaluation de la recherche, calqués sur les sciences dures, qui ont eu tendance à privilégier les articles scientifiques aux monographies, les articles aux livres. Il n’est pas question ici de revendiquer le bon vieux temps des rats de bibliothèque, mais plutôt de souligner comment ces transformations ont affecté notre travail, tant pour la recherche que pour l’enseignement. Tout va plus vite, tout se consomme plus rapidement, tant dans l’écriture que dans la lecture. L’article est un point d’un parcours, le livre un aboutissement qui entame un dialogue : une proposition argumentée qui requiert une attention patiente de la part du lecteur, capable non seulement d’utiliser le texte, mais aussi de le méditer et d’apprendre les techniques de mise en forme d’un travail de recherche.
Cette transformation dans le sens d’une consommation de plus en plus rapide et urgente du savoir a engendré une modification de la nature des livres « scientifiques », dans laquelle la narration prend le pas sur l’argumentation rendant, certes, la lecture plus facile et plus agréable, mais aussi, paradoxalement, plus inutile, du moins pour les publics universitaires. Les genres se mélangent et la fiction empiète sur la science, tout comme la narration remplace l’argumentation.
L’une des catégories de livres qui a accompagné plusieurs générations d’historiens, la monographie, est le résultat d’un long travail, solitaire pour l’essentiel, d’un rapport à la discipline où les entreprises collectives avaient une place différente de celle qu’elles ont désormais. Là encore, une transformation politique et économique, cette fois, change la donne : le travail de direction d’un volume collectif ou d’un numéro de revue scientifique l’emporte souvent sur la production individuelle. On est pris par la vitesse de l’évaluation et de la carrière, tant comme chercheurs confirmés que comme jeune chercheur : la thèse s’achève plus vite, soustrayant à l’étudiant le temps qui, pour plusieurs générations, a été celui de l’apprentissage par la pratique du travail d’autrui et de la discussion entamée avec celui-ci. Éric Vigne (Le Livre et l’éditeur, Paris, Klincksieck, 2008) l’avait souligné il y quinze ans : la transformation radicale du monde de l’édition et de l’université laisse moins d’espace à la maturation des idées et à l’élaboration de problématiques nouvelles (p. 48, entre autres). La semestrialisation de l’enseignement universitaire contribue, de son côté, à renforcer une consommation rapide des livres, dont peu sont lus en entier, mais plutôt saucissonnés en chapitres, à favoriser les synthèses sur les travaux de recherche et à fragiliser l’édition universitaire et généraliste, comme le même Vigne le dit de manière claire. Comme la plupart des transformations en cours, elles finissent par modifier nos pratiques sans qu’on y ait réfléchi, et l’on se retrouve avec des résultats dont on n’avait que peu mesuré les conséquences.
Faisons-nous une science moins bonne qu’auparavant ? Je ne le crois pas et là n’est pas la question ; mais nous avons indiscutablement changé nos pratiques de lecture, notre rapport aux livres, et nous nous sommes silencieusement pliés à leur marginalisation de l’apprentissage par l’« espace livre » - ce qui, à mon avis, est une perte, d’autant plus dans un monde où l’accès à l’information est de plus en plus ouvert, mais où la critique de cette information et plus généralement de la connaissance est de plus en plus fragile.