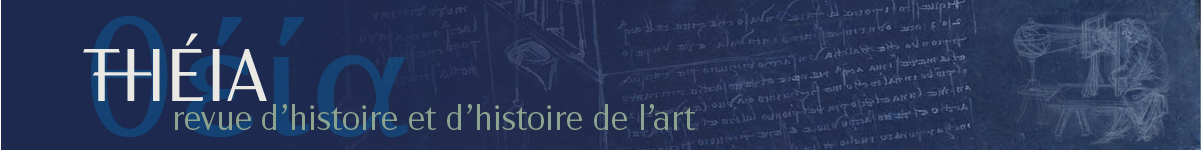Au regard de l’histoire de l’art, Victorine Meurent (1844-1927) n’a été qu’un nom, une anecdote dans l’œuvre de l’artiste de la modernité Édouard Manet (1832-1883). Selon l’historienne de l’art britannique Frances Borzello, cette femme artiste et modèle est l’exemple parfait du traitement marginal accordé aux modèles d’atelier qui ont servi à la représentation en peinture1. À la croisée de l’histoire sociale de l’art, des études de genre et des modèles vivants, cette recherche a eu pour ambition de rassembler l’ensemble des connaissances consacrées à la vie et à l’œuvre de Victorine Meurent2. Cette étude a permis d’offrir une nouvelle compréhension aux sources archivistiques et aux œuvres pour lesquelles Meurent a posé. À cela s’ajoute l’analyse technique et iconographique de quatre tableaux de l’artiste exposés au musée municipal d’art et d’histoire de Colombes3 et au Museum of Fine Arts de Boston4. Ces recherches ont surtout permis d’accéder à un manuscrit non publié du journaliste Adolphe Tabarant (1863-1950).
Tabarant est considéré comme l’un des premiers historiens de l’impressionnisme français5. Rédacteur du Bulletin de la vie artistique et proche des artistes néo-impressionnistes, il écrivit de nombreux articles sur la peinture de cette période. En 1931, puis en 1947, il publie deux ouvrages sur Édouard Manet, fruit d’années de recherche et d’entretiens qui constituent la source de toute étude sur l’artiste6. Ces ouvrages réunissent la biographie du peintre et la première tentative de catalogue raisonné de ses œuvres, proposant une réflexion sur le processus de création, les influences, mais également la réception de ses œuvres. Tabarant est la principale source écrite consacrée à la vie de Manet, souvent citée dans les études sur l’artiste et dans les expositions qui lui sont consacrées7.
Le document d’archive étudié est un manuscrit que Tabarant a rédigé entre octobre 1948 et mars 1949. Il s’agit plus précisément d’une copie de l’original tapuscrit, qui a disparu à ce jour. L’accès à ce document a été rendu possible grâce à Eunice Lipton, historienne de l’art féministe étasunienne. En 1988, Lipton obtient un fac-similé du document par le biais de l’assistante de recherche de la précédente propriétaire du fonds d’archives de Tabarant, Mina Curtiss. Lipton cède en 2023 cet exemplaire à la Morgan Library & Museum de New York, au moment où nous effectuons des recherches sur l’œuvre et la vie de Meurent8.
L’analyse de ce document nous fait se confronter à une réalité complexe. D’un côté, s’impose la figure de Tabarant comme source reconnue de l’histoire de l’art, depuis la publication de la biographie Manet, histoire catalographique publiée en 1931. Cependant, ce document ne présente pas les qualités des précédents ouvrages de l’auteur, n’étant pas une source historique fiable de première main. Tabarant répète des éléments qu’il a déjà évoqués en 1931 et en 1947, à partir de sa réflexion personnelle, de ses hypothèses et des témoignages de l’époque. Les sources de Tabarant sont difficilement identifiables, en dehors des propos de Léon Koëlla-Leenhoff (1852-1927), fils de Suzanne Manet, la veuve du peintre, de l’artiste Suzanne Valadon (1865-1938), ainsi que des Mémoires du romancier et critique d’art Georges Moore (1852-1933). Ces propos rapportés sont un gage de véracité, puisque ceux de Koëlla sont associés au lien familial avec Manet et ceux de Valadon, à son statut de personnalité artistique de Montmartre et proche de Tabarant. S’agissant des propos de Moore, ils ne peuvent pas être considérés comme une source fiable, car l’auteur anglais a eu tendance à modifier les récits et les dates des évènements au gré des publications9. L’ensemble des propos rapportés par Tabarant s’apparentent ainsi à des « on-dit », des rumeurs montmartroises datées10 que les deux principaux témoins confirment et alimentent :
Je vais conter, sans en rien taire, une bouleversante histoire dont le déroulement dépasse l’horizon du romanesque, une authentique histoire qui démontre que la réalité peut quelques fois défier la fiction.11
D’un point de vue rédactionnel, le manuscrit s’oppose totalement aux précédents ouvrages. Tabarant est omniprésent en tant qu’auteur-narrateur. Les premières et dernières phrases du manuscrit le démontrent. Il se présente comme le conteur d’une histoire, celle de Meurent artiste et modèle dont la vie a longtemps été tue et qu’il révèle au grand public. Plus étonnant encore pour une démarche historique, Tabarant affirme répondre à un devoir, celui de raconter la vérité, de partager l’histoire de Meurent telle qu’il la connaît. Il se présente en homme accablé par ses informations et qui doit se soulager de ses découvertes.
Miette après miette, je nourrissais mon dossier. Et je faisais d’affreuses découvertes. Les rendrais-je publiques. […] dans Manet et ses œuvres, j’en disais moins encore, m’arrêtant effrayé au bord du gouffre que j’avais découvert. […] J’y suis enfin descendu. M’imposant la tâche d’évoquer Victorine Meurent à toutes ses heures et toute entière, je suis allé droit à cette héroïne jusque-là si indéterminée, attirante et repoussante.12
Les recherches postérieures au récit de Tabarant démontrent qu’il fait erreur sur l’identification de l’artiste et modèle. Il présente Meurent comme une fille de Montmartre dont le « millésime de sa naissance est imprécis »13. En 1967, l’étude de l’historien Jacques Goedorp découvre que Meurent est finalement née le 18 février 1844 à Paris dans le quartier ouvrier de Popincourt. Son enfance semble plutôt se situer sur la rive gauche dans le quartier de la place Maubert14. Plus important encore, Tabarant situe le décès de Victorine Meurent en 1892, alors qu’elle réside encore à Paris jusqu’en 1906, puis à Colombes où elle décède finalement en 192715.
Quant à la carrière de peintre de Meurent, les propos du narrateur-auteur démontre surtout sa profonde admiration pour la peinture de Manet. La vie personnelle de Meurent prend le pas sur sa création artistique et le jugement de Tabarant conduit à une interprétation biaisée et fausse, comme le démontre l’extrait suivant :
[…] Elle faisait de la peinture, disait-elle. Courant à quelques académies, elle circulait avec un carton à dessins sous le bras, des toiles, une boîte à couleurs. On sut que celle qui eût pu recevoir l’enseignement de Stevens se rendait rue Turgot à l’atelier d’Étienne Leroy, obscur peintre de portraits et de genre qui exposait irrégulièrement au Palais de L’Industrie. Quelle étrange fille !16
À l’image de nombreuses femmes artistes, Victorine Meurent se tourne en effet vers les académies privées. Elle suit les cours du soir de l’Académie Julian, académie privée la plus renommée de Paris. Elle est présente dans les différents livrets listant les élèves féminines de l’Académie depuis 186817. Dans les catalogues des Salons de 1876, 1879, 1885 et 1904, elle est présentée comme l’élève d’Étienne Leroy (1828-1876). Peintre portraitiste, élève de François-Édouard Picot (1786-1868), exposant au Salon chaque année entre 1857 et 187318, Leroy ne correspond pas à l’esthétique défendue par Tabarant. Ses œuvres sont appréciées des critiques de Salon, notamment Edmond de Laqueuille et Gonzague Privat qui vantent ses choix chromatiques, mais fustigent la position de ses œuvres au Salon19. Cet investissement à l’Académie Julian et auprès de Leroy témoigne d’une carrière professionnelle déjà engagée à cette période, où Meurent pose en parallèle pour Manet. Rappelons enfin que Meurent reste une peintre active jusqu’en 1913, au moins selon les registres de Salon et les annuaires artistiques que notre étude a mis à jour20.
Ces observations démontrent que ce manuscrit peut difficilement être étudié comme porteur d’une vérité historique, mais bien comme le témoignage de la construction d’un mythe, dont Meurent fera les frais tout au long de sa carrière artistique. Par ailleurs, l’étude de Tabarant s’inscrit dans un contexte particulier : le transfert de l’Olympia (1863) de Manet au musée du Jeu de Paume en 1947. Ce contexte institutionnel entraine des discussions et des interrogations sur le modèle du tableau. Le texte de Tabarant s’assimile donc bien plus à une tentative d’écrire au sujet du tableau, plutôt que de traiter de Victorine Meurent. Tabarant résume par ces mots le récit qu’il partage : « L’histoire d’une créature féminine, longtemps parées d’attraits, belle, intelligente, artiste, et qui sombra dans la pire ignominie. »21 Assimilée à Olympia, Meurent devient la figure mythique de la fille des rues qui connaît la lumière grâce à un artiste de génie et qui, lorsqu’elle s’en détache, ne rencontre que des échecs à travers les choix qu’elle fait. Si le manuscrit resté inédit ne peut constituer la source unique dans la construction de ce mythe décadent, les précédents écrits de Tabarant et les sous-entendus sur la vie de misère de l’artiste auront contribué à le forger. Cette image se renforce à travers les interprétations sur l’hypersexualisation et les prétendus vices cachés des femmes modèles, que l’on retrouve dans la presse de l’époque, dans les écrits de Tabarant et à travers ce corps offert au spectateur qu’est l’Olympia de Manet.