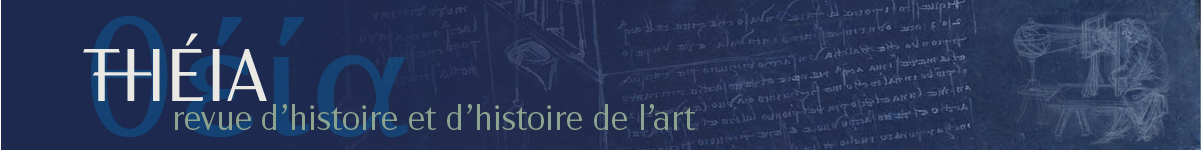Soumission des contributions : revue_theia@groupes.renater.fr
La revue généraliste Théia. Revue d’histoire et d’histoire de l'art est dédiée aux périodes moderne et contemporaine. Elle est coordonnée par des chercheurs et enseignants-chercheurs du LARHRA (Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes). Elle est ouverte aux perspectives transdisciplinaires qui permettent d'analyser un objet au prisme des approches de toutes les sciences humaines et sociales. Elle paraît sous la forme d’un numéro annuel constitué d’articles regroupés en dossiers thématiques, et accueille des varia. Les articles sont publiés dans l’une des cinq langues suivantes : français, anglais, espagnol, italien, allemand.
Évaluation
Les articles proposés sont soumis à une double procédure d’expertise en double-aveugle, en externe.
Le comité de rédaction désigne deux rapporteurs externes, sélectionnés selon les thématiques de l’article.
L’auteur est averti par le secrétariat de rédaction du rejet ou de l’acceptation, avec ou sans corrections, de l’article évalué selon une grille d’évaluation interne.
Textes
Les articles, du dossier thématique comme de la section Varia, entre 35 000 et 55 000 signes, espaces et notes compris, peuvent être accompagnés de documents (images, cartes, graphiques…).
Les articles de la section Notes et documents, entre 5 000 et 8 000 signes, respectent les mêmes critères scientifiques.
Les articles et les documents doivent être préparés selon les normes suivantes :
-
Vous ne devez utiliser aucun style personnalisé, mais les styles de base proposés par votre logiciel de traitement de texte : Normal pour le texte, Titre, Titre 1 et 2 pour les intertitres, Citation ;
-
Le titre de l’article et les intertitres doivent être en minuscule. Les intertitres ne doivent pas être numérotés. Il est recommandé de ne pas dépasser deux niveaux d’intertitres ;
-
Les majuscules doivent porter l’accent s’il y a lieu, ex. : Église, État, Être ;
-
Pour les articles en français, ne pas utiliser ces guillemets : ˝ ˝ ou : “” , mais ceux-là : « » ;
-
Les notes sont mises en bas de page, les appels de notes sont en exposant. Exemple : 1 ;
-
Les citations longues (dépassant trois ou quatre lignes) sont détachées du texte (paragraphe spécifique), sans guillemets, corps n-1.
Les références bibliographiques se font dans les notes de bas de page et sont présentées de la façon suivante :
-
Pour un ouvrage, et dans l’ordre suivant : prénom de l’auteur en minuscules et nom en petites majuscules, le titre de l’ouvrage en italique, la ville d’édition, l’éditeur, la date d’édition, la ou les pages concernées.
Émile MÂle, L’Art religieux après le Concile de Trente : étude sur l’iconographie de la fin du XVIe siècle, du XVIIe, du XVIIIe siècle : Italie, France, Espagne, Flandres, Paris, Armand Colin, 1932, p. 120.
-
Pour un article : prénom en minuscules et nom de l’auteur en petites majuscules, le titre de l’article entre guillemets et en romain, le nom de la revue en italique, l’année, le numéro, les pages concernées.
Henri-Stéphane Gulczynski, « Le mobilier et le décor peint du collège des Godrans (1595-1634). Contribution à l’histoire de l’art religieux de la première moitié du XVIIe siècle à Dijon », Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, 2001, n° 137, p. 242-249.
-
Pour un ouvrage collectif : le prénom en minuscules et nom en petites majuscules du coordinateur ou directeur de publication suivi de (dir.) ou (éd.), le titre de l’ouvrage en italique, la ville d’édition, la date de l’édition, la ou les pages concernées.
Jean-Claude Boyer, Bénédicte Gady, Barbara Gaehtgens (dir.), Richelieu, patron des arts [Actes du colloque international, Paris, 2003], Paris, Éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 2009.
-
Pour un article dans un ouvrage collectif : prénom en minuscules et nom en petites majuscules de l’auteur, le titre de l’article entre guillemets et en romain, dans prénom en minuscules et nom en petites majuscules du coordinateur ou directeur de publication (dir.) ou (éd.), titre de l’ouvrage en italique, la ville d’édition, la date de l’édition, la ou les pages concernées.
Barbara Gaehtgens, « À toutes les gloires de l’État. Richelieu, les Jésuites et le maître-autel de Saint-Louis à Paris », dans Jean-Claude Boyer, Bénédicte Gady, Barbara Gaehtgens (dir.), Richelieu, patron des arts [Actes du colloque international, Paris, 2003], Paris, Éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 2009, p. 215-249.
-
Pour un ouvrage ou un article en ligne : si revue ou ouvrage papier numérisé reprendre les indications mentionnées ci-dessus et ajouter entre parenthèses le lien du site, soit la référence exacte inscrite dans la barre d’adresse lors de la consultation en ligne. Si revue ou ouvrage uniquement en ligne indiquer le prénom en minuscules et nom en petites majuscules de l’auteur puis la référence exacte inscrite dans la barre d’adresse lors de la consultation en ligne.
Yves Moreau, « Jacob Spon et les arts : un savant protestant dans la République des Lettres », Chrétiens et sociétés [En ligne], Numéro spécial 1 / 2011, mis en ligne le 29 septembre 2011, Consulté le 12 janvier 2012. URL : http://chretienssocietes.revues.org/index2732.html
Marion Deschamp, « Luther et ses conjoints : de quelques portraits peints du couple luthérien », Europa Moderna. Revue d’histoire et d’iconologie, 2010, n° 1, p. 10, Consulté le 8 janvier 2023, (http://www.europamoderna.com/images/stories/DeschampsLuther.pdf)
-
Pour un ouvrage ou un article plusieurs fois cité : utiliser selon les cas op. cit. (si l’ouvrage ou l’article a été cité auparavant mais pas dans la note immédiatement précédente) précédé du prénom abrégé et du nom entier de l’auteur, ou ibid. (ouvrage ou article cité dans la note immédiatement précédente)
É. Mâle, op. cit., p. 380.
Ibid., p. 380.
Images
Pour les contributions au dossier thématique et à la section Varia les articles seront accompagné au maximum de 10 images ; les contributions de la section Notes et documents de 3 images au maximum.
L'auteur insèrera la liste des légendes à la fin de son article. Les légendes de chaque image préciseront les informations suivantes : auteur, nom, date de création, technique, lieu de conservation, dimensions. Les droits de reproduction seront indiqués comme suit : © X auteur/institution.
Exemple :
Ill. 1 : Simon Vouet, Le Ravissement de Saint Louis, vers 1641, Huile sur toile, Rouen, musée des Beaux-Arts, Inv. 803 21, 2,797 × 1,77 m.
Droits de reproduction : © auteur
Si l’article est accepté, les images devront être envoyées en fichiers séparés, aux formats jpeg/jpg ou png. Elles feront 1000 px de largeur maximum, et 72 dpi minimum, et seront converties en colométrie RVB. Chaque image sera nommée NOMDELAUTEUR-1 ; NOMDEL'AUTEUR-2 …
Résumé et mots clefs
Joindre obligatoirement un résumé de 4 000 signes en français et de 4 000 signes en anglais, quelle que soit la langue dans laquelle les contributions sont proposées.
Les auteurs doivent fournir 7 à 10 mots clefs en français et en anglais.
Présentation de l’auteur
Indiquer les mentions suivantes : prénom et nom institution d’appartenance et une adresse courriel.
Droits
La revue Théia. Revue d’histoire et histoire de l’art est une œuvre collective.
Si le document soumis n’est pas un inédit, le signaler et justifier des droits pour une diffusion dans la revue.
Les images doivent être libres de droit ou l’auteur doit pouvoir justifier des droits d’utilisation. Leur statut au regard du droit de propriété et de reproduction doit être clairement précisé. Le LARHRA ne peut – sauf exception à discuter avec le comité de rédaction – pas prendre en charge des frais de reproduction ou des droits d’auteur, pas plus que les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations.
Les auteurs peuvent reproduire les textes qu’ils ont publiés dans la revue à condition de faire mention de la publication originale et d’adresser au directeur de la publication un exemplaire du document concerné ou de lui signaler l’URL du site qui accède au document (site personnel, institutionnel).
Pour les contributeurs relevant du ministère de la Culture et de la communication et de ses établissements publics, il est rappelé que pour toute œuvre créée par un fonctionnaire ou un agent de droit public dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, les droits patrimoniaux appartiennent à l’institution qui l’emploie.