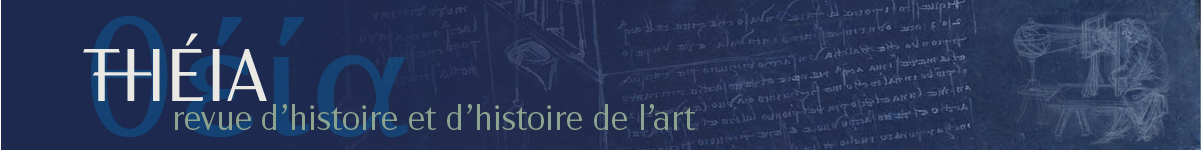Elle aura été l’une des plus grandes historiennes d’un XXe siècle qu’elle a traversé avec passion et engagement, en transformant la manière de faire et penser l’histoire. De quoi est-elle faite, cette grandeur ?
On pourrait y répondre en puisant dans son œuvre les éléments qui nourrissent la réflexion de tous ceux qui étudient les différents objets sur lesquels elle a posé ses yeux : des imprimeurs et femmes lyonnaises au XVIe siècle et leur adhésion à la Réforme protestante à Lazare Sainéan, objet de son dernier livre, en passant par Martin Guerre, Léon l’Africain, Maria Sibylla Merian, Gluckel von Hameln ou Marie de l’Incarnation – ces dernières rassemblées dans un livre qui tisse leurs trajectoires différentes à partir d’une interrogation portant sur les possibilités des femmes au XVIIe siècle. Et bien d’autres encore. Mais cela serait insuffisant à rendre compte de ce qu’elle a représenté. Parce que son importance repose surtout, à mes yeux, sur la manière dont elle a exercé notre métier, la liberté avec laquelle elle a su créer une cohérence à partir d’objets divers et la curiosité qui l’a poussée à chercher toujours l’altérité, à se laisser étonner par ses découvertes et par les gens, d’hier et d’aujourd’hui, qu’elle rencontrait.
Son expérience en tant que conseillère historique sur le tournage du film Le Retour de Martin Guerre (1983) lui inspire une recherche propre, historienne, sur ce cas étonnant de fausse identité au XVIe siècle ; mais elle entame aussi une réflexion qu’elle poursuivra longtemps sur les rapports de l’histoire avec la fiction, en revendiquant à la première une ouverture aux possibilités que la seconde fermerait par un choix interprétatif unique de l’auteur. C’est la lecture du roman d’Amin Maalouf, Léon l’Africain, qui relance cette réflexion : elle la proposera lorsqu’elle sera invitée à prononcer la Conférence Marc Bloch en 1995 et elle en fera un « prétexte » pour aborder à son tour, en historienne, l’histoire de celui qu’elle appellera systématique Hassan et Léon, comme à souligner la multiplicité, voire les ambiguïtés, des identités qui libèrent les individus. Son livre aura un retour intéressant à la fiction d’où il était parti lorsqu’en 2017 Wajdi Mouawad en proposera une mise en scène théâtrale avec Tous des Oiseaux et dont elle acceptera avec enthousiasme le déplacement total proposé par le réalisateur qui en fera une œuvre à lui, et non pas une réécriture de son livre à elle. En 2006, elle revient à l’étude de la fiction, avec Slaves on screen dans lequel elle interroge, encore, la manière dont la fiction s’approprie l’histoire et en donne une lecture particulière, dont elle met à l’épreuve, de manière critique et fine, le rapport à la réalité du passé, à cette réalité que l’historien se doit de saisir, ne serait-ce qu’en mode incertain.
Son engagement politique, qui lui a valu des poursuites par le gouvernement américain imprégné du maccarthysme anticommuniste – entre autre le retrait du passeport lui empêchant de retourner en France pour terminer le livre qu’elle aurait voulu écrire sur les imprimeurs lyonnais – a inspiré ses recherches, toujours tournées vers les plus fragiles, qu’elle a traité avec délicatesse et rigueur, en les plaçant à la fois à côté d’elle et à distance : si l’historienne invente un dialogue possible avec les « trois femmes en marges » auxquelles elle consacre un livre en 1995 qui dévoile les sentiments et les intentions qui portent cette étude, elles reprennent leur place distante, bien assises dans un XVIIe siècle « autre ». Ainsi, cette étude retrouve ses allures toutes scientifiques, prouvées et fiables, en dialogue non plus avec les Marie, Maria Sybilla et Gluckel, mais avec les sources et les lecteurs.
Sa manière d’être historienne est une leçon pour nous toutes et nous tous, particulièrement dans un temps où la recherche semble s’imbriquer à nos vies personnelles d’une manière sans doute inattendue même par ceux qui avaient revendiqué, il y a quelques décennies, l’importance de la subjectivité de l’historien dans la recherche. Passionnée de récit, elle n’a jamais fait de celui-ci la modalité unique de l’opération historienne, ni de ses sentiments l’origine de ses interprétations – ou du moins, elle n’a jamais pensé à les mettre au centre du dispositif de la preuve, en reléguant l’empathie pour les gens qu’elle étudiait à sa juste place : un mobile de la recherche, non pas une recherche d’adhésion à ses propres interprétations, qu’elle proposait de manière à la fois décidée et réservée, basé sur un dialogue à plusieurs voix, entre passé et présent, entre historiens, entre l’autrice et ses lecteurs. Elle a su admirablement partager avec nous une idée de l’histoire profondément démocratique, ouverte, passionnée. Intelligente et respectueuse par-dessus tout.