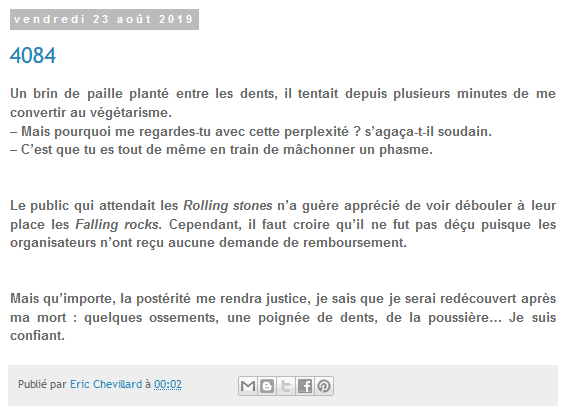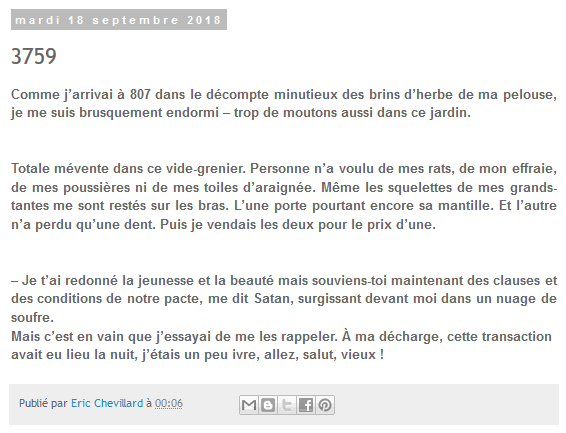L’autofiction a dépassé le seul cadre de la littérature pour contaminer le genre pictural, plastique mais aussi scénique et performatif. En effet, se prendre soi comme objet d’étude à sa création afin de se réinventer participe de l’autofiction. L’autoreprésentation contemporaine représente à l’heure actuelle la plus grande majorité des créations artistiques. Il n’est pas anodin que, selon Yves Michaud, l’art contemporain tende à l’expérimentation de la création plus qu’à la réalisation concrète d’objets artistiques ou d’œuvres plastiques. Les démarches artistiques de Paul Beatriz Preciado, Éric Chevillard et Chloé Delaume s’inscrivent dans une contamination des genres et des registres. Une grande importance est donnée à l’hybridation. Elle met donc littéralement en place de nouvelles modalités de dialogue entre littérature et création artistique.
Cet article se donne comme objectif de questionner l’autofiction non comme un genre purement littéraire mais comme un médium artistique interdisciplinaire. Il ne s’agit pas pour autant de remettre en question la filiation de l’autofiction à la littérature. Pour rappel, celle-ci trouve son origine dans la littérature. Nous devons à Serge Doubrovsky l’invention du terme en 1977 dans un « Prière d’insérer » à son roman Fils. Nous analyserons le lien de co-construction entre la littérature et la performance à travers l’autofiction. En ce sens, la néolittérature (pour reprendre l’expression de Magali Nachtergael) établit une relation symbiotique avec la néo-performance.
Essai corporel
À cet égard, l’ouvrage Testo Junkie de Beatriz Preciado est un point de compréhension du lien entre littérature et performance et plus spécifiquement entre l’autofiction et l’espace. L’ouvrage commence sur la description d’une installation vidéo. Preciado se filme. On est en droit de se demander s’il s’agit d’une performance filmée, d’une vidéo-performance ou d’une auto-expérimentation. Testo Junkie s’ouvre sur cette première phrase : « Ce livre n’est pas une autofiction1. » Pourquoi, si tel est vraiment le cas, donner tant d’importance à ce terme même d’autofiction ? Pourquoi introduire son livre sur ce qu’il ne serait pas si malgré tout il ne l’est pas quand même ? Peut-on y voir une référence à Magritte et à sa fameuse toile La Trahison des images ? Preciado userait-elle d’ironie comme le peintre ? Serait-ce une simple expression jouant à se contredire ? L’intention la plus évidente de l’auteur serait alors que même écrite, une autofiction ne serait pas une autofiction. Dans ce cas on est à même de paraphraser Magritte et de parler d’une trahison du texte. Une autofiction ne pourrait avoir lieu que dans une dimension de vécu et non de consignation de faits. En ce sens, elle ne resterait qu’une image, qu’une représentation dans un livre qu’on ne pourrait pas expérimenter. Preciado, tout comme Magritte, interroge le rapport entre l’objet, son identification et sa représentation. L’écrivaine initie ainsi une réflexion sur les rapports entre mots et performance. En somme, la seule écriture d’une autofiction ne rend pas compte de ce qui fait une autofiction. Preciado trahit, elle écrit : « Je ne prends pas la testostérone pour me transformer en homme, ni pour transexualiser mon corps, mais pour trahir ce que la société a voulu faire de moi […]2. » C’est pourquoi le livre de Preciado n’est pas un avertissement. Il est une réponse. L’écriture est partie prenante de la trahison. En ce sens, une dimension performancielle doit lui être ajoutée. C’est peut-être du fait d’avoir utilisé l’écriture comme si elle reflétait, pour avoir joué sur la métonymie que l’ouvrage de Preciado s’inscrit autrement. Ce qu’il dénonce en somme concerne d’abord le caractère métaphorique du pacte de vérité, celui qui dit par exemple « Ce livre n’est pas une autofiction ». L’auteur introduit une réflexion sur la ressemblance. Cet ouvrage a beau ressembler à de l’autofiction il n’en est pas réellement. À moins que la phrase ne se réfère justement à une dimension plus onirique comme : ne cherchez pas une vraie autofiction, c’en est le rêve. Chez Magritte, la toile La Trahison des images sur laquelle une pipe est dessinée au texte juxtaposé « Ceci n’est pas une pipe » montre une pipe, en tout cas son avatar puisque tout l’art de Magritte est de questionner le langage, la représentation et la matérialité. En ce sens, Preciado semble présenter un avatar d’autofiction et en donner sa définition.
L’autofiction, pour être entière et pas simplement un simulacre, doit s’accompagner d’une dimension matérielle. Preciado s’inspire-t-elle de Butler et de son ouvrage Bodies That Matter3 en accordant à la matérialité du corps tout son substrat ? Peut-être alors que cet énoncé est parfaitement vrai puisqu’un livre en lui-même n’est pas lui-même une autofiction. Preciado montre peut-être une habitude de langage. C’est-à-dire qu’il est inévitable de rapporter le contenu du livre au livre lui-même. Traquant la chose dont elle parle, elle lui tend un piège. Et elle en garantit sa capture. Elle impose le jeu d’une écriture dans l’espace. Et en retour les mots travaillent de l’intérieur ce processus d’autofiction. Elle se joue de l’écriture jusqu’à lui faire simuler le caractère simplement descriptif en faisant semblant de la destituer de sa dimension littéraire puisque l’écriture est – au début en tout cas – renvoyée à un support pour nommer, expliquer la performance de genre qu’accomplit Preciado chez elle. Mais tout ça n’est qu’un simulacre puisque le reste de l’ouvrage, outre sa critique historique, rendra hommage à la littérature et notamment à celle de Guillaume Dustan. L’ouvrage vient donc prolonger la performance plus que la supporter. Preciado a redistribué, dans l’espace, le texte. L’ensemble des mots « ce livre » indique un entrecroisement entre l’ouvrage, l’écriture et la performance. Par exemple, « ce livre » (en tant que tel, en tant qu’assemblage de feuilles) « n’est pas » (n’est pas substantiellement lié à, n’est pas affilié au genre de…) « de l’autofiction » (genre qui n’en est pas tout à fait un mais quand même un peu et dont la définition au moment où Preciado écrit Testo Junkie s’apparente plus à une « nébuleuse floue », pour reprendre l’expression de Colonna). Ou encore, « ce livre » qui pourrait dire « ce livre d’autofiction » n’est pas « une autofiction » puisque l’autofiction ne pourrait se contenter pleinement d’une mise en texte. En d’autres termes, « ce livre » ne pourrait se substituer à une autofiction pleine et entière. Preciado dit bien « une autofiction » et non « de l’autofiction ».
De ce fait, elle indique la filiation de son texte à de l’autofiction tout en précisant qu’une autofiction ne peut pas se contenter de n’être que du texte. Il a suffi de cette première phrase pour qu’aussitôt l’intention apparaisse contraire à son inscription. Ce qui résulte de cette ambiguïté, voire de cette déstabilisation première est finalement une stabilité. En effet, le mot autofiction surgit et reste permanent dans l’esprit du lecteur. Il est ainsi redéfini sous la plume preciadienne et désigne une co-construction du récit de soi et de la performance. Preciado commence donc son ouvrage en incisant le langage dans la forme des choses. Le terme d’autofiction s’impose par ce jeu consistant à l’évincer qui finalement ne fait que l’exposer. Autre interprétation : Quand Preciado écrit « Ce livre n’est pas une autofiction », peut-être peut-on entendre cette phrase quantitativement. S’il ne s’agit pas que d’une autofiction peut-être que ce sont plusieurs autofictions qui sont alors mises en récit. Peut-être devons-nous entendre celle de Beatriz et celle de Paul en devenir. Preciado précise :
Je ne me reconnais pas. Ni quand je suis sous T., ni quand je ne suis pas sous T. […] Contrairement à la théorie lacanienne de l’état du miroir, selon laquelle la subjectivité de l’enfant se forme quand celui-ci se reconnaît pour la première fois dans son image spéculaire, la subjectivité politique émerge précisément quand le sujet ne se reconnaît pas dans la représentation. Il est fondamental de ne pas se reconnaître4.
Selon l’auteur, l’expérimentation se distingue de la représentation. Ainsi faut-il entendre que la représentation crée de l’unité, du « une » et que l’expérimentation crée du pluriel ? Si Preciado considère avoir plusieurs identités, Testo Junkie est-il porteur de plusieurs autofictions ? En fin de compte, pour dénoncer le mensonge de la métaphore scripturaire tout en gardant un procédé caractéristique de l’autofiction une autre structure s’impose : celle de la performance et de son récit descriptif.
Elle reprend à son compte l’idée qu’« une carte n’est pas le territoire qu’elle représente5 ». En ce sens, la carte serait l’écriture et le territoire la performance. Faudrait-il ainsi voir chez Preciado une séparation entre l’élément graphique et plastique ? Si nous suivons cette piste nous en déduisons que le texte conteste le rapport à l’expérience et nous incite par là même à repenser son identité. Testo Junkie combine le récit à la consignation d’une performance de sorte que le lecteur perçoit un rapport d’étrangeté entre les deux. L’ouvrage est une constatation de l’impossibilité d’être lecteur et spectateur à la fois. Nous lisons la consignation de la performance mais nous n’en verrons jamais la vidéo. Elle poursuit en écrivant :
Il s’agit d’un protocole d’intoxication volontaire à base de testostérone synthétique concernant le corps et les affects de B.P. Un essai corporel. Une fiction, c’est certain. S’il fallait pousser les choses à l’extrême, une fiction autopolitique ou une autothéorie6.
Recontextualisons, Preciado rédige cet ouvrage au début des années 2000 et le publie en 2008. Cette période connaît, comme le dit Chloé Delaume, une véritable « explosion démographique » des écritures de soi. À ce moment, le nombre d’ouvrages s’autoproclamant être de l’autofiction ou décrit comme tel connaît son apogée7. En effet, prêter son nom à son personnage, son double fictif est devenu un véritable leitmotiv dans la création littéraire et artistique. Pour cerner les propos de Preciado il nous faut prendre en considération une différence entre faire de l’autofiction et écrire une autofiction. De ce fait, il y aurait l’autofiction stricto sensu et l’autofiction comme source d’inspiration. Ces premières phrases de Preciado sont confuses à plusieurs niveaux. Pourquoi donner la primauté à ce qui n’est pas ? N’est-ce pas en prouver la filiation ? Preciado se perd dans une liste de termes qui ont pourtant l’air d’être utilisés comme synonymes. On remarque que finalement l’auteur cherche plus à s’extraire du débat critique portant sur l’autofiction du début des années 2000 que de s’exclure du genre de l’autofiction lui-même. Autrement dit, si Preciado n’écrit pas une autofiction il fait de l’autofiction. Ainsi, on peut imaginer que Preciado refuse de se ranger sous la bannière de l’autofiction par idéologie car il semble promouvoir, à l’instar d’Annie Ernaux « un rapport de soi avec la réalité sociohistorique8 » pratiquant ainsi une « auto-socio-biographie ». Avec cet ouvrage Preciado crée un espace autofictif. Tout l’objet de son discours sera bien de montrer à son paroxysme l’idée que toute image de soi est une construction fictive. Ce qu’indique Preciado également c’est que l’autofiction au tournant des années 2000 a évolué par rapport à son année de prise en considération.
À cet égard, l’une des transformations les plus notables de l’autofiction est la place centrale qu’elle accorde à la performance. En effet, que ce soit Preciado ou Delaume, l’autofiction contemporaine lie écriture et corps. Certes l’idée en elle-même ne date pas des années 2000, Doubrovsky écrivait déjà :
Je serai. Mon propre patron. Fil à fil. Il faudra. Bâtir. Me reconstruire. De toutes pièces. Mourir. Vrai. Renaître. Fictif. Ce sera. Ma métamorphose. Finale. Ma personne. Deviendra. Mon personnage. Je serai. Mon propre acteur. Je jouerai mon rôle. Pièce à pièce. Me reconstruire dans ma mise en scène. J’écrirai. Ma tragédie9.
La différence est que d’une mise en scène textuelle, d’une volonté de sortir de l’espace du livre en y ajoutant une dimension scénographique, de cette substance métaphorique nous sommes passés à l’engagement tout entier du corps. En effet, Preciado (d)écrit son protocole, qu’elle nomme auto-intoxication volontaire, en esthétisant et romançant sa prise de testostérone en gel transformant inéluctablement son corps et son identité. On peut aller jusqu’à se targuer du fait que Preciado semble avoir mis en place le plus parfait des « récits transpersonnels10 » tel que décrit par Bruno Blanckeman. Dans l’article « Identités narratives du sujet, au présent : récits autofictionnels / récits transpersonnels », l’essayiste définit les récits transpersonnels comme des textes qui :
[…] tentent d’appréhender l’être en l’autre, démettent toute position d’individualité accomplie, dissolvent l’identité dans des liens de généalogie familiale ou littéraire partiellement oubliés, donc partiellement, réinventés11.
Preciado, elle/lui, joue bien entendu sur la polysémie du terme « trans » et met ainsi en acte un récit transpersonnel, c’est-à-dire le récit d’une personne en transition. Le texte se fait donc action tout autant qu’objet.
Les formes littéraires performées rendent compte du caractère expérimental de l’œuvre. Chez Preciado, entre autres, cette dimension passe par l’exploration des formes variées de médiatisation du soi. En effet, son protocole est filmé mais ce n’est pas la vidéo qui sera destinée au public. Preciado n’est donc pas à proprement parler un performeur revendiqué. Cette médiatisation du soi advient alors par sa transcription textuelle. Et cette transcription textuelle décrivant le caractère performatif fera œuvre à part entière. Preciado œuvre ainsi à montrer que d’une médiatisation du soi elle en arrive à une médiatisation du texte. Dans ce cas, et c’est bien ceci qui nous intéresse dans le lien entre autofiction et performance, c’est qu’il y a une co-construction de l’œuvre écrite et performée. Les deux prennent forme dans un même mouvement. Il n’y a pas de représentation, nous ne sommes pas dans un acte théâtral mais véritablement dans un geste de performance et qui plus est dans lequel ici l’écriture acquiert toute sa valeur performative. Par le biais de la présence de la caméra témoignant des faits et questionnant sur la portée de l’instrument et le geste en train d’être enregistré, Preciado crée une double valeur, celle d’une dimension visuelle non soumise au texte. Testo Junkie problématise l’identification sexuelle. Cette caractéristique est propre à l’auteur et il serait incorrect de tenter de généraliser cette problématique en créant une sous-branche de l’autofiction qui correspondrait à dire que l’autofiction contemporaine entretiendrait systématiquement un lien avec la sexualité – comme certains critiques ont pu le faire. La démarche de transition, de changement d’identité, de « transfert » écrit Preciado, est un des thèmes principaux de l’ouvrage questionnant ainsi les identités. Preciado fait de ce questionnement sa performance et en l’écrivant il se double d’une valeur performative. L’auteur s’interroge également sur le rapport marchand des industries pharmaceutiques en traçant dans une veine foucaldienne une épistémologie critique et féministe lui permettant de remettre en question le biopouvoir et la norme hétérosexuelle. Son discours est alors accompagné de la prise de testostérone lui permettant de pirater et par là même de se réapproprier son propre corps. En exploitant une mise en scène textuelle découpée en chapitre alternant tantôt des recherches théoriques d’ordre philosophico-historico-politique tantôt du récit de soi et parallèlement un dispositif de performance face à une caméra rendu par une description littéraire autofictive, Preciado arrive à une anamnèse du soi par le je. Elle/Il exploite les virtualités de l’autoreprésentation pour constituer à travers elle/lui la mémoire de son soi passé, en transfert et à venir.
De l’autofictif à l’autoportrait
De même, nous pouvons nous intéresser au travail d’Éric Chevillard. Le 18 septembre 2007, il ouvre son blog L’Autofictif12 en annonçant : « J’écris pour occuper moins de place. » Consignant alors le travail qu’il s’apprête à faire, il ouvre la voie au questionnement du lien écriture/espace. Tous les jours hormis les week-ends il rédigera jusqu’à aujourd’hui encore quelques phrases, quelques aphorismes quotidiens aux sujets variés témoignant d’une pensée instantanée. Il s’impose chaque jour la rédaction de trois courts textes indépendants. Les dix premières années à respecter cette consigne aboutissent à la publication du recueil monumental L’Autofictif ultraconfidentiel13. La visite de son blog nous permet de constater l’extrême rigueur presque obsessionnelle de la tenue de cette contrainte aux allures oulipiennes.
Figure 1 : Éric Chevillard
Visible sur le site personnel d’Éric CHEVILLARD, http://autofictif.blogspot.com/, consulté le 15/10/2019.
Figure 2 : Éric Chevillard
Visible sur le site personnel d’Éric CHEVILLARD, http://autofictif.blogspot.com/, consulté le 15/10/2019.
De ces deux images tirées à presque un an d’intervalle (23 août 2019 pour la première et 18 septembre 2018 pour la seconde) nous constatons que l’auteur s’est fixé une certaine ligne graphique. En effet, un premier bandeau indique la date, en dessous est inscrit en caractères plus importants le nombre du texte (nous avons sélectionné ici les textes numéros 4084 et 3759), suivent les trois paragraphes distincts et un dernier bandeau indiquant l’heure de publication. Ce système visuel systémique, par ce nombre grandissant chaque jour et cette heure de publication toujours proche de minuit, n’est pas sans rappeler celui de deux artistes conceptuels : Roman Opalka et On Kawara. Opalka14 effectue une série de toiles recouvertes de nombre. En 1965 débute le chiffre 1 dans ce projet vers l’infini. Il se photographie à la fin de chaque séance de travail, à la même heure et selon le même angle de vue, devant ses toiles et s’enregistre en train de nommer les chiffres en les peignant. En 1972, arrivé au nombre 1 000 000, Opalka décide d’ajouter 1 % de blanc dans la peinture utilisée pour le fond de ses toiles initialement noir à 100 %. Le 6 août 2011 il décède et achève par là même son travail sur le nombre 5 607 249. Chaque toile est appelée un détail, chaque photo prise quotidiennement est nommée un extrême détail. Opalka écrit :
Ma proposition fondamentale, programme de toute ma vie, se traduit dans un processus de travail enregistrant une progression qui est à la fois un document sur le temps et sa définition. Une seule date, 1965, celle à laquelle j’ai entrepris mon premier Détail. Chaque Détail appartient à une totalité désignée par cette date, qui ouvre le signe de l’infini, et par le premier et le dernier nombre portés sur la toile. J’inscris la progression numérique élémentaire de 1 à l’infini sur des toiles de même dimensions, 196 sur 135 centimètres (hormis les « cartes de voyage »), à la main, au pinceau, en blanc, sur un fond recevant depuis 1972 chaque fois environ 1 % de blanc supplémentaire. Arrivera donc le moment où je peindrai en blanc sur blanc. Depuis 2008, je peins en blanc sur fond blanc, c’est ce que j’appelle le « blanc mérité ». Après chaque séance de travail dans mon atelier, je prends la photographie de mon visage devant le Détail en cours. Chaque Détail s’accompagne d’un enregistrement sur bande magnétique de ma voix prononçant les nombres pendant que je les inscris15.
À la manière de cet artiste conceptuel, Chevillard prend son corps comme marqueur temporel de la réalisation d’une œuvre. La mort devient l’instrument de l’œuvre. Ce qui en contrepartie permet à l’existence de se manifester. Opalka n’est pas le seul artiste conceptuel à s’intéresser à la matérialité du temps, On Kawara réalise dans les mêmes années sa série Date painting (aussi nommée Today series).
Ces deux exemples nous aident à saisir le « programme » mis en place par Éric Chevillard. Tout comme Opalka qui, ayant atteint le nombre 1 000 000, intègre un nouveau dispositif à sa création, Chevillard atteignant dix années d’écriture quotidienne publie un recueil intitulé L’Autofictif ultraconfidentiel : journal 2007-2017. Depuis la publication papier, ne sont consultables sur son blog que les recensions réalisées après cette publication, c’est-à-dire (re)commençant le mardi 18 septembre 2018 et continuant avec le dénombrement du nombre 3 759. Chaque nouveau texte est destiné à la poursuite d’une progression mathématique qui, on le présuppose, n’aura pour seule limite que la mort de l’écrivain. L’œuvre nommée par le terme générique « autofictif » démontre en quelque sorte le processus même de l’objet plus que son contenu. 2018 annonce par conséquent un moment crucial dans la progression de ce dispositif littéraire. Avec cette publication passant du blog au papier, Chevillard crée un espace-temps en devenir, celui d’une latence où on est en droit de se demander ce qu’adviendra de cette deuxième vague de consignations quotidiennes. Dans la perspective d’un tome 2 que le lecteur est en droit de s’imaginer vers 2028, Chevillard poursuit l’écriture quotidienne de trois paragraphes. En outre, après chaque rédaction l’écrivain complète son dispositif par sa publication après minuit (de 00:03 pour une très – trop – grande majorité, bien que nous puissions rencontrer 00:02 ou encore 00:27). Nous sommes surpris par le rythme horaire et sommes en droit de nous interroger sur la véracité ou la duperie de ce temps attestant ou simulant l’attestation de l’achèvement du jour. Chevillard s’impose-t-il une discipline de vie ascétique ? Est-il réellement tous les soirs après minuit sur son ordinateur ? Est-ce finalement l’écrivain lui-même qui poste ses textes ou un logiciel programmé à publier à horaire fixe enregistré au préalable ? Dans ce dernier cas la mise en scène serait telle que Chevillard prendrait la peine de temps à autre de programmer le logiciel à un autre horaire afin de simuler la publication par sa main même. En ce sens, le dispositif correspondrait lui aussi au principe d’autofiction. L’indication de l’horaire, outre sa véracité ou non, atteste un double jeu, elle est une mise en corps de l’acte d’écrire prenant sens dans l’inscription du temps. En somme, par la mise en corps du chiffrage tant numérologique témoignant tant du nombre de textes écrits que de l’horaire de publication, Chevillard dresse un autoportrait en devenir. Le choix du dénombrement systématique et systémique qui continue sur son blog même après la publication en ne recommençant pas à zéro témoigne d’un temps réel. En effet, le 18 septembre 2018, Chevillard postait son 3 759 e texte alors que les 3 758 premiers avaient été publiés au sein de L’Autofictif ultraconfidentiel.
On est à même de s’interroger sur ce choix de poursuivre ces publications sur son blog le 18/09/18. Il est flagrant de constater la mise en miroir du jour et de l’année. En effet, Chevillard ne réactualise pas son blog le 01/09/18 mais bien le 18 septembre 2018 tout comme il avait commencé le 07 septembre 2007. De plus, cette rigueur numéraire se poursuit jusque dans l’ouvrage par cet encart précisant qu’« il a été tiré de cette édition de L’Autofictif ultraconfidentiel 1 500 exemplaires dont 100 numérotés et signés par l’auteur […]16 ». La numérologie est donc exploitée dans sa chronologie la plus maniaque se faisant à la fois marqueur temporel – pour l’inscription systématique de la date et de l’heure – et succession régulière – pour la nomination des cent premiers ouvrages. Le chiffrage semble ainsi permettre de construire une solution, une limitation face à l’infini. Chevillard explique :
Trois notes chaque jour, depuis dix ans, qu’il vente ou neige. Au lieu de sortir le cerf-volant ou la luge. Qu’est-ce que cette assiduité maniaque, cette routine ? […] Une discipline quotidienne. Un devoir. Un scrupule. Mais la corvée est abattue par un paresseux qui aura su rendre son geste machinal17.
À la manière d’Opalka, Chevillard rend compte de l’éternité qu’une œuvre peut prendre pour se réaliser. En ce sens, son œuvre devient « l’image d’une existence18 » ; cet opus, « c’est une vie19. » Contrairement à la démarche d’un écrivain qui rechercherait « le calme, le retrait, la solitude20 », le noteur « est partout au spectacle. Il attend que quelque chose se passe. Sa méditation veut être troublée. Son plaisir naît de la gêne21. » Ainsi, cet objet littéraire « sera lu comme il fut écrit, en somme, sans rien s’interdire, puisque, là au moins, tout est permis. » Cette mise en corps par l’écriture, le respect des trois paragraphes, la numérotation des textes et la publication quasi à heure fixe montrent la mise en place d’un espace-temps que se crée Chevillard qui serait peut-être le summum de l’ultraconfidentiel dans lequel est restituée une existence en acte se construisant dans celle en devenir. En donnant corps aux nombres de façon continue, Chevillard semble renouveler à chaque post sa signature. La permanence du processus du dénombrement paraît maintenue grâce à une certaine rigueur. Le diariste écrit :
Puis me voici à Oaxaca, à Basse-Terre, à Lanzarote. Vais-je pouvoir me connecter ? Que ferai-je sinon de ces pyramides zapotèques, de ces iguanes, de ces volcans ? Ce n’est vraiment pas le moment d’être lâché par la technique22 !
Il semble que la rupture même est calculée et anticipée. Chevillard suspend donc son mouvement par la mise en miroir textuelle anticipée, déjà contée. Cette pause provoquée par une absence de technologie introduit un temps de séparation avec le mouvement des nombres. Dans un même geste, Chevillard cherche à expérimenter la fixité et le mouvement, les deux modalités temporelles. Cette performance scripturaire reprend le mouvement de son existence et en consigne la trace sous forme de journal, de témoignage.
Chevillard devient un écrivain-chronomètre. Afin de qualifier les textes de l’auteur, on peut emprunter l’expression Chronomes d’Opalka qui lui servait à définir ses toiles. Ces aphorismes, ces chronomes, cette captation du temps ne sont en rien proches de l’image d’un sablier qui matérialise l’idée d’un temps réversible, au contraire, il témoigne d’une captation du temps chronologique, du temps dans son irréversibilité. Cette progression numérique porte en elle la conscience de la mort gisante au fond de cette écriture. Est-ce qu’elle en achèvera l’accomplissement ? Le premier nombre, le premier texte signe l’irréversibilité de l’œuvre, il porte en lui tous les autres. Le temps du vécu, que Chevillard traduit, ne peut se refaire, il a eu lieu, il est incorrigible. Sa démarche, exige un engagement à la fois physique et mental, corporel et émotionnel qui implique de fait la mise en corps de ce projet. Le temps de l’œuvre et le temps de l’écrivain impliquent que vie et œuvre soient intimement liées. Il inscrit donc par-là l’à-venir de la mort, de la sienne propre tout comme de son œuvre qui prendra fin avec lui. Précisons que Chevillard ne s’est pas exprimé en disant jusqu’à quand il poursuivrait ou non son travail de diariste. C’est bien la continuation de l’écriture après la publication des dix années qui nous amène sur cette voie. C’est en toute conscience que nous reconnaissons fournir une interprétation plus qu’une analyse mais ceci n’ôte en rien la valeur de nos propos. Son programme se nourrit également de la vie, de son temps, impliquant la dimension du vieillissement. Il réalise peu à peu son autoportrait. Le dernier nombre est inconnu, indécidable depuis la mise en route de ce journal aux allures de programme. C’est aussi une situation nouvelle dans la littérature que la matérialisation du vieillissement de l’écrivain. Il n’y a pas de chapitres, mais un avancement numéraire. Cet univers se créant par l’accumulation formant un tout, montre l’expansion du monde se déployant à travers une phrase. La démarche de Chevillard pour matérialiser le temps vécu n’est pas la nostalgie du temps passé ni la chronique d’un devenir vieillissant mais la mise en place du plaisir d’être troublé.
Au début, Chevillard ouvre ce blog sans autre intention que de se distraire d’un roman en cours d’écriture. Rapidement, il prend goût à son identité de diariste traitant « cette forme d’intervention dans le deuxième monde que constitue aujourd’hui Internet23 ». Se considérant comme un personnage, il bascule entièrement dans ses univers de fiction flottant avec le réel. Il chavire littéralement de l’autre côté du miroir. Dans cette perspective de recherche permanente, l’écrivain fait des allers-retours sur ce qui est en train de se produire dans ce déroulement de publication en ligne. Par exemple :
Une coccinelle atterrit sur la page du carnet ouvert sur mes genoux. Elle entreprend la descente et, parvenue en bas, tâte le vide au-delà avant de rebrousser chemin ; bravement, elle entreprend l’ascension de ma page […]24.
De plus, un jeu esthétique avec le dénombrement se met en place durant le programme en exécution. En effet, la publication de l’ouvrage, contenant dix années d’ascétisme scripturaire, s’achève le 17 septembre 2017 et ne reprendra sur internet que le 18 septembre 2018. Chevillard établit le chiffrage de son existence. Cet opus livre également dix années sur la rencontre de l’Autre, à entendre dans son sens large exploitant les liens chimérique et réel avec, par exemple, les animaux. Avec cette rigueur définie dans un temps et un projet précis où l’engagement de soi est au cœur du protocole, Chevillard (tout comme Preciado) place l’autofiction en étroite relation avec la performance et l’art conceptuel.
Autofiction performative
Chloé Delaume, revendiquant sa proximité à l’artiste Sophie Calle, enlace invariablement écriture et performance. Elle-même se définit comme écrivaine et performeuse. Son cycle J’habite dans la télévision en est exemplaire. En effet, de 2005 à 2006 Delaume établit un cycle de performances sur le thème de la télévision tout en publiant parallèlement des chroniques au sein de la revue Le Matricule des anges. Ses interventions scéniques sont alors nommées des pièces dans lesquelles elle utilise des captations des chaînes hertziennes pour en faire une bande-son sur laquelle elle met en voix ses chroniques. Cette mise en scène n’est pas sans lien à John Cage et ses happenings basés sur la « musique indéterminée ». En 2006 ce travail prend la forme d’une publication d’ouvrage. Durant 22 mois, Delaume sera, dit-elle, « sentinelle » de la télévision, expérience immersive à domicile devant les programmes télé afin de performer la célèbre phrase de Patrick Le Lay, tout en cherchant à en comprendre le sens, « ce que nous vendons à Coca-Cola c’est du temps de cerveau humain disponible ».
Le médium de la télévision a ouvert la création dans différents registres : performance, vidéo, installation, assemblage, sculpture et littérature qui ont véritablement marqué la scène artistique. Un nombre considérable d’artistes ont eu recours à ce médium. Sans pour autant en effectuer une liste exhaustive, nous pouvons citer (par ordre alphabétique) : Marina Abramovic & Ulay, Vito Acconci, Eija-Liisa Ahtila, Eric Anderson, Ant Farm, Michael Asher, Michel Auder, Olivier Bardin, Joël Bartoloméo, Fred Barzyk, Lynda Benglis, Dara Birnbaum, Brecht, Roderick Buchanan, Chris Burden, Daniel Buren, Peter Campus, Cao Fei, César, Chen Shaoxiong, Étienne Chambaud, David Cort, Douglas Davis, Deep Dish Television Network, Brice Dellsperger, Jan Dibbets, Christoph Draeger, Éric Duyckaerts, Valie Export, Omer Fast, Robert Filliou, Peter Foldes, Fred Forest, Gala Committee, General Idea, Douglas Gordon et Philippe Parreno, Karl Otto Götz, Dan Graham, Richard Hamilton, Dick Higgins, Gary Hill, Jonathan Horowitz, Pierre Huyghe, Fabrice Hyber, Sanja Ivekovic, Christian Jankowski, Piotr Kamler, Mike Kelley, David Lamelas, Ben F. Laposky, Jacques Lizène, Benoît Maire, Filippo Tommaso Marinetti, Paul McCarthy, Susan Mogul, Bruce Nauman, Claes Oldenburg, Nam June Paik, Raindance Corporation, Robert Rauschenberg, Martha Rosler, les spatialistes italiens, Nicolas Schöffer, Gerry Schum, Richard Serra et Carlota Fay Schoolman, Jeffrey Shaw, Pierrick Sorin, Woody & Steina Vasulka, Francesco Vezzoli, Bill Viola, Wolf Vostell, Wang Du, Wang Jianwei, Andy Warhol, William Wegman, Peter Weibel, Lawrence Weiner, Tom Wesselman, Knud Wiggen.
En ce sens, Chloé Delaume s’inscrit pleinement dans un héritage artistique. Ce médium donne lieu à des créations qualifiées d’in process, c’est-à-dire à des actions plus qu’à des créations matérielles où le temps de l’œuvre se donne pour objet d’atteindre le temps du quotidien. Robert Smithson qualifia cet art inachevable comme un art de l’entropie où est valorisé le temps de l’expérience de l’œuvre. Delaume, en connaissance de ce cadre artistique, effectue-t-elle un détournement de l’art vidéo et/ou s’inscrit-elle pleinement dans la performance ? On peut dire qu’elle marque une filiation avec l’artiste Nam June Paik et ses « téléviseurs préparés » qui font eux-mêmes écho au « piano préparé » de John Cage25. Branchés sur treize magnétophones diffusant des fréquences électroniques, les téléviseurs produisent toutes sortes de zébrures, distorsions, phénomènes visuels proches d’un parasitage26. Des interactions entre le son et l’image sont alors produites. À travers la lecture de J’habite dans la télévision, on sent le zapping auquel s’emploie Delaume. Le livre est constitué de 27 pièces reprenant, pour certaines, des citations de personnages télévisés. L’autoréflexion de Delaume sur elle-même expérimentant une plongée dans « l’aquarium hertzien27 » est parasitée par des pubs et des remarques tenues lors de certaines émissions.
Le terme même de « pièce », par sa polysémie, indique un dispositif. En effet, nous entendons, premièrement, une pièce de théâtre, ce livre comprendrait ainsi plusieurs actes et serait pure mise en scène ; deuxièmement, il converge vers une portée juridique, une pièce à conviction, des preuves de la performance ; troisièmement, il exprime un lien à l’architecture, des parties d’une habitation, le logement s’agrandirait par l’avancée dans l’ouvrage faisant se multiplier des espaces dont le format carré reprendrait celui du téléviseur, invitant ainsi à un jeu d’optique et de miroirs réfléchissant des TV dans la TV afin de montrer l’omniprésence dévorante (rappelons que la télé est nommée l’Ogre dans l’ouvrage) ; quatrièmement, ce terme renvoie à une œuvre d’art, ce livre s’inscrit bien dans une démarche héritière et ironique vis-à-vis de l’histoire de l’art (notamment : performance, art vidéo, art conceptuel), il se présente comme pièce artistique ; cinquièmement, une pièce est aussi synonyme de morceau, que ce soit d’un tissu, d’un mécanisme ou d’une machine, il est un bout octroyé à un tout tel un puzzle qui nous amène enfin au sixièmement, la dimension ludique, une pièce de jeu. C’est par cette polysémie que nous pouvons rapprocher le cycle J’habite dans la télévision aux téléviseurs préparés de Paik. Le livre – apparaissant plus comme un objet plastique restituant à la fois la performance à domicile et les performances scéniques dictées sur compilation de musique hertzienne – est en effet une pièce préparée.
La contrainte que se fixe Delaume, rester à son domicile devant la télévision pour tester son temps de cerveau humain disponible, est proche des consignes que se fixait Paik qui donna lieu à des performances et des recueils. Pensons à sa consigne de 1962 :
Lundi, coucher avec Elisabeth Taylor,
Mardi, coucher avec Brigitte Bardot
Mercredi, coucher avec Sophia Loren
Jeudi, coucher avec Gina Lollobrigida
Vendredi coucher avec Pascale Petit
Samedi coucher avec Marilyn Monroe – if possible.
Dimanche, coucher seul.
(SILENCE)
Lundi coucher avec la Reine Elisabeth II et voir la différence.
Mardi coucher avec la Princesse Margaret et voir la différence.
Mercredi coucher avec la Princesse Soraya et faire un enfant.
Jeudi coucher avec une fille des rues qui saigne. Etc.28
L’artiste coréen faisait ainsi référence à la culture de masse en donnant à ses fantasmes un cadre dans lequel ils pourraient évoluer, à savoir (se) coucher le soir avec les programmes télévisés. Notons que ce que nous entendons par « art vidéo » ne possède pas la même acception aux États-Unis et en Europe. La position américaine – qui est celle principalement adoptée par les scènes de la vidéo militante et des arts plastiques – privilégie la simple capacité d’enregistrement de la vidéo, ce qui produira les « vidéos d’artistes ». Cette conception amène ainsi à rejeter toute œuvre qui ne serait pas réalisée à partir d’une caméra. En Europe, l’intérêt se porte davantage au détournement de l’objet (la TV), à la spécificité d’une image poussée à son abstraction ainsi qu’à la manipulation du signal électronique et l’utilisation de matière nouvelle pouvant être extraite. Cette seconde acception est donc plus large que la première tout en l’englobant. En ce sens, nous pouvons affirmer que le cycle J’habite dans la télévision est une œuvre d’autofiction faisant écho à l’art vidéo.
Ce cycle doit se comprendre selon trois gestes. Le premier, Delaume performe le temps passé inexorablement chez elle devant la télévision. En effet, elle consigne :
Pièce 15/27. Mardi. Première pause depuis le début de l’expérience. Deux jours à l’extérieur et assez loin de la maison. Cela fait presque trois mois que la télévision habite dans mon salon. Pleinement, volume variable. Les moments où je fais corps avec elle se font de plus en plus fréquents. […] C’est à son diapason que depuis trois mois je fonctionne […]29.
Elle se fixe une contrainte qu’elle performe à domicile. Le second, Delaume intervient sur scène mettant en voix ses chroniques qu’elle publie parallèlement à son expérience ascétique. Pour ce faire, elle crée un environnement sonore basé sur des montages des chaînes hertziennes. Troisièmement, Delaume écrit un ouvrage où elle consigne sa performance à domicile tout en y menant un travail d’autoanalyse sur les modifications engendrées sur sa personne en tant que cobaye consentant. L’ouvrage J’habite dans la télévision narrativise la performance à domicile mais ne revient pas sur celle scénique puisqu’il en porte le contenu. Ce livre en tant qu’objet, a priori peu identifiable par les catégories littéraires, se révèle être une curiosité. Il est déterminant dans le cadre de ce cycle car, au-delà du travail de mémoire et de poésie du quotidien, il semble être avant tout une manière de penser le contexte, l’environnement et la situation plutôt que d’être créé pour lui-même en tant que fin. En ce sens une certaine radicalité delaumienne a lieu en ce qu’elle se rend disponible à l’immédiateté d’une situation expérimentée.
L’histoire de la performance montre que celle-ci apparaît comme une suite logique de l’assemblage. En effet, pour Allan Kaprow, les environnements sont des « représentations spatiales d’une attitude plurielle face à la peinture ». Il ajoute :
[…] un environnement est une extension de l’assemblage, qui est lui-même une extension tridimensionnelle du collage. Un Environnement est un environnement composé de n’importe quels matériaux, intéressant le toucher, l’ouïe et même l’odorat, réalisé dans une ou plusieurs pièces, ou en plein air. Littéralement, le visiteur est dans l’art30.
On connaît l’intérêt que Kaprow avait envers John Dewey et notamment son ouvrage Art as Experience. L’influence de Kaprow, Dewey et Cage sur l’art a été considérable, ils l’ont notamment engagé dans une voie nouvelle où performer le réel relève d’une volonté de mêler l’art et la vie. Pour Delaume, il s’agit effectivement de se retrancher dans un quotidien dans ce qu’il a de fondamentalement « expérimental ». Ne s’attardant pas sur une exigence de virtuosité artistique, elle profite d’une expérience esthétique. Cette situation est radicale dans le sens où elle joue sur l’acceptation, Delaume est « devenue [son] propre sujet d’étude31. » Précisons que nous entendons le qualificatif « expérimental » dans son sens pragmatiste. En effet, si Cage définit l’expérimental comme un processus dont il est impossible de prévoir le résultat, nous nous inscrivons dans la dimension pragmatique du concept d’« expérience », c’est-à-dire dans l’expérience commune du quotidien. En ce sens Delaume expérimente l’expérience.
Ce cycle peut être compris comme une fiction anthropomorphique. Le dispositif scénographique se construit sur la confusion entre le corps de l’artiste et l’objet technique. Par sa personnification démesurée, la télé étant appelée l’Ogre, elle étend son activité corporelle autant qu’elle en prend possession. Delaume narrativise une captation de son propre corps par le corps télévisuel. Cette métamorphose repose sur le truchement anthropomorphique prêté à la TV et sur la littéralité de l’expérience, enfin sur la manière dont la TV est intégrée au processus de création. Cette modalité de la confusion du corps humain et de l’objet est en réalité assez symptomatique de l’art de la performance. La chimère ainsi obtenue peut rappeler des figures mythologiques et très clairement des contes classiques puisque les ogres en sont les personnages traditionnels. On retrouve par là même le thème de l’enfance, bien qu’ici un peu dilué, si cher à Delaume. Ce mélange technologie/enfance amène inévitablement à une image proche du monstrueux qui n’est pas sans rappeler, une fois de plus et entre autres, les installations de Nam June Paik.
Le dispositif mis en scène par Delaume, déplaçant l’expérience sur son corps et son psychique constitue un moyen de capter l’attention des lecteurs et des publics présents lors des mises en voix. Elle les amène à penser une transformation à laquelle ils prennent part. La variation des sentiments auxquels Delaume est soumise – elle écrit :
Au début c’était une lucarne hystérique, vitraux maniaco-dépressifs et mosaïques d’un carnaval foulant le temple en saccadés. À présent je ne sais plus très bien, c’est peut-être lié au silence, à l’angoisse du silence qui m’égorge dans cette chambre. En ce moment. Je crois bien qu’elle me manque, je me sens mal à l’aise […]32.
– est traversée par la possibilité à venir (comme le montre la fin de l’ouvrage) que le corps et l’objet technique auront fusionné. Nous savons que la technique dans l’art vise à construire à la fois un dispositif scénographique mais aussi la fascination du public (d’autant plus par le biais si elle est anthropomorphisée) en capturant son attention. De ce fait, la fiction forme un espace pour l’expérimentation delaumienne.
Conclusion
À travers cette exemplification de l’autofiction en tant que dispositif de performance, nous avons démontré que la filiation de l’autofiction à la performance ne résulte pas d’un texte porté à la scène dans le but de sa lecture mais est un texte faisant émerger une relation symbiotique du récit autofictionnel et d’une performance. Nous pensons donc que l’autofiction contemporaine est intrinsèquement liée à la performance. Cette filiation nous amène donc à (re)circonscrire ce genre en pleine expansion depuis son appellation par Doubrovsky. Aussi, les critiques et les recherches sur l’autofiction doivent par conséquent être renouvelées car l’autofiction, plus qu’un genre littéraire, est un médium et une tradition (en train de se faire) artistique interdisciplinaire trouvant certes son origine dans la littérature mais non sa destinée.