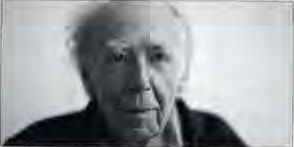« Contrairement aux conceptions libérales selon lesquelles seul l’individu fait des choix et prend des risques, je pense que l’individu est un sujet social. Nous sommes tous traversés par l’histoire. Ce n’est pas seulement un décor. Cela marque très profondément nos choix, nos amours, nos peines. Nous avons une dette vis-à-vis de l’histoire ».
Robert Castel, L’humanité, Entretien publié le 14 mars 2013.
Robert Castel était un Monsieur, un grand Monsieur. Et, comme tout grand Monsieur, il savait que la grandeur a des petitesses qui interdisent la vanité et c’est pourquoi une telle qualification l’aurait sans nul doute fait sourire et plaisanter. Les vices et les vertus, tellement imparfaits disait Éluard rappelant par là-même que l’écorce dont est fait l’homme n’est qu’aspérités, jeux d’ombres et de lumières. Robert Castel, qui savait pratiquer l’art de la nuance sans pour autant faire de concession, ne disait pas autre chose lorsqu’il évoquait, dans les termes qui lui étaient propres, la fragilité structurelle des corps sociaux, leur vulnérabilité, les menaces d’effritement pesant sur leurs solidarités prenant des formes toujours multiples et renouvelées. S’y montrer attentif de manière distanciée, c’était certes là une des exigences fortes de l’exercice de son métier de sociologue, mais pas seulement. Du monde qui l’avait vu naître, le monde des petites gens, il avait gardé cette mémoire du fragile et si, à l’instar de Norbert Elias, il estimait qu’il était de son devoir de savant de montrer que la marginalité ne s’observe jamais en soi, mais repose bien sur des processus socio-historiques qu’il convient d’analyser, l’orphelin que, bien trop tôt, il avait été savait d’expérience ce qu’est la dissolution des protections rapprochées et n’avait rien oublié de la possible fraternité des hommes et de son influence sur le cours de la vie. C’est, disait-il, à un événement survenu dans sa trajectoire sociale alors qu’il avait 12 ou 13 ans qu’il devait d’avoir pu vivre sa vie d’intellectuel. Alors qu’il préparait un certificat d’aptitude professionnelle d’ajusteur mécanicien qui le destinait à s’inscrire dans la continuité de l’histoire de sa classe sociale d’origine, son professeur de mathématiques, un certain « Buchenwald », l’avait convoqué et encouragé, contre toute attente, à entrer au lycée. Contre toute attente parce que la voie semblait tracée et l’homme que les élèves appelaient « Buchenwald » parce qu’il était, comme disait Jorge Semprun pour évoquer ceux qui avaient survécu aux camps de la mort, un revenant, lui paraissait non seulement triste et sévère, mais aussi malveillant. Il le faisait venir régulièrement au tableau pour faire des exercices de mathématiques que le collégien qu’il était ne savait pas faire et il éprouvait donc vis-à-vis de lui un sentiment de peur mêlé de suspicion et de rancune qui lui masquait la bienveillance dont cet homme-là, en réalité, faisait preuve à son endroit. En l’enjoignant d’aller au lycée et de tenter sa chance, cet ancien résistant communiste au surnom sinistre fut celui qui, ce jour-là, lui ouvrit les portes de la liberté, qui fut, pour reprendre sa formule, son professeur de liberté. Robert Castel n’était certes pas un bon élève en mathématiques, mais il l’était en français et la littérature était son refuge, les livres offrant quelque répit à son désespoir d’enfant : sa mère était décédée alors qu’il avait neuf ans et son père alors qu’il en avait onze. C’était sa sœur et son beau-frère qui l’avaient recueilli et ce dernier, électricien de métier, avait lui aussi fait en sorte qu’il puisse s’émanciper de sa condition sociale d’origine en le soutenant dans son projet, jugé fou pour un enfant de sa condition, de poursuivre ses études dans le cycle supérieur1. La carrière brillante qui fut celle de Robert Castel a donné à cette bifurcation sa justification, l’œuvre qu’il nous a léguée si élégamment étant une œuvre profonde et consistante.
La consistance de cette œuvre, ainsi que la robustesse de ses démonstrations, tiennent fondamentalement à la démarche historique retenue par Robert Castel et au principe épistémologique qui la sous-tend : pour comprendre et expliquer le monde, encore faut-il le tenir à distance et l’historicisation des objets de recherche qu’il se donne le conduit, dans le sillage d’autres penseurs comme Michel Foucault ou Norbert Elias, à porter une attention accrue au passé dont la compréhension est nécessaire à celle du présent, ce dernier estimant, par ailleurs, que l’avenir risquait fort d’échapper aux hommes s’ils ne travaillaient pas à prendre la mesure des conséquences de leurs actions présentes. La profondeur de son travail repose aussi sur une hypothèse forte qui guide l’ensemble de sa réflexion, à savoir que la liberté du sujet social résulte des conditions sociales et historiques qui la rendent possible. Il est évidemment difficile de savoir si l’élaboration d’une telle hypothèse prend sa source dans l’analyse que Robert Castel propose de l’événement dans sa trajectoire sociale et familiale ou si la restitution de l’enchaînement des événements qu’il rapporte résulte de cette hypothèse générale qu’il appliquerait à sa trajectoire. Cependant, et quel que soit le chemin emprunté pour la construction de cette hypothèse, on peut dire, sans trahir sa pensée, qu’il existe une cohérence forte entre l’expérience singulière qu’il relate et l’objet de recherche qu’il privilégie, à savoir l’étude des conditions de la liberté de l’individu. Robert Castel savait d’où il venait et proposait une version cohérente de sa trajectoire. L’ensemble de son travail porte la marque de l’attachement, du respect et de la reconnaissance qu’il témoignait à ceux qui avaient contribué à son émancipation, comme si l’homme, dans l’accomplissement de son œuvre, était guidé par un serment de fraternité envers ceux qui, du fait de leurs conditions de vie et de socialisation, se trouvaient relégués et ne parvenaient pas à s’extraire de la vulnérabilité et de la précarité dans laquelle ils étaient nés ou dans laquelle ils avaient chu. En cela, Robert Castel est un sociologue de la socialisation attentif, comme Norbert Elias, à l’intériorisation des contraintes sociales dont il soulignait qu’elles allaient jusqu’à constituer la trame de nos affects les plus personnels2. Si les sujets sont bien actifs dans les processus de subjectivation, les déterminismes historiques qu’ils subjectivent s’actualisent toujours dans les processus de socialisation qui leur sont donnés à expérimenter. D’où l’importance pour Robert Castel de l’événement ou de la rencontre susceptible de rendre possible la bifurcation. D’où aussi sans doute son intérêt pour l’analyse des situations tremblées et fragiles, celles mettant en jeu des bifurcations dont on ne peut prédire si elles contribueront à l’affiliation ou à la désaffiliation individuelle. Son travail montre, cependant, que le risque de désaffiliation concerne l’individu le plus exposé, en général, à l’insécurité sociale, économique et symbolique et que la fragilité de l’individu s’accroît au fur et à mesure que s’érodent les collectifs protecteurs. D’une certaine manière, Robert Castel s’est appliqué à lui-même, en toute humilité, cette hypothèse de travail. Non pas que ses qualités personnelles doivent être sous-estimées dans ce qu’il est advenu de l’homme, mais elles n’auraient pu, à elles seules et, selon lui, changer la trajectoire de sa vie. Pour que le processus de subjectivation permette au sujet social – que Robert Castel a toujours conçu comme un sujet en interaction avec le monde – de déboucher vers un nouveau registre de l’existence sociale, l’individu doit rencontrer et s’affronter à des conditions sociales qui en rendent possible l’émergence et l’accomplissement. Comme il aimait à le dire, la conscience de soi n’est pas une donnée spontanée à la conscience, elle advient comme telle lorsque la socialisation, processus par lequel s’établit l’ajustement de la subjectivité aux conditions sociales objectives, est mise à l’épreuve d’expériences n’entrant pas dans les schèmes de pensée habituels. Son compagnonnage avec la psychosociologie et la sociologie clinique tenait, pour partie, à la volonté de comprendre aussi, du point de vue de l’individu, les étayages que ce dernier mobilise dans l’ici-et-maintenant pour prendre une direction lorsqu’une bifurcation se présente comme porteuse d’un nouvel horizon, fusse pour le meilleur ou pour le pire.
Robert Castel était convaincu que la grande Histoire dont on est le produit est toujours traversée par la petite histoire et il en avait été ainsi pour lui. De sa renommée, il n’a tiré aucune vaine gloire et s’est toujours gardé d’autonomiser la place qu’il avait occupée dans le champ social de la trajectoire sociale qui l’avait rendue possible. C’est ici que l’homme de science se fond avec l’homme d’honneur et de valeurs car, pour Robert Castel, être responsable de sa vie risque toujours de n’être qu’un discours performatif qui renvoie aux individus les plus vulnérables la responsabilité de leurs situations. Or, la marginalité est d’abord marginalisation, c’est le nom, disait-il, que l’on peut donner aux formes les plus fragiles de la vulnérabilité populaire3. À une époque où les zones d’intégration ne cessent de se fissurer et les zones de vulnérabilité et de désaffiliation d’enfler, où les luttes agonistiques vont bon train et où la ferveur méritocratique tend à faire croire aux individus que seuls leurs talents et leur vouloir font le jeu du social, les méditations castéliennes offrent à nos incertitudes les plus beaux fruits de cette vulnérabilité populaire dont Robert se souciait tant.
Au revoir Monsieur Castel et merci.