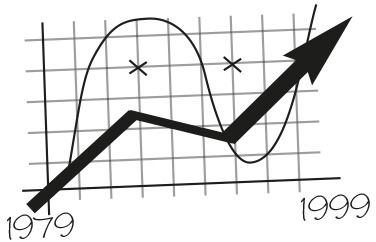En juin 1999, au 20e anniversaire de la filière, son fondateur, Alain-Noël Henri, a réalisé une enquête sur les étudiants et anciens étudiants de la FPP. Les 606 questionnaires retournés représentent 22,9 % des 2 650 étudiants anciens et inscrits à l’époque.
L’enquête nous apprend que les étudiants FPP sont des adultes en reprise d’études qui s’inscrivent entre 35 et 38 ans. Près d’un étudiant sur deux travaillait dans le champ social avant l’inscription, 43 % dans le champ sanitaire, 27 % dans l’enseignement et la formation, 14 % dans le secteur administratif et commercial1. Quelques étudiants ayant déjà le titre de psychologue s’inscrivent en FPP (de 2 à 6 par promotion) probablement sans chercher à valider.
Ils ont tous connu la FPP par leur réseau relationnel, l’étudiant FPP, cité par trois anciens et quatre inscrits sur dix, étant le principal prescripteur de la filière auprès des futurs étudiants.
Avec une distribution de 76 % de femmes et 24 % d’hommes la FPP est une filière de formation en psychologie plus masculinisée que le régime général qui compte 84 % de femmes et 16 % d’hommes. Les étudiants s’inscrivent en FPP vers 37 ans. Les femmes s’inscrivent en moyenne à 37,6 ans, soit deux ans plus tard que les hommes (35,7 ans).
Les anciens étudiants passaient en moyenne 3,6 ans en FPP, les inscrits y sont restés plus de 4 ans. Cette évolution est conditionnée par le fort accroissement des étudiants qui restent trois ans et plus sans valider de diplôme.
Un peu plus d’un étudiant sur quatre valide la maîtrise. Un étudiant sur cinq deviendra psychologue.
Le diplôme le plus élevé qu’obtiennent les étudiants est le Deug pour 16 % d’entre eux, la licence pour 12 %, et la maîtrise pour 26 %. 46 % des étudiants n’en valident aucun. Trois étudiants sur quatre déclarent que la formation à « plutôt ou tout à fait » répondu à leurs attentes.
| Extrapolation des diplômes obtenus à la fin de la cohorte 98/99 | Effectifs | % |
| Aucun diplôme | 1 203 | 45 % |
| Deug | 433 | 16 % |
| Licence | 322 | 12 % |
| Maîtrise | 692 | 26 % |
| Total | 2 650 | 100 % |
Lorsque tous les étudiants de la cohorte 1998/1999 ont quitté la filière (tableau ci-avant), ce qui est vraisemblablement le cas depuis juin 20092, sur les 2 650 inscrits jusqu’à juin 1999, environ 433 ont validé un Deug, 322 une licence et 692 une maîtrise.
Sur les 2 650 étudiants entrés en FPP en juin 1999, 547, soit environ 20 % ont vraisemblablement obtenu le titre de psychologue. En moyenne, un étudiant sur cinq qui s’inscrit en FPP deviendra psychologue.
Ils s’inscrivent en FPP pour évoluer
Un étudiant sur deux déclare s’être inscrit en FPP pour son « évolution personnelle et professionnelle, un changement, une reconnaissance ». Trois anciens et seulement deux inscrits sur dix se sont déclarés motivés par « le diplôme et la validation officielle ».
Quant à « l’originalité de la formation », elle arrive en troisième position. Elle a motivé un peu plus de deux anciens et près de quatre inscrits sur dix. L’originalité de la filière FPP semble avoir été une motivation d’inscription beaucoup plus importante pour les étudiants de la fin des années 90 que pour ceux de la décennie précédente. Nous devons toutefois rester prudents sur l’interprétation d’un tel point, les motivations subjectives étant d’autant plus reconstruites par les anciens étudiants que leur inscription est ancienne. Seuls 9 % des anciens et 12 % des inscrits ont déclaré qu’ils se sont inscrits en FPP pour « devenir psychologues ». Ces derniers n’ont toutefois pas validé de maîtrise dans des proportions supérieures aux autres.
Hommes et femmes, des parcours similaires
Hommes et femmes ont donné des réponses très semblables sur leurs motivations à l’inscription, leurs parcours et leurs appréciations de la filière. Si les hommes s’inscrivent en moyenne deux ans plus tôt que les femmes, ils passent autant de temps les uns que les autres en FPP et valident des diplômes de façon comparable.
Les femmes sont plus satisfaites de « l’autonomie dans le travail : rythme et contenu des dossiers » citée par une femme sur trois contre seulement un homme sur sept. Les hommes sont plus satisfaits du « lien avec la pratique professionnelle » cité par un étudiant sur dix contre seulement deux étudiantes sur cent.
Les femmes se déclarent plus insatisfaites que les hommes du « manque de structure et d’organisation ». Les hommes se déclarent plus insatisfaits que les femmes du « manque de repères ». On peut faire l’hypothèse que les femmes, mieux armées en termes de bases théoriques réclament plus des méthodes de travail, et que les hommes, plus sûrs d’eux en matière de méthodes de travail, réclament plus de bases théoriques. Une telle hypothèse reste toutefois à vérifier.
Les étudiants qui ne valident pas de diplôme, un phénomène nouveau
La validation d’un diplôme était une motivation plus fréquente pour les étudiants de la première décennie que pour ceux de la deuxième. Sur 100 étudiants qui rentrent en FPP, les 46 qui ne valideront aucun diplôme resteront en moyenne à peine plus de deux ans. La proportion d’étudiants qui restent plus de trois ans en FPP sans valider de diplôme a considérablement augmenté depuis la dernière décennie, passant de 4 % des anciens à 18 % des inscrits. Il y a dans la deuxième décennie quatre fois et demie plus d’étudiants qui restent inscrits plus de trois ans sans valider de diplôme que dans la première. Nous avons imaginé trois hypothèses explicatives qui pourraient avoir contribué à engendrer ce phénomène :
- Les anciens étaient plus performants et validaient plus vite. Cette piste pourrait ouvrir une réflexion sur l’influence du contexte social sur la confiance des étudiants en leur capacité à mener des études en situation professionnelle, avec l’idée que la situation était plus favorable pour les étudiants de la première décennie que pour ceux de la suivante.
- Le niveau de validation s’est peut être renforcé entre la première et la deuxième décennie, et, à niveau équivalent, il était devenu plus difficile de valider des diplômes en FPP en 1999 qu’auparavant. La réévaluation d’anciens dossiers, en lecture seule, par de nouveaux jurys ignorant les niveaux attribués à l’époque, pourrait constituer un procédé de vérification de cette hypothèse.
- La sélection sur dossier a peut-être contribué à engendrer des changements de profils et de motivations, provoquant l’accroissement de la proportion d’étudiants qui sont plus motivés par l’évolution personnelle et professionnelle que par la validation de diplômes.
Les étudiants ne sont pas égaux en termes de motivations et de possibilités de s’investir dans le processus FPP, et il est envisageable que certains se contentent des regroupements et de leur travail personnel sans éprouver la nécessité de présenter des dossiers en jury. Choisi par plus d’un étudiant sur deux, « le développement personnel et professionnel » est la motivation d’inscription qui arrive en première position. Satisfaire ce besoin n’implique pas nécessairement de passer devant un jury. Nous avons également constaté une décrue de la motivation d’obtenir un « diplôme ou une validation officielle par rapport à une pratique », les anciens étant 31 % à avoir choisi cette réponse contre 22 % des inscrits. Nous pourrions avoir affaire, si cette hypothèse était confirmée, à une proportion croissante d’étudiants qui utilisent marginalement les ressources de la FPP, comme des auditeurs libres peuvent le faire dans le régime général en assistant aux cours magistraux de leur choix sans passer d’examens.
La baisse d’intérêt pour la validation n’explique pas tout. Une partie des 46 % d’étudiants qui quittent FPP sans avoir validé de diplôme, semble ne pas y être parvenu. Trois motifs d’insatisfaction différencient nettement les étudiants qui ont validé des diplômes et ceux qui n’en ont pas validé :
- « Pas assez de structure/de méthodologie : cadre flou » : cité par 19 % des étudiants qui ont validé au moins un diplôme et 41 % de ceux qui n’en ont pas validé. Cette proportion du simple au double est significative d’une difficulté manifeste de certains étudiants à s’adapter à un cadre singulier. La FPP est un régime où l’angoisse liée au manque de cadre et de prise en charge est un ingrédient nécessaire au parcours d’un candidat en découverte de sa propre capacité active à construire son savoir. Bien des étudiants qui pensent venir puiser des connaissances et se voient enjoints de découvrir leur pensée, doivent traverser une période confusion. Tous ne vont pas supporter la solitude dans le travail qui semble être un des marqueurs de ce régime.
- « Jurys/validations aléatoires et décalées avec travail fourni » : cité par 13 % des étudiants qui ont validé au moins un diplôme et 4 % de ceux qui n’en ont pas validé. Pour une part non négligeable d’étudiants, le jury semble avoir été mal vécu. L’identification d’un étudiant au travail qu’il présente peut rendre les critiques difficiles à vivre et donner peut-être l’impression que l’évaluation faite est injuste compte tenu des efforts fournis. Parmi ceux qui n’ont pas validé de diplôme, une proportion importante (39,1 %) quitte FPP après une ou deux inscriptions. Si les étudiants qui ont validé un ou plusieurs diplômes ont nécessairement soutenu plusieurs dossiers devant un jury, il est probable que la majeure partie de ceux qui n’en ont validé aucun et partent au bout d’un an n’ait pas fait cette expérience.
- « Difficulté à concilier formation, vie professionnelle et privée » : cité par 1 % des étudiants qui ont validé au moins un diplôme et 9 % de ceux qui n’en ont pas validé. Bien qu’elle ne représente qu’un nombre limité de réponses, et que sa représentativité soit faible, il est intéressant de noter que ce motif d’insatisfaction soit presque uniquement cité par les étudiants qui n’ont pas validé de diplôme. Nous faisons la supposition qu’en arrivant en FPP, beaucoup d’étudiants (c’était mon cas) n’appréhendent pas nettement la particularité du régime, ni les efforts et les sacrifices en matière de vie privée que la poursuite des études va engendrer.
Les « disparus » de FPP
Chaque année, 30 % des étudiants qui viennent de s’inscrire pour la première fois en FPP ne se réinscrivent pas l’année suivante. La question des raisons de départ de ces étudiants qui ne s’inscrivent qu’un an et partent sans avoir validé de diplôme reste posée.
Trois dossiers FPP ont été rédigés entre 1986 et 1988 par une équipe d’étudiants3, partant de l’hypothèse que les départs étaient liés à des situations matérielles lourdes (éloignement, nombre d’enfants à charge…). Les résultats de leur enquête, bien que non significatifs, les ont conduits à observer qu’il y avait des « disparus » aussi bien chez les étudiants en situation « lourde », que chez ceux qui se trouvaient en situation « légère » (résidant à moins de 50 km de l’université, sans enfant à charge). Ils ont également constaté que les étudiants en situation « légère » sont les plus critiques vis-à-vis de la FPP. Les conclusions d’un des trois dossiers suggèrent, sans accéder à la significativité statistique, que le cadre pédagogique pourrait expliquer le départ des étudiants qui n’abandonnent pas à cause de conditions matérielles trop lourdes. Dans l’enquête 1999, les étudiants qui ne sont restés qu’un an émettent très peu de motifs d’insatisfaction vis-à-vis de la filière, et lorsqu’ils le font, c’est souvent dans des proportions moindres que les autres. Ces « disparus de FPP » n’ont pas eu le temps d’apprécier pleinement les particularités du dispositif pédagogique, ni d’en vivre les inconvénients. La « difficulté à concilier formation, vie professionnelle et privée » n’est citée que par 7 % des étudiants qui ne sont restés qu’un an. Tant l’hypothèse de la situation lourde que celle des particularités d’un dispositif pédagogique difficile à supporter semblent invalidées. Nous avons envisagé l’angoisse occasionnée par la confrontation avec la solitude qu’engendre le parcours en FPP comme une des variables explicatives de l’abandon de 30 % des étudiants qui viennent de s’inscrire dans l’année. Cette hypothèse pourrait, si elle était confirmée, fonder une critique du dispositif pédagogique. Mais je ne peux m’empêcher de penser que l’angoisse vécue est peut-être un ingrédient nécessaire au succès du parcours en FPP, en ce sens qu’elle serait la manifestation d’un remaniement liée à une crise migratoire (Mercader, 2007), à l’abandon d’anciens repères pour en intégrer de nouveaux. L’angoisse pourrait être le marqueur de la déconstruction de la croyance inconsciente que la connaissance est extérieure, faisant progressivement place à une nouvelle conception d’un savoir à construire individuellement. Il me paraît difficile de critiquer le dispositif au prétexte qu’il fait traverser des moments de désagrément, car l’issue qu’il propose, l’apprentissage d’un savoir penser par soi-même, me semble valoir le prix d’inconfort à payer.
Les raisons d’abandon de ces étudiants sont vraisemblablement fondées sur des composantes multiples. On peut imaginer qu’ils n’ont appréhendé la nature du dispositif qu’après avoir participé à quelques regroupements. Beaucoup ont pu fantasmer qu’ils n’arriveraient pas à faire face à leur idéal d’apprentissage dans un tel régime. La conception d’un « contenu insatisfaisant, ennuyeux, peu ouvert : psychanalyse seule » a pu confirmer à 10 % d’entre eux que la FPP n’était pas à leur portée. L’idée d’une dominante psychanalytique de la FPP ne semble pas ressortir du seul fantasme, en effet, l’enquête d’Alain Giré (1991) a fait apparaître que les enseignants de la filière, interrogés à l’époque4, déclaraient quasiment tous (80 %) qu’un « travail psychothérapeutique, et même spécifiquement psychanalytique dans certains cas, est quasi impératif ». Selon Alain-Noël Henri, la référence à la seule clinique est une interprétation des étudiants, des enseignants de groupe FPP et des membres des jurys extérieurs à ce régime, et que « le recours au référentiel psychanalytique s’est imposé comme culture commune du système5 ».
L’insatisfaction vis-à-vis d’eux-mêmes, fruit d’une réflexivité et d’une forme de culpabilité, laisse supposer que c’est peut-être dans un espace d’idéal du moi, de fantasmes et de peurs que se nichent une partie des explications du départ de 30 % des nouveaux inscrits dès la première année.
Enfin, il est important de prendre en compte le contexte de départ. L’enquête nous apprend que la moitié des étudiants a changé d’activité depuis leur inscription en FPP. Elle nous révèle également que 15 % d’entre eux connaissent une période sans activité professionnelle après l’inscription en FPP. Il est envisageable que dans une partie des cas, des étudiants se voient contraints de quitter la FPP car des événements personnels ou professionnels ne leur permettent pas de poursuivre leurs études.
Si 30 % des étudiants partent après la première année, 70 % poursuivent leurs études. Avec un « taux de poursuite » de 70 %, la FPP atteint un niveau de performance très supérieur à celui du régime général en sciences humaines dont seulement 56 % des étudiants restent après une première année (Vitry, 2008).
Quatre étudiants sur dix font une formation supérieure après FPP
C’est le diplôme le plus élevé obtenu en FPP qui conditionne le type de formation que feront quatre étudiants sur dix après avoir quitté la filière. Ceux qui n’ont pas pu aller jusqu’où ils le souhaitaient poursuivront des études ailleurs.
Les étudiants qui ont obtenu la maîtrise, ou le master 1 continuent en psychologie dans le régime général (DESS, DEA, Master 2) pour les trois quarts d’entre eux. Ceux qui se sont arrêtés à la licence font « d’autres formations » pour un quart d’entre eux et 22 % continuent en « psychologie », mais aucun en DESS ou DEA. Peut-être se sont-ils réinscrits en psychologie dans le régime général, une autre université, ou une formation privée ? Ceux qui se sont arrêtés au Deug choisissent une « autre approche thérapeutique » (19 % d’entre eux), une « autre » formation (17 %), une formation dans le domaine de la « santé » (10 %) ou de « l’éducation » (10 %). Enfin, ceux qui n’ont pas validé de diplôme en FPP, 26 % déclarent une « autre » formation, 18 % une formation à une « autre approche thérapeutique », ou 10 % une formation dans le secteur de la « santé ».
Des étudiants qui changent
Anciens étudiants et étudiants inscrits ne sont pas venus en FPP pour les mêmes raisons, n’ont pas vécu la même expérience. Les inscrits restent plus longtemps que les anciens en FPP : 4,1 années contre 3,6 années en moyenne. Ils viennent deux à trois fois plus souvent que les anciens « d’autres formations universitaires », « d’autres secteurs médical et para médical » et de « formations de thérapeutes, médiateurs et conseillers. »
« L’autonomie dans le travail, le rythme et le contenu des dossiers » semble être un critère beaucoup plus apprécié par les étudiants inscrits que par ceux de la décennie précédente. Un ancien sur quatre et plus de quatre inscrits sur dix se déclarent insatisfaits du manque d’efficacité de l’organisation. Plus d’un ancien sur quatre et plus d’un inscrit sur trois se déclarent insatisfaits à cause de leurs propres difficultés à faire face aux exigences d’un tel régime de formation. Ces critiques, dont la fréquence s’accroit d’une décennie à l’autre, renvoient aux particularités du cadre, à ses conséquences en matière de solitude, et à la difficulté d’élaborer dans de telles conditions. La limite synchronique d’observation dans laquelle la structure de l’échantillon nous contraint, ne permet que d’émettre des hypothèses.
Les anciens reconstruisent peut-être leurs souvenirs en omettant en partie ce qui a pu être difficile pour n’en retenir que le meilleur. Les étudiants inscrits éprouvent peut-être plus de difficultés face à l’organisation spécifique de la filière que les anciens n’en ont éprouvées. Ces hypothèses militent pour une différence d’attitudes, d’attentes et d’idéalisations entre anciens et inscrits. Il est également concevable que les enseignants de la FPP aient animé différemment les promotions de la première décennie et les suivantes. Les étudiants FPP changent, et vraisemblablement les enseignants-chercheurs qui animent la filière également. Nous ignorons toutefois où situer les lignes de changement, faute d’un échantillon représentant de manière suffisamment homogène les anciennes promotions. Ces changements, s’ils se confirment, peuvent-ils être attribués au recrutement sélectif d’étudiants présentant de nouveaux traits de personnalité, ou à l’influence de phénomènes sociaux plus vastes affectant ceux qui entreprennent des études en FPP ?
Identifier les ruptures temporelles entre les représentations, les attentes, les idéalisations des étudiants, suppose des vagues d’enquêtes à rythme régulier. Des entretiens semi-directifs réalisés auprès d’un petit nombre d’anciens et d’inscrits, pourraient apporter un riche matériau susceptible d’étayer une telle recherche.
Les fréquences d’inscription de chaque promotion aux modules pourraient également être observées comme indices des centres d’intérêt qui se manifestent selon les époques. Cette approche pourrait être réalisée en traitant sur longue période les fiches d’inscription aux modules ou leur saisie informatique. Il s’agirait d’observer sous un angle à la fois quantitatif et qualitatif, vers quels libellés, et donc vers quelles idéalisations, se porte l’intérêt d’année en année, comme piste du statut subjectif accordé à la filière par ses étudiants (Ginet, 2007).
Nous faisons l’hypothèse, qu’une nouvelle vague d’enquête par questionnaire à partir du fichier des anciens et inscrits, en utilisant une version évoluée du questionnaire, celle que nous proposons ou une autre, confirmerait des évolutions importantes entre ces nouveaux étudiants, et les anciens. Nous pourrions vérifier, en demandant aux futurs enquêtés s’ils ont déjà répondu à l’enquête 1999, si les réponses de ces étudiants ont changé, laissant deviner une reconstruction de leur expérience à une décennie d’écart. Notre approche n’a pas épuisé tout le minerai qu’on peut extraire de cette enquête, et, l’analyse des données par une approche en composantes multiples est toujours une idée pertinente.