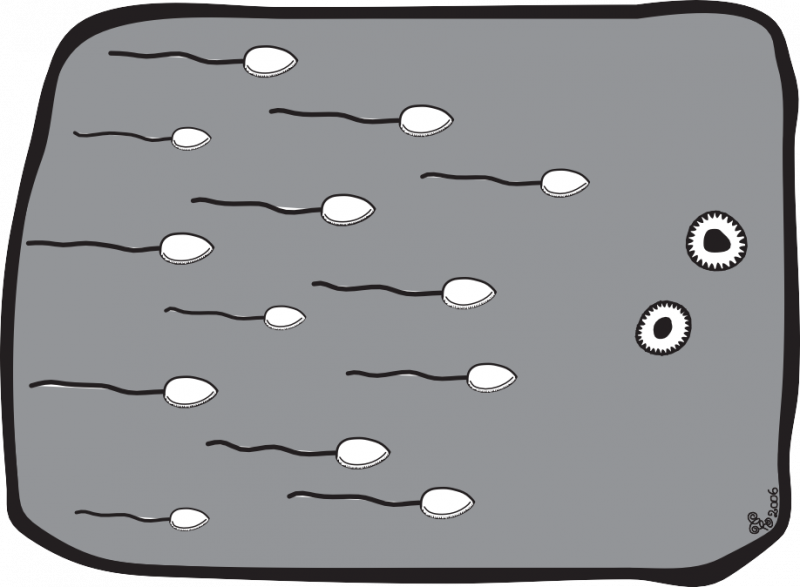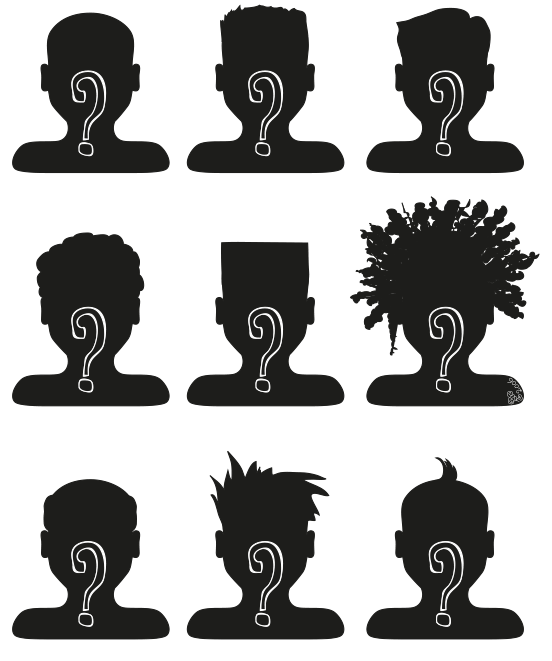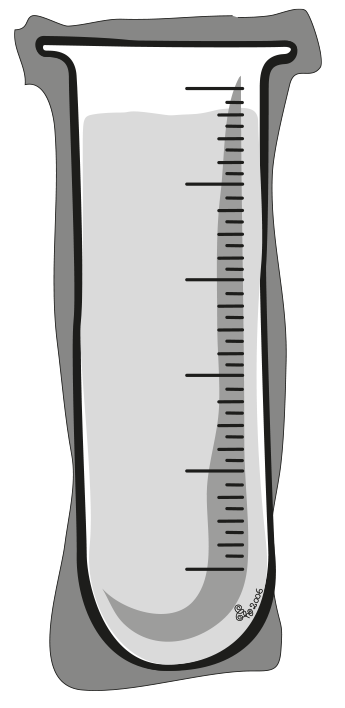En janvier 2006, le Comité national consultatif d’éthique a émis un avis favorable à l’assouplissement « prudent » de l’anonymat et du secret de la filiation. Cet avis concerne les enfants nés grâce au recours à des techniques de procréation médicalement assistée, notamment, le don de sperme. Un don, qui, depuis 1971 en France, reste anonyme et gratuit et constitue la devise des CECOS (Centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains). Que faut-il entendre par cet avis ? Pourquoi cette demande d’assouplissement ? Pourquoi l’appel à la prudence ?
Voici quelques questions fondamentales qui touchent de près les domaines de la parenté, de la filiation, des nouvelles formes de parentalité qui caractérisent nos sociétés et qui nous font changer le regard porté jusqu’à présent à l’institution familiale. Ces questionnements sont au cœur d’une recherche de psychologie sociale, dont les contours seront présentés ici, menée au sein du Groupe d’étude des relations asymétriques en collaboration avec la fédération française des CECOS1.
Présentation de la recherche
Cette étude, venant de débuter, a pour but d’explorer les informations, représentations, valeurs et normes qui orientent chez les hommes et les femmes les prises de position relatives à la question sensible de l’anonymat du donneur lors du recours à l’insémination artificielle avec don de sperme (IAD). De plus, nous nous intéressons à l’étude des nouvelles problématiques, éthiques et sociales, soulevées par cette technique de procréation quant à la représentation de la procréation, du don, de l’enfant, des nouvelles formes de parentalité qui en découlent (p. ex. homoparentalités), de la filiation et de la transmission (ou pas) d’un récit de conception à l’enfant et au sein du cercle social et familial.
Il est attendu des résultats de cette recherche qu’ils servent, principalement, de base permettant d’inventorier les raisons qui plaident pour ou contre l’abandon de l’anonymat et de dresser des profils d’attitudes dont on étudiera la distribution, au sein d’un large échantillon, selon des variables socio-démographiques. Grâce à la collaboration de recherche établie avec la fédération française des CECOS, nous avons la possibilité d’avoir accès à un échantillon représentatif de la population française.
Laurence Chassard
Sans préjuger des motifs, bioéthiques et légaux, qui peuvent orienter les politiques de santé dans le sens d’un encouragement ou d’une imposition de l’accès aux informations concernant l’identité de(s) donneur(s), dans le cadre de cette technique spécifique de procréation, il est loisible de penser que les résultats de cette recherche pourront également être utilisés pour l’établissement de programmes d’information et d’argumentaires destinés à mettre en évidence les enjeux sociétaux de ces politiques.
Position du problème
De plus en plus de couples rencontrant des difficultés de procréation, notamment l’infertilité masculine et/ou la stérilité, font appel à l’IAD qui a permis la naissance d’environ 30 000 enfants en France jusqu’à présent. Les CECOS, créés depuis 1973, assurent la congélation et la conservation des spermatozoïdes, garantissent l’anonymat et la gratuité du don, tandis que leur fonctionnement est réglementé par la loi française sur la bioéthique (29/07/94).
Une revue de littérature attentive permet de constater que nous possédons peu de données fiables sur le devenir familial des couples qui demandent l’aide des CECOS, sur l’incidence de ce mode de procréation à leur vie de famille, de parents ou d’enfants. À ce jour, rarissimes sont les études scientifiques ayant exploré le champ représentationnel couvert par les questions de cette nouvelle forme de parentalité en France (cf. Manuel et Czyba, 1983 ; Houel et Clément, 1988) tandis que depuis une dizaine d’années, un nombre croissant d’études, anglo-saxonnes pour la plupart d’entre elles, commencent à étudier la question de manière longitudinale et comparative.
Pour construire l’objet de cette recherche, il nous semble pertinent de dégager plusieurs dimensions à propos desquelles peuvent intervenir divers systèmes de représentations et de valeurs : l’anonymat du donneur, la parenté, la filiation, les rapports de genre. Il va de soi que ces dimensions sont interconnectées ou se chevauchent, et qu’elles ne sont distinguées et traitées séparément ici que pour répondre à des exigences analytiques. Leur exploration devrait permettre dans une phase ultérieure de traitement des données de dégager les structures d’attitudes et les systèmes de représentations mobilisés par ce type spécifique de procréation et correspondant à des choix spécifiques. Nous développons rapidement, ci-après, les axes de questionnement qui correspondent à ces différentes dimensions.
L’anonymat du donneur
Le cadre législatif relatif à l’anonymat du donneur de sperme varie selon les pays, à l’intérieur même de l’Europe. Un bref tour d’horizon suffit pour s’en persuader, mais également pour saisir des tendances.
En Suède et aux Pays-Bas, l’enfant né par IAD a le droit d’accès aux informations complètes sur le donneur dès l’âge de 18 ans. En Allemagne, en Autriche et en Suisse l’anonymat a été aboli pour les donneurs. En Grande-Bretagne, l’enfant conçu (avant avril 2005) peut avoir accès aux informations génétiques concernant son géniteur (poids, taille, origine ethnique, profession) sans pour autant pouvoir l’identifier. C’est chose faite pour les enfants conçus grâce à l’IAD après avril 2005 qui pourront dès leur majorité avoir accès à l’identité du donneur. Au Danemark des tensions existent entre le Comité d’éthique qui suggère un accès aux informations sur le donneur et le ministère de la Santé (pro anonymat). En Israël, un des premiers pays ayant légalisé l’IAD pour des femmes célibataires, la pratique du secret et de l’anonymat est de rigueur (Landau, 1998). En France, le don de sperme est, jusqu’à présent, anonyme et gratuit. Le nombre d’enfants conçus avec le sperme d’un même donneur est strictement limité. Le récent avis émis par le Comité national consultatif d’éthique, cité en début d’article, pourrait conduire à une remise en cause progressive de l’anonymat du donneur.
Néanmoins, des études anglo-saxonnes réalisées ces dernières années soulignent le besoin vital du maintien de cet anonymat (cf. Pennings, 2001). L’argument majeur consiste à attirer l’attention sur la diminution drastique des donneurs au cas où leur identité serait dévoilée. En Australie, moins d’un donneur sur deux souhaiterait perdre son anonymat, tandis qu’aux États-Unis, deux tiers des donneurs souhaitent rester anonymes. En Finlande, le pourcentage des donneurs désirant procurer des détails sur eux-mêmes atteint le 17 %, tandis que des centres spécialisés à l’IAD en Grande-Bretagne et dans d’autres pays européens occidentaux craignent une perte de 80 % de leur taux de donneurs si leur anonymat n’est plus garanti. La British Andrology Society considère que la levée de l’anonymat aura des conséquences importantes au niveau du choix de couples désirant utiliser l’IAD, tant par la formation de longues listes d’attente, que par le risque de grossesses multiples dues à des traitements hormonaux « agressifs » maximisant les chances d’une grossesse pour compenser le manque de donneurs.
Néanmoins, si l’anonymat est synonyme de diminution quantitative des donneurs, qu’en est-il des familles récipiendaires ?
Les stratégies parentales, constatées à ce jour, concernant la « gestion » du mode de conception vis-à-vis de l’enfant se déclinent en trois types de choix : (a) garder le secret absolu des origines génétiques et du mode de conception ; (b) dévoiler le mode de conception à l’enfant ; (c) parler du donneur. Ces stratégies témoignent des pôles de tension, éthiques et identitaires, psychologiques et sociétaux qui se situent sur un continuum entre ce que les parents peuvent/savent/doivent dire et ce que l’enfant doit/peut/veut savoir.
Cependant, toutes les études réalisées à ce jour auprès de familles ayant eu recours à l’IAD tentent de montrer que, malgré les différents cadres législatifs existants sur l’anonymat du donneur, la grande majorité des parents fait le choix de ne rien raconter à l’enfant sur les conditions de sa conception. Le récit du don génétique disparaît au profit, sans doute, des récits plus « normalisés » et canoniques garantissant une vie de famille « comme celles des autres ».
Laurence Chassard
L’enjeu psychosocial, éthique et légal concerne, d’un côté, le droit de l’enfant d’avoir accès à ses origines et si oui, jusqu’à quel degré, de l’autre, le droit et l’intérêt du donneur de rester anonyme, enfin, le maintien d’un équilibre familial. On pourrait résumer une bonne partie de cet enjeu en l’expression « pour l’intérêt de l’enfant ». Les tenants de l’anonymat pensent que l’information sur les origines pourrait être dommageable pour l’enfant et pour les relations familiales. À l’inverse, les défenseurs de l’accès à l’information sur les origines clament les conséquences psychosociales dommageables pour l’enfant dues au secret en se référant notamment aux études concernant les familles adoptives et à la littérature sur les thérapies familiales. La controverse, dans son ensemble, soulève également, et indirectement, le problème du droit à l’information personnelle qui englobe avec insistance aujourd’hui les sociétés occidentales.
Une étude approfondie récente, longitudinale et à échelle européenne (Golombok et al., 2002), comparant quatre types de familles différentes (adoptives, ayant eu recours à la fécondation in vitro, à l’IAD, n’ayant pas eu recours à la procréation médicalement assistée), a clairement établi qu’il n’y avait aucune différence significative entre elles en ce qui concerne le climat affectif et émotionnel familial, ainsi que le développement et le bien-être psychologique des enfants (à l’âge de passage à l’adolescence). Concernant, en particulier, les familles ayant eu recours à l’IAD, cette même étude révèle que seulement 8,6 % des parents ont parlé à leurs enfants de leur mode de conception (contre 69,9 % ayant décidé de ne rien dire). La protection des enfants, l’inquiétude de l’impact du récit sur l’équilibre relationnel de l’enfant avec le père ou la mère, ou encore, le maintien des relations sociales extra familiales, font partie des raisons principales évoquées pour justifier la décision des parents de ne rien dire à leurs enfants. À l’inverse, le droit de l’enfant de savoir, la peur de l’apprendre par quelqu’un d’extérieur à la famille et le risque d’endogamie consanguine, ont été évoquées comme raisons principales par la minorité des familles ayant parlé à leurs enfants de l’IAD.
Il est important de signaler que même en Suède, où pourtant la législation donne le droit d’obtenir des informations sur l’identité du donneur, seulement 11 % des parents interrogés avaient informé leur enfant de son mode de conception (Van Berkel, 1999). Il convient d’ajouter qu’une grande proportion de parents (environ la moitié) ayant opté pour le maintien du secret au sein du cercle familial a parlé de l’IAD à, au moins, une personne de leur entourage proche, ou médical prenant ainsi le risque d’une rupture future, accidentelle ou volontaire, de leur secret. Aucune étude portant sur des familles ayant au recours à l’IAD ne mentionne une quelconque détérioration du climat familial ou du vécu parental dû à ce mode de conception. De plus, ces mêmes familles déclarent un sentiment de satisfaction de vie largement au-dessus de la moyenne et ont un taux bas de séparation. Le contraste est frappant lorsqu’on regarde cette fois-ci les familles homoparentales, notamment féminines, ayant eu recours à l’IAD. Ce sont les seules au sein desquelles on envisage majoritairement de parler à l’enfant quant à son mode de conception (Touroni & Coyle, 2002). Une structure familiale nouvelle, une parenté nouvelle, et, de surcroît, minoritaire, serait plus ouverte au récit des origines de l’enfant, serait plus à même de lui parler de son mode de conception et, souvent, du donneur.
Il convient d’ajouter que l’IAD, comme tout autre technique de procréation médicalement assistée, est à mettre en rapport avec les projets familiaux et les aspects temporels et quantitatifs de leur réalisation. Interviennent également les conceptions relatives à l’institution familiale et ses transformations, ainsi qu’à ses formes traditionnelles ou alternatives. Les résultats des nombreux travaux existant sur ce sujet (cf. De Singly, 1996 ; Jodelet, 1994 ; Vayena et al., 2002) seront utilisés pour déterminer les indicateurs permettant d’en estimer la valeur par rapport à d’autres formes de procréation. Un aspect qui semble important à relever ici concerne les effets de l’évolution de la famille sur la manière dont les hommes se situent par rapport à la filiation. De ce point de vue, on s’interrogera sur l’évolution des sentiments de responsabilité dans l’engendrement et du vécu d’une parenté pleinement sociale (liens symboliques versus liens génétiques).
Toutes ces études mettent en lumière, au moins, trois formes d’asymétries que nous tenterons d’explorer en détail :
- une asymétrie de parenté ; la parenté génétique de l’un des deux parents versus la parenté uniquement sociale de l’autre. Le symbolique prime-t-il sur le génétique ? La parenté du social prime-t-elle sur la parenté du biologique ?
- une asymétrie d’intention ; au sein des couples hétérosexuels les mères naturelles sont plus favorables que les pères à dévoiler à l’enfant son mode de conception ;
- une asymétrie de partage ; la moitié des parents, dans les familles IAD, partagent le « secret » de la conception de leur enfant avec des tiers, des proches, sans pour autant le partager avec le ou leurs enfants.
La procréation médicalement assistée a donné lieu à la satisfaction d’un désir social grandissant d’enfantement et a inauguré de nouvelles formes et structures parentales inédites jusqu’alors. Il suffit, par exemple, de penser qu’aujourd’hui, théoriquement, un enfant peut être en lien de parenté (génétique ou sociale, directe ou indirecte) avec cinq autres personnes (donneur de sperme, donneur d’ovule, mère porteuse, « parent(s) » sociaux). Ceci crée un décor parental nouveau dont les épiphénomènes ne sont pas encore suffisamment étudiés. En tout cas ceci invite à repenser les métamorphoses de la parenté (Godelier, 2004) sous leurs dimensions politique, juridique, psychologique et sociétale. Cette recherche2 vise à contribuer à cette réflexion.
Laurence Chassard