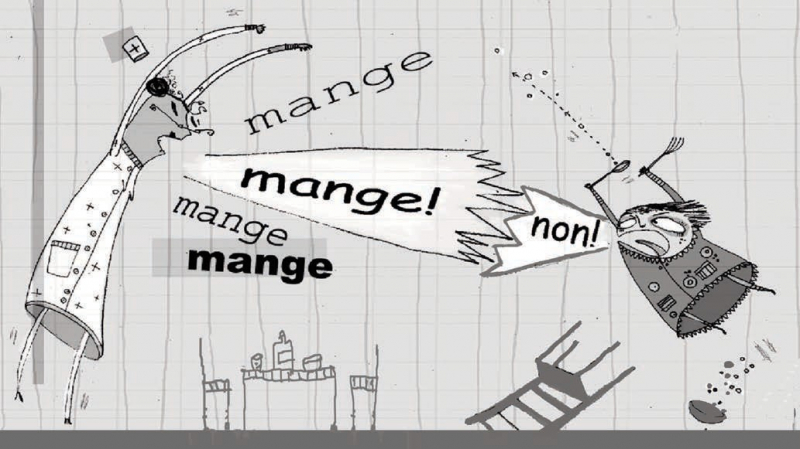Ni historien ni même ancêtre historique, je souhaite ici aborder quelques questions qui me paraissent fondamentales pour l’analyse de la pratique en m’appuyant sur des débats passés dont il m’arrive de constater aujourd’hui l’actualité. Il s’agit donc d’une réflexion personnelle de praticien, ayant participé à des travaux collectifs de réflexion sur ces questions, travaux auxquels j’accorderai une place sans rapport avec leur place « historique ».
L’absence d’Appellation d’Origine Contrôlée
Le constat est facile à faire, il y a une multitude de dispositifs de réflexion faisant appel à de multiples théories. Il est facile aussi de constater que les efforts pour mettre de l’ordre posent eux-mêmes de nombreux problèmes. Deux publications collectives successives sur le sujet, coordonnées par Claudine Blanchard-Laville et Dominique Fablet (1996 ; 2000) témoignent de cette diversité et comportent des articles visant à « mettre de l’ordre », chaque fois avec des résultats différents.
Des distinctions s’établissent en fonction :
- Des référents théoriques, généralement sociologie et psychanalyse, mais il peut aussi y avoir des référents moins théorisés lorsque c’est l’expérience du professionnel « chevronné » qui vient éclairer les difficultés de personnes en formation ou de jeunes professionnels.
- De la pratique analysée, cure psychanalytique (contrôle psychanalytique) travail social (groupe Balint, supervision dans le travail social) consultation médicale (groupes Balint).
- Du dispositif, individuel ou groupal, le contrôle psychanalytique est individuel alors que le groupe Balint est clairement désigné comme groupal, la supervision du travail social étant généralement dans un dispositif de groupe mais on en trouve des formes individuelles.
Mais peut-être qu’en réalité la question de la source est plutôt la question de la nomination ou de la formalisation. Des pratiques spontanées, multiples, de réflexion sur la pratique professionnelle ont été confrontées à des modèles théorisés et des orthodoxies se sont mises en place. Dans une étude à laquelle j’ai participé (Dosda et al., 1989) menée conjointement par un laboratoire universitaire (CRI Lyon 2) et les formateurs d’une école d’éducateurs en formation en cours d’emploi (Loire Promotion) j’avais été étonné que ce que les uns considéraient comme des groupes de type Balint n’était pas du tout identifié comme tel par nombre de ceux qui les pratiquaient. Le surnom ironique de « confessionnal » donné par des éducateurs peut tout simplement renvoyer à un modèle très général, d’évaluation, est-ce que mon comportement a été conforme à tel modèle, me suis-je bien comporté, ai-je fauté ? Les référents théoriques viennent plutôt canaliser, sans être source ou origine.
L’approche psychanalytique et l’appui sur Balint
La diffusion des idées psychanalytiques, a fait apparaître les limites d’autres démarches. Que ce soit ce qui peut être étiqueté « réunion de synthèse » à travers l’apport des différents spécialistes, ou « étude de cas » il s’agit d’obtenir une meilleure connaissance d’un « autre ». Dans ces deux dispositifs on peut dire que, pour le moins, l’implication dans la relation est hors champ, et que le cas est traité comme un objet externe. Sans reprendre tous les débats qu’il peut y avoir sur ces sujets on peut tout simplement considérer cela dans un registre courant qui est celui de l’expertise. Chacun peut intervenir avec son savoir spécifique ou partagé pour contribuer à la connaissance la plus complète et rigoureuse possible. Cette démarche a bien sûr sa légitimité et ses limites. Limites donc essentiellement dans la non prise en compte, ce n’est pas son objet, de l’implication personnelle des professionnels y compris dans son effet sur la description d’un cas. La volonté d’appréhender différemment se marque aussi parfois au niveau du langage par l’abandon du terme « cas » au profit de « situation », ce qui permet d’intégrer dans la réflexion le professionnel mais aussi un ensemble d’acteurs y compris institutionnels.
Les personnes qui souhaitaient intégrer les apports de la psychanalyse dans l’étude de situations ont pu trouver, dans la référence aux « groupes Balint », un point d’appui, une référence. J’ai évoqué plus haut la possibilité de faire du Balint sans le savoir mais la formule mérite d’être interrogée et peut-être est-il préférable de dire que l’influence des idées psychologiques et plus spécifiquement psychanalytiques, le développement du travail de groupe, l’évolution du secteur social ont entraîné de nombreuses tentatives de se former, formation initiale ou continue, à l’analyse du vécu de la relation entre professionnel et « client ». Parmi toutes ces tentatives celle de Michaël Balint a été particulièrement féconde car à l’origine de la théorisation d’un dispositif : le groupe Balint. Balint a commencé auprès de travailleurs sociaux son travail d’analyse de la pratique à orientation psychanalytique mais c’est auprès des médecins qu’il a développé sa théorie et son mouvement. Le succès de son livre Le médecin son malade, et la maladie (Balint, 1957) marqué par les rééditions successives et la fréquence des citations et références, est tel que « Balint » est pratiquement devenu un nom commun.
Je reprends les caractéristiques résumées par Gérard Soria (1989, p.126) :
« Le groupe Balint se définit comme un petit groupe de recherche et de formation. Le leader, nom donné par M. Balint à l’animateur du groupe, est toujours un psychanalyste. Le travail se centre sur l’étude des cas concrets, rapportés par les participants. Le groupe n’a pas de visée thérapeutique directe et n’aborde donc pas la vie personnelle de ses membres. La dynamique de groupe n’est utilisée que lorsque la cohésion du groupe est menacée. »
À ce stade je voudrais juste insister sur le lien avec la psychanalyse mais l’éloignement de la cure psychanalytique. Il s’agit bien d’apporter l’éclairage des concepts psychanalytiques, y compris dans ce que l’on appelle, mais cela mériterait discussion, les éléments transférentiels et contre-transférentiels. L’insistance parfois sur la filiation évidente à la psychanalyse a pu faire oublier l’originalité de la démarche consistant à proposer non pas une analyse de l’inconscient individuel « privé » mais une analyse de la relation en situation professionnelle. En introduisant la distinction entre transfert public et transfert privé Balint délimite un nouveau champ de l’analyse qui n’est plus celui de la thérapie, de l’intime de soi, la sphère privée mais qui prend pour objet par le transfert public ce qui est mis en jeu dans la sphère publique, dans une pratique sociale, professionnelle.
Pour ne pas l’évacuer, mais j’y reviendrai plus loin, il s’agit d’analyser la relation médecin malade, avec l’idée qu’il y a une spécificité dans cette relation thérapeutique, spécificité pour une part exprimée par le concept de « remède-médecin », la recherche de la façon dont le médecin, avec ou sans médicaments participe au soin par la relation.
Balint du pauvre ou pauvre Balint ?
C’était un constat de départ, il n’y a pas d’appellation d’origine contrôlée et une multiplicité de formes de travail de groupe, de travail d’analyse dans laquelle il est bien difficile de s’y retrouver. Mon titre un peu provocateur, ne correspond pas à la lecture que je fais de la situation mais à une position disons doctrinale qui évaluerait ces pratiques en référence aux authentiques groupes Balint. J’aurais dû peut-être intituler ce paragraphe « De l’étude de cas à l’analyse de la pratique en passant par Balint ».
Selon le point de vue que l’on prend on peut effectivement considérer certaines formes de groupes comme des déviations ou comme des formes « légitimes » ayant emprunté telle référence ici ou là. Ce débat est présent dans cette publication en particulier dans l’article déjà cité de Gérard Soria (1989) dont un paragraphe s’intitule « Éléments pour l’application de ces modèles à la formation des travailleurs sociaux ».
Cette réflexion venait parfois explicitement répondre à une position orthodoxe exprimée par René Gelly (Missenard et al., 1982, p.47) évoquant les contradictions qu’il y a chez Balint à se référer à la méthode hongroise de formation des analystes tout en refusant que les groupes soient thérapeutiques, il écrit :
« La seule solution pour sortir de ce dilemme, c’est de considérer, comme l’a fait M. Balint, que la relation médecin-malade a une originalité telle qu’on peut la prendre comme objet d’étude, sans pour autant mettre en question tout l’ensemble de la personnalité du médecin. C’est la nature de la relation médecin-malade qui permet d’introduire une limitation dans le travail d’élucidation qui s’y rapporte. Cela tient au fait que la relation médecin-malade est différente aussi bien de toute autre relation professionnelle, même paramédicale, que de toute autre relation interpersonnelle, même si on découvre des modèles communs mobilisant des affects analogues. »
Les groupes Balint c’est pour les médecins, la position est claire et nette. Ayant discuté la position de Gelly, j’ai repris (Dosda, 1990a) ce critère de la limitation dans le travail d’élucidation, pour en dire à la fois la nécessité et la difficulté. C’est une difficulté rencontrée d’ailleurs dans la formation des éducateurs à cette époque où il était beaucoup question de l’implication, de l’engagement personnel et de transformation de soi, le titre lui-même de notre travail collectif en est un bon indicateur « se former ou se soigner ? ».
En appui sur et en appui contre Gelly, il me paraît important de retenir la différenciation à faire avec des groupes thérapeutiques, l’objectif n’est pas de se soigner soi-même mais de se changer dans la visée d’aider au changement de l’autre « le client », à guérir pour le médecin, à éduquer, à aider, à prendre soin… pour d’autres professions. D’où l’importance de la limitation de l’analyse au « transfert public » et l’importance de comprendre ce qui se joue dans la pratique de telle ou telle profession.
L’analyse clinique, en groupe, des pratiques professionnelles
J’aurais envie d’écrire « enfin Missenard vint » en réalité il était déjà venu puisque l’article auquel je me réfère date de 1976. Il me semble que, par formation et par culture d’une manière plus générale, les psychologues animant des groupes d’analyse de la pratique nous étions disposés, formés, à intégrer l’analyse clinique des relations, l’approche psychanalytique des groupes (Anzieu, Kaës, etc.) mais que nous disposions de peu ou pas de bagages concernant une approche des pratiques professionnelles. Analyser des pratiques professionnelles c’était plus analyser des pratiques relationnelles que réellement des pratiques professionnelles. C’est pourquoi, au moins à titre personnel, j’ai été très intéressé et j’ai beaucoup utilisé un petit article (trois petites pages) d’André Missenard, paru en 1976 dans la revue Connexions qui cherche à définir les systèmes psychiques impliqués dans le professionnel :
« […] On peut distinguer une formation qui vise principalement à modifier ce que j’appelle la “personnalité professionnelle” […] Il s’agit d’un ensemble de systèmes psychiques articulés entre eux, reliés à l’ensemble de la personnalité tout en ayant leur autonomie de fonctionnement. Ces systèmes comportent :
-
l’ensemble des motivations, désirs conscients et inconscients, des fantasmes qui sont sous-jacents à l’exercice et au choix du métier,
-
les interdits liés à ces désirs et souvent articulés aux règles d’exercice de la profession,
-
les idéaux professionnels et les images qui leur sont liées (les maîtres, les formateurs, les initiateurs, les “patrons”),
-
l’objet désiré, c’est-à-dire, l’objet du travail, l’objet créé, l’objet construit, l’objet soigné (le malade et le corps malade, par exemple pour un médecin).
La personnalité professionnelle est acquise au cours d’un processus de changement qui comporte, à côté de l’acquisition du savoir, des phénomènes d’identification au formateur, à l’éducateur, au maître, au modèle :
-
l’intégration des techniques du métier, des règles de l’art et des règlements professionnels et enfin
-
la reconnaissance de ces modifications diverses par l’obtention d’un titre, d’un diplôme délivré après une ou des épreuves. »
Missenard utilise ici en 1976, l’expression « personnalité professionnelle ». Par la suite, il utilisera l’expression « part professionnelle de la personnalité » (Missenard et al., 1982, p.262), qui me paraît moins propice à induire l’idée d’une dualité voire d’un clivage. Il faut aussi distinguer l’aspect collectif de l’aspect individuel. Lorsque l’on parle d’identité professionnelle il y a risque de confusion entre l’identité d’une profession et l’identité du professionnel.
Il me paraît plus clair de conserver identité professionnelle pour l’identité d’une profession, l’accent est mis sur les caractères communs des membres d’une profession. Je ne peux ici reprendre la discussion du contenu que donne Missenard à la part professionnelle de la personnalité, je voudrais juste insister sur l’intérêt qu’il y a à travailler sur les représentations que le professionnel a de lui-même en tant que professionnel et celles qu’il a du « client ». Cela concerne me semble-t-il la constitution de la part professionnelle de la personnalité motivations, idéaux, modèles, interdits et la constitution de l’objet professionnel, qu’est-ce que de l’autre, du « client », je prends en compte/en charge ? Cela peut contribuer à un débat ouvert par Balint autour de l’expression de la bonne distance, débat très présent dans le cadre des formations, il est souvent reproché aux jeunes professionnels de « manquer de recul », de n’être pas à la bonne distance. On a pu à l’inverse se moquer des « éducateurs Tefal » ceux qui n’attachent pas. Peut-être est-il plus juste de parler alors de « bonne place » ou « juste place », c’est-à-dire tout simplement penser/agir en professionnel et non en copain, frère, parent… Et du même coup considérer l’autre dans ce qu’il est pour moi dans ce cadre professionnel.
Dans la voie ouverte par Missenard, de la part professionnelle de la personnalité il y a certainement beaucoup de développements à attendre d’une approche qui affinerait les spécificités de différentes pratiques et de l’analyse de ces pratiques. Si on limite à une analyse clinique de la relation, il ne me semble pas que ce soit très développé. Dans les deux ouvrages cités au début de ce texte coordonnés par Claudine Blanchard-Laville et Dominique Fablet (1996 ; 2000) sur une trentaine d’articles j’en identifie dans cette perspective (Dosda, 1990a ; 1990b).
Je m’autorise du peu de publications spécifiques et de mon narcissisme, pour signaler ne pouvant développer, que j’ai cherché à poser quelques jalons de la spécificité de l’analyse de la pratique concernant les situations d’assistance éducative en milieu ouvert (Dosda, 1990b) et d’enseignement (Dosda, 1990c).
Ouverture
Bien sûr c’est la conclusion de cet article, mais puisqu’il s’agit aussi d’histoire, elle continue, et nous la prenons tous en route pour un petit bout de chemin. Sur mon chemin j’ai rencontré… des personnes qui prennent toutes sortes de moyens pour réfléchir à leur pratique. Ce qui me paraît important c’est l’effort de définir ce que l’on fait, dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit. Et si l’on peut, dans cette diversité n’exclure personne, mais ne pas faire n’importe quoi, c’est-à-dire avoir une certaine exigence de cohérence. Cohérence de la pensée, cohérence entre les intentions et le dispositif et après Balint y retrouvera les siens… si besoin.