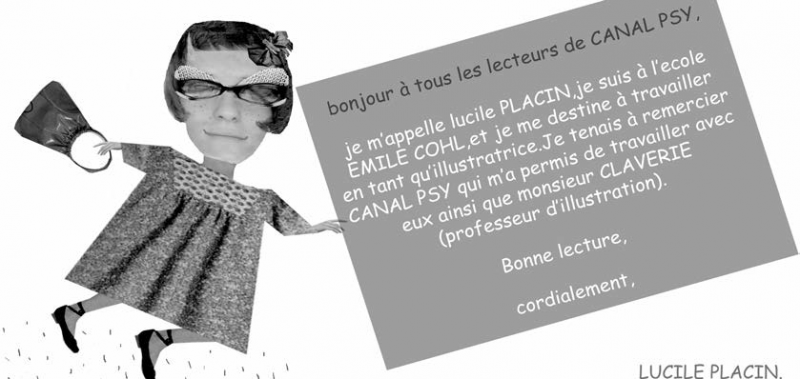Quand Jean-Baptiste Grenouille vint au monde, sa mère ne l’attendait pas. Ce 17 juillet 1738,
« la mère de Grenouille, quand les douleurs lui vinrent, était debout derrière un étal de poissons dans la rue aux fers et écaillait des gardons qu’elle venait de vider […]. Elle n’avait qu’une envie, c’était que cette douleur cessât, elle voulait s’acquitter le plus vite possible de ce répugnant enfantement. C’était son cinquième. Tous les autres avaient eu lieu derrière cet étal et, à tous les coups, ç’avait été un enfant mort-né ou à peu près, car cette chair sanguinolente qui sortait là ne se distinguait guère des déchets de poissons, et ne vivait d’ailleurs guère davantage […]. Et quand les douleurs se précisèrent, elle s’accroupit et accoucha sous son étal, tout comme les autres fois, et trancha avec son couteau à poisson le cordon de ce qui venait d’arriver là. »
Cette femme eut un malaise ; on s’empressa autour d’elle puis elle se releva pour aller se laver.
« Mais voilà que, contre toute attente, la chose sous l’étal se met à crier. On y va voir et, sous un essaim de mouches, au milieu des entrailles et des têtes de poissons, on découvre le nouveau-né, on le dégage. On le confie d’office à une nourrice, la mère est arrêtée. »
Et condamnée à mort pour infanticide.
Tel est le contexte de la venue au monde de cette « chose » non encore prénommée. Celui qui s’appellera Jean-Baptiste Grenouille s’est obstiné à vivre, s’est agrippé à la vie, contre rejet et indifférence, au milieu des déchets de poissons… contre vents et marées (!). Celui qui s’appellera Jean-Baptiste tentera – en vain nous le découvrirons – de s’approprier des qualités, des éprouvés qui, du statut de « chose » non investie en ferait un être humain, un être ayant quelques traits d’humanité.
Tout nous inciterait en effet, d’après la suite du récit, à ne reconnaître à Grenouille qu’une vie végétative, nourrisson élevé-nourri mais méconnu quant à sa vie psychique. Comment se représenter cette Naissance à la vie psychique chez Grenouille, si ce n’est en reprenant cette expression de Jean Begoin, « la violence du désespoir » : il ne s’agit plus d’un danger vécu au sein au sein de la vie psychique, mais d’un danger menaçant l’existence même de cette vie psychique, un danger de mort psychique.
Grenouille a très certainement vécu, au milieu des entrailles et des têtes de poissons, un moment de « terreur sans nom » (W. R. Bion) ; « la modalité dépressive qui accompagne l’existence d’un noyau de terreur menaçant la vie psychique elle-même et contrecarrant toute réelle autonomie est le désespoir : le sujet a le sentiment de ne pouvoir que “survivre” au lieu de “vivre” (Begoin, p.621-622). Grenouille n’a pas été capable d’attirer l’attention et l’amour de sa mère. Il fut confronté ainsi au vide du non-investissement, au désespoir le plus total, mais fort de son appétit de survivre, sinon de vivre, il décida de ne pas mourir, quitte à en vouloir, toute sa vie durant, à la terre entière de l’avoir si mal accueilli.
Il lui restait alors à choisir les modalités défensives de son économie de survie et, dans sa quête de tout signe lui permettant de s’agripper au monde des vivants, une modalité sensorielle fut d’emblée chez lui très sollicitée, sollicitée même jusqu’au vertige : l’odorat. Grenouille naît parmi les déchets de poissons, […] dans un Paris saturés d’odeurs fortes, fortes jusqu’à la nausée. Grenouille concentre toute sa sensorialité et toute sa « capacité d’attention » (W. R. Bion) dans cette modalité de survie que devient son odorat […], il n’est qu’un nez qui repère d’emblée toutes les odeurs qui l’entourent… mais il est au moins ce nez reniflant. […] Bien trop démuni et seul pour assumer les très difficiles conditions de sa naissance et de ses premières heures de vie, ne pouvant pas faire appel à un objet maternant accueillant, prêt à l’accueillir et désireux de l’accueillir, Grenouille ne trouva qu’une seule issue : « être-nez »… à défaut d’être né. […]
Grenouille aurait eu recours très précocement à un retrait autistique, comme seule modalité de survie, physique et psychique. Il grandira autistiquement agrippé à ce nez, dont les capacités à repérer toutes les odeurs, tous les parfums, seront exacerbées jusqu’à la folie. Son « enveloppe psychique » (D. Anzieu) sera organisée, avant tout, en une « enveloppe olfactive ».
Grenouille fut un nourrisson à l’appétit vorace, épuisant le lait de ses nourrices successives. Plutôt que d’être envoyé dans un orphelinat, il fut confié au prieur du cloître St-Merri, où il fut baptisé et prénommé Jean-Baptiste, par un homme donc – unique trace de la présence d’une paternité. Une nouvelle nourrice […] s’en occupera alors « pour trois francs par semaine pour salaire de ses efforts » et fut, elle aussi, bientôt épuisée par ce bébé. Mais le motif principal de son refus de poursuivre l’élevage de ce nourrisson surprit beaucoup le prieur auquel elle le ramena : je n’en veux plus, dit-elle, car « il ne sent absolument rien ». Paradoxe suprême, pour l’individu Jean-Baptiste : lui qui n’est qu’une capacité à sentir… ne sent rien et n’engendre pas chez ses nourrices l’élan maternel, le désir de l’investir. Comme si une défaillance première, dans le portage physique et psychique de ce nouveau-né, l’avait maintenu dans l’en-deçà des caractéristiques de l’humain, empêchant ainsi toute mère de se percevoir comme capable de lui apporter, en plus de ce lait bu goulûment, un plaisir dans le corps à corps, dans le contact de peau à peau, qui l’eusse imprégné, lui bébé, d’une odeur et lui eusse donné un goût. Il fallait que le bébé ait une bonne odeur pour que la nourrice soit une bonne mère. Cette odeur ne naîtrait-elle pas dans l’interaction ?
Peut-être les échanges corporels, à l’occasion des tétées, avaient-ils été trop brutaux, la nourrice s’acquittant de sa tâche rémunérée sans joie et même avec dégoût, le bébé ne donnant quant à lui aucun signe de gratitude. Jean-Baptiste n’était peut-être qu’une bouche à nourrir, pas moins pas plus.
C’est à se demander s’ils échangeaient même des regards. On se pose en effet cette question quand on écoute les explications de cette nourrice à propos de l’arrière de la tête des bébés, là « où les cheveux font un rond » et où ils sentent le plus bon, où ils « sentent le caramel ». Ce bâtard de Jean-Baptiste ne sentant à cet endroit « rien du tout », on imagine que les face-à-face nourrice/bébé – position où la mère maintient fermement le dos et la tête du bébé dans ses bras et ses mains –, les babillages du bébé repris en écho par la nourrice, les caresses et les baisers furent rares, voire absents. Quand le prieur Terrier se retrouvera un peu plus tard avec ce nourrisson sur les bras, bien encombrant, il décrira un réveil de Jean-Baptiste qui confirmera nos premières impressions :
« C’est alors que l’enfant s’éveilla. Son réveil débuta par le nez. Son petit bout de nez bougea, se retroussa et renifla […]. Puis le nez se plissa et l’enfant ouvrit les yeux. Ces yeux étaient d’une couleur mal définie, à mi-chemin entre un gris d’huître et un blanc crémeux et opalin, et ils semblaient voilés d’une sorte de taie vitreuse, comme si manifestement ils n’étaient pas encore aptes à voir. » [Nous dirions qu’ils n’avaient pas encore trouvé de regard les regardant.]
« Terrier eut l’impression que ces yeux ne le percevaient pas du tout. Il en allait tout autrement du nez. » Le regard vide du nourrisson Jean-Baptiste – regard opaque, fermé à l’échange – n’avait pas trouvé les yeux pétillants d’une mère attentive avec qui « discuter ».
Ce roman foisonnant regorge d’anecdotes qui toutes pourraient faire l’objet de libres associations, telles celles que je vous soumets. Je voudrais poursuivre en ne reprenant que quelques étapes marquantes – à mes yeux – de l’histoire de Jean-Baptiste Grenouille, histoire racontée par ce romancier très doué qu’est Patrick Süskind. Vous ne manqueriez pas vous-même, en lisant ou relisant ce livre, de repérer d’autres passages qui pourraient faire l’objet d’une « discussion », au regard de concepts psychanalytiques. […]
Mais revenons à l’histoire contée de notre héros. La nourrice ayant maintenu son refus de poursuivre son travail de nourrice avec Grenouille, le prieur Terrier, d’abord épris d’un élan paternel, ne tarda pas à trouver ce nourrisson braillard fort encombrant et chercha prestement à s’en débarrasser, le plus loin possible. Il pensa le confier à Madame Gaillard, « femme morte (qui) ne ressentait rien » mais qui assurerait le gîte et le couvert de façon tout à fait convenable. « Là, chez cette femme sans âme, il prospéra », Grenouille. Tout comme lors du dernier cri qui avait suivi sa naissance, Grenouille « avait pris parti contre l’amour et pourtant pour la vie ». La carence affective, confirmée, réitérée chaque fois qu’il fut arraché aux bras de ses nourrices successives, s’édifiait en loi définitive, dictant sa conduite d’exclu, de marginal. Grenouille, aigri, fomentait sa revanche.
Au fil du temps, la « peau psychique » (E. Bick) de Jean-Baptiste Grenouille apparaît comme se résumant dans cette « identité adhésive » (E. Bick) qui lui fait se coller aux excitations sensorielles qu’il perçoit, faute d’avoir été hébergé psychiquement dans la tête d’une mère et d’un père l’ayant voulu et attendu. Cette identité adhésive, cet agrippement aux qualités de surface de l’entourage maternant, fait décrire Grenouille comme « la tique solitaire », animal qui un jour « sort de sa réserve, se laisse tomber, se cramponne, mord et s’enfonce dans cette chair inconnue ».
Grenouille prononcera son premier mot à quatre ans : « poisson », en commémoration en quelque sorte de sa naissance sous l’étal de poissons de sa mère. Les troubles du langage et l’utilisation privilégiée de mots désignant des objets odorants signent là encore la nature archaïque des troubles psychiques de Grenouille. Il semble effectuer petit à petit des « équations symboliques » (H. Segal) sans arriver à une véritable capacité de symbolisation, ce que la persistance de symptômes autistiques lui interdit. « De plus en plus renfermé », il possède « un gigantesque vocabulaire d’odeurs », échafaude et conforte ainsi son univers, où toute nouvelle sensation qui pourrait réveiller angoisse ou détresse est immédiatement maîtrisée, contrôlée, analysée, décortiquée, décomposée en autant de parfums la constituant. Le monde olfactif tout-puissant dans lequel s’est réfugié Jean-Baptiste n’admet aucune inconnue, aucune « inquiétante étrangeté » (S. Freud).
La « peau psychique » de Jean-Baptiste est défaillante en ceci qu’elle ne lui fournit qu’un sentiment très ténu d’identité ; elle ne lui permet pas d’exister autrement que comme un individu percevant tous les parfums qui s’offrent à ses narines. S’il sent tout, il ne ressent affectivement rien ou presque, nous l’avons déjà dit. S’il sent tout, il ne se sent pas lui-même, il ne se connaît pas lui-même comme ayant une identité affirmée, comme ayant un corps et un psychisme lui permettant de dire « je ». Cette quête d’une identité d’humain différencié lui fera entreprendre de nouvelles aventures.
La première sera d’être embauchée à l’âge de huit ans par un tanneur nommé Grimal. Tâcheron exploité, chargé entre autres d’écharner de peaux de bête en décomposition, il est étonnant de voir ce petit d’homme s’affronter ainsi au travail de la peau, du cuir, lui qui souffre manifestement d’une « peau psychique », d’un « moi-peau » inachevés.
Grandissant, il s’éloignera petit à petit de son lieu de résidence, découvrant, s’enivrant de nouvelles odeurs, de nouveaux parfums. L’appétit de vivre parmi ses frères humains, lui, n’ira pas grandissant et Grenouille deviendra de plus en plus sauvage. C’est à l’occasion d’une balade dans une foule en liesse qu’il sera irrésistiblement excité, attiré, désorienté par la présence d’un parfum dont il cherchera à connaître l’origine. Sa quête l’amènera près d’une jeune fille qui sera sa première victime :
« Lorsqu’il l’eut sentie au point de la faner, il demeura encore un moment accroupi auprès d’elle pour se ressaisir, car il était plein d’elle à n’en plus pouvoir. Il entendait ne rien renverser de ce parfum. Il fallait d’abord qu’il referme en lui toutes les cloisons étanches […]. Il avait conservé d’elle et s’était approprié ce qu’elle avait de mieux : le principe de son parfum. »
Une jeune fille – « il sentait qu’elle était un être humain » –, immolée par Grenouille, est ainsi réduite à son « principe », le parfum qu’elle exhale. Là encore, la réduction unisensorielle de l’échange élationnel se manifeste en force. Grenouille montre là dans quel travers infernal sa pathologie l’entraîne : il ne peut que s’annexer autrui, tenter désespérément de prendre possession du corps de l’autre.
C’est dans des termes analogues qu’il voudra plus tard s’approprier « la jeune fille derrière le mur » : « Le parfum de cette jeune fille […], il voulait véritablement se l’approprier ; l’ôter d’elle comme une peau et en faire son parfum. » Peut-être Grenouille voulait-il en effet en faire son parfum. On peut penser qu’il voulait avant tout en faire sa peau : lui faire la peau pour se faire enfin une peau. À partir d’une peau féminine – maternelle ? –, Grenouille essaye d’intérioriser le contenant physique et psychique qui lui a cruellement fait défaut. Il s’agit d’une tentative d’incorporation (N. Abraham – M. Torok), signant « l’échec d’une introjection de la fonction contenante de l’environnement maternant » (A. Ciccone – M. Lhopital).
Grenouille n’exhale, lui, que sa colère, face à l’échec de son Moi à profiter des qualités psychiques de l’entourage. Sa rencontre avec le parfumeur Guiseppe Baldini, qui exploitera ses dons extraordinaires, entre autres pour la fabrication frauduleuse du parfum « Amor et psyche », sera pour Jean-Baptiste l’occasion de s’enfermer un peu plus dans son monde olfactif. Son don devient démoniaque, Grenouille apprend, s’enivre de connaissances en parfumerie, voudrait, par tous les moyens que le métier de parfumeur lui enseigne, « extraire des corps leurs parfums ». C’est ainsi qu’il décidera d’aller à Grasse, dans le midi de la France, là où il savait qu’on pouvait apprendre mieux qu’ailleurs certaines techniques d’extraction des parfums. Une technique en particulier manquait à son palmarès : l’effleurage à chaud, à froid et à l’huile.
Le livre nous fait alors vivre le périple de Jean-Baptiste en direction de Grasse et il est intéressant de constater qu’ayant quitté son maître Baldini, Grenouille vit un épisode régressif et dépressif, même s’il ne le reconnaît pas comme tel et ne voit dans son attitude que le signe d’une libération du fait de l’éloignement d’avec les hommes et de la rencontre avec un air de « plus en plus délayé, de plus en plus étranger à l’humanité ». Se déplaçant « vers le pôle magnétique de la plus grande solitude possible », Grenouille fera une longue halte sur « la montagne de la solitude » appelée le Plomb du Cantal.
Là, sur cette montagne où « régnait uniquement, comme un léger bruissement, l’haleine homogène des pierres mortes, des lichens gris et des herbes sèches, et rien d’autre », Grenouille « mit beaucoup de temps à croire ce qu’il ne sentait pas ». Son agrippement aux sensations olfactives étant déstabilisé, du fait du peu d’odeurs côtoyées sur cette montagne pelée, Patrick Süskind décrit alors Jean-Baptiste comme ayant « recours à l’aide de ses yeux » pour y fouiller l’horizon, comme ayant recours à ses oreilles pour guetter le moindre bruit qui puisse évoquer une présence humaine. Grenouille, au lieu de démanteler ses perceptions, les réunit, les met toutes à contribution. D’une certaine façon, il va mieux, Grenouille ! Il dit qu’il exècre les hommes : il se félicite d’être enfin seul, « complètement seul », mais derrière cette euphorie de façade se manifeste tout de même une très profonde détresse. Il s’autorisera une longue période dépressive. Il éprouvera la douleur de la perte – suite à la séparation d’avec Baldini – du fond d’une galerie souterraine.
« L’endroit présentait d’inappréciables avantages : au bout de ce tunnel, il faisait nuit noire même en plein jour, il y régnait un silence de mort, et l’air exhalait une fraîcheur humide et salée. Grenouille flaira tout de suite que jamais être vivant n’avait pénétré en ce lieu […]. Il gisait comme son propre cadavre dans cette crypte rocheuse, c’est à peine s’il respirait, à peine si son cœur battait encore… »
À cinquante mètres sous terre, « comme s’il gisait dans sa propre tombe », Grenouille se recroqueville dans son trou et retrouve les jouissances de l’espace intra-utérin, qu’il idéalise, semble-t-il comme lieu du bonheur suprême et qu’il regrette peut-être d’avoir quitté. Blotti dans sa caverne, il s’agrippe cette fois-ci à ses pensées : son espace psychique est un « empire intérieur où, depuis sa naissance, il avait gravé les contours de toutes les odeurs qu’il avait jamais rencontrées ». Il se remémore ainsi quelques impressions des différents objets psychiques maternants qui ont peuplé son univers autistique. Ses souvenirs sont des souvenirs olfactifs, des souvenirs de sensations, souvenirs de ses « agrippements autosensuels » (F. Tustin) :
« L’exhalaison hostile et moite de la chambre à coucher, chez Madame Gaillard ; le goût de cuir desséché qu’avaient ses mains ; l’haleine vineuse et aigre du père Terrier ; la transpiration chaude, maternelle et hystérique de la nourrice ; la puanteur cadavéreuse du cimetière des Innocents ; l’odeur de meurtre que dégageait sa mère. »
Grenouille est toujours enfermé dans sa « forteresse vide » (B. Bettelheim) mais il s’autorise quelque souffrance, quelque ressenti : quelque chose lui manque. La tombe, idéalement à l’abri de tout et de tous, n’en est pas moins une tombe. Elle est froide. Les émotions y sont gelées, figées. La suite de l’histoire nous montrera Grenouille faire de furtives excursions dans un univers psychique plus construit, plus intégré. Il fallait en passer par la souffrance dépressive.
Malheureusement, Jean-Baptiste Grenouille filera très vite vers la mélancolie et l’excitation maniaque (G. Haag). Le « royaume Grenouillesque », le monde interne de Grenouille, sur le Plomb du Cantal, aussi hermétiquement forclos qu’il puisse être, n’empêche pas l’émergence fugace de quelques zones d’ombre. Le « brouillard » dont il parle, qui serait une odeur, ne serait-il pas cette partie de son Moi qui cherche à se défaire du retrait autistique, du monde de l’autisme ? « Ce qui était atroce, c’est que Grenouille, bien qu’il sût que cette odeur (ce brouillard) était son odeur, ne pouvait la sentir. Complètement noyé dans lui-même, il ne pouvait absolument pas se sentir. »
Lui qui ne peut plus se sentir… commettra de nombreux crimes […] à propos desquels on aurait pu l’interpeller en lui disant : « mais tu ne te sens plus de faire une chose pareille ».