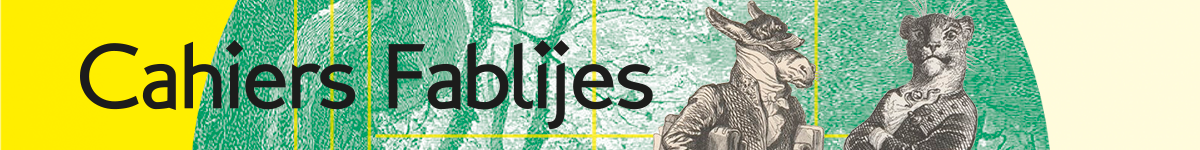Le 9 décembre 1897, Marguerite Durand lance La Fronde, « journal féminin et féministe », ainsi que le proclament les affiches publicitaires qui couvrent alors les murs de Paris. Ce n’est pas le premier titre féministe français1, mais La Fronde se distingue des journaux militants antérieurs par la composition exclusivement féminine de son personnel ainsi que par sa large diffusion : le journal a pu atteindre un tirage de 50 000 exemplaires quotidiens. Malgré son titre véhément2, La Fronde est avant tout un quotidien d’information généraliste qui aborde l’actualité dans son ensemble et dont le discours féministe modéré est porteur de revendications sociales plus que politiques3. De ce fait, La Fronde accorde une grande importance aux questions d’éducation : le journal s’attache la collaboration de l’inspectrice générale des écoles maternelles Pauline Kergomard4 et consacre régulièrement des articles aux problématiques scolaires et plus largement pédagogiques. S’adressant aux parents ainsi qu’aux enseignants et enseignantes qui constituent pour le journal un lectorat privilégié5, La Fronde développe article après article un éloge de l’éducation et s’attarde particulièrement sur les initiatives visant les publics populaires6 et féminins. Ce journal apparaît dès lors comme un lieu d’observation privilégié en ce qui concerne la question de la lecture des jeunes filles, d’autant que son lectorat est surtout issu de ces classes moyennes libérales7 qui souhaitent que leurs filles soient instruites (dans les lycées, les cours secondaires8 et en préparant les concours de l’enseignement9). La problématique des lectures des adolescentes est d’ailleurs récurrente dans le courrier des lecteurs, où des parents s’interrogent sur les ouvrages appropriés pour leurs enfants. La lecture des filles apparaît en effet comme une question d’actualité, dans un contexte de mutation des lois scolaires (des lois Ferry à la loi Sée) et d’interrogation sur la place des femmes dans la société, notamment dans la presse10. Pour autant, si les journalistes comme les lecteurs de La Fronde s’accordent sur l’importance de faire lire les filles, les motivations et les enjeux de cette lecture font davantage débat et des représentations antagonistes coexistent au sein de la polyphonie du journal11. En s’appuyant sur les thèses les plus récurrentes, et en s’attachant surtout aux rubriques les plus à même de porter le discours de la rédaction (les articles à la une plutôt que le courrier des lecteurs ou le feuilleton), on peut dégager un discours cohérent sur la lecture des filles au sein du journal, qui la présente comme un divertissement à surveiller, doté d’une vocation didactique mais aussi de fonctions politiques visant une forme d’émancipation féminine.
Lire pour lire ?
À la fin du xixe siècle, la lecture, et en particulier celle des esprits supposés influençables comme les jeunes filles, est un sujet aussi sensible que polémique : la crainte de voir la jeunesse corrompue transparaît régulièrement dans les discours12. Néanmoins, cette peur des mauvaises lectures disparaît souvent dans La Fronde devant l’évocation émue du plaisir de lire.
Le plaisir de lire
La Fronde met régulièrement en avant le plaisir que peut procurer la lecture aux filles, comme dans cette scène d’intérieur exemplaire qui montre deux générations de femmes réunies autour d’un recueil de contes :
Une jeune femme, d’esprit intelligent et charmant, faisait la lecture à sa petite fille, âgée de cinq ans. Elle avait choisi parmi les Contes d’Alphonse Daudet, celui-ci, adorable : La Chèvre de M. Seguin. L’enfant suivait la lecture avec un intérêt intense. Incapable de définir le pourquoi du charme où elle était tenue, elle le subissait entièrement et s’en imprégnait. (26 novembre 1898).
D’autres commentaires sur le plaisir des lectures enfantines ou adolescentes prennent la forme de souvenirs, comme celui qu’une journaliste glisse dans sa chronique de la période des fêtes :
Quand il s’agit de cadeaux à donner aux enfants le choix est illimité, mais les mieux accueillis seront certainement de beaux et bons livres, qui, à la longue, composeront une bibliothèque personnelle. Je me souviendrai toujours des heures charmantes que je passai à la lecture du Magasin d’éducation et de récréation où j’étais abonnée. (27 décembre 1901)
À plusieurs reprises, le journal évoque également un type de lecture passionnée qui serait propre à la jeunesse :
Parmi les impressions de l’enfance que l’on regrette plus tard, une des plus exquises est celle de ces lectures fiévreuses où de la première à la dernière ligne, on restait subjugué, tour à tour pleurant et riant, oubliant l’heure et la vie. (3 juin 1903)
Ces figures récurrentes de fillettes ou d’adolescentes conquises par la lecture sont liées à l’expérience personnelle des journalistes mais aussi à la place importante qu’occupe la vie culturelle dans les pages de La Fronde13. Mais ces portraits de jeunes lectrices servent également d’exemples intégrés à une argumentation visant à disculper la lecture des accusations de corruption morale qui pèsent sur elle. La thèse sans cesse reprise par La Fronde est la suivante :
La vérité est qu’il n’y a pas à proprement parler de bons et de mauvais livres. Ils n’auront, les uns et les autres, qu’un effet tout relatif correspondant à la nature secrète des êtres qui les lisent. […]
Et cette autre [fillette de 13 ans], également avide, prenait connaissance à ce même âge de livres tels que : Madame Bovary et la Sapho de Daudet… et, précisément de ce que deux pareilles œuvres furent choisies, aimées et relues par elle, entre cent autres ouvrages où d’autres sujets analogues étaient traités sans art, doit-on conclure que c’était là, chez elle, perversité d’esprit ?
Non, sans doute, et, au travers des ignorances où elle demeurait quant à la matérialité exacte de certains détails et des inconsciences mêmes de son instinct de précoce qui la poussait à connaître toute seule la valeur de beauté pure, qu’elle sentait en de pareilles pages, sans même les comprendre entièrement, n’y aurait-il pas eu un parti merveilleux à tirer pour la formation intellectuelle et morale de son esprit ? (27 novembre 1898)
Cette citation est révélatrice des tensions et des ambiguïtés qui persistent dans un discours apparemment en faveur d’une liberté de lecture sans réserve : les lectures que La Fronde permet aux jeunes filles sont bien plus variées que celles qu’autorisent alors la plupart des familles mais le journal remplace en partie (mais en partie seulement) les critères moraux par des critères esthétiques et didactiques.
Apprendre à bien lire
La lecture préconisée pour les jeunes filles est d’abord une lecture encadrée, qui n’est bonne que dans le cadre d’une éducation dans laquelle la famille joue un rôle primordial. C’est d’ailleurs la question signée d’« une mère » se demandant si une jeune fille doit lire des romans qui entraîne la réponse suivante :
Il faut que les jeunes filles lisent, d’abord pour s’instruire, puis pour se distraire, enfin pour s’améliorer. […]
Pour ce faire, il est indispensable de leur apprendre d’abord à lire dans le sens général du mot. Ce que je recommanderai à la mère qui veille à l’éducation de sa fille, c’est au début, alors qu’elle lui mettra un livre entre les mains de commenter avec elle la préface de l’ouvrage s’il en est une, sinon de lui indiquer les grandes lignes de l’action et d’en faire ressortir le côté moral.
Ensuite de l’habituer, après une lecture, à rédiger succinctement l’analyse de l’ouvrage parcouru, à se rendre un compte exact de ce qu’a voulu dire l’auteur, à en extraire l’essence de sa pensée. (6 août 1899)
Cette approche studieuse des textes n’est pas mise en avant dans toutes les évocations des lectures de jeunesse ; elle donne cependant le ton : les jeunes lectrices doivent être formées et encadrées pour que leurs lectures leur soient bénéfiques.
De même, tout en prônant la variété des lectures, La Fronde développe un discours ambivalent à l’encontre de certains contenus. Le journal se montre favorable aux lectures susceptibles d’apporter aux jeunes filles des connaissances sur le monde qui les entoure, et notamment aux publications documentaires. En revanche, on repère une certaine méfiance vis-à-vis du roman qui apparaît comme un véritable fléau social pour les lectrices. Certains articles accusent ainsi le genre romanesque d’encourager une imagination néfaste qui fait faire des choix inconsidérés, de diminuer la fécondité (9 juin 1898), de pousser à la consommation de drogue (10 mars 1899) et de causer des suicides (3 mai 1898). Ici, le journal féministe s’inscrit pleinement dans le discours social de son temps14, même si La Fronde reste mesurée puisqu’elle ne va jamais jusqu’à déconseiller totalement aux filles la lecture de romans. Le journal conseille seulement de tenir les filles éloignées du feuilleton15, des romans trop idéalistes ainsi que de publications trop explicites sur le plan sexuel. Ainsi, peut-on lire dans la « Causerie littéraire » du 4 novembre 1901 :
Il est évident que je ne recommande pas la lecture de Claudine à Paris aux jeunes filles. Ce n’est pas évidemment un livre pour elles, quoique à vrai dire, j’en sache qui sous des dehors plus corrects sont autrement dangereux.
La possibilité de laisser les filles lire le journal fait également débat, ce qui peut sembler inattendu dans le cadre d’un quotidien mais qui renvoie à un modèle d’éducation traditionnel d’inspiration catholique dont La Fronde se moque d’ailleurs avec humour. Un article à la une du 19 juin 1903 ironise ainsi à propos du procès intenté par un père bien-pensant à un journal libéral qui était tombé entre les mains de sa fille et qui aurait pu la corrompre. Toutefois, en recommandant la lecture de la presse aux jeunes filles, La Fronde établit une hiérarchie (attendue) entre les rubriques :
Je vois encore dans la lecture expliquée et complétée de certains articles de journaux un puissant moyen d’éducation sociale.
Le journal quotidien, le journal politique à l’école normale d’institutrices !…
Cela va paraître à beaucoup une énormité, une extravagance, un crime de lèse-pédagogie !
Je prétends, moi, que ce qui prolonge l’infériorité intellectuelle et sociale de la femme, dans le peuple surtout, c’est de ne pas savoir lire le journal, ou de n’en lire que les faits divers et le feuilleton. (1er janvier 1904)
La Fronde porte ainsi un discours libéral sur la lecture des filles : des journalistes qu’on sent elles-mêmes lectrices font preuve d’une certaine audace en revendiquant pour les jeunes filles des supports variés ou des auteurs qui leur étaient habituellement refusés (comme Zola16). Toutefois, le plaisir de lire reste subordonné à des objectifs pédagogiques : les lectures visent à instruire ou à éduquer les jeunes esprits féminins.
Lire pour former
Le discours récurrent sur la dimension pédagogique de la lecture s’articule autour de deux personnages littéraires érigés en repoussoirs par La Fronde : la lecture (et plus largement l’éducation) doit éviter aux jeunes filles modernes d’être des Sophie ou des Agnès.
La lecture comme formation esthétique et intellectuelle
D’une manière assez prévisible, la lecture est préconisée en tant qu’expérience de formation esthétique et intellectuelle pour les jeunes filles. S’il est conseillé à une mère de faire lire sa fille (dans le courrier des lecteurs du 6 août 1899), c’est qu’
Ainsi, elle lui formera le goût, l’habituera à réfléchir, à mettre de la justesse dans ses idées, à les exprimer avec précision pour enfin chercher à approprier le résultat de ses réflexions à ses propres besoins et à son élévation morale.
Pour cela, La Fronde rejette avec virulence le modèle d’éducation préconisé par Rousseau : la figure de Sophie, qui apprend à coudre plus facilement qu’à lire dans l’Émile et à qui aucune éducation intellectuelle n’est offerte apparaît comme un contre-modèle pédagogique dans des articles très polémiques17. À l’inverse, le journal encourage des lectures variées : « Aujourd’hui, le sentiment du beau se développe aussi bien par la lecture de Victor Hugo, de Goethe et de Shakespeare que par la lecture d’Homère, de Virgile et d’Ovide » (1er février 1901) et s’interroge sur l’opportunité d’enseigner le latin aux jeunes filles pour leur permettre de lire les œuvres antiques dans le texte et de pouvoir ainsi les apprécier pleinement (5 août 1899). La Fronde fait toutefois comprendre que ces réflexions enthousiastes sur les bienfaits de la lecture ne correspondent pas aux pratiques sociales et scolaires françaises : des articles déplorent régulièrement le faible niveau de l’éducation offerte aux filles, ainsi que les obstacles économiques et pédagogiques qui leur interdisent d’accéder à la lecture (12 mai 1902 ; 24 septembre 1898). C’est pourquoi les représentations de jeunes filles éclairées par leurs lectures sont surtout développées sur un ton quasi prophétique (1er mars 1904) ou associées à d’autres pays comme l’Angleterre : « si la jeune fille anglaise travaille peu, elle n’en est pas moins instruite, grâce aux lectures auxquelles elle s’est livrée depuis sa plus tendre enfance » (9 novembre 1899).
La lecture comme formation sociale et morale
Par ailleurs, si la lecture est présentée comme une opportunité pour les jeunes filles de développer leur intelligence et leur goût à l’égal et en compagnie des garçons (La Fronde est assez favorable à la « coéducation »), elle est presque toujours assortie d’un enjeu moral et social : le journal rejette ainsi fermement le modèle traditionnel de la jeune fille arrivant au mariage et à l’âge adulte sans rien connaître du monde18.
Ce n’est vraiment pas la peine d’élever nos filles dans une innocence, ou plutôt dans une ignorance dont s’étonnent les vierges fortes des nations voisines – ignorance telle que la meilleure définition de la jeune fille vraiment pure suivant notre idéal se réduit à ce mot qui a fait fortune : l’oie blanche.
Mais ayons le courage de notre opinion. Voyons en quoi elle consiste, cette fameuse pureté, et à quoi elle sert.
Elle n’a nullement pour but de faire des femmes honnêtes. Nous allons en donner la preuve.
Voici une mère d’une sévérité proverbiale : sa fille de seize à dix-huit ans n’a lu un roman ou mis un pied dans un théâtre de genre. Un épouseur se présente. Le parti est avantageux. On l’accepte. Du jour au lendemain, la fillette devient femme. Quelques mois plus tard, on la rencontre dans un boui-boui de Montmartre, on voit traînant sur sa table toutes les subtiles dépravations qui peuvent se condenser dans trois cents pages sous une signature à la mode. (5 avril 1901)
Cette dénonciation constante des dangers moraux de l’ignorance passe bien souvent par des allusions à la figure d’Agnès dans l’École des femmes, qui apparaît comme un repoussoir tourné en ridicule, comme dans la suite du même article, qui souligne avec ironie l’hypocrisie sociale selon laquelle
[…] il est indispensable qu’Agnès, approchât-elle la trentaine, ne sache pas dire autre chose que « le petit chat est mort », semble croire que les enfants naissent sous les roses et ne sorte qu’accompagnée d’une petite bonne en tablier blanc, qui d’ailleurs a souvent dix ans de moins qu’elle et quelque bébé clandestin à l’Assistance publique.
Cette référence à Molière a une valeur polémique : Françoise Mayeur a signalé la fréquence des références aux personnages du dramaturge au moment du vote de la loi Camille Sée, en 188019. Renvoyer à Agnès, c’est donc s’inscrire dans ce débat pour prendre clairement position en faveur de l’éducation des filles et faire de leurs adversaires conservateurs des barbons qui, à l’instar d’Arnolphe, ne pourront que finir désavoués.
La Fronde présente d’ailleurs ces positions traditionnelles comme archaïques et leur préfère une éducation « moderne » qui serait en train de se mettre en place progressivement : une courte fiction à la une du 7 août 1899 montre ainsi l’opposition générationnelle entre une mère et sa fille mariée, lectrice depuis l’enfance et parfait bas-bleu, pour la plus grande joie de son mari. Toutefois, si l’éducation des filles proposée par La Fronde se veut moderne, elle ne remet pas radicalement en cause la place des femmes dans la société : les lectures des jeunes filles sont valorisées avant tout dans la mesure où elles leur permettront d’aborder la vie avec lucidité (18 septembre 1898), de choisir un bon mari20, d’être des compagnes intellectuellement égales à leurs époux (1er novembre 1899 et 22 avril 1901) et des mères averties21. En cela, le discours différentialiste de la plupart des articles de La Fronde rejoint les positions républicaines de Ferdinand Buisson22 et Jules Ferry sur l’éducation des filles, à qui est reconnue une égalité intellectuelle avec les garçons en même temps qu’un rôle social distinct, tourné vers la famille et la sphère privée23.
Lire pour s’émanciper ?
À ce stade de l’analyse, il semble que le discours de La Fronde à l’égard de la lecture des filles ne soit pas d’une grande originalité puisqu’il rejoint par beaucoup d’aspects les positions qui ont présidé à la promulgation de la loi Sée en 1880. La fonction d’émancipation attribuée à l’éducation en général et à la lecture en particulier paraît dans un premier temps elle aussi tout à fait compatible avec la perspective républicaine, dans la mesure où la première tutelle dont les jeunes filles doivent être émancipées est celle de l’Église24.
De la tutelle de l’Église
Les reproches adressés à la mainmise de l’Église sur l’éducation des filles ne manquent pas dans La Fronde : ils n’étonnent pas dans un journal dirigé par Marguerite Durand, dont les positions laïques et assez anticléricales sont connues25. Ces critiques prennent tout leur sens dans le contexte où paraît le journal : tout au long du xixe siècle, l’Église a été un acteur de premier plan dans l’éducation féminine en France26 et ce n’est qu’à la fin du siècle, dans la période qui précède la loi de séparation des Églises et de l’État que se développe un modèle alternatif d’éducation non confessionnelle pour les filles. Les attaques à l’encontre de l’instruction catholique sont nombreuses : le journal oppose ainsi la figure de l’institutrice bien formée par l’École normale à celle de la religieuse ignorante, dont la lettre d’obédience est la seule qualification (8 avril 1899). Mais surtout, La Fronde redoute l’influence de l’Église qui cherche à attirer dans les couvents des adolescentes influençables : à cette emprise, le quotidien ne préconise qu’un remède : la lecture ! Et le journal de raconter plusieurs de ces cures contre le mysticisme :
Mais le père de la jeune Louise [la future poétesse Mme Ackermann] veillait sur elle et pour réparer le mal que l’enseignement religieux avait déjà fait à son âme, il lui « glissa du Voltaire entre les mains ». La fillette se calma peu à peu et reprit le cours de ses lectures ordinaires. Elle lisait de tout et pêle-mêle, ce qui est peut-être la meilleure façon de lire à cet âge-là. (6 mars 1900)
Les ouvrages conseillés pour éloigner les jeunes filles de la tentation religieuse varient : il s’agit tantôt d’ouvrages scientifiques27, tantôt de textes littéraires anticléricaux comme ceux de Voltaire ou comme ce roman de Max-Lyan dont on peut lire la critique dans La Fronde du 6 juillet 1900 :
On peut conseiller la lecture [du roman La Vocation de sœur Extase par Max-Lyan] aux jeunes filles pour lesquelles les parents redoutent une vocation religieuse, elles verront, d’après le récit de l’auteur, quelles terribles souffrances endurent ces cœurs altérés d’amour et détournés, par une exaltation passagère, de leur véritable chemin. Le couvent de Max-Lyan est tout simplement un petit enfer, où la malheureuse Lila, qui n’a fait que pleurer toute sa vie, expire en riant aux éclats dans un accès de fièvre délirante…
Et moi qui sans cesse ai rêvé de la paix des cloîtres ! encore une illusion qui s’en va !
Dans tous les cas, ces lectures sont destinées à faire contrepoids à l’influence d’ouvrages pieux ou du confesseur28 et à développer la raison des jeunes lectrices :
Les jeunes filles actuelles pourraient se diviser en deux classes : celles qui raisonnent, celles qui ne raisonnent pas.
Celles qui raisonnent, qu’elles aient été élevées dans le culte catholique, israélite ou protestant, ont lu des ouvrages sérieux, et qu’elles soient pratiquantes ou non, le raisonnement les amène au respect d’elles-mêmes ; au sentiment du devoir. Elles considèrent Dieu comme le principe du bien, créateur et conservateur de l’Univers, non comme un tyran mesquinement accapareur et jaloux […]. Ce sont les fées du foyer domestique, mais elles n’éprouvent nul besoin de tenter une union mystique, de s’arracher à leurs affections pour convoler en justes noces avec le Très-Haut ; elles passent dans le monde en faisant le bien et recevraient mal les invitations au noviciat, leur venant d’un directeur quelconque. (17 février 1903)
La référence à Voltaire (qu’on peut lire aussi dans le théisme du deuxième paragraphe), la haine des couvents et l’insistance sur la raison montrent clairement que La Fronde cherche à s’inscrire dans le prolongement des Lumières, rejoignant là encore une référence centrale de la république.
Du patriarcat ?
Pour autant, le journal de Marguerite Durand n’est pas vraiment un porte-parole du camp républicain : d’abord parce que si les principes et les références sont pour partie communes, dans les faits, à l’exception de Camille Sée, les républicains se sont peu engagés en faveur de l’éducation des jeunes filles29. Ensuite parce qu’en encourageant une lecture extensive et variée d’ouvrages contemporains parfois controversés et en soulignant que la lecture ne présente pas grand risque pour des lectrices averties, le journal est bien loin des lectures préconisées aux filles par la république au travers de programmes scolaires qui restent extrêmement classiques30. Enfin, le féminisme de La Fronde l’entraîne à suggérer discrètement que toutes ces lectures pourraient permettre aux jeunes filles d’occuper une nouvelle place dans la société. Cette idée d’une lecture émancipatrice n’est jamais présentée explicitement mais on ne peut qu’être frappé par l’insistance sur la place importante de la lecture dans la formation des femmes que le journal met à l’honneur : on se souvient des journalistes rappelant avec émotion les lectures de leur jeunesse (11 février 1902), mais on découvre aussi la passion pour la lecture d’écrivaines, de futures scientifiques comme Clémence Royer, première femme à donner un cours en Sorbonne (18 août 1900 et 6 février 1902, à l’occasion de sa mort) ou la première astronome inscrite à l’observatoire de Paris, Mlle Klumpke :
Comparant sa vie à une étoile, Mlle Klumpke racontait en quelques mots et ses débuts […] : « Il y a vingt ans, lorsque je suis arrivée en France, mon étoile était télescopique, inférieure à la vingtième grandeur peut-être. Je l’aperçus pour la première fois, lorsqu’élève bachelière, je contemplai astronomiquement le Ciel et que je fus initiée aux choses d’Uranie par la lecture de notre éminent secrétaire général, M. Camille Flammarion, qui fut mon premier maître en Astronomie. » (28 novembre 1901).
De même, les Mémoires de Madame Roland, publiées en feuilleton en 1902, font l’autoportrait en lectrice précoce et passionnée31 d’une future « femme politique » (l’expression apparaît dans un article consacré aux mémoires de femmes du 27 juin 1902). Le journal consacre aussi de très nombreux articles aux lectures des normaliennes (comme le 1er janvier 1904) et des institutrices comme lorsqu’il prend parti pour l’égalité salariale entre les instituteurs et leurs collègues féminines :
Les besoins de l’esprit ne sont-ils pas les mêmes ?
La lecture des livres, revues, journaux n’est-elle pas aussi nécessaire à l’institutrice qu’à son collègue, ‒ je dirais même plus nécessaire, car souvent l’éducation a imprégné l’esprit de la femme de préjugés dont doit se débarrasser une institutrice vraiment laïque… (12 mai 1904)
Au travers de ces multiples exemples, La Fronde laisse ainsi entendre qu’à côté (ou en plus) du rôle traditionnel d’épouse et de mère, qui est explicitement mis en valeur dans les articles, la jeune lectrice pourrait suivre une autre voie et que ses lectures pourraient lui permettre d’accéder à une vie professionnelle propre et un rôle dans l’espace public. Le journal salue d’ailleurs avec fierté les réussites de dix jeunes agrégées le 11 août 1903 et s’engage pour défendre l’égalité des femmes diplômées (comme le médecin Madeleine Pelletier en 1904, à qui était refusé l’accès au concours de l’internat des asiles psychiatriques). On pourrait penser que le discours explicitement très mesuré du journal fait passer au second plan un féminisme plus virulent qui défend une lecture émancipatrice pour les femmes. Mais la remise en cause prudente du patriarcat qui s’exprime par des exemples plus que par des discours permettait de garder un certain équilibre au sein d’une rédaction réunissant des sensibilités idéologiques différentes et de conserver un lectorat divers au-delà des seuls cercles militants ; par ailleurs, la multiplicité de ces représentations de la féminité constituait aussi une contestation des discours essentialistes sur « La Femme » et en particulier ceux visant la femme moderne, éduquée et lectrice32.
D’article en article, La Fronde présente une conception féministe de la lecture féminine, qui postule que, débarrassée de ses dangers par une éducation soignée, la lecture des jeunes filles constitue une sorte de panacée qui leur assurera une vie heureuse. Plaisir et formation de l’esprit comme de la sensibilité, la lecture telle que la préconise le journal semble aussi destinée à former des citoyennes éclairées, libérées de la tutelle de l’Église et peut-être aussi de celle du patriarcat, même si ce message reste discret. Construit en réaction à l’éducation catholique traditionnelle, qu’ont connue Marguerite Durand et la reporter Séverine33, et en parallèle de positions républicaines qu’il radicalise, ce discours féministe sur la lecture des filles semble rencontrer un certain écho dont témoigne le courrier des lecteurs, même s’il est très difficile de savoir si ces préconisations ont réellement influencé des pratiques éducatives, sauf à mener une vaste enquête dans les autobiographies des femmes nées autour de 190034.