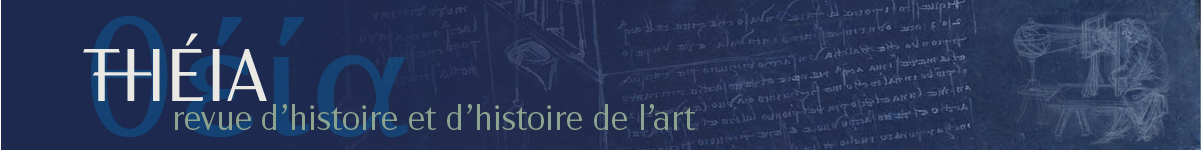« Je pourrais passer ma vie dans une chambre ». Ces mots d’Orhan Pamuk dans Bir odada [Dans une chambre] disent l’honneur qu’il nous fait ce soir en étant dans cet amphithéâtre pour recevoir l’hommage de notre université, un hommage modeste au regard de tous ceux qu’il a déjà reçus dans le monde entier, mais un hommage absolument sincère. Évoquer en l’espace de quelques minutes son œuvre immense est vain et dérisoire. Qu’il me soit permis, en guise d’éloge, de dire quelques mots du rapport qu’elle entretient aux objets et aux images, ne serait-ce que parce qu’en tant qu’historien de l’art, je suis censé savoir en parler ; censé seulement car, simple lecteur parmi tant d’autres à travers le monde, j’éprouve comme eux une fascination qui déjoue mes compétences académiques.
Tout lecteur d’Orhan Pamuk aura ressenti la même impression : son écriture, avec une force singulière, fait naître ou renaître des espaces, des moments, des images. Elle fait vivre des instants ou des époques, des pays et des villes, des quartiers et des rues, des maisons, des appartements… et des chambres. Elle nous les rend aussi coutumiers que si nous y avions vécu ou, plus précisément, aussi familiers que si nous les avions observés au prisme d’une image, graphique ou photographique, qui aurait durablement imprimé notre mémoire. Dans cette chambre où il dit pouvoir passer sa vie, comme dans une chambre photographique, se projettent les images des espaces et des objets d’autres vies, celles de ses personnages. Le roman, selon Pamuk, « raconte notre propre vie comme si c’était celle d’un autre et nous offre la possibilité d’écrire la vie d’autres personnes comme s’il s’agissait de la nôtre » (D’autres couleurs, Paris, Gallimard, 2006, p. 299). Nous, ses lecteurs, vivons ces vies et ces espaces en nous les appropriant. Ils s’insinuent dans notre propre expérience vécue. Ce qui nous rend ces vies si familières, au point qu’elles se confondent avec les nôtres, est sans doute lié au rapport très particulier de l’écrivain aux images et aux objets.
Alors qu’il était étudiant en architecture, le jeune Orhan Pamuk semble avoir été surtout intéressé par l’histoire et le dessin plus que par les aspects techniques de cette formation. Un de ses amis de l’époque a dit avec quelle jubilation ils avaient ensemble parcouru les rues du quartier de Beşiktaş pour en dessiner ses maisons anciennes, probablement parce qu’elles offraient la possibilité de plonger tant dans l’histoire de ce faubourg populaire que dans celles de ses habitants. De cette période, des dessins de jeunesse ont été retrouvés qui témoignent d’une recherche littéraire et visuelle et même de leur interaction puisqu’il s’agit parfois de calligrammes. Je tiens à mentionner également des caricatures et des dessins satiriques parce que, comme souvent dans ce genre graphique, l’effet obtenu procède de du frottement de l’image et des mots qui la légendent.
Si, très jeune, Orhan Pamuk a renoncé à sa vocation de peintre, il a, toute sa vie, continué à dessiner. Souvenirs des montagnes au loin reproduit ses Carnets dessinés. Pour autant il ne s’agit pas de livres illustrés, un genre dans lequel très peu d’écrivains se sont essayés, même quand ils dessinent ; mais plutôt de dessins accompagnés de texte. Les images de Pamuk capturent des moments, des odeurs et des formes. Flâneur baudelairien, c’est au cours de promenades dans le quartier de Çukurkuma, dans ses odeurs et ses ambiances, dans le fouillis de son marché aux puces, qu’il imagine le roman Le Musée de l’Innocence. Et le véritable musée lui-même est installé dans une maison découverte au fil de semblables pérégrinations, une maison dont les façades repeintes en rouge contribuent à nier ses propriétés architecturales pour en faire un grand objet destiné à contenir tous ceux qui ont été glanés dans les rues de ce quartier. En exposant ainsi les matériaux (au sens propre et figuré) de l’œuvre littéraire, il donne à ses lecteurs la possibilité de partager le processus d’écriture et de construction de la fiction. Ces objets sont des condensateurs d’expérience. Que l’on pense au sac à main de luxe que vend Füsun à Kemal, caractérisé par le papier de rembourrage couleur crème de la pochette centrale, dont le crissement entre les mains de Füsun, seulement imaginé par le lecteur, rend l’instant incroyablement présent.
Le lecteur de Marcel Proust pourra rapprocher cette quête nostalgique du moment disparu et de l’être aimé du rôle des espaces, des objets et des parfums dans l’œuvre de l’écrivain français. Même coalescence du présent et du passé pour revivre le temps d’une existence, « dans le temps » – les derniers mots de la Recherche de Proust –, mais aussi et peut-être davantage, chez Pamuk, hors du temps – comme l’inconscient qui selon Freud « ignore le temps ». L’objet est le médiateur de cette expérience du temps, très différente néanmoins chez Proust et Pamuk. Les « vivantes échasses grandissant sans cesse » sur lesquelles les personnages de Proust sont juchés plongent « dans le temps » caractérisant un écrivain aux prises avec l’angoisse des ruptures de la modernité du début du XXe siècle. Chez Pamuk, un siècle plus tard, le temps ne présente pas cette verticalité plongeante car le récit est fondé sur le parcours de la découverte des objets, que cette découverte soit celle de l’écrivain, au fil de ses promenades, ou qu’elle soit celle de son lecteur/visiteur du musée de l’Innocence. Ainsi que Pamuk l’a souligné, en se référant au formaliste russe Victor Chklovski, les objets sont des points de passage reliés par la ligne qu’emprunte la fiction. De la même manière que dans The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, de Laurence Sterne, cette ligne du temps du récit n’est pas droite – elle est dessinée comme une arabesque par l’auteur lui-même – la ligne du temps pamukien n’a pas la rectitude des échasses proustiennes qui tentent de retrouver un passé menacé d’abolition. Elle relie les temps et les lieux par de nombreux parcours, comme l’histoire polyphonique de la ville d’Istanbul qui s’écrit entre deux continents, plusieurs civilisations et de multiples cultures.
Cette conception plurielle et polysémique de l’histoire et du temps, que l’on peut qualifier de post-moderne, s’incarne dans la spirale peinte sur le sol du rez-de-chaussée du Musée de l’Innocence. Elle représente tant les pérégrinations du flâneur Pamuk à la recherche des objets et de la maison musée, que la construction du récit du lui-même et le parcours du visiteur d’un objet à l’autre. Le récit spirale le temps de nos vies faites de chemins plus ou moins erratiques – quels que soient nos efforts pour les organiser et nous convaincre que nous y parvenons.
L’architecte et critique Charles Jencks, un des fondateurs de la notion de postmodernité, a accordé une attention particulière à la forme de la spirale dans son Garden of Cosmic Speculation. Ainsi que ce nom l’indique, Jencks a inscrit dans le paysage des confins de l’Angleterre et de l’Ecosse, à la manière d’un pétroglyphe, la forme de l’univers, ou tout au moins celle de notre galaxie. La spirale inscrite sur le sol du Musée de l’Innocence, de la même façon, relie les objets, les personnages et les époques de l’histoire, l’écrivain et ses lecteurs, le temps révolu et le temps vécu, comme autant de corps célestes qui gravitent dans des temporalités diverses et complexes. C’est peut-être ce qui rend l’écriture de Pamuk à la fois si intime et si universelle : les objets et les images qui la fondent sont les fragments ou les vestiges d’autres mondes, d’autres univers intérieurs. Ils se sont formés dans la chambre où Pamuk écrit, devant les objets qu’il y a rapporté ; cette chambre bien semblable à toutes celles que traverse le visiteur de la maison du musée de l’innocence, toute semblable aussi à cette chambre où nous lisons le récit d’existences qui sont toutes celles de Pamuk et toutes les nôtres.
Je termine, comme j’ai commencé, avec une citation d’Orhan Pamuk :
Les romans sont des structures singulières qui nous permettent de n’avoir aucun mal à faire coexister dans notre esprit des pensées contradictoires, et de comprendre simultanément des points de vue divergents.1
Les livres d’Orhan Pamuk nous aident à mieux comprendre le monde, à apprécier sa diversité en nous ouvrant aux autres, d’où qu’ils viennent, plutôt que de refermer notre histoire sur elle-même en la figeant. Lire Pamuk, c’est suivre la spirale qui part de sa chambre pour parcourir, connaître et embrasser l’universalité du monde à travers chacun des individus qui le composent.