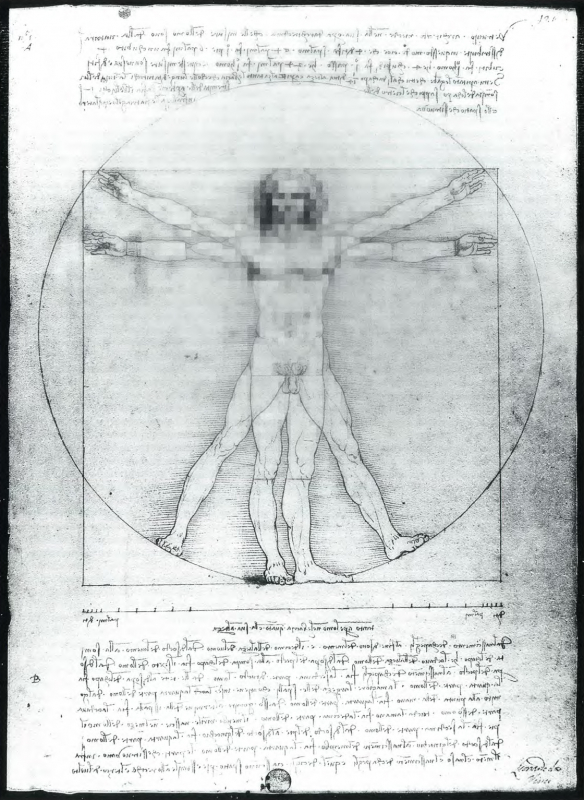Il n’est aujourd’hui guère d’opinion plus convenue que celle consistant à considérer la technique (et son avatar contemporain : la technologie, co-produite par l’activité scientifique) comme neutre, c’est-à-dire dépendante des usages que l’on en fait. L’argument peut être avancé de façon vulgaire (« C’est qu’un outil, l’ordinateur. ») ou savante (« Il faut penser les usages sociaux du numérique. »), alors même qu’une telle posture est réductrice, idéologique, et in fine fausse.
L’idéologie du progrès, qui prend ses racines dans un XIXe siècle fanatiquement scientiste (notamment après 1850), a produit cet énoncé double, rationnellement contradictoire, mais sur le plan politique terriblement efficace : la science et la technique sont neutres et ne promettent rien ; en même temps, la science et la technique sont tout, et promettent le bonheur futur de l’humanité1. En ce sens, ces deux propositions incompatibles (la technologie n’induit rien par elle-même, et pourtant, elle améliorera la condition humaine) sont souvent tenues pour acquises, voire évidentes.
Voulant s’ériger contre le progressisme naïf, notamment véhiculé par la seconde affirmation (technologie = davantage de bonheur), le courant dit ScoT (acronyme de social construction of technology – construction sociale des techniques2) a montré que toute technique était engrammée dans des pratiques et des univers sociaux, et qu’il y avait un grand intérêt à questionner non pas seulement les visées des producteurs de technologies (par exemple « il faut inventer la télécommande pour aider les personnes handicapées »), mais aussi les réappropriations successives dont elles sont l’objet (la télécommande a ainsi progressivement été plébiscitée par tous les foyers équipés de téléviseurs).
Sortir des usages pour penser les effets des techniques
Malheureusement, cette stratégie, gagnante lorsqu’elle visait à s’opposer au progressisme naïf, a plus solidement encore arrimé l’évidence de la doxa selon laquelle toute technique est neutre, c’est-à-dire uniquement déterminée par ses usages sociaux. On assiste alors à ce paradoxe, selon lequel la technique, souvent définie comme un moyen de produire efficacement une action sur le réel, ne déterminerait rien par elle-même : la technique serait ce qui réalise un effet spécifique, mais elle n’aurait pas d’effet propre !
Après deux siècles de politiques industrialistes, force est de constater que l’industrialisation et la technologisation du monde naturel et humain (pour peu qu’on imagine pouvoir séparer les deux) ont été les principaux vecteurs de transformation des écosystèmes et des sociétés. Plus que n’importe quelle politique, fût-elle de droite, de gauche ou de n’importe lequel des bords extrêmes du spectre politique, les pays occidentaux, puis l’ensemble du globe, ont été moulés dans une production technologique du réel qui surdétermine les rapports sociaux bien davantage que ne le ferait n’importe quelle politique volontariste.
Issu de l’immigration italienne, mon père me racontait comment dans les années 1950, il était de coutume, dans les banlieues ouvrières, de se retrouver les soirs d’été en bas des immeubles pour discuter jusqu’à très tard entre voisins. Nulle circulaire ministérielle n’a missionné le moindre policier pour faire rentrer tout ce bas peuple dans ses casemates : la télévision s’en est chargée. C’est au fond ce que disait déjà Marshall Macluhan dès 1968 : « le medium, c’est le message3 ». Le message de la télévision, ce ne sont pas les diverses paroles qu’elle fait transiter : le message de la télévision, c’est la télévision elle-même, avec les formes de vie et les rapports sociaux qu’elle induit. Jaron Lanier, développeur informaticien de haut niveau et auteur de plusieurs ouvrages critiques des technologies contemporaines, a ainsi constaté que la taille des avatars mis en scène dans les univers de réalité virtuelle influait directement sur le sentiment d’estime de soi des utilisateurs :
« Il est impossible de travailler dans les TIC sans s’engager du même coup dans l’ingénierie sociale. […] Nous autres [ingénieurs] construisons des extensions de l’être, comme des yeux et oreilles télescopiques (webcams et téléphones portables) et une mémoire étendue (l’univers infiniment détaillé à disposition de nos recherches en ligne). Tout ceci produit des structures au travers desquelles on se connecte au monde et aux autres. Ces structures peuvent changer en retour la façon dont on se conçoit, soi-même aussi bien que le monde. Nous bricolons avec votre philosophie par manipulation directe de votre expérience cognitive, et non indirectement, par la discussion et la conviction. Il suffit d’un tout petit groupe d’ingénieurs pour créer une technologie qui transforme la totalité de l’expérience humaine, et ce à une vitesse à peine concevable4. »
Lanier considère ainsi que le meilleur moyen de transformer les sociétés n’est pas de faire appel à des politiciens, des rhéteurs ou des philosophes pour convaincre les gens de changer, mais simplement de mettre au travail un petit groupe d’ingénieurs pour recomposer intégralement le cadre technique de la vie contemporaine.
Il ne s’agit pas de dire que la technique fait tout, ni qu’il existerait un déterminisme technique linéaire, mais bien plutôt de prendre acte du fait que les motivations et envies des êtres humains sont coproduites par les objets techniques qui les entourent. De ce point de vue, savoir-faire et usages se mêlent aux artefacts, au point qu’on ne les en distingue que difficilement5 : pour le dire autrement, les usages produisent des techniques, qui elles-mêmes produisent des usages, le tout dans un cercle sans fin (et probablement sans réel début, puisque l’être humain et la technique seraient apparus simultanément6).
Si l’on accède à cette idée d’une co-évolution (nommée transduction par le philosophe Gilbert Simondon7) de l’humain et des techniques qu’il produit et qui le produisent en retour, il convient bien sûr d’étudier les formes d’appropriation et de réappropriation des technologies contemporaines, mais il est tout aussi nécessaire de penser les effets propres que ces techniques ont sur l’être humain. Or, ce dernier point est systématiquement oblitéré, sous prétexte d’un humanisme libéral qui ferait la part belle à la conscience humaine et refuserait tout déterminisme, alors même qu’il n’est rien d’autre, in fine, qu’un déterminisme social naïf.
En 1787, Elizabeth Vigée-Lebrun provoque un petit scandale en exposant un autoportrait où elle se représente souriant à pleines dents, ce qui contrevient aux règles de l’Académie des Beaux-arts édictées notamment sous Louis XIV. L’historien Colin Jones montre que cet épisode, qui advient au cours de ce qu’il nomme une révolution du sourire (qui est dès lors connoté positivement à la cour) n’est qu’un contrecoup – un épiphénomène – d’une recomposition plus radicale provenant de l’introduction des pratiques techniques inédites mises en œuvre par les dentistes, nouveaux personnages dans le paysage médical du siècle des Lumières. Même les Anglais (dont le pays n’a pas connu la même évolution médicale) en visite à Versailles s’étonnent de ces sourires à pleines dents que leurs offrent les dames de la cour. La technique a produit ici un désajustement au sein des pratiques culturelles curiales8.
Il faut donc s’efforcer de penser les effets spécifiques des techniques sur le social. Cependant, élaborer un modèle d’analyse non-linéaire des déterminations technologiques est un sujet de recherche à part entière en histoire et philosophie des techniques, sujet que le présent article ne peut qu’effleurer. Il est néanmoins indispensable d’avoir à l’esprit ces enjeux pour comprendre la nature des travaux qui tentent aujourd’hui de produire une description fine des implications du numérique dans la production psychique du sujet contemporain.
Le numérique, ou la pensée im-médiate
Le numérique n’est donc pas un phénomène neutre : d’une part, il est produit par et s’inscrit au sein d’une société, notamment libérale et individualiste ; d’autre part, il induit par lui-même un certain rapport aux autres et au monde. Une activité traditionnelle « numérisée » fait ainsi montre de caractéristiques différentes de sa version « physique9 ». Pour s’en convaincre, il suffit d’observer l’intérêt que suscitent les réussites, ces solitaires, spiders et autres patiences jadis pratiqués à l’aide de jeux de cartes en bois, puis en papier plastifié, et désormais disponibles sur d’innombrables interfaces numériques – des smartphones aux tablettes et ordinateurs plus perfectionnés. Même s’il est délicat d’obtenir des statistiques concernant leur utilisation, quiconque prend le métro peut observer combien ces jeux, jadis confinés à quelques chambres ou maisons de retraite, ont désormais conquis les contemporains. Par ailleurs, s’adonner à leur pratique montre immédiatement combien le rapport est différent comparativement à leur exécution sur table : aussi mordu soit-on de réussites, il est délicat d’y consacrer plus de quelques dizaines de minutes lorsque l’on y joue « physiquement », alors que le temps semble passer incroyablement vite, et les parties s’enchaîner les unes aux autres, lorsque l’interface numérique gouverne la pratique.
Marc-Antoine Buriez.
Partant de ce phénomène en apparence anecdotique (le fait que la patience numérique absorbe davantage que son équivalent sur table), je voudrais tenter de montrer que le numérique en tant que tel induit un rapport psychologique spécifique, qui n’existe pas dans des conditions purement « analogiques ».
La différence première qui frappe le pratiquant de patiences numériques, c’est la vitesse à laquelle on peut enchaîner les parties : une donne initiale ne convient pas ? Qu’à cela ne tienne, un simple clic et l’ensemble du jeu est rebattu puis redistribué. Plus encore, dans ces quelques jeux où il faut régulièrement déplacer d’importantes quantités de cartes (comme le solitaire classique où l’on peut glisser une suite allant de la reine au deux sur la colonne d’un roi), on s’aperçoit que le fait que la machine prenne en charge des tâches en apparence sans importance (mélanger, distribuer, déplacer une ou plusieurs cartes, etc.) change la nature du jeu. Pour le dire autrement, ce qui apparaît comme une condition annexe mais nécessaire à sa pratique sur table (le temps d’organisation des cartes indispensable au fonctionnement du jeu) s’avère bien plus constitutif de la pratique que ce que l’on pourrait imaginer de prime abord. Là où ces diverses tâches plus ou moins rébarbatives induisent un rapport à l’activité plus distanciée et moins frénétique (qui laisse notamment la place à une certaine rêverie, voire un ennui sur le long terme), leur disparition engendre la possibilité de s’y noyer bien davantage, précisément parce que l’activité est délestée de toute sa logistique physique « annexe ». Du même coup, le jeu se rapproche plus encore de ses mécanismes primaires, détaché de sa pesanteur d’exécution matérielle, pour devenir une pure activité intellectuelle d’optimisation. Mon point ne consiste pas à discuter cette transformation de la pratique de la patience sous l’angle du progrès ou de la régression (est-ce bien ou mal que le jeu soit transformé ainsi ?), mais de considérer cette recomposition comme l’indice d’une tendance propre au numérique, qui transparaît ici dans la pratique de la réussite.
Contrairement au monde « analogique », où la moindre action nécessite généralement un minimum d’effort physique (ne serait-ce que pour battre le jeu de carte, le distribuer, mais aussi se tourner pour parler à quelqu’un, se déplacer pour aller au supermarché, etc.), le monde numérique offre la possibilité d’un recouvrement de la pensée par l’action, qui, en son point focal, se constitue comme adéquation radicale entre la pensée et la réalisation pulsionnelle : au moment où je veux commencer une nouvelle partie, celle-ci débute immédiatement ; dès que mon esprit veut bouger la reine de cœur sur le roi de trèfle, la carte se déplace par simple clic (les actions automatisables sont même généralement prises en charge par la machine, comme lorsque les cartes pouvant s’empiler sur les As initiaux sont découvertes). Cette réduction du temps d’exécution à sa portion congrue (puisque tout le temps de traitement est réalisé par un calculateur pouvant effectuer quelques milliards d’opérations logiques à la seconde10), qui correspond désormais quasiment au temps de pensée de l’action, rapproche l’activité humaine de son aspect pulsionnel. La satisfaction pulsionnelle est de l’ordre de l’im-médiat, de ce qui n’est pas médiatisé par un principe de réalité ou une instance surmoïque, qui aurait la possibilité (et donc le temps) d’interférer avec cette immédiateté de la réalisation pulsionnelle. En raccourcissant à l’extrême le temps entre le projet et l’action, le numérique tend à faire coïncider pensée et mise en acte : dès que je veux déplacer tel groupe de cartes, l’opération s’effectue de façon quasi instantanée (et prothétique, puisque j’ai le sentiment de déplacer réellement les cartes, avec ma souris, ou mon doigt sur l’écran). De la même façon, dès que j’ai envie de tel produit, un simple clic sur Amazon ou E-bay assouvit ma pulsion : de la pensée à l’acte d’achat, le numérique raccourcit considérablement temporalité d’exécution de la réalisation pulsionnelle.
Cet épiphénomène de la technologie numérique – qui n’a pas particulièrement été produite dans le but de ce rétrécissement temporel – a de nombreuses conséquences. Tout d’abord, si l’on poursuit l’exemple de la patience, il permet d’être bien davantage absorbé par le jeu, puisque tous les aspects annexes, générateurs de fatigue attentionnelle sur le long terme, sont évacués : on comprend alors pourquoi il est possible d’être « pris par le jeu » pendant plusieurs heures sans s’en apercevoir (tout comme devant la télévision), alors que ce phénomène ne se produit pas lorsqu’on joue « sur table » au solitaire : le numérique, en amalgamant pensée et action, rend possible une forme d’immersion, voire d’« hypnose », alors que le flux de la conscience se calque sur celui du jeu, au point de l’épouser, et ce précisément parce que la personne qui joue maîtrise totalement ses actions – c’est d’ailleurs même cet enchaînement de micro-décisions qui constitue la conscience humaine lorsqu’elle s’immerge dans des activités numériques. Plus généralement, le jeu vidéo, en général, se présente comme un mécanisme d’amalgame entre pensée et réalisation pulsionnelle, d’où son pouvoir de fascination sans précédent, puisqu’il joue parfois en même temps sur le plan fantasmatique (je fantasme de lancer des météores enflammés sur mes ennemis et ceux-ci jaillissent directement « de ma conscience », médiatisée par la touche « Y »).
Ensuite, cette adéquation entre pensée et réalisation immédiate, qui opère quasi pleinement dans la pratique numérique, épouse parfaitement les formes de la marchandise contemporaine, qui doit toujours aller plus vite, sans le moindre accroc (les entrepôts d’Amazon sont ainsi de gigantesques usines à fluidification de la marchandise11). Côté consommateur, le numérique accentue la coïncidence, mise en œuvre massivement par la publicité dès les années suivant la crise de 1929, entre contrôle serré de la production au sommet et irrationalité des pulsions à la base : pour qu’un système économique fondé sur le choix et la tentation puisse fournir les biens désirés, il faut qu’il existe un système de mise en correspondance, ou plutôt d’intégration, de la disponibilité marchande au sein des consciences. Là où la publicité classique opère industriellement cette promotion, la publicité numérique ciblée, adjointe à la commande immédiate, réduit encore les frictions (et donc les pertes) qui peuvent advenir entre la pensée d’un achat et sa réalisation : dès que la pub clignotante apparaît sur mon écran, je peux cliquer sur le produit et le recevoir ensuite par la poste. On peut alors penser le numérique comme un phénomène technologique à la fois produit par une société capitaliste marchande, mais qui l’alimente et la pérennise du même coup. Alain Giffard, notamment, qualifie ce régime consumériste pulsionnel inédit d’« économie de l’attention12 », désignant ainsi le nouveau modèle économique dont Google est le fer de lance, qui vend contre de l’accès l’attention active des utilisateurs aux annonceurs, ce que matérialise la « bourse aux mots-clef » (« ski » est un mot vendu plus cher par le moteur de recherche en hiver qu’en été). Dès lors, surfer sur un maximum de pages et lancer un maximum de requêtes en ligne devient un enjeu d’incitation économique fort, comme le remarque Nicholas Carr : « La dernière chose que souhaitent les entrepreneurs du Net c’est d’encourager la lecture lente, oisive, ou concentrée. Il est de leur intérêt économique d’encourager la distraction13. »
Enfin, si l’idée d’un raccourcissement de la distance séparant pensée et mise-en-acte apparaît comme liée au numérique, il faut prendre au sérieux le fait que la croissance d’une telle technologie influe massivement sur la psyché humaine et son développement. Ainsi, ce qui traditionnellement pouvait être considéré comme l’apanage de l’enfance (la difficulté à différer le désir de son assouvissement), devient la condition normale de l’activité intellectuelle à l’ère du numérique. Autrement dit, il n’y a pas que le capitalisme qui nous infantilise14, mais bien aussi les technologies numériques, qui favorisent l’émergence d’un horizon émotionnel d’attente impatiente propice au consumérisme.
Ce genre d’analyse nous a mené, Cédric Biagini et moi-même, à développer le concept de technolibéralisme pour qualifier cet univers promu par les technologies contemporaines, s’adaptant (au point de les radicaliser) aux nécessités du libéralisme contemporain :
« Le terme technolibéralisme désigne pour nous la profonde intrication du déferlement technologique (promu par les idéaux de maîtrise et de toute-puissance) à l’idée libérale selon laquelle les sociétés ne peuvent choisir leur destinée hors de l’individu en tant que monade infiniment potentielle. […] Cette culture vise à déraciner, désaffilier et rendre flexible, malléable, un être humain réduit à se vivre en tant qu’individu, n’agissant que pour son propre intérêt dans un rapport coût/avantage avec le monde et avec autrui. Cette "machine à calculer", de par sa soif de puissance et de maîtrise, désire s’affranchir de toutes les contraintes – temps, espaces, corps, autres. Cet objectif d’autosuffisance, régi par les principes d’utilité, de rationalisation et de performance, trouve dans les nouvelles technologies et notamment Internet, la possibilité de se réaliser véritablement. […] L’individu, seul face au monde, ou plutôt face à son écran, se retrouve en permanence relié mais de moins en moins lié, coupé de tout ancrage social réel, connecté en permanence et accroc au changement perpétuel, désir que les mutations technologiques incessantes comblent provisoirement15. »
Au final, la prétention d’une analyse centrée sur les seuls usages, et aveugle aux implications des technologies numériques, me semble participer de ce que l’on pourrait qualifier de « déni », au sens psychanalytique du terme. Alors même que la technologie est sans doute le principal moteur de la transformation des sociétés contemporaines (des start-up jusqu’au gouvernement, la mode est d’ailleurs aujourd’hui à l’innovation à marche forcée), la mythologie de la neutralité de la technique continue à emplir les colonnes des revues, aussi savantes soient-elles. Comme le remarquait Bernard Charbonneau : « [La technique] n’est pas neutre, au contraire, elle ne semble telle que lorsqu’elle s’impose automatiquement à nous : ce que nous prenons pour la neutralité de la technique n’est que notre neutralité vis-à-vis d’elle16. » Sans doute l’être humain a-t-il peur de s’avouer dépassé par les machines qu’il a contribué à créer – ce qui constitue le cœur de la honte prométhéenne analysée par Günther Anders dès 195617, et nourrit l’imaginaire de la science-fiction (de 2001 l’odyssée de l’espace à Matrix en passant par THX-1138 ou Terminator), preuve s’il en est du retour de ce refoulé comme angoisse civilisationnelle majeure à l’aube du troisième millénaire.