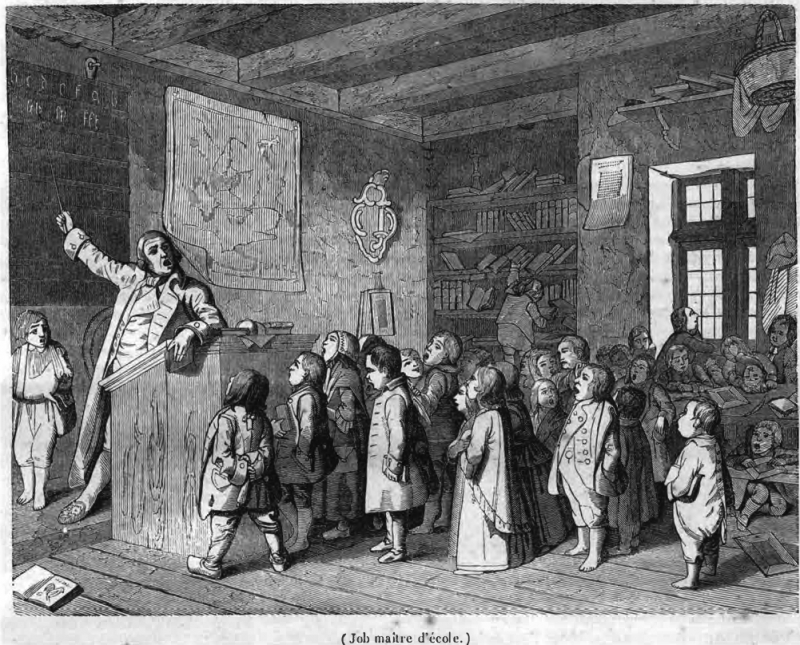Des recherches initiées en toute partialité
La question du groupe et de ce qui s’y joue sur le plan intersubjectif n’est pas nouvelle pour les praticiens de la « pédagogie institutionnelle » au sens de Fernand Oury et Aïda Vasquez. En créant le « Groupe d’Éducation Thérapeutique » au milieu des années soixante, les fondateurs de cette approche pédagogique se donnaient comme projet de lier la pratique de la classe coopérative avec « une production intellectuelle commune et [la] formation personnelle de chacun » (Oury, Vasquez, 1967, p. 254). En cette période initiale, ces auteurs indiquaient notamment : « Beaucoup [de] groupes ne survivent pas à la période de fusion et d’effusion. Il semble que très souvent apparaissent, d’une façon imprévisible, des tensions incompréhensibles entre des personnes, animées du même idéal, dont les buts sont communs. » (Id., p. 253.)
Il se trouve que ma recherche actuelle prend sa source dans un partage de travail avec ces auteurs, en tant que praticien de la pédagogie institutionnelle à l’école élémentaire ou en formation professionnelle. Ce qui fait donc pour moi origine, c’est une expérience personnelle d’événements « déstabilisants » ou de questionnements de même ordre que ceux à partir desquels j’essaie aujourd’hui de proposer une lecture. Un tel rapport à mon domaine de recherche nécessite bien entendu un travail d’élaboration. Mais, dans le cadre de cet article, je présenterai simplement quelques éléments relevés au cours des premiers entretiens de recherche réalisés.
À la suite de travaux s’inscrivant dans une approche clinique d’orientation psychanalytique dans le champ de l’éducation et de la formation, en particulier ceux initiés et conduits par Claudine Blanchard-Laville, mon projet vise à rendre compte des modalités selon lesquelles, dans l’espace de la classe institutionnalisée comme dans celui du groupe de praticiens, l’enseignant se trouve confronté à des « événements psychiques » susceptibles de faire évoluer sa démarche didactique et son propre rapport au savoir, entendu ici au sens du « processus créateur de savoir pour un sujet-auteur, nécessaire pour agir et penser » (Beillerot, 1989). Mon attention porte donc sur la manière dont les professionnels évoquent leur rapport à la structure d’enseignement dont ils sont les initiateurs, mais aussi au groupe local d’enseignants dont ils font partie. Mon travail vise à approcher certains processus psychiques à l’œuvre, dans la perspective d’un apport à la compréhension de ce qui est en jeu dans le double contexte de la classe coopérative et du groupe local de praticiens.
L’organisation du discours manifeste
Les entretiens dont je rapporte ici quelques fragments ont été réalisés auprès de deux enseignants de l’école primaire. Esther, ainsi qu’elle sera nommée ici, travaillait dans une classe comprenant une grande section de maternelle et un cours préparatoire. Et celui que j’appellerai Marc enseignait dans un CM1-CM2. L’un et l’autre participaient aux travaux de deux groupes distincts de praticiens de la pédagogie institutionnelle.
C’est d’abord sous la forme d’un récit que chacun décrit le début puis le renforcement de son implication dans les pratiques de la pédagogie institutionnelle. Dans cette narration, la confrontation avec des collègues ayant déjà mis en place une classe coopérative tient une place importante et c’est la rencontre avec un praticien expérimenté qui semble ouvrir la voie à l’engagement personnel. Mais cette entrée dans une pratique nouvelle est aussi évoquée comme un moment de transformation sur le plan subjectif, puisqu’Esther met en avant le « changement » que suscite chez elle cette modification de l’activité professionnelle, tandis que Marc insiste sur la possibilité qu’elle lui offre « d’échapper » à un type de relation avec les élèves qu’il paraît redouter.
C’est seulement dans un deuxième temps que la parole des enseignants vient se lier avec ma question de départ qui portait sur la manière dont ils vivent l’organisation de classe qu’ils ont instituée. Il est alors question de la place qu’ils occupent dans la classe à travers certaines institutions, en particulier le « Quoi de neuf ? » et le « Conseil », mais aussi de leur positionnement en tant qu’individu dans le groupe-classe.
En un troisième temps, spontanément ou après ma reprise du terme de « groupe » à propos du collectif de praticiens, l’un et l’autre passent du groupe des élèves au groupe local de collègues pratiquant la pédagogie institutionnelle dans leur classe. Les propos d’Esther et de Marc se centrent alors sur les échanges qui s’y opèrent et sur la manière dont ceux-ci s’articulent avec des questionnements qui surgissent en situation professionnelle.
L’entrée dans la classe institutionnelle, changements, résistances et menaces
Esther raconte d’abord d’une voix tranquille sa mise en place de la pédagogie institutionnelle, en précisant les lieux, les dates et les personnes concernés. Elle insiste sur sa proximité avec une collègue de l’école, praticienne aguerrie et sur les appuis recherchés auprès du groupe de travail local. Puis sa voix s’altère quelque peu lorsqu’elle indique :
« Et puis le défi ça a été de changer d’école et d’changer d’niveau et c’t’année j’étais en prim/ enfin, en primaire, non / j’avais des Grande section et des CP et / et j’ai eu du mal à / résister [elle rit] / donc / là heureusement je retourne vers des moyens gr/ des Moyenne section Grande section donc je vais pouvoir me remettre dedans à fond. »
Archives Daniel Chatry
J’entends à ce moment-là le changement de tonalité dans la voix et je ressens fugacement une sensation d’inquiétude et d’épreuve. J’entrevois Esther comme face à une menace floue. De quel changement est-il question à propos de « changer d’école » ? S’agit-il de changer de lieu ou de changer d’école telle qu’elle est vécue, faite ou peut-être subie ? Et quel est le sens du changement de niveau : s’agit-il de la classe ou est-ce Esther qui se sent changer de niveau ?
Elle poursuit : « C’est pas qu’j’suis pas à l’aise, mais j’suis pas encore / enfin pis j’crois qu’on l’est jamais quoi / complètement satisfait de c’que j’fais. » Je note que l’insatisfaction « toujours là » est formulée à l’aide d’un pronom indéfini (« on ne l’est jamais » [satisfait], dit-elle) et que le terme même est énoncé au masculin (« j’suis pas encore / complètement satisfait de c’que j’fais »). Je m’interroge donc sur qui il s’agit de « satisfaire » en cette entreprise qui semble pouvoir n’être que vouée à l’échec. Esther ajoute que si elle est « retombée dans des choses plus systématiques », c’était « pour rassurer les parents et puis pour me rassurer à moi aussi avec des CP », ajoute-t-elle, tout en indiquant que « quand j’vois que j’ai eu du mal à résister avec des primaires et ben j’me pose / j’me remets encore en question ».
Durant les deux minutes et demie du début d’entretien, le verbe « résister » est apparu à trois reprises. Je pense que nous voyons là affleurer la « résistance » de la littérature psychanalytique, pour laquelle Freud nous indique qu’elle « se manifeste sous des formes très variées, raffinées, souvent difficiles à reconnaître » (Freud, 1970, p. 268). Mais il serait probablement hasardeux, à cette étape, d’en proposer une interprétation univoque, car ne pouvons-nous faire l’hypothèse que c’est dans le contexte d’une position professionnelle clivée qu’Esther manifeste cette tendance à « résister » ? Tiraillée entre les différentes instances de son « moi-enseignant » (Blanchard-Laville, 2001), Esther, en mettant en place la structure de la classe institutionnelle, se confronte peut-être au risque du « changement catastrophique » (Bion, 1970) dont on ne peut prédire qu’il sera suivi d’un effondrement ou, au contraire, « d’une maturation, d’une récupération de la part non intégrée et psychotique de la personnalité » (Baroni, Fadda, 2006, p. 130).
Marc, quant à lui, raconte d’abord sa mise en œuvre de la pédagogie institutionnelle selon un récit très structuré. Il décrit la manière dont, à l’occasion du trajet de retour après un congrès Freinet, une collègue et lui-même ont élaboré ce qu’il nomme une « Constitution de la classe » sur laquelle s’est ensuite fondée sa pratique. Mais, son récit très ordonné est rompu par une pause après laquelle Marc dit son intérêt pour les institutions de la classe coopérative. Il explique alors :
« C’qui m’a intéressé moi dans la pédagogie institutionnelle c’est que les institutions fassent médiation entre j’dirais l’enseignant et / et l’enfant / c’est-à-dire qu’à un certain moment je puisse à la limite presque me mettre en retrait ou au moins échapper un p’tit peu à cette relation qui est / duelle souvent / souvent dans une classe presque assez exclusive hein entre l’enseignant et / et l’enfant / qui peut être une relation / ben c’est à double tranchant hein / relativement perverse / puisque c’est soit de l’amour soit de la haine. »
Le contenu du discours, mais aussi la voix plus basse, les silences, le débit un peu haché, me font alors penser que l’intérêt de Marc pour l’établissement, dans la classe, d’une loi fondamentale, une Constitution, paraît entretenir quelque rapport avec ce qui pourrait s’avérer menaçant dans la confrontation aux élèves, en un rapport marqué par une certaine ambivalence. Dans les sept premières minutes de ce début d’entretien, le terme de « règle » est apparu six fois et quand Marc donne comme exemple d’institution la « monnaie intérieure » de la classe, c’est pour préciser que
« cette monnaie, elle permet de dépassionner les choses / de faire en sorte que / on soit moins sur l’ressenti hein [...] on a une amende et puis si on paye l’amende [...] ben voilà la page est tournée, alors que si on est sur quelque chose de j’dirais de plus affectif / il est plus difficile de dire un petit peu quel / en quelque sorte de se laver de la faute hein ».
À ce moment de l’entretien, je remarque l’importance de l’emploi du pronom personnel indéfini « on ». Alors que Marc tend à présenter la monnaie intérieure à partir de l’usage qu’en font les élèves, je m’interroge sur qui serait menacé par la faute si l’affectif venait au premier plan.
Un « individu » dans le groupe
Les termes « résistance » ou « résister » reviendront à plusieurs reprises au cours de l’entretien avec Esther. Notamment au début de ce que je distingue comme une deuxième partie, où elle parle de sa pratique de classe en commençant par évoquer le « Quoi de neuf ? ». Cette institution, située en introduction de la journée, est le moment durant lequel le groupe se recrée chaque jour, un temps de parole sans objet désigné a priori. Quand Esther parle de ce temps, c’est pour dire : « C’est par rapport à ça j’trouve c’est dur d’avoir des résistan/ / on a des résistances de s’dire on est / on a les mêmes / les mêmes lois que les enfants / on a le droit de parole tout pareil. » Ce « droit » qu’évoque Esther, je l’entends aussi comme un « risque » dans sa manière de l’énoncer. Qui sera sollicité pour parler dans le groupe-classe ? L’enseignante, la personne, ou quelque partie de l’une ou l’autre dont la parole menace d’être imprévisible ?
Marc, après son récit de la mise en œuvre de la classe institutionnelle, évoque ensuite certaines difficultés à organiser le groupe-classe en début d’année. Il dit alors à propos de la structure qu’il institue :
« J’avoue que je ne saurais pas comment faire autrement parce qu’évidemment dès lors qu’il y a une collectivité quelque part, forcément il y a des soucis de rapport à l’autre hein et le rapport à l’autre comment l’réguler / moi je trouve que c’est l’conseil qu’a un outil sacrément commode parce que ça permet aussi de renvoyer le règlement du problème à un autre moment [...] où les choses sont moins passionnelles. »
Avec la mise en place du « Quoi de neuf ? » et du « Conseil », Esther et Marc ne se confrontent-ils pas à un groupe « potentiellement traumatogène » (Kaës R., 2006, p. 143) ? Les « frontières singularisantes » (id.) dont parle René Kaës ne se voient-elles pas menacées lorsqu’elles se trouvent confrontées à ce cadre nouveau ? Nous pouvons penser aussi au « contrat narcissique » au sens de Piéra Aulagnier (1975, p. 129-213), pour qui chaque sujet prend place dans le groupe par la « filiation » qui l’assujettit à la chaîne des générations et par « l’affiliation » qui le lie au social.
Je relève aussi l’utilisation du verbe « avoir » quand Marc parle du « conseil qui a un outil sacrément commode ». Est-il plus facile pour Marc de se servir de cet outil qu’est le conseil lorsqu’il évite de se désigner directement comme celui qui le possède ?
Prendre place dans le groupe ne semble pas forcément aller de soi. Telle paraît être une des questions sous-jacentes au discours d’Esther lorsqu’elle indique : « Des fois on aurait tendance à vouloir prendre la parole sans la demander / donc c’est ça qu’est difficile / de garder sa place de maître, mais tout en étant aussi / un individu dans un groupe quoi / pour aider justement les enfants à deven/ à avoir cette place / d’individu / de personne en tant que telle. »
La problématique d’individuation qui pointe là me paraît s’inscrire dans la perspective proposée par Kaës lorsqu’il affirme que « le Je, terme du processus de subjectivation, ne peut advenir que dans un Nous dont il est d’abord tributaire et dont il se dégage, sans toutefois s’en affranchir radicalement, puisqu’il en est solidaire jusque dans sa solitude » (Kaës, 2006, p. 139). C’est d’ailleurs un sentiment de solitude que je ressens en entendant Esther terminer ainsi ce que je désigne comme la deuxième partie de l’entretien : « Pour être en vraie situation de communication / j’sais pas comment dire / j’ai du mal à exprimer ça / arrêter d’parler quoi [...] C’est plus dur de pas / de laisser la place au silence. »
Le groupe de pairs, groupe d’appartenance
Je relève ce terme de « silence » en le répétant et Esther poursuit alors en parlant du groupe de travail local dont elle fait partie : « Ça, je l’ai plus ressenti moi en vivant la P.l. au sein du groupe de N. j’trouvais ça pesant ces silences. » Esther précise que le moment du « Quoi de neuf ? » fut au départ particulièrement déroutant pour elle. À ce moment de l’entretien, elle semble chercher ses mots, fait silence, rit, puis se lève et se déplace dans la pièce. Quand elle revient s’asseoir, Esther enchaîne en parlant d’un outil élaboré avec une collègue et le groupe : le plan de travail individuel, « la première chose sur laquelle on a travaillé ensemble », dit-elle. Indiquant combien le travail avec le groupe soutient son « envie d’essayer des choses », elle s’interroge sur ce qui agit lors des rencontres : « J’sais pas alors c’est peut-être propre à ma personne ou propre au groupe je sais pas, mais on repart vraiment avec des envies. » Elle marque une pause, puis ajoute : « Ça permet de partager aussi alors, soit de façon formelle ou plus informelle pendant l’casse-croûte [...] comme un groupe de parole quoi. » Si, en écoutant Esther, j’associe le « casse-croûte » avec la thématique de la résistance du début d’entretien, ce n’est que dans un deuxième temps que la mention du « plan de travail individuel », cet outil qui singularise le travail de chacun, m’apparaît signifiante. Comme me fait sourire le fait qu’Esther se soit déplacée à ce moment-là de l’entretien. En reprenant la notion de « groupe d’appartenance secondaire » (Rouchy, 1990, p. 45-60), il me semble qu’à ce moment de l’entretien, émergent certains des processus dont parle cet auteur lorsqu’il avance que « tout changement effectif implique conjointement d’une part l’évolution des processus d’identification, des investissements et contre-investissements, de l’identité des professionnels qui ont intériorisé des éléments du cadre qui structurent leur rapport à la réalité, et d’autre part des changements dans la structuration du cadre institutionnel donnant corps à une nouvelle organisation de la réalité » (Rouchy, 2006, p. 59).
À la fin du moment où Marc parle des difficultés d’organisation en début d’année, il utilise à plusieurs reprises le terme de « groupe ». Je rappelle qu’en début d’entretien il a mentionné le groupe local dont il fait partie. Il poursuit alors en évoquant une expérience particulièrement difficile. Il parle
« d’un enfant [...] qui est arrivé à l’âge de dix ans / qui avait déjà comparu deux fois au pénal pour des faits graves [...] un enfant absolument incontrôlable [...] j’ai eu droit régulièrement à des insultes à des [il souffle] / des gros mots / des crises où il bazardait tout, enfin [...] c’était une situation extrêmement difficile à vivre [...] le matin j’arrivais avec un poids [iI rit] un poids et / et l’fait de pouvoir effectivement parler de cet enfant avec des collègues c’était en quelque sorte / une thérapie hein / quand on est seul à partager ça c’est terrible terrible terrible terrible / c’est vrai que bon c’est un enfant qui pendant un an a fusillé la classe [...] et si en ce qui m’concerne je n’avais pas eu des temps de parole ailleurs je sais pas trop comment j’aurais survécu à c’t’affaire-là [iI rit] ».
Je ressens l’accablement qui semble peser sur Marc à l’évocation de cet épisode professionnel, je note la répétition du mot « terrible », les termes « fusillé » ou « survécu » et les images d’exécution ou de péril qu’ils suscitent. Si Marc a été mis en danger sur un plan psychique durant cette période, il dit aussi que c’est le fait d’avoir pu en parler dans le groupe de pairs qui lui a permis de « survivre ».
Mais je relève surtout sa déclaration paradoxale lorsqu’il évoque la possibilité d’être « seul à partager ça ». Il me semble que cette formulation contient d’une part la possibilité ou l’espoir d’un partage avec le groupe et donc une possibilité d’élaboration de la situation qui provoque la souffrance professionnelle, mais aussi, d’autre part, une dimension de « partage en soi », autrement dit de clivage. Je pense ici à certaines modalités de clivage évoquées par C. Blanchard-Laville à partir de son travail en groupe d’analyse de pratiques avec des enseignants qui semblent souvent ne pouvoir être en situation d’accueillir « les mouvements psychiques internes que les situations professionnelles provoquent » (Blanchard-Laville, 2001, p. 104).
Pour une approche clinique de la situation d’enseignement
Ma démarche part du postulat que les pratiques d’enseignement ne se réduisent pas aux seules conduites manifestes et rationnelles, mais qu’elles sont pour partie régies par l’inconscient, au sens freudien du terme. Je précise aussi que l’écoute du chercheur dans cette approche, si elle est clairement d’orientation-psychanalytique, n’est pas celle de la cure, car elle vise essentiellement à engager un processus de compréhension des processus psychiques à l’œuvre dans la situation ordinaire d’enseignement ou de formation. Il ne saurait donc être question de l’établissement d’une sorte de « diagnostic psychologique » des personnes rencontrées. La proposition que je tente de soutenir est plutôt qu’à partir des travaux montrant que « le rapport au savoir de l’enseignant s’actualise de manière singulière pour chaque enseignant dans l’espace psychique de la classe » (Blanchard-Laville, 2001, p. 8), l’étude des relations subjectives que le professionnel entretient avec les structures propres à la pédagogie institutionnelle, à la fois dans sa classe et dans son groupe d’appartenance, peut contribuer à la description et à l’interprétation des liens institués et, par conséquent, des souffrances ou dynamiques qui en découlent dans la situation ordinaire d’enseignement.