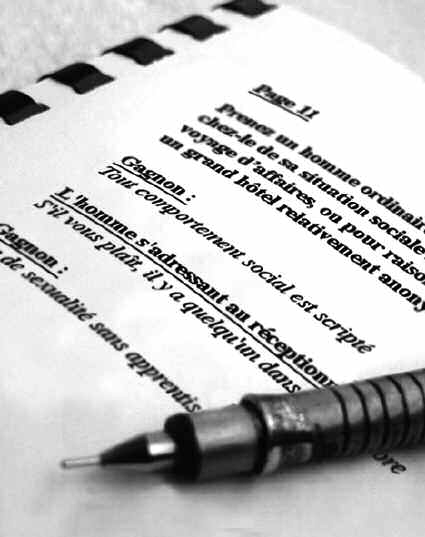Pour celui qui étudie la sexualité d’un point de vue anthropologique ou sociologique, ce qui est mon cas, la référence à la théorie des scripts sexuels est devenue incontournable. Celle-ci a été proposée par John Gagnon et William Simon au début des années 1970, puis élaborée tantôt par les deux auteurs ensemble, tantôt par l’un d’eux séparément (Gagnon 1977 et 2004, Simon 1996). Elle pose les principes théoriques pour une sociologie de la sexualité qui méritent de s’y arrêter, ne serait-ce que pour l’importance que certains lui accordent1. La théorie des scripts a l’ambition d’aller au-delà de Kinsey et de Freud. Pour la présenter, j’utiliserai l’exemple que Gagnon a donné à différentes reprises2. Je cite ici la version de 2004, dans la traduction française de 2008 (Gagnon, p. 60).
« Prenez un homme ordinaire de la classe moyenne, détachez-le de sa situation sociale habituelle et envoyez-le en voyage d’affaires, ou pour raisons professionnelles, dans un grand hôtel relativement anonyme. On peut même lui accorder un certain intérêt pour les aventures sexuelles. En retournant à l’hôtel le soir, il ouvre sa porte et là, dans la pénombre du couloir, il distingue une femme extrêmement séduisante et presque nue. On peut tout à fait penser que l’excitation sexuelle ne va pas être sa première réaction. Une petite minorité d’hommes – ceux qui sont un peu plus paranoïaques que les autres – vont tout d’abord chercher à identifier les signes de la présence de l’avocat de leur femme ou d’un détective privé. La majorité d’entre eux optera tout simplement pour une retraite embarrassée et précipitée. Même de retour dans le couloir et voulant vérifier le numéro de sa chambre, notre homme n’aura pas de réaction sexuelle. Il retournera plus probablement à la réception pour élucider le problème et utilisera le téléphone, qui est affectivement neutre. Dans cette situation, il manque un script efficace qui autoriserait cet homme à définir cette femme comme acteur érotique potentiel (le simple fait qu’elle soit séduisante ou presque nue n’est pas suffisant en soi) et la situation comme potentiellement sexuelle. Si ces deux éléments définitionnels avaient existé, la suite aurait pu être prévue avec exactitude. Mais sans un tel script, l’activité sexuelle ou l’excitation sexuelle ne sont guère probables. »
Une interprétation classique de l’événement n’aurait pas de difficulté à analyser la séquence : l’homme est séduit par la femme qu’il aperçoit (« il distingue une femme extrêmement séduisante ») mais son jugement de la situation l’empêche d’y répondre positivement, par exemple en engageant une conversation. Le désir contrarié s’exprime alors par une « retraite embarrassée et précipitée ». C’est un exemple banal de conflit entre désir et passage à l’acte, en l’occurrence arbitré au détriment du dernier. L’homme a jugé que la situation avait peu de chances de devenir sexuelle, il a coupé court au désir. Le contrôle de soi a fonctionné. Cette interprétation classique, reposant sur l’antagonisme entre désir et normes intériorisées et donnant un rôle important au contrôle de soi, est rejetée explicitement par Gagnon. Elle est remplacée par le constat laconique : il n’y a pas de sexualité, car « il manque un script efficace ». Pas de script donc pas de sexualité, ni contrôle, ni interdit, ni refoulement. L’antagonisme a disparu. En l’absence d’un script approprié, la situation n’est pas potentiellement sexuelle, il n’y a ni excitation sexuelle ni contrôle de celle-ci. Le script est producteur de sexualité. S’il n’en produit pas, il n’y a rien à contrôler.
Cependant, l’analyse que donne Gagnon de son propre exemple est plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord. « Même en combinant des éléments tels que le désir, l’intimité et une personne du sexe approprié et attirante physiquement, la probabilité que quelque chose de sexuel se produise restera extrêmement réduite si l’un ou les deux acteurs n’intègrent pas l’ensemble de ces conduites dans un script approprié. » (Gagnon, 2008, p. 59.)
Plus loin, toujours en analysant la même situation, il désigne les éléments mentionnés d’« ingrédients nécessaires à la survenue d’un événement sexuel » (ibid., p. 77). Et parmi les « ingrédients nécessaires », il compte bien le désir sexuel. Ingrédient nécessaire au départ, si celui-ci se transforme en fuite embarrassée, c’est que le script a failli dans sa mission de passer du désir à l’action. Le rôle du script est donc celui d’une interface entre les « ingrédients » et les actes, entre le désir et le passage à l’acte. À plusieurs reprises, Gagnon décrit le script comme une interface : « Le script est ce qui fait le lien entre le sentiment de désir et de plaisir ou de dégoût et de désintégration et les activités corporelles qui sont associées aux contacts physiques et aux signes physiques de l’excitation. » (Ibid., p. 78.) Gagnon semble donc rejoindre l’interprétation classique d’une instance intrapsychique évaluant, arbitrant et contrôlant plus ou moins efficacement le passage du désir à la réalisation. Et Gagnon situe bien l’origine de ce désir dans l’individu lui-même et non pas dans un quelconque script situationnel : « On peut même lui [l’homme] accorder un certain intérêt pour les aventures sexuelles. » Ainsi, dès la première présentation de la théorie des scripts, celle-ci montre une contradiction majeure : le script est défini comme instance de production de la sexualité, mais renvoie aussitôt à des pré-requis nécessaires, dont l’un est le désir sexuel lui-même.
Pluralité des scripts
Pour résoudre cette contradiction, et sauver le concept de script, Gagnon introduit la pluralité des scripts. Ils seraient de trois types : intrapsychiques, interpersonnels ou culturels. L’exemple de l’homme à l’hôtel s’interpréterait alors ainsi : l’homme possède des scripts intrapsychiques qui l’amènent à s’intéresser aux aventures sexuelles en général et à considérer que la femme en question est extrêmement séduisante. Mais il ne possède pas de script interpersonnel adéquat pour interpréter la situation comme potentiellement sexuelle. Ce que l’analyse classique interprète comme un conflit entre désir et passage à l’acte devient ici un conflit entre script intrapsychique et script interpersonnel. Nous serions porteurs de scripts plutôt que d’une libido. Quel est le gain théorique ? Dans ce qui suit j’essaierai de démontrer qu’il n’y a pas de gain, mais davantage une perte théorique, car le changement théorique est fondé sur deux suppositions qui me paraissent problématiques.
La première concerne la matière première des scripts. Celle-ci est culturelle et langagière. Son origine se trouve hors individu. Ce dernier est implicitement ramené à la coquille vide, la tabula rasa sur laquelle s’inscrivent, dès la naissance, les gestes et paroles significatifs. Un ordinateur né vide, que l’on remplit jour après jour avec des bouts de programmes culturels. Ceux-ci y inscrivent non seulement les normes et valeurs, mais aussi les désirs. Sans inscription, point de désir. La théorie du désir rejoint ici le phantasme des pensionnats, colonies pénitentiaires pour enfants et autres couvents pour jeunes filles : les adolescents n’auront pas de sexualité (pas de désir), si personne ne le leur apprend. « Pas de sexualité sans apprentissage » dit la théorie des scripts et ce n’est pas à prendre au sens figuré. Le désir sexuel étant le produit de scripts, et ceux-ci étant d’origine extra-individuelle, il n’y aura pas de sexualité tant que ceux-ci n’ont pas été implantés. Bien entendu, ce phantasme a toujours été voué à l’échec. Non pas parce que le contrôle sur l’apprentissage aurait failli, mais parce que la sexualité ne vient pas de l’extérieur, mais de l’intérieur. La culture, l’apprentissage ne font que modeler, ils ne créent pas la matière première. C’est là où la théorie des scripts rompt avec la théorie classique qui suppose un désir sexuel trouvant sa matière première (instinct, libido, énergie sexuelle… peu importe le nom) dans l’individu lui-même. C’est cette matière première qui fait de l’individu un acteur. Acteur formaté par la culture, certes, mais qui y apporte l’énergie du désir. Dans ce modèle, l’homme est une « machine désirante » plutôt qu’un ordinateur vide. Le modèle des scripts, en éliminant la notion de libido, nie toute matière première autre que les éléments culturels que la vie sociale apporte. L’homme n’est plus un acteur, mais un ordinateur plus ou moins bien programmé, dont le courant vient d’on ne sait où.
La deuxième supposition concerne le sens du mot « script ». En anglais, script (littéralement « écrit ») signifie aussi bien « récit » que « scénario » ou « programme » informatique (comme dans JavaScript). Le script en tant que récit rapporte une série d’événements qui ont déjà eu lieu. Dans le sens où toute conduite sociale peut donner lieu à un récit a posteriori, la théorie des scripts peut proclamer que tout comportement est scriptable. Mais quand elle dit, avec Gagnon (2008, p. 131) que « tout comportement social est scripté », elle utilise le terme script dans sa signification de « scénario » ou de « programme ». Le propre du scénario est qu’il est écrit avant l’action. Le scénario ne décrit pas, il prescrit. Et c’est bien dans le sens de scénario que l’on doit entendre la théorie des scripts. Pour elle, tout comportement social est écrit, est programmé d’avance. Pas de programme, pas de désir, d’action, ou de comportement social, on l’a vu plusieurs fois. Mais qui prescrit ? « L’individu est un dramaturge qui écrit son comportement pour faire face à la nature problématique des interactions. […] l’individu est à la fois le public, le critique et le correcteur. À l’interface entre l’interaction et la vie mentale, l’individu est un acteur, un critique et un dramaturge. » (Gagnon, 2008, p. 85.) Qui est cet individu ? Si tout est script, quelle instance est là pour arbitrer entre les fragments de script, pour juger, combiner et écrire ? En vue de quel objectif, si le désir n’est autre qu’un des scripts en concurrence ? Ayant aboli la notion de libido, ayant postulé le caractère langagier, culturel, et donc extra- individuel des scripts, rien ne permet plus d’asseoir l’individu. On le dit dramaturge, public, critique et correcteur, mais on l’a vidé de sa substance propre. Un dramaturge programmé, peut-il écrire des programmes ?
« L’utilisation du concept de script s’inscrit dans le courant cognitiviste… » (ibid., p. 84) nous annonce Gagnon.
Effectivement. Mais elle trouve son origine dans le behaviorisme des années 1950 (behavioral scripts) et est passée par la philosophie computationniste d’Hilary Putnam avant d’intégrer les sciences cognitives. Les deux suppositions sont cohérentes avec la vision behavioriste et cognitiviste de l’homme. Si celui-ci n’est autre qu’un vase rempli de programmes, son action se limiterait effectivement à sortir le bon fragment de programme, adapté à la situation et qui en prescrirait la suite. Il en prescrirait aussi les désirs et les sentiments. Et tant qu’il n’en a pas prescrit, ceux-ci n’existent pas. La théorie des scripts n’a pas seulement rayé le concept de libido, mais aussi celui d’inconscient. On les recherche en vain dans les écrits de Gagnon. Les présuppositions sont du domaine de la philosophie plus que de celui des sciences sociales. Il est impossible de prouver empiriquement la présence ou l’absence du désir ou même de l’acteur en dehors de la socialisation, c’est-à-dire en dehors de toute « programmation » culturelle. Il est également impossible de prouver ou de réfuter la thèse que toutes les actions sont écrites d’avance. Revenons une dernière fois à l’exemple de Gagnon. Imaginons que l’homme était rentré à l’hôtel fatigué – après tout, il est en voyage d’affaire – et désireux de se coucher. L’incident avec l’inconnue dénudée étant résolu, il finit par se coucher. Au lit, il repense sans-doute à l’incident. Il regrette peut-être ne pas avoir eu l’à-propos d’un Sean Connery quand il s’est trouvé face à face avec la femme. Cela aurait pu changer la suite des événements. Il imagine peut-être des propos qu’il n’a pas eus, face à la femme, face au réceptionniste, il rêve de scénarii alternatifs. Puis il s’endort. La théorie des scripts analyserait, à juste titre, ces rêveries comme un travail de réflexion et de réécriture du script, un entraînement dans la conception des scripts dont l’homme tirera peut-être profit une prochaine fois. La théorie classique serait entièrement d’accord mais poserait une question supplémentaire : pourquoi cet homme réécrit le script de telle manière ? Parce qu’il trouve cette femme séduisante. S’il avait été séduit par le réceptionniste plutôt que par la femme, ou ni par l’une ni par l’autre, les scénarii imaginés auraient certainement été différents. Le désir de cet homme, cet « ingrédient » préalable au script, ne reste pas extérieur au script. Il y pénètre et en définit les grands traits comme les moindres détails.
Et il y a plus. En arrivant à l’hôtel, l’homme désirait dormir. La suite des événements a été plus longue et complexe que prévue, mais il finit par se coucher et s’endormir. Là aussi, on a une séquence désir/script/passage à l’acte et en l’occurrence le script a réussi, il y a eu passage à l’acte. La théorie des scripts dirait peut-être que le désir de dormir comme le désir sexuel ne sont que des scripts, résultats de socialisation. Ce serait confondre le fond et la forme. Quoique formatés culturellement, la matière première des désirs est fournie par l’acteur lui-même. Et celle-ci ne renvoie pas à une lointaine origine que l’on pourrait reconnaître pour mieux oublier, elle est présente à tous les instants, elle dirige les « scripts » des traits principaux jusque dans les moindres détails. Si la forme a ses origines dans la culture, le fond a les siennes dans l’homme.