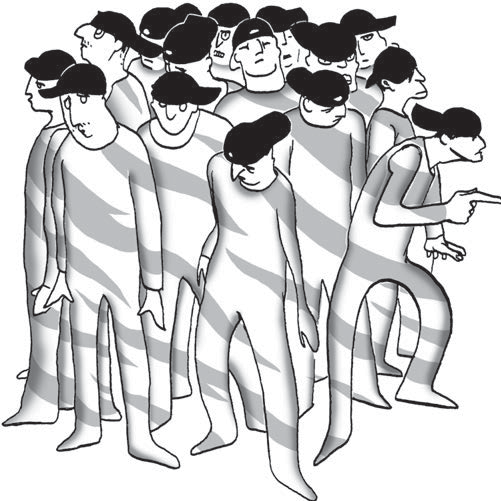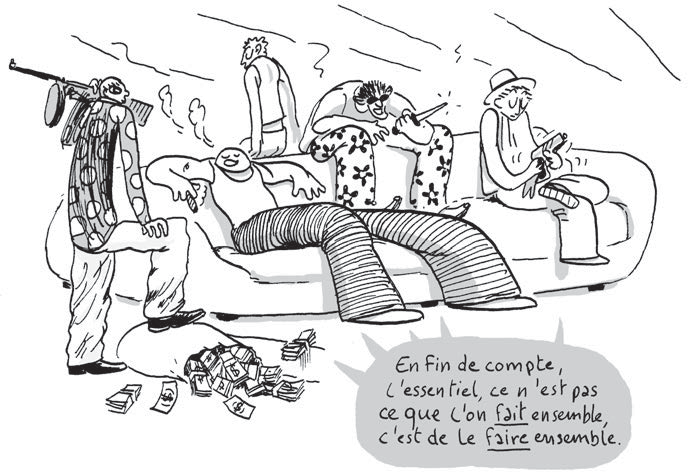Cette contribution trouve son origine dans une expérience de six mois en tant que psychologue-stagiaire auprès d’adolescents incarcérés dans le « quartier mineurs » d’une maison d’arrêt, dans le cadre d’une recherche de DEA en psychologie et psychopathologie clinique. Cette expérience a consisté essentiellement en la mise en place et la co-animation de groupes de parole ouverts aux adolescents incarcérés, avec deux infirmiers (un homme et une femme) du service médico-psychologique régional (SMPR), référents des soins psychiatriques proposés aux détenus mineurs. Un tel dispositif avait déjà été expérimenté auprès des adolescents pour s’interrompre quelques mois avant le projet qui nous concerne, suite à des « débordements » dans l’espace de groupe. Il s’agissait donc de prendre en compte l’expérience passée pour penser et construire un nouveau projet de groupe de parole auprès des adolescents incarcérés.
La mise en place d’un groupe de parole auprès d’adolescents incarcérés suppose certaines interrogations préalables à sa mise en pratique, ainsi que certains ajustements aux contraintes du quotidien carcéral.
La première difficulté consiste à prendre en compte les représentations recouvrées par la psychiatrie en prison, et les angoisses de folie qu’elle suscite chez les adolescents délinquants. L’intervention de deux infirmiers et d’une psychologue-stagiaire du SMPR au « quartier mineurs » pour la mise en place d’un groupe de parole fait rapidement peser un « soupçon de folie » sur le groupe, qui nécessite que le dispositif s’adapte au plus près des modes de figuration privilégiés des adolescents. Dans cette perspective, notre premier souhait aurait été d’utiliser le monde des images – qui correspond si bien au monde adolescent, sous forme de séquences choisies de reportages à discuter en groupe. Les contraintes matérielles pénitentiaires nous ont imposé le deuil de ce premier projet. Après quelques séances où nous mettons quelques images ou revues à disposition des adolescents afin de les commenter en groupe, nous sommes vite amenés à reconnaître que ces supports ne facilitent pas les échanges de groupe, mais ont plutôt tendance à révéler l’emprise de l’un ou de l’autre sur le support, et son isolement du reste du groupe. Nous sommes alors amenés à mettre en place un petit groupe de discussion non directive sur le mode de la conversation. L’animateur occupe ici une position active, s’investit dans le jeu de parole avec les adolescents, en laissant libre cours à ses propres associations.
Jérôme Dupré-Latour
En tout état de cause, la fréquence des mouvements des adolescents entre l’extérieur et l’intérieur de la maison d’arrêt (courte durée des peines, transferts dans d’autres maisons d’arrêt) rend impossible la perspective de proposer un groupe « fermé », d’inscrire les groupes de parole dans la durée. La place du soignant est ici limitée par le fonctionnement pénitentiaire, en ce qui concerne le temps et les lieux qui lui sont attribués. Nous proposons donc un groupe de parole ouvert à tous les adolescents incarcérés, sans obligation ni indication de participation. Nous décidons de constituer des groupes de six adolescents au plus. Nous devons par ailleurs nous en remettre aux surveillants pour la constitution des groupes, qui devra éventuellement se calquer sur celle des groupes de promenade, en fonction des incompatibilités de rencontre entre certains adolescents. Nous définissons quelques consignes : parler de ce que l’on souhaite, essayer, quand on décide d’assister à une séance, de rester jusqu’au bout des 45 minutes, éviter de fumer, écouter celui qui s’exprime. Ces règles, aussi modestes soient-elles, représentent une contrainte importante pour les adolescents délinquants, ce qui implique leur transgression sans réponse de l’ordre d’une sanction.
Les sujets de conversation apportés en groupe par les adolescents tournent souvent autour de la violence et des rapports au même et au différent.
La violence entre les adolescents en détention interpelle, surprend le candide qui imagine que la loi règne dans les murs. Cette violence apparaît quasiment organisée dans le groupe, les positions au sein du groupe restant fixes ; certains occupent une position d’« agresseurs » ou de « leaders violents », tandis que les autres sont stigmatisés comme « victimes », ou encore « tricards » pour utiliser le même vocable que les adolescents.
Les violences que font subir les uns aux autres consistent surtout en actes d’humiliations, commis à plusieurs contre un seul : menaces, racket, déshabillages forcés dans la cour de promenade, brûlures, coups portés à plusieurs sur la victime, ce que les adolescents appellent « faire une boulette »… Les sujets cibles d’agressions évitent de rencontrer leurs agresseurs lors des séances de groupe, de la même façon qu’ils se privent parfois de promenade ou de douche pour ne pas à avoir subir ces rencontres.
Les auteurs de violence ne se cachent pas de ces actes qu’ils considèrent comme allant de soi, ils appellent leurs « victimes » les « tricards », disent qu’ils « mettent » certains adolescents « tricards ». (« tricard ou triquard : interdit de séjour, refusé d’un lieu1. »)
Les premières violences sont souvent mises en lien avec l’origine ou le délit de la victime : les adolescents d’origine gitane, les adolescents venant d’autres régions, les adolescents pour lesquels il s’agit d’une première incarcération, ou incarcérés pour affaires de mœurs sont plus particulièrement les cibles de ces actes de violence. L’escalade violente se déploie ensuite envers l’adolescent qui ne connaît pas vraiment les règles de la rue et de la prison, qui ne se défend pas la première fois, ou encore qui montre trop sa « fragilité » face à l’incarcération. Les auteurs s’accordent à dire que les « tricards » sont « ceux qui ne se défendent pas, qui font les malins à l’extérieur mais se comportent en prison comme des “tapettes” », comme tel adolescent qui « pleure comme une fille quand il se retrouve dans la cour de promenade en calbut ». « C’est la règle, c’est comme ça, c’est normal, ceux-là n’ont rien à faire en prison, comme ça ils ne reviendront pas. »
Il est impossible pour les violents comme pour leurs victimes d’accepter d’être qualifié de « tricard », le terme recouvre une connotation d’insulte pour les uns comme pour les autres. Quand on essaie de faire travailler cette question en groupe, les adolescents se défendent contre l’idée que nous proposons qu’il est sans doute arrivé à chacun d’entre nous d’être « nouveau » dans un groupe, ou de se sentir différent, ou encore de ne pas être en possibilité de se défendre d’autrui. Ils refusent massivement d’avoir pu connaître des vécus semblables d’exclusion, ou de passivité.
Entre les adolescents qui agressent les autres, existe aussi une violence qu’ils considèrent ludique, voire occupationnelle. Ils disent ainsi qu’ils « aiment quand il y a de l’ambiance, de l’action, au quartier mineurs », qu’ils se battent pour « passer le temps », parce qu’il n’y a pas d’autre occupation, surtout depuis qu’a été supprimé l’« enquillage » (c’est-à-dire la possibilité des uns d’aller visiter les autres dans leurs cellules) et le sport en commun avec les majeurs. Il n’y alors plus d’agresseur ou de victime dans ces échanges violents, seulement un goût commun pour la violence, qui leur permet de rire ensemble du coup de lame que l’un a porté au visage de l’autre. Ces « jeux » violents entre les adolescents peuvent être rapprochés de ce qu’ils racontent sur les amusements des « grands frères » dans les quartiers, qui selon eux n’hésitent pas à lâcher les chiens sur les plus jeunes « pour jouer », ou à leur mettre des « coups de lame pour s’amuser ». On comprend ici que la dimension de jeu ne peut être reconnue par un observateur extérieur : il n’y a pas d’agir semblant, le coup est porté, non mimé.
Comment comprendre ces phénomènes de violence organisés au sein du groupe d’adolescents ? Plusieurs pistes de réflexion peuvent être interrogées.
Tout d’abord, la haine développée entre les différents sous-groupes de minorités ethniques différentes nous rappelle ce que Freud (1981, p. 163-164) appelle le narcissisme des petites différences. La violence dans le groupe peut alors être comprise comme un rituel d’initiation, elle apparaît comme une mise à l’épreuve des capacités de la victime à appartenir à un groupe qui ne tolérerait aucune « petite différence », un groupe pour lequel tout signe d’altérité pourrait être menaçant.
La violence correspondrait alors à un rituel d’initiation, d’admission dans le groupe, un rituel de passage de l’extérieur à l’intérieur du « quartier mineurs », et même un rituel de passage de l’enfance à l’âge adulte. Dans ce sens, certains des adolescents parlent de « baptême » pour désigner ces violences.
Les adolescents témoigneraient ainsi du manque de régulation de la violence sociale générée par l’absence de rituels de passage dans notre société, ainsi que de la recherche de rites substitutifs. O. Douville (1999) souligne cependant que ces rituels permettant de canaliser la violence de l’adolescent n’opèrent qu’au sein de sociétés violentes.
On peut alors penser que le groupe d’adolescents reconstitue ici un rituel pour accéder à une identité sociale violente. L’identification aux « grands frères », de même qu’aux détenus majeurs – souvent mis en avant par les adolescents – confirme encore l’idée de l’initiation propre au rituel. Le rituel s’inscrit ici dans une compulsion de répétition pathologique. Une loi déviante imparable et collective se substitue ici à la loi sociale majoritaire, l’inversion des valeurs, des jugements bon/mauvais socialement admis étant de rigueur : la nécessité de « mériter » son identité délinquante, sa place en prison, est ici prégnante. Il semble même que le passage en prison constitue en quelque sorte une étape incontournable pour l’initiation de l’adolescent à la tradition délinquante. Nous entendons le fantasme d’auto-engendrement inscrit dans cette idéologie de la marginalité, constituée de conduites et de règles précises antinomiques aux règles sociales admises. L’idéal de toute-puissance porté par le groupe prive alors le sujet de tout sentiment de culpabilité.
On comprend que, dans cette organisation, les limites du groupe viennent en quelque sorte supplanter les limites de l’adolescent, en quête de repères identitaires et identificatoires. L’espace psychique de l’adolescent s’élargit ainsi à celui du groupe.
Notons par ailleurs que la violence d’un groupe envers certains adolescents s’aggrave lors des périodes de surpopulation dans le « quartier mineurs ». Nous pouvons alors penser que la mise en péril du narcissisme individuel, le sentiment de perte de limites, s’avèrent d’autant plus importants que le groupe est grand : certains adolescents adopteraient une position violente pour s’en défendre et constitueraient ainsi un sous-groupe de « pairs » violents, à l’image d’un ou de plusieurs leaders.
Après avoir interrogé la dimension d’initiation dans ces phénomènes violents entre adolescents, il faut nous arrêter un peu sur la fonction que le bouc-émissaire endosse pour le groupe.
On peut en effet se demander si le groupe d’adolescents ne serait pas à la recherche – de victimes sacrificielles – pour reprendre le terme de R. Girard, victimes sacrificielles sur lesquelles le groupe transfert la violence destinée aux siens, le « tricard » apparaît comme la figure où le sujet et le groupe peuvent destiner leur haine. Cette tentative d’exclusion de mauvais objets persécuteurs configure l’organisation la plus rudimentaire du groupe, conceptualisée selon le phénomène du bouc émissaire. Je cite D. Anzieu (1999, p. 85) : « Pour que le groupe puisse devenir un bon sein introjecté, il faut qu’il trouve un mauvais objet sur lequel le transfert négatif clivé soit projeté. »
Notons que les victimes à la fois intruses et exclues du groupe, occupent en son sein une position d’entre-deux. Je cite J.-B. Chapelier (2000, p. 8) : « On comprend que le bouc-émissaire soit dans une position intermédiaire. En effet, il est dans le groupe, car nécessaire à sa première organisation, et hors du groupe comme support des projections de ce dernier. »
Quelle partie clivée du sujet et du groupe est-elle projetée sur la figure du « tricard » ?
Il apparaît ici que le tricard est un représentant de la passivité, passivité qui correspond ici à la seule définition du féminin pour ces adolescents, passivité qui correspond aussi aux tendances homosexuelles contre lesquelles les adolescents luttent par le recours à l’agir.
En se défendant de tout mouvement de compassion ou d’identification aux victimes, il semble que les sujets manifestent la façon dont le lien à elles fait menace. La partie clivée du Moi individuel et groupal, dont les adolescents cherchent à se débarrasser dans la figure du « tricard », apparaît ici comme la partie « faible » ou « fragile » du sujet et du groupe, celle qui souffre et pourrait manifester sa souffrance dans l’affect (« pleurer »), celle qui correspond pour nos sujets à la position passive homosexuelle (« tapette », « qui ne se défend pas »), représentant pour l’adolescent un objet avec lequel le rapport homosexuel serait possible. On peut souligner ici les connotations violentes mais aussi sexuelles auxquelles renvoit le terme de « tricard », qui trouve son origine dans le mot « trique ».
Le masculin se résout ici à l’activité et à la domination, et le féminin à la passivité et à la soumission (« pleurer comme une fille »). Selon D. Marcelli et A. Braconnier (1995, p. 88) : « La peur de la passivité, renvoyant à la soumission infantile et aux tendances homosexuelles amène les adolescents à se servir de l’action (et de l’affirmation de soi) pour nier cette passivité. »
Les écrits de P. Jeammet mettent aussi en évidence la façon dont l’agir intervient dans le processus adolescent comme une défense face à l’« être agi ».
On devine ainsi le jeu de miroir établi entre les « victimes » et la partie clivée du groupe violent. Tout se passe comme si le sujet rencontrait dans l’autre de la réalité extérieure une partie de la réalité intérieure à contrôler, à maîtriser. Cette collusion entre réalité externe et réalité psychique, vécu comme une intrusion, mènerait le sujet à l’agir violent, pour rétablir la différenciation soi/non-soi dans le contact corporel violent et pour contrôler dans l’autre sa partie clivée. Cette analyse nous amènerait à considérer la victime comme simultanément porteuse et dépositaire de la partie clivée de l’agresseur et du groupe auquel elle appartient.
Quels dispositifs de groupe proposer à ces adolescents pour les aider à « coexister » en milieu fermé ? Comment amorcer un travail de contenance et de transformation de la violence des adolescents ? À l’issue de cette expérience, ces questions restent ouvertes ; cependant les relations entretenues entre groupe d’adolescents et animateurs apparaissent comme les leviers de processus identificatoires et de processus de différenciation que l’on pourrait qualifier de « pré-thérapeutiques ».
Jérôme Dupré-Latour
Dans l’expérience qui nous concerne, il me semble que le choix d’un trio d’animateurs, inscrit dans la différence des sexes et des générations, répondait aux besoins de diffraction du transfert du groupe d’adolescents : nos présences respectives dans cet espace de groupe venaient en effet réactiver les questions du paternel, du maternel et du féminin. La capacité des animateurs à endosser – dans le groupe et par la parole – la fonction de bouc-émissaire nous est également apparue comme un préalable à la restauration de la parole en lieu et place de l’agir. La reprise dans l’« après-coup » des séances aux côtés d’un tiers extérieur au groupe – en l’occurrence la psychologue du SMPR, s’imposait enfin pour entretenir une dynamique de compréhension, et élaborer nos vécus d’impuissance, de sidération ou de révolte face à la violence des adolescents.
Ces différents éléments du dispositif ont sans doute contribué à ce que, par la suite, les groupes de parole puissent s’inscrire dans la durée et la régularité au « quartier mineurs », au-delà des départs/arrivées de différents animateurs.