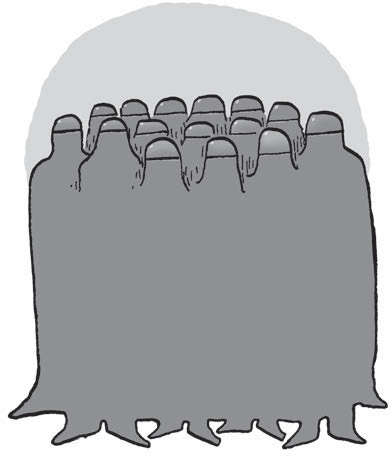« Le groupe primaire est l’espace et le processus où le Je peut advenir, à la condition que le sujet, ayant noué et contracté dans ce groupe les alliances structurantes nécessaires à la formation de sa vie psychique, quitte ce groupe et, dans le mouvement d’une nouvelle affiliation mette en jeu, pour pouvoir se les approprier, les enjeux de sa filiation. »
(R. Kaës, Un singulier pluriel, Dunod, 2007, p.XV)
Canal Psy : M. Kaës, pour présenter votre dernier ouvrage à nos lecteurs, voulez-vous nous expliquer votre choix du titre et du sous-titre : Un singulier pluriel, la psychanalyse à l’épreuve du groupe ?
René Kaës : Cet ouvrage m’a été demandé à la suite d’une « leçon » que j’avais été invité à donner au Congrès de l’IPA (Association Psychanalytique Internationale) en mars 2004 à la Nouvelle-Orléans. Le thème de ce congrès était « La psychanalyse et ses frontières ». C’était un événement pour moi, et pour tous ceux qui s’occupent de comprendre en quoi consiste la réalité psychique dans les groupes et comment elle fonctionne, que de disposer d’un temps suffisant pour exposer en quoi la psychanalyse est concernée par ces recherches. J’ai voulu présenter et soutenir l’idée que ces recherches ont une incidence sur le champ de la pratique psychanalytique généralement définie depuis Freud par la pratique de la cure individuelle. Elles ont aussi une incidence sur la définition de ses objets théoriques et par conséquent sur les constructions qu’elle élabore pour rendre compte de l’inconscient et de ses effets dans l’organisation de la vie psychique d’un sujet considéré dans la singularité de sa structure et de son histoire.
Mon propos n’était pas de parler de la psychothérapie psychanalytique de groupe ou par le moyen du groupe. Les psychanalystes connaissent ces pratiques. Mon propos était de montrer comment ces pratiques nous apprennent quelque chose d’essentiel sur la réalité psychique inconsciente commune et partagée par plusieurs sujets lorsqu’ils participent à un espace intersubjectif, dans toutes les configurations de lien dont ils sont parties constituées et parties constituantes : couple, famille, groupes et institutions.
Depuis plus de quarante ans, j’essaie de décrire et de rendre intelligible les relations complexes qui articulent, distinguent et opposent l’espace intrapsychique, celui du sujet singulier, et celui de ces espaces pluriels, organisés par des processus et des formations psychiques spécifiques.
Dans cet ouvrage, qui forme une suite à d’autres travaux (Le groupe et le sujet du groupe, La polyphonie du rêve, parmi les plus récents), je me suis placé du point de vue où je pouvais mobiliser l’attention des psychanalystes – et plus largement des psychologues cliniciens et des psychothérapeutes habituellement centrés sur le sujet « individuel ». À mes yeux, ce sujet est un sujet « singulier pluriel ». Il se construit dans la pluralité des liens par lesquels il se forme, et cette situation « groupale » du sujet en fait un sujet du groupe, en conflit et en construction entre la « nécessité d’être à soi-même sa propre fin », comme le dit Freud, et les exigences de travail psychique que lui impose le fait qu’il est sujet du groupe, qu’il en procède, qu’il en hérite et qu’il en sert les intérêts.
Je porte cette idée du singulier pluriel depuis de nombreuses années – depuis le début des années 1980 – lorsque j’ai commencé à remettre sur le métier la notion de groupe interne que j’avais construite avec le modèle de l’appareil psychique groupal, dix ans auparavant, pour l’élargir à celle de groupalité psychique. En travaillant sur le concept d’alliances inconscientes comme fondement de l’intersubjectivité, j’ai retrouvé cette manière de formuler cette idée. Je la crois cliniquement pertinente pour rendre compte de cette tension entre la pluralité et la singularité qui soutient nos identifications, nos fantasmes, nos rapports à l’autre.
Peut-être vaudrait-il mieux dire « un pluriel singulier », car nous accédons au Je qui nous singularise à travers un long processus d’intégration de la pluralité, et ce processus reste inachevé. C’est une richesse de notre vie psychique qu’il ne s’achève pas. C’est à cette pluralité que nous devons d’éprouver, comme le disait Artaud, « les innombrables états de l’être ». Mais pour l’éprouver il est nécessaire que se singularise notre rapport à nous-mêmes, aux autres et aux groupes qui les contiennent. Une part de notre capacité de symboliser et de créer tient à cette tension irrésolue, mais suffisamment acceptable entre le singulier et la pluralité.
Voilà pourquoi j’ai choisi ce titre, et que le sous-titre précise : « La psychanalyse à l’épreuve du groupe ». La psychanalyse a déjà connu d’autres « épreuves », lorsque les psychanalystes ont commencé à conduire des cures avec des enfants, puis avec des patients psychotiques. On a d’abord considéré que c’étaient là des applications de la psychanalyse, mais pas de la psychanalyse. La psychanalyse a toujours travaillé en intensité sur l’espace intrapsychique et en extensivité sur ses frontières. Cette fois, avec le groupe, nous changeons de modèle de l’appareil psychique, car nous avons à penser les relations entre le sujet singulier et la réalité de l’ensemble qu’il forme avec d’autres, et dont il se forme, pour une part qu’il nous reste à découvrir. Cette épreuve est aussi une mise à l’épreuve de sa capacité de se renouveler. Mais pour que cette épreuve soit féconde, il faut être exigeant sur la méthode et sur les concepts, il faut rendre compte de la manière dont se construit notre connaissance de l’inconscient. C’est pourquoi j’attache une grande importance à l’épistémologie de la psychanalyse.
Jérôme Dupré-Latour
C. P. : Vous abordez la notion d’intersubjectivité, du point de vue dynamique, comme une exigence de travail psychique. Faites-vous ici allusion au travail psychique nécessaire au maintien du lien groupal ?
René Kaës : Oui, mais la question est beaucoup plus vaste et plus complexe. En résumant ce que j’ai dit jusqu’à présent, je dirais que mon travail a été de tenter une articulation entre la réalité psychique du groupe et celle du sujet singulier pour essayer de rendre compte de la part que celui-ci prend à la formation de celle-là, et de la manière dont le sujet se forme dans l’intersubjectivité comme sujet de l’inconscient.
C’est là une raison pour les psychanalystes de se sentir concernés par l’approche psychanalytique du groupe et du sujet dans le groupe, car elle apporte une contribution substantielle à la problématique de l’intersubjectivité. Aujourd’hui, la question de l’intersubjectivité intéresse de nombreux psychanalystes contemporains, mais elle les oppose selon leurs traditions culturelles et leurs références théoriques.
Je rappelle que le concept de l’intersubjectivité a d’abord été construit avec les problématiques philosophiques et psychologiques de la conscience et du sujet dans ses rapports avec la reconnaissance d’autrui. Les sources d’inspiration de ces problématiques sont diverses, elles sont issues de la phénoménologie, de la linguistique de l’énonciation, de la psychologie de l’interaction (avec G.-H. Mead), de l’ethnologie. Ces approches modernes ont des antécédents bien connus dans la philosophie dialectique de Hegel et la phénoménologie de Husserl, puis dans les philosophes de la reconnaissance et de la réciprocité avec notamment Buber et Levinas. Cette intuition d’une différence interne, d’un écart de soi à soi au cœur du sujet contient les prémisses de la moderne sentence de Rimbaud : « Je est un Autre. » Formule assurément intrasubjective, qui dévoile un sujet divisé, mais qui reste à conjuguer avec un contrepoint nécessaire pour fonder toute réciprocité intersubjective : l’expérience que Je est un Autre se fonde dans cette expérience préalable que l’Autre est un Je pour un autre Je. On peut à juste titre considérer que cette réciprocité, symétrique ou asymétrique, est une acquisition tardive, et dans l’espèce et pour chaque sujet. Il reste que cette conception de l’altérité qui passe par les vicissitudes de l’altérité interne définit l’intersubjectivité d’une manière beaucoup moins opératoire que celle de l’interactionnisme nord-américain, qui renvoie pour l’essentiel à des boucles de comportements ou, avec Stolorow et Atwood, au contextualisme.
Dans le champ de la psychanalyse post-freudienne, plusieurs théories de l’intersubjectivité coexistent. Dans la suite du post-hégélianisme, Lacan a été l’un des premiers à en introduire la notion en privilégiant ses effets d’aliénation sur un sujet essentiellement assujetti au désir de l’autre, celui-ci n’étant qu’un représentant inadéquat du grand Autre. Lacan ne décrit la réalité psychique qui se produit dans et par le lien intersubjectif que pour en retenir la consistance imaginaire. Sa critique du groupe en est la conséquence.
J’utilise cette notion dans son sens et son contexte européens, mais avec la psychanalyse et en ne suivant pas sur ce point Lacan, et s’il me faut donner une référence d’inspiration, je la trouve plutôt chez P. Castoriadis-Aulagnier1. J’entends par intersubjectivité non pas un régime d’interactions comportementales entre des individus qui communiquent leurs sentiments par empathie, mais l’expérience et l’espace de la réalité psychique qui se spécifie par leurs rapports de sujets en tant qu’ils sont sujets de l’inconscient. L’intersubjectivité est ce que partagent ces sujets formés et liés entre eux par leurs assujettissements réciproques – structurants ou aliénants – aux mécanismes constitutifs de l’inconscient : les refoulements et les dénis en commun, les fantasmes et les signifiants partagés, les désirs inconscients et les interdits fondamentaux qui les organisent.
Pour prendre en considération l’ensemble des processus et des formations de l’intersubjectivité, il faut avoir recours à une autre logique des processus psychiques. À une logique des processus et des formations internes, il est nécessaire d’articuler une logique des corrélations de subjectivités, une logique de la conjonction et de la disjonction, dont la formule pourrait être énoncée de la manière suivante : « Pas l’un sans l’autre et sans l’ensemble qui les constitue et les contient ; l’un sans l’autre, mais dans l’ensemble qui les réunit. » Cette formule soutient que nous ne pouvons pas ne pas être dans l’intersubjectivité. Cela signifie que le sujet se manifeste et n’existe que dans sa relation à l’autre, et j’ajoute : à plus d’un autre. Cela signifie aussi que la voie du « devenir Je », du Ich werden freudien, tout comme les butées et les impasses de ce devenir, est tracée dans la relation intersubjective avec l’autre : ceci est vrai pour l’enfant, pour le devenir homme et le devenir femme, pour le devenir père et le devenir mère.
L’intersubjectivité n’est pas seulement la partie constitutive du sujet tenue dans la subjectivité de l’autre ou de plus d’un autre. Elle se construit dans un espace psychique propre à chaque configuration de liens. Cela revient à dire que la question de l’intersubjectivité consiste dans la reconnaissance et l’articulation de deux espaces psychiques partiellement hétérogènes dotés chacun de logiques propres.
Entendue dans ce registre, la problématique de l’intersubjectivité nous ouvre l’accès à des souffrances psychiques et à des formes de la psychopathologie contemporaine qui ne peuvent être comprises, analysées et soulagées que d’être articulées avec les valeurs et les fonctions qu’elles ont prises ou qu’elles continuent de prendre pour un autre, pour plusieurs autres et finalement pour le groupe dont le sujet est partie constituée et partie constituante.
En résumant ma position, je dirai que la problématique de l’intersubjectivité ouvre une question centrale de la psychanalyse : elle concerne les conditions intersubjectives de la formation de l’inconscient et du sujet de l’inconscient. Dans ces conditions, j’appelle intersubjectivité la structure dynamique de l’espace psychique entre deux ou plusieurs sujets. Cet espace comprend des processus, des formations et des expériences spécifiques, dont les effets infléchissent l’avènement des sujets de l’inconscient et leur devenir Je au sein d’un Nous. Selon cette définition, nous sommes très éloignés d’une perspective qui réduirait l’intersubjectivité à des phénomènes d’interaction.
Notre statut dans l’intersubjectivité nous impose en effet un certain travail psychique. La notion d’exigence de travail psychique est indiquée par Freud lorsque, envisageant la question de la pulsion sous l’angle de la vie psychique, il écrit : « “La pulsion” nous apparaît comme un concept limite entre le psychique et le somatique, comme un représentant psychique des excitations émanées de l’intérieur du corps et parvenu dans l’âme, comme la mesure de l’exigence de travail imposée au psychique par suite de sa corrélation avec le corporel ». J’ai souvent cité ce texte pour argumenter qu’un certain travail psychique est exigé par la rencontre avec l’autre, pour que les psychés ou des parties de celles-ci s’associent et s’assemblent, pour qu’elles s’éprouvent dans leurs différences et se mettent en tension, pour qu’elles se régulent.
Je distingue quatre principales exigences de travail psychique imposées par le lien intersubjectif ou les conjonctions de subjectivité. La première est l’obligation pour le sujet d’investir le lien et les autres de sa libido narcissique et objectale afin de recevoir en retour de ceux-ci les investissements nécessaires pour être reconnu comme sujet membre du lien. Cette exigence de travail se forme sur le modèle du contrat narcissique décrit par P. Castoriadis-Aulagnier (1975).
La deuxième exigence est la mise en latence ou le renoncement ou l’abandon de certaines formations psychiques propres au sujet. Freud avait indiqué en 1921 que le Moi doit abandonner une partie de ses identifications et de ses idéaux personnels au profit d’idéaux communs et en échange des bénéfices attendus du groupe et/ou du chef. Tout lien impose des contraintes de croyance, de représentation, de normes perceptives, d’adhésion aux idéaux et aux sentiments communs. Être dans l’intersubjectivité n’implique pas seulement que certaines fonctions psychiques soient inhibées ou réduites et que d’autres soient électivement mobilisées et amplifiées. On doit admettre une exigence de non-travail psychique, des abandons de pensée, des effacements des limites du moi, ou d’une partie de la réalité psychique qui spécifie et différencie chaque sujet. C’est le cas des groupes sectaires et des groupes idéologiques. Nous devons admettre que des processus d’auto-aliénation sont mis au service de ces exigences groupales.
On parle beaucoup aujourd’hui d’une troisième topique, ce fut un thème majeur du dernier Congrès des psychanalystes de langue française. En fait « topique » est une métonymie de « métapsychologie » ou d’« appareil psychique ». Le débat qui s’engage prend essentiellement en compte les termes des relations entre la configuration du monde interne d’un sujet et les relations qu’il a entretenues avec les premiers autres, les parents, la famille. Le point de vue est centré sur l’individu. C’est normal puisque la pratique de référence est celle de la cure individuelle. À partir du moment où l’on travaille avec un dispositif pluri-subjectif, où l’espace psychique qui s’y développe est celui d’une réalité psychique spécifique, commune et partagée, cette troisième topique inclut aussi cet espace entre les sujets, intersubjectif. C’est celui que j’ai modélisé dans mes premières recherches sous le nom d’appareil psychique groupal. La troisième topique que j’expose dans Un singulier pluriel contient une articulation entre la réalité psychique du groupe et celle du sujet singulier. Je pense que, de cette manière, il est possible – il est devenu nécessaire – de rendre compte de la manière dont le sujet se forme dans l’intersubjectivité comme sujet de l’inconscient, et de la part que celui-ci prend à la formation de celle-là.
Canal Psy : Est-ce en ce sens que les « alliances inconscientes » ont une fonction structurante pour le groupe ?
René Kaës : En effet. La troisième exigence relève de la nécessité de mettre en œuvre des opérations de refoulement, de déni ou de rejet pour que les conjonctions de subjectivité se forment et que les liens se maintiennent. Ces opérations ne concernent pas seulement les appuis méta-défensifs que les membres d’un groupe peuvent trouver dans celui-ci, comme E. Jaques l’a jadis montré. Elles concernent toute configuration de liens qui assure et entretient les dispositifs métadéfensifs nécessaires à son auto-conservation et à la réalisation de ses buts. Elles sont donc à la fois requises par le lien et par les intérêts personnels que les sujets trouvent à les contracter. Tels sont le statut et la fonction des alliances inconscientes défensives. Ces alliances sont les processus producteurs de l’inconscient actuel dans le lien, elles forment ses nœuds névrotiques et psychotiques, et pour cet ensemble de raisons, elles sont les pièces majeures de la formation de la réalité psychique propre à une configuration de lien.
La quatrième exigence s’articule avec les interdits fondamentaux dans leurs rapports avec le travail de civilisation (Kulturarbeit) et les processus de symbolisation. Freud a insisté sur la nécessité du renoncement mutuel à la réalisation directe des buts pulsionnels pour que s’établisse une « communauté de droit » garante des liens stables et fiables. Le résultat de cette exigence est les alliances inconscientes structurantes, dans la catégorie desquelles nous comptons le contrat narcissique, le pacte entre les Frères et avec le Père et le contrat de renoncement mutuel. Le résultat de cette exigence de travail est la formation du sens, l’activité de symbolisation et d’interprétation, mais aussi la capacité d’aimer, de jouer, de penser et de travailler.
Ces quatre exigences concourent à la création d’un espace psychique commun et partagé. Considérées du point de vue du sujet auquel elles sont imposées, ces exigences sont structurantes et conflictuelles. La conflictualité centrale se situe entre la nécessité d’être à soi-même sa propre fin et celle d’être un sujet dans le groupe et pour le groupe. En accomplissant ce travail psychique, les membres d’un groupe s’attribuent ou reçoivent en échange des bénéfices et des charges. Une balance économique s’établit, en positif ou en négatif, sur ce qu’ils gagnent et sur ce qu’ils perdent à satisfaire ces exigences.
D’une certaine manière, nous n’avons pas le choix de nous soustraire à ces exigences : nous devons nous y soumettre pour entrer dans un lien et pour exister comme sujet. Mais nous avons aussi à nous en dégager, à nous en délier chaque fois que ces exigences et que les alliances qui les scellent servent notre auto-aliénation et l’aliénation que nous imposons aux autres, le plus souvent à l’insu de chacun. Je pense que c’est dans cette perspective que nous pourrions définir le champ pratique du travail psychanalytique en situation de groupe.
Canal Psy : Qu’est-ce qui a guidé votre choix du tableau La vocation de Saint Mathieu, du Caravage, pour illustrer la couverture du livre ?
René Kaës : Il y a tout d’abord que j’aime l’œuvre du Caravage et tout particulièrement ce tableau. Il ne se passe pas de voyage à Rome que je n’aille admirer la vocation de Saint Mathieu à Saint Louis des Français, puis les toiles de Santa Maria del Popolo.
Il y a dans La vocation de Saint Mathieu une dramatisation de la rencontre qui bouleverse une vie, qui la révèle à elle-même, qui fait de celui qui se sent appelé un nouveau sujet que l’appel, on pourrait dire le désir d’un autre, fait se lever et le suivre, comprenant sans doute après coup le sens et les enjeux de cette « vocation ».
On peut bien sûr être sensible à la dimension religieuse de cette représentation. Mais je pense que ce qu’elle nous propose est d’une autre nature que religieuse, c’est de l’ordre de l’imprévisible et de la force d’une rencontre, dont le sujet appelé ne peut que pressentir assez fortement qu’elle aura pour lui une valeur décisive. Comme dans une rencontre amoureuse, comme dans la rencontre avec une œuvre, une pensée.
Jérôme Dupré-Latour
Canal Psy : Certaines configurations familiales perçoivent parfois le processus de subjectivation des membres qui la composent – induit par « l’appel » – comme une menace pour l’identité commune. Comment soutenir ce mouvement psychique dans ces cas de figure paradoxaux ?
René Kaës : Je pense que Laing et Esterson ont le mieux décrit ce qui se passe avec les familles qui se sentent menacées lorsqu’un de ses membres rompt avec la culture familiale, ou plus exactement avec l’image de la famille interne commune à tous les membres de la famille. Laing parle de co-inhérence à propos des familles psychotiques, ce qui est un cas de figure de ce que j’ai appelé un appareillage psychique isomorphique : dans ce cas, l’espace commun est isomorphe à l’espace interne des membres de la famille, du couple ou du groupe, il a la même « forme », c’est-à-dire, le même contenu et le même agencement interne. L’appel de la famille ne supporte aucun autre appel. Le sujet ne peut avoir accès à sa singularité, faute d’une séparation acceptable et d’une pluralité assimilable. Évidemment, dans ce cas, aucun processus de subjectivation n’est possible, il menace de dislocation toute la famille et chacun de ses membres. C’est en effet une menace pour l’identité commune, mais aussi pour le devenir de l’identité de l’enfant ou de l’adolescent. Le contrat narcissique s’est mué en pacte léonin, aliénant, mortifère.
Nous connaissons ces familles où, pour un adolescent ou un jeune adulte, ne pas s’engager à la lettre dans la vocation professionnelle d’un parent est un véritable drame. J’ai connu des jeunes gens qui rencontraient un problème identique parce qu’ils voulaient devenir psychologues, bien qu’aucun parent ne le fût…
Le mouvement psychique à soutenir est celui de la séparation et de l’appropriation de son espace psychique, la reconnaissance de ce que l’on appelait jadis sa « vocation », notion très complexe, qui peut aussi servir à éviter de reconnaître en soi la voix – et la voie – qui vous appelle à devenir Je.