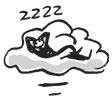Canal Psy : M. Scharnitzky, vous mettez en lien la construction de stéréotypes et la manifestation de comportements discriminatoires. De quoi s’agit-il selon vous ?
Patrick Scharnitzky : C’est toujours très polémique de parler de la fonction des stéréotypes car cela revient à dire qu’ils sont utiles et que, de fait, il n’est peut-être pas légitime de les combattre. Bien entendu, je ne partage pas cette opinion mais elle existe. Les stéréotypes sont des raccourcis de pensée qui remplissent au moins deux fonctions évidentes. D’une part, ils participent à la construction identitaire de la personne. Le soi se forge dans les groupes d’appartenance. Nous sommes un genre, une catégorie d’âge, une nationalité, un lieu d’habitation, etc. Donc, notre identité prend corps dans un jeu d’identifications avec ceux qui nous ressemblent et de différenciations avec tout ce qui nous est étranger. Les exogroupes incarnent ce que nous ne sommes pas et les stéréotypes sont donc des outils de définition de ce qui n’est pas nous. D’autre part, les stéréotypes sont des outils formidables de lutte contre la dimension anxiogène que peuvent représenter les interactions sociales. Par sa stabilité dans le jeu de la reproduction culturelle et éducative, le stéréotype assure une forme de contrôle sur la perception de la réalité sociale et des individus qui la composent.
C. P. : Vous évoquez l’étude de Theodor Adorno, réalisée en 1950. Qu’est-ce qui vous a retenu votre attention dans cette étude ?
P. S. : Cette recherche est immense et parfois sous-estimée en psychologie sociale. Elle montre, à l’appui d’une méthodologie très riche et variée, comment les préjugés se construisent dans un « syndrome » qu’il appelle la personnalité autoritaire. Les rapprochements avec la psychologie clinique sont d’autant plus évidents et naturels que Theodor Adorno revendique s’inspirer de la psychanalyse pour expliquer dans une logique « psychodynamique » le fondement de l’ethnocentrisme et de l’antisémitisme. C’est le degré de rigidité de l’éducation (père tout-puissant, toute forme de discussion impossible, vision dichotomique du monde…) qui prédispose à la personnalité autoritaire.
C. P. : Vous citez des études qui ont mis en évidence la puissance des stéréotypes, concernant la répartition sexuée des rôles, agissant souvent à notre insu. Cette constatation n’est-elle pas a priori surprenante dans une société telle que la nôtre, où l’égalité entre les sexes est peu contestée au premier abord ?
P. S. : Je partage tout à fait la thèse de Françoise Héritier selon laquelle le genre est la matrice de toutes les autres formes de découpage de la réalité sociale. C’est la distinction entre hommes et femmes (qui commence d’ailleurs bien avant la naissance) qui nous conditionne à percevoir la réalité sociale à travers un prisme binaire du bien et du mal, du noir et du blanc, du beau et du laid. On pourrait dire que le sexisme est à l’origine de toutes les autres formes de discrimination. C’est la raison pour laquelle cette distinction est ancrée si intensément dans les pratiques et les transmissions culturelles. De fait, ce sont aussi les représentations contre lesquelles il est le plus difficile de lutter.
C. P. : Vous vous êtes penché dans cet ouvrage sur la façon dont nos stéréotypes « peuvent devenir réalité », notamment dans le contexte scolaire. Qu’est-ce qui vous a intéressé dans l’étude de R. Rosenthal et L. Jacobson ?
P. S. : Dans toute l’histoire de la psychologie sociale, les résultats les plus contre-intuitifs ont toujours suscité des polémiques violentes de la part de la communauté scientifique. On pourrait par exemple évoquer les accusations dont Milgram a fait l’objet quand il a commencé à publier ses résultats concernant sa célèbre recherche sur l’obéissance.
Jérôme Dupré-Latour
L’idée de créer une forme de réalité sociale en projetant ses croyances sur les autres est assez insupportable car elle est très menaçante pour l’image de « l’homme sage » que nous voulons avoir. Cela inverse totalement la logique de la pensée cartésienne qui est le modèle communément admis pour décrire la pensée humaine. Je perçois le monde, je l’analyse puis je me forme une impression. Les résultats de Rosenthal et Jacobson nous apprennent que, dans certaines conditions, nous projetons des impressions sur le monde qui s’en trouve modifié sans nous en apercevoir ! Admettre cette possibilité demande une certaine maturité et l’acceptation d’un être humain faillible.
C. P. : En introduction vous rappelez de façon un peu provocatrice qu’il y a depuis longtemps en France des conduites discriminatoires à l’échelle nationale. Les mesures adoptées actuellement pour lutter contre ces discriminations vous semblent-elles pouvoir avoir un effet sensible sur ces questions ?
P. S. : La grande nouveauté en France est la prise de conscience collective du problème de la discrimination. Les actions de testing et leur médiatisation ont permis de sortir la discrimination de la logique de l’auto-victimisation des publics concernés. C’est donc une première étape très importante qui a donné lieu, notamment, à la création de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalite) en décembre 2005. Partout en France, des entreprises signent des chartes de lutte contre les discriminations, des collectivités territoriales nomment des chargés de mission dévolus à cette cause, et des organismes de formation développent une offre centrée sur cette problématique. Les choses bougent donc dans le bon sens aussi parce qu’on a pris conscience que la discrimination ne concerne pas uniquement les personnes d’origine étrangère dans l’accès à l’emploi. La discrimination touche aussi l’accès au logement, à la santé, à l’école, aux loisirs et surtout, la discrimination touche toute forme de « différence » par rapport à la norme. On peut être discriminé parce qu’on est handicapé, obèse, homosexuel, banlieusard, syndicaliste, trop âgé… Cette hétérogénéité des contextes et des critères a permis de sortir la discrimination de son ghetto.
Jérôme Dupré-Latour
En ce qui concerne maintenant les moyens de lutte, deux orientations semblent privilégiées. D’une part, on renforce le dispositif répressif envers tous les actes de discrimination et la HALDE doit jouer ce rôle en pénalisant, parfois lourdement, les entreprises qui se laissent aller à des discriminations dans le recrutement ou les stratégies de promotion interne.
D’autre part, on propose des politiques de rééquilibrage et de compensation pour favoriser les individus classiquement victimes de la discrimination. Cela s’appuie sur des dispositifs tels que la politique des quotas, la discrimination positive ou encore de l’anonymat des CV. Très peu d’études sont disponibles pour rendre compte de l’efficacité éventuelle de telles mesures dans le contexte français mais d’un point de vue psychologique, tout porte à croire que ces politiques sont susceptibles de provoquer des phénomènes de stigmatisation des minorités et de ne pas leur permettre d’exister indépendamment de leur étiquette catégorielle. Une seule recherche francophone teste l’effet sur un groupe social comme une entreprise d’une politique de discrimination positive envers les femmes et les résultats montrent que cela accentue encore un peu plus l’assimilation de ces bénéficiaires au modèle stéréotypée de LA femme.
Il faut cependant souligner une piste de lutte contre les discriminations qui est totalement ignorée par les politiques et qui est celle de norme d’exemplarité. Nous évoluons dans une société qui s’appuie sur des normes discriminatoires implicites ou explicites acceptées par tous, qui ne montrent pas le bon exemple. Les médias mettent en scène des attitudes discriminatoires dans la publicité par exemple, sans que cela ne choque le CSA. Les politiques et les lois qui régissent notre pays ne sont pas plus respectueuses des groupes minoritaires. La citoyenneté se définit par un compromis entre droits et devoirs. Pourtant, un étranger vivant en France paye de la TVA sur chaque produit manufacturé qu’il achète mais n’a pas le droit de voter pour les dirigeants de son pays de résidence. Pire, dans la fonction publique, certains corps de métier très valorisés comme celui des enseignants-chercheurs dans les universités sont ouverts à des candidatures étrangères hors communauté européenne alors que les autres ne le sont pas, comme celui de personnel ATOS dans ces mêmes universités. Comment imaginer imposer à toute une population une discipline de respect des différences et de rejet des discriminations quand les normes et les lois qui régissent la société proposent tout le contraire ?