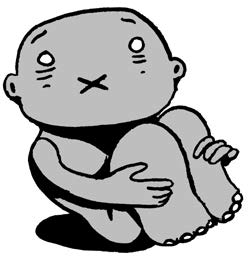Jérôme Dupré-Latour
Entre le temps de la naissance/accouchement et le temps ultérieur plus classiquement décrit des interactions mère-bébé ou parents-bébé, la période du post-partum immédiat est encore peu regardée alors qu’elle engage très intensément l’ensemble du groupe familial autour du nouveau-né. Nous défendrons dans cet article l’importance, en prévention, d’un soutien émotionnel dans « l’ici et maintenant » du post-partum, sans attendre les signes pathologiques. Le post-partum immédiat est un moment particulier, comme en témoigne l’état normal de « folie maternelle » de la jeune accouchée. L’émotionnalité, la temporalité – témoin de l’expérience subjective du sujet par rapport à ce qu’il vit – sont déréglés. Lorsque le bébé paraît, chacun est tout retourné (Aubert), indication d’une perte des repères habituels. Avant que n’ait lieu une réorganisation identitaire pour chacun des protagonistes et une redéfinition des liens et des appareillages dans le groupe familial, cette période est marquée par une grande porosité des frontières psychiques, porosités repérables au niveau intrapsychique avec l’affleurement (ou l’envahissement dans certaines pathologies puerpérales) de secteurs jusque-là maintenus silencieux par le refoulement ou le clivage. La porosité des frontières – en doubles limites – concerne aussi les liens intersubjectifs, comme si ceux-ci se trouvaient dessoudés par l’arrivée d’une pièce supplémentaire dans le puzzle familial alors qu’aucune autre ne manque (Athanassiou).
La question des places est aiguë, avec une relecture des investissements narcissiques et objectaux à l’aune de l’arrivée du nouveau-né, support projectif et catalyseur de tous les aléas passés et présents de la constitution identitaire. Repères identificatoires brouillés, rencontre avec l’inconnu, la problématique du baby blues et de la dépression du post-partum – problématique centrée sur l’état thymique maternel – ne rendent, à notre sens, pas suffisamment compte de toute la complexité d’un travail psychique individuel et groupal rendu nécessaire par l’événement naissance. Entendons bien que même si la venue d’un bébé n’entraîne pas systématiquement un « changement catastrophique », la rencontre avec l’archaïque, l’extrême dépendance et la fragilité du nouveau-né, met chacun face à des anxiétés très primitives diffuses et peu localisées chez un sujet ou dans une symptomatologie précise (Mellier 2005). Moment d’intense remaniement psychique, le post-partum immédiat contient à la fois un fort potentiel (ré)organisateur mais aussi des facteurs de risques pour le bébé, ses parents et le groupe familial. L’hypothèse est que seule une conjonction temporelle suffisante, dans « l’ici et maintenant », ou chacun serait réglé sur la même horloge psychique peut favoriser la rencontre entre parents et bébé. Les cas de pathologie d’établissement des premiers liens sont marqués par une distemporalité du post-partum. Les dispositifs de soin en périnatalité pourraient viser à ce que cette conjonction temporelle, entravée par des souffrances primitives puisse s’amorcer ou se renforcer.
La trame du post-partum immédiat : le temps du bébé, de la mère et du socius
Nous avons souligné, dans nos précédents travaux, trois types de temporalité psychique qui tissent la trame du post-partum immédiat juste après la sortie précoce de la maternité (Rochette 2005). L’après naissance est un temps dévolu à la rencontre, et au complexe réglage du temps de la mère sur celui de son bébé. Ce moment composite conjugue plusieurs réalités : celle du bébé avec ses exigences vitales, celle de la mère – temps qui allie l’engagement hic et nunc dans le maternage et un intense travail psychique avec une déconstruction temporaire des repères habituels et un retour dans son passé –, et la réalité du socius et de l’organisation communautaire de l’acte de naissance et du devenir parent. Lorsque la conjugaison de ces trois temps s’avère délicate, le soin périnatal a la vocation de promouvoir un « temps au présent » (Mellier 2005), à l’instar du « moment présent » développé par D. Stern comme levier thérapeutique propice à la mise en lien du sujet avec son corps et avec l’autre.
Un cadre d’intervention dans le post-partum immédiat
Dans le cadre d’un Centre Thérapeutique Parents-Bébé, nous avons créé un dispositif inter-institutionnel entre psychiatrie périnatale et Protection Maternelle et Infantile, dispositif dont l’originalité consiste à s’adresser aux dyades dès le retour de la maternité, offrant une prévention primaire dans le post-partum immédiat. Il s’agit d’une pratique en réseau mettant à contribution une collaboration directe du secteur « psy » engagé en périnatalité et des soignants de première ligne (puéricultrices, médecins de la protection maternelle et infantile). Pendant la permanence pour la pesée des bébés, la présence – « en poste avancé » – d’un soignant de pédopsychiatrie formé à l’observation selon la méthode d’Esther Bick, puis la reprise de ses observations, visent à soutenir la pratique d’accueil des parents et des bébés dans ce moment saturé de « tensions émotionnelles » (Mellier 2002) de l’immédiat post-partum. La rencontre intersubjective de la pesée permet le dépôt d’éléments bruts, des « choses en soi » liées au débordement émotionnel de l’évènement naissance et d’une temporalité dyadique quelques fois discordante. On connaît bien la difficulté, dans cette période de mutation du post-partum, à formuler une demande de soin psychique. Ce dispositif inter-institutionnel contribue aussi à travailler la question de l’orientation des dyades vers un soin, avec des propositions en prévention secondaire, comme la possibilité pour les dyades de fréquenter des groupes de présentation de bébé (Rochette 2002). Ces petits groupes fermés se déroulent dans les deux premiers mois de vie du bébé, entre naissance et relevailles. Ils sont conduits par la psychologue de pédopsychiatrie et le médecin de PMI. Ils s’articulent avec les offres de soin plus classiques du Centre Thérapeutique Parents-Bébé (thérapie parents-bébé, soins à domicile, groupes à médiation…).
Barbara et sa mère, échec de l’ajustement et intervention thérapeutique dans un dispositif en réseau
C’est au fil du dispositif inter-institutionnel que nous rencontrons cette dyade.
Le couple est arrivé il y a quelques mois dans la ville, pour des raisons professionnelles, et n’a pas de famille sur place, ce qui les met dans un grand isolement au moment de l’attente de leur bébé. Mme A. a tissé, dès la grossesse de forts liens avec la PMI. Elle sera suivie par la sage-femme en prénatal dans le cadre d’une menace d’accouchement prématuré et d’un diabète gestationnel assez sévère qui a fait peser une réelle menace sur le bon déroulement des événements. En fin de grossesse la puéricultrice prend le relais de la prise en charge et note lors des visites à domicile que Mme est en souci pour son mari et dans une anticipation anxieuse par rapport à l’arrivée prochaine du bébé. Le thème récurrent de l’aménagement d’une chambre pour le bébé, la plus éloignée de la porte d’entrée pour éviter la fumée de cigarette ou les germes qui pourraient venir du hall, laisse entrevoir à la puéricultrice des fantasmes de contamination et un extérieur perçu comme dangereux. La recherche du meilleur lieu pour le bébé montre bien le souci de lui faire de la place et d’aménager aussi métaphoriquement la topique interne pour lui fournir un espace à l’écart des contaminations somatiques (le diabète) et sans doute à l’écart aussi de transmissions trans-générationnelles qui vont s’avérer fort complexes. Après la naissance la puéricultrice fait une première visite à domicile ou elle constate que malgré la fatigue d’un accouchement difficile qui a nécessité forceps et épisiotomie, Mme dans une tonalité un peu hypomane – réaction bien compréhensible par rapport à l’issue positive d’un péril encouru pendant la grossesse – se débrouille bien pour l’allaitement et pour les soins. Barbara est un beau bébé tonique, exempt apparemment de toute pathologie métabolique. Mme exprime sa crainte, démentie par les examens pratiqués à la maternité d’avoir transmis son diabète au bébé, ou de l’avoir « abîmé » in utero. L’observation de la première pesée du bébé à onze jours en PMI, où est présente la grand-mère maternelle de Barbara, laisse l’impression d’une relation assez harmonieuse qui s’installe entre la mère et le bébé avec toutefois une réaction contre-transférentielle excessive de la puéricultrice face à la découverte lors du déshabillage du bébé d’un gros clip accroché au cordon ombilical, objet que les soignants de la maternité ont « oublié ». Ceci fait associer la soignante sur l’incompétence supposée de cette équipe débordée par le nombre des accouchements, dans un mouvement projectif qui laisse à penser la PMI comme le bon objet maternant, alors que la maternité serait le mauvais. Nous comprendrons ces mouvements de clivage et de projection comme la mise en acte dans le lien soignants-soignés d’éléments appartenant à la dyade et à son environnement, mais ne pouvant à ce moment précis encore prendre une forme représentable pour Mme A. Lors de la deuxième pesée, alors que Barbara a un mois, rien ne va plus !
Jérôme Dupré-Latour
Madame est épuisée, elle souffre d’un début de lymphangite et d’un état fébrile qui rend l’allaitement très douloureux. Le bébé pleure sans cesse. La rencontre va prendre une tonalité alarmante qui ne va cesser de croître pour les soignants, alors que Mme A., elle, ne pourra pas se mobiliser autour de la perte de poids, de l’hypotonie de son bébé, et de ses manifestations patentes de faim. Malgré les conseils de supplémenter l’allaitement avec des biberons, Mme A. va « s’acharner » à allaiter Barbara. Un troisième temps de rencontre, lors de la participation de Mme A. et de Barbara à un groupe de présentation de bébés à la PMI, va faire émerger une conflictualité jusque-là occultée, voire forclose. Ce groupe met Mme A. en présence d’une autre mère, dont l’expression de la détresse post-natale se fera sur un versant beaucoup plus hystérisé, et autour de reproches appuyés à l’égard du corps médical, de propos crus sur l’accouchement, de plaintes sur les contraintes du maternage, et d’expression de sentiments hostiles à l’égard du bébé. Pour la première fois Mme A. va pouvoir manifester des émotions en lien avec les difficultés de son parcours obstétrical, ouvrant ainsi la voie à l’émergence de la problématique inconsciente qui grève dans l’actuel son vécu post-natal. Elle parlera avec beaucoup d’émotions des restrictions alimentaires imposées par son diabète, du fait « qu’elle a crevé de faim pendant six mois » et du manque de communication dramatique entre l’obstétricien et le diabétologue qui l’a laissée dans un douloureux sentiment de solitude et de non-assistance. Ce temps thérapeutique groupal, articulé avec les autres niveaux, rend possible le déploiement de ce moment nodal pour la suite de la dynamique du lien mère-bébé. Le contact de l’autre mère, et les effets de diffraction du transfert sur les membres du groupe, vont rendent exprimable la conflictualité à l’égard des personnages réels engagés dans l’aventure obstétricale de Mme A., mais surtout au sujet des imagos parentales intériorisées par Mme A. et projetées sur les soignants. En effet, comme nous le comprendrons dans la suite de la thérapie, le couple diabétologue-obstétricien vient condenser les caractéristiques d’un couple parental désuni, centré sur des positions narcissiques, incapables d’entendre sa réalité psychique, et réactiver une intense culpabilité primaire et des positions œdipiennes mal élaborées. L’arrivée du bébé revisite aussi le processus de deuil entravé lors du décès de son père, dix ans en arrière. Nous rechercherons les motifs inconscients de la propension d’une mère pourtant si attentionnée, à affamer son bébé, comme elle-même s’est trouvée affamée pendant sa grossesse… Au-delà d’un simple retournement passif/actif – en talion – sur le bébé de ce qu’elle a elle-même subi passivement, cet agir comportemental dans le maternage prendra une dimension polymorphe complexe à la lumière de l’histoire maternelle. Sans rendre compte de toute la richesse associative et du déroulement de la thérapie individuelle qui va suivre – à la faveur du lien transféro-contre-tansférentiel – nous pouvons donner quelques autres éléments anamnestiques. Nous apprendrons que la grand-mère de Barbara avait perdu un bébé avant la naissance de Mme A. et que ce drame caché n’a été révélé à Mme, par sa mère, qu’au début de sa grossesse. Dans sa position d’enfant de remplacement face à une mère endeuillée, le bébé qu’elle était alors « n’a pas pu être entendu ». Peut-elle maintenant faire mieux que sa mère et être présente à son bébé bien vivant ? De quelles pulsions meurtrières se protège-t-elle en s’interdisant un sentiment ambivalent à l’égard de cette grand-mère qui provoque, par la révélation du secret, un choc émotionnel imputable dans la décompensation somatique lors de la grossesse ?
Au fur et à mesure que la conflictualité va se mentaliser ouvrant une voie aux affects dépressifs, les fixations traumatiques et la répétition du traumatique « dans le lien de maternage » vont laisser place à une possibilité de différenciation des temporalités et des espaces.
Deux aspects peuvent être soulignés :
- Concernant la temporalité, Mme A. n’est pas, au départ, dans le temps synchronique de son bébé mais reste prise dans une temporalité diachronique liée aux aléas de son histoire infantile, à l’inapproprié de ce qui n’a pas reçu de statut psychique satisfaisant en son temps. Depuis cette « zone traumatique primaire » théorisée par les travaux de R. Roussillon (1999, 2002), les éléments agonistiques « qui n’ont pu être mis au passé », sous forme de souvenirs ou de refoulés, font effraction « au présent du Moi » dans l’actuel du lien au bébé. Ce qui ne peut pas se mentaliser/symboliser tente classiquement de faire retour sous forme de traces hallucinatoires ou de somatose. Ici, peut-on penser que l’expression d’une conflictualité destructive n’a trouvé pour l’instant qu’une « solution somatique », comme avec le diabète et les problèmes à l’allaitement ? En plus de cette voie d’expression de la souffrance, « une solution par l’agir », qui a la particularité de se situer dans le lien, au sein de la relation dyadique et dans la concrétude du maternage, va aussi se déployer dans la restriction alimentaire imposée au bébé.
- Concernant les espaces psychiques, le régime relationnel mère-bébé s’était instauré dans une indifférenciation symbiotique régie par la pulsion de mort et sous le primat d’un masochisme mortifère. Dans ce régime d’indifférenciation, l’état somatopsychique du bébé, alarmant pour les soignants, ne pouvait pas faire signal d’alarme pour sa mère, elle-même coupée de ses propres éprouvés par un clivage du moi. Les manifestations du bébé réel, comme celles du bébé dans la mère, étaient maintenues hors psyché.
En conclusion, dans ce dispositif proposé dès la sortie de la maternité pour une prévention primaire des dysthymies maternelles, des souffrances précoces du bébé et des troubles de l’établissement des premiers liens, la qualité de l’attention des soignants, dédoublée et renforcée par tout un travail de reprise des observations, permet de « tenir » un cadre pérenne, favorisant pour les accueillis « un temps au présent », à l’instar du kaïros des Grecs. Une meilleure connaissance de la temporalité spécifique du post-partum permet d’être attentif au processus « du naître humain et du devenir parent » (Missonnier). Après la période de marge qui suit l’accouchement et la naissance, moment de flottement identitaire trop souvent réduit dans sa description clinique aux seuls symptômes dysthimiques (comme pour le fameux « blues »), un point d’orgue du retour à un régime psychique élaboratif doit être repéré, accompagné lorsqu’il peine à se mettre en route. Coutumièrement, relevailles et présentation du bébé étaient le marqueur collectif de cette reprise. Nos dispositifs de soins pourraient y trouver une inspiration féconde. « La symbolisation est nécessaire à tous les âges et tous les temps de la vie, elle est nécessaire au fonctionnement non-traumatique de la psyché » (Roussillon), cependant ses enjeux sont d’autant plus capitaux qu’ils engagent un nouveau sujet, le bébé, sur les voies de la naissance psychique. Autant que le socius, et par la même occasion l’organisation de la psychiatrie préventive périnatale, en prennent la part qui leur revient.