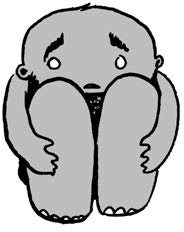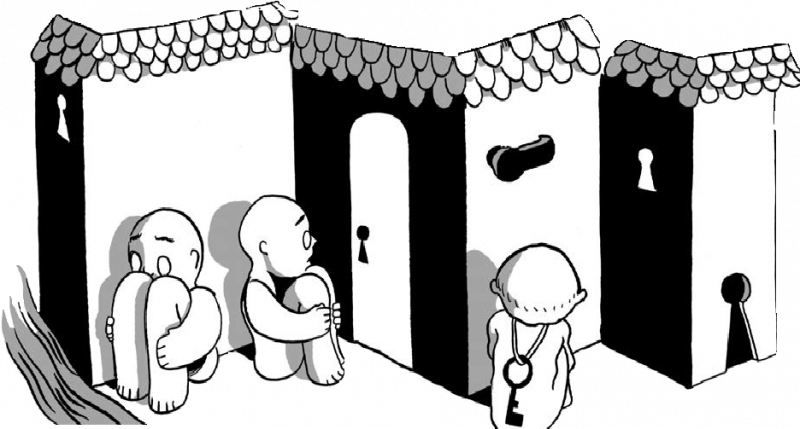Jérôme Dupré-Latour
Canal Psy : Tout d’abord je souhaitais vous remercier pour cet ouvrage qui se révèle être un outil fort appréciable pour les jeunes psychologues dont je fais partie, qui sont amenés à se trouver confrontés à ces situations où la demande est diffuse, le cadre peu défini, et la mise à l’épreuve du travail sur son contre-transfert non négligeable… La première vignette que vous exposez en introduction, et à partir de laquelle vous définissez la problématique qui est le fil conducteur de cet ouvrage, donne d’entrée de jeu le ton qui sera le vôtre au fil des pages. Elle nous permet de suivre le cheminement de votre réflexion, à partir de son ancrage dans les situations cliniques inconfortables que les cliniciens sont amenés à rencontrer et à vivre, souvent au moment même où ils sont le moins expérimentés et étayés.
Qu’est-ce qui vous a amené à travailler sur ces cliniques où la souffrance entrave la possibilité d’adresser une demande à un tiers ?
Denis Mellier : Je pense que ce sont mes premières expériences de psychologue. Je me suis trouvé en effet dans des situations où j’étais au carrefour de différentes demandes, peu claires voire contradictoires. J’ai commencé à travailler en crèche. Les bébés ne s’adressent pas directement à nous…, les personnes de l’équipe ou leurs parents portent leurs demandes. Mais il y avait aussi la demande d’une directrice pour son personnel, celle d’une puéricultrice pour une personne de l’équipe ou un parent, sans compter la propre perception que j’avais de bébés en souffrance ou de l’administration qui me demandait d’aller voir telle ou telle crèche, etc. Parfois, il fallait voir les parents car « ils avaient des problèmes », parfois il ne fallait pas que je les approche, c’était « chasse gardée » ! À l’époque où j’ai débuté, ce n’était pas une pratique très courante, on n’en parlait pas tellement à l’université.
Ensuite, au fil du temps, il m’a semblé que cette situation pouvait être paradigmatique des différents lieux où comme en crèche la tâche primaire de l’institution n’est pas la psychothérapie. Comment aborde-t-on dès lors la demande dans les institutions éducatives, rééducatives, médicales, sanitaires, sociales ou judiciaires ? Comment également « faire de la prévention » alors que le clinicien ne peut travailler que sur une souffrance bien présente et non à venir, hypothéquée ? Les cliniciens sont pourtant de plus en plus présents dans ces lieux. Cette question de la demande méritait d’être travaillée de front pour penser la souffrance, les symptômes, la place et le positionnement du clinicien.
C. P. : Vous décrivez le travail du psychologue clinicien en institution comme un travail de symbolisation primaire, que souhaitez-vous souligner ici ?
D. M. : Les terrains institutionnels sont envahis par des souffrances qui ne sont pas forcément adressées à un autre. On retrouve alors dans la clinique des processus tels que les clivages, l’identification projective, le déni, le dépôt, la somatisation, pour ne citer que les plus courants et les plus massifs. Je pense qu’ils pointent l’existence d’un registre très archaïque où la psyché est peu différenciée de ses étayages tant somatiques que groupaux ou sociaux. C’est à ce niveau que René Roussillon développe la question d’une symbolisation primaire. Dans ce contexte, il y a très spécifiquement un positionnement clinique à travailler, on ne dispose pas d’un cadre qui contiendrait déjà l’ensemble des problématiques archaïques, au sens où l’évoque Bleger. Ces éléments, qui sont en appel d’être déposés, transitent alors sur un sujet, sur un autre, sur un espace ou sur un autre, au sein de l’institution. Tant qu’il n’y a pas un cadre psychique en tant que tel de construit, on ne peut pas les travailler de face. Préalablement il faut œuvrer à la construction de liens au sein d’un appareillage psychique, groupal, d’équipe, qui pourra permettre dans un second temps d’aller plus loin, dans l’efficience d’un dispositif.
L’institution recueille, qu’elle le veuille ou non, l’ensemble des problématiques des patients et des personnes qui la constituent. Je crois qu’on a beaucoup privilégié une certaine névrotisation de la problématique institutionnelle au détriment de ses enjeux narcissiques. Le registre de l’archaïque infiltre tous les processus du langage.
C. P. : Vous soulignez que dans ce registre des souffrances primitives, le sujet ne se sent pas nécessairement souffrant, au contraire de son entourage. Comment le psychologue peut-il être amené à intervenir dans ce contexte d’absence de demande du sujet ?
D. M. : Le terme de « primitif » est directement en rapport avec les relations primitives et les « agonies primitives » que décrit Winnicott et qui caractérisent les relations unissant la mère et l’enfant avant que celui-ci n’ait conscience de la séparation. Le tout-petit ne différencie pas toujours ce qu’il peut ressentir de ce que sa mère elle-même peut ressentir. Une souffrance va alors d’autant plus abraser le peu de différenciation qui existe entre eux. Je ne crois pas que le bébé soit une masse indifférenciée, bien au contraire, tous les travaux nous montrent qu’il existe très tôt pour lui des processus de différenciation. Mais quand surgissent des événements trop douloureux, ces modalités d’être en lien avec l’extérieur peuvent disparaître, et du coup la conscience qu’il peut avoir de lui par rapport à l’autre fait défaut. Qui va alors être le porte-parole de ces souffrances du bébé, mais également des adultes qui peuvent se trouver dans un état psychique similaire ? Qui va pouvoir adresser une demande de soin sinon quelqu’un d’autre ? Il en va d’ailleurs ainsi avec la schizophrénie où le sujet généralement n’arrive pas à exprimer sa souffrance ni une demande de soin ; mais que penser des troubles liées à la psychopathie, au somatique ou à la détresse sociale ? Dans ces voies pathologiques pourtant si différentes, il y a un même point commun, une détresse très profonde, l’atteinte du sujet dans la conscience de sa subjectivité, du sens de son existence.
Considérer dès le départ l’éprouvé comme étant une modalité de différenciation entre soi et l’autre, et même de soi par rapport à soi, en termes de réflexivité, permet d’envisager l’implication des autres, familles ou professionnels qui portent en quelque sorte l’ouverture vers un soin psychique.
Dans la clinique, on est amené à passer par d’autres professionnels pour approcher la souffrance d’un sujet. C’est le cas lors des entretiens avec des personnes hospitalisées où une personne du service peut être présente. On parle traditionnellement de « moi auxiliaire » parce que quelqu’un d’autre peut témoigner de la souffrance que le patient peut ressentir, tandis que lui-même n’arrive pas à la porter suffisamment pour la mettre au travail, cette expression n’est cependant pas complètement satisfaisante.
C. P. : Selon vous, l’émotion serait le produit d’un premier travail de symbolisation réalisé par le sujet ?
D. M. : Oui, pas toutes les émotions, certaines restent de façade, mais certaines traduisent pour moi un processus vraiment central de subjectivation. Ce sont les travaux sur les bébés qui m’ont beaucoup appris là-dessus, et là aussi j’ai trouvé des correspondances dans différentes pathologies. Le tout-petit qui ne va pas bien peut pleurer ou se mettre en colère et exprimer ainsi un affect de déplaisir. Mais quand l’enfant est beaucoup plus petit, si le déplaisir dure, s’il est plus intense, d’autres types de processus apparaissent qui se traduisent par la disparition de toute manifestation d’affect. On a alors des enfants qui se figent, qui ne bougent pas, voire qui développent des processus d’auto-sensualité tels qu’on peut les observer chez les enfants autistes. Ces modalités musculaires ou sensorielles, auxquelles s’accroche le bébé, lui évitent de passer dans le registre émotionnel qui risquerait de le déborder. La désorganisation psychosomatique trouve ici un point d’ancrage. Le bébé perd la possibilité d’éprouver et d’être en lien avec lui-même et avec l’autre. Il faut bien attendre six/sept mois, la régulation émotionnelle ou l’accordage affectif (Stern), pour que les émotions puissent se mettre en place et devenir des vecteurs privilégiés de la communication. Le sens de ce mouvement émotionnel pourra ensuite se transférer à la gestualité puis aux mots. Nous sommes dans des registres où le travail psychique repose en partie sur une « parole » non-verbale.
Jérôme Dupré-Latour
C. P. : À propos du travail d’attention nécessaire au clinicien dans l’écoute du patient, vous rappelez les propos de W. R. Bion qui préconisait d’être « sans mémoire, sans désir, ni compréhension ». Pouvez-vous nous expliquer la pertinence de cette attitude intérieure dans le lien au patient ?
D. M. : Ce précepte, bien connu, est souvent dénaturé. On a pu parler de mysticisme, alors qu’en fait il correspond tout simplement à un travail psychique qui est à réaliser du côté de l’écoute : Bion parle d’une « discipline de l’attention ». Le malentendu provient en France du sens du mot « désir ». Pour Lacan le Désir définit la place même du Sujet, alors que Bion fait ici seulement référence à la satisfaction pulsionnelle. Pour travailler l’indifférenciation, il faut développer l’attention à l’autre dans ses modes de lien, ce qui suppose abstinence, neutralité et réceptivité. Bion a été amené à développer cette notion après avoir écrit Apprentissage à partir de l’expérience (1962). Après avoir travaillé sur la fonction alpha avec des psychotiques, il s’est aperçu que l’expérience même de l’analyste pouvait lui être préjudiciable. Dans sa formule, « sans mémoire » ne veut donc pas dire sans processus de remémoration, bien au contraire, puisqu’ils sont un appui au travail psychique, Bion l’a très clairement noté. Il faudrait recevoir chaque patient comme s’il s’agissait d’une première visite. Bien sûr ce n’est jamais vrai, mais cela montre à quel point les modalités de connaissance peuvent enfermer notre écoute de l’autre. Lacan disait la même chose à propos du « sujet supposé savoir », et de la problématique du moi qui était du côté de la méconnaissance. Il y a ici une très grande proximité entre eux. Lacan parle d’un grand « Autre », Bion d’un grand « O » qui représente pour lui l’origine, l’inconnu, l’inaccessibilité de toute écoute. Il s’agit ainsi d’un travail pour rester en lien ouvert avec l’autre, avec ce qui n’est pas encore suffisamment construit, élaboré comme expérience. Cela permet peut-être de montrer que l’on ne se situe pas uniquement au niveau des représentations de mots, contrairement à ce que le mot implicite « d’écoute » suggère, mais du côté de ce qui parle, de comment ça parle, etc. Travailler avec l’idée de l’attention, c’est alors inscrire l’ensemble de la sensorialité ou de l’émotionnalité comme pouvant être un espace, un lieu ou une modalité de lien avec l’autre.
C. P. : Vous relevez par ailleurs que le désir de séduction est toujours présent dans le lien soignant/soigné, ou superviseur/supervisé, et qu’il peut même constituer un moteur du travail de penser. N’est-ce pas paradoxal compte tenu de votre référence précédente à Bion ?
D. M. : Cela peut paraître assez provocant que de dire qu’il faut de la séduction dans certaines situations. Mais ce n’est pas parce qu’il en faut qu’elle ne doit pas être mise au travail, comme on le fait dans l’analyse des pratiques ou en supervision. Lorsque domine la déliaison, comme dans les états de désaffectivation chez le bébé ou d’autres sujets, on ne voit pas comment un soin pourrait se mettre en place. Pour cela, il faut du désir afin qu’il existe une circulation pulsionnelle intersubjective, entre les sujets. Cela peut paraître contradictoire avec la notion de Bion d’être « sans mémoire, sans désir, sans compréhension », mais cette discipline suppose l’existence d’un tel cadre où le désir et la vie peuvent s’animer.
Mon hypothèse est que les dispositifs qui mettent au travail le registre le plus archaïque de la psyché doivent a minima être séducteurs, dans le sens où ils doivent accueillir des souffrances très primitives et être/rester vivants. Comment sinon réanimer la vie chez l’autre ? Freud l’a très bien souligné : c’est bien parce que la mère est séductrice que le bébé, comme l’a ensuite mis en relief Laplanche, va pouvoir se développer pulsionnellement et entrer dans une dialectique du désir et de la défense, une dialectique de subjectivation. Cette séduction, qui n’est bien sûr pas une séduction narcissique, dit à quel point nous sommes reliés à l’autre par Éros. Cela ne veut pas dire qu’il faut séduire l’autre, mais plutôt qu’il faut légitimer notre propre position de Désir par rapport à l’autre et à notre tâche.
Ce désir à respecter, il est nécessaire pour travailler quand nos repères identificatoires sont défaillants comme avec des personnes polyhandicapées, grabataires, en grande détresse sociale, les tout-petits, les prématurés ou les situations extrêmes de démence, de violence, etc. C’est notre propre désir qui peut rendre possible une accroche et une survivance à la destructivité. Ensuite, dans l’écoute, ce désir ne doit pas trouver de satisfaction directe, sinon l’autre sera réduit à devenir objet et non plus sujet du lien. Il s’agit là de pulsions sexuelles inhibées quant au but, telles que les a décrites Freud.
C’est un des paradoxes de la prévention. Les dispositifs d’accueil, d’accompagnement ou de permanence disent implicitement : « viens, je peux t’accueillir ». Ils sont profondément ancrés dans une dialectique d’accueil et de réceptivité. La séduction est donc là du côté d’une séduction primaire, animer chez l’autre la vie, et du côté d’une réceptivité, au sens d’une attention à l’inconnu, à la vie psychique de l’autre. C’est ici une autre façon d’appréhender des souffrances que le sujet ne porte pas lui-même, dont il n’a pas forcément conscience et qui demandent pourtant à être hébergées.
C. P. : Vous proposez par ailleurs de penser la psychopathologie également en fonction de la façon dont l’environnement est affecté par le sujet. Voulez-vous nous en dire davantage sur ce point ?
D. M. : Au fond, j’essaie de développer un modèle radicalement intersubjectif pour envisager le processus de subjectivation de la souffrance quand elle n’est pas encore suffisamment élaborée pour permettre au sujet d’exprimer une demande. Je ne pars pas d’un modèle intrapsychique avec une problématique de souffrance interne avec laquelle il est difficile de négocier, mais plutôt d’une souffrance qui se manifeste dans les liens, et qui vient à s’exprimer au travers d’un autre.
Il n’est pas rare, dans un groupe, qu’une personne devienne le porte-parole de ce qui fait souffrance pour quelqu’un d’autre, avant que cela ne puisse être repris par celle-ci. En pensant ainsi dès le départ les effets intersubjectifs, on va majorer ce que soi-même en tant que psychologue clinicien on ressent, c’est-à-dire la problématique contre-transférentielle. On imagine parfois que l’affect que nous éprouvons, le patient l’éprouve également, mais ce n’est pas toujours le cas, bien au contraire. Ainsi on peut ressentir massivement de la tristesse vis-à-vis d’un patient sans que celui-ci soit réellement triste en face de nous. Ces situations nécessitent donc un important travail contre-transférentiel.
Dans le cas d’institutions, la souffrance d’un sujet en détresse ne va pas nécessairement être perçue, reçue et contenue de la même manière par un soignant ou par un autre, elle peut être diffractée et diffusée sur une multitude de personnes. L’ensemble du travail d’équipe doit donc être pris en compte pour penser ce sujet en souffrance. Au-delà du contre-transfert individuel, il est essentiel que le groupe ou l’équipe arrive à se penser comme pouvant être le dépositaire ou l’objet de situations qui sont en lien avec la difficulté du sujet à penser sa propre souffrance. Kaës parle d’intertransfert pour le travail des psychanalystes entre eux dans les groupes, nous avons à réaliser un travail de ce type-là.
Cette option met donc l’accent sur le travail à plusieurs, avec des corps de spécialités différentes. Je pense par exemple aux CAMSP. On sait que ces équipes peuvent très vite éclater parce que la dimension psy et la dimension médicale – somatique – ne se marient pas toujours bien. Au sein même de l’équipe, des clivages entre ces différentes modalités d’approche du sujet peuvent amener à poser la question en termes de l’un ou de l’autre, alors qu’il s’agit, au contraire, de trouver comment les professionnels peuvent travailler ensemble pour recevoir ce qui est déposé sur eux. La continuité d’une expérience, au sens de Winnicott, repose sur des liens et des associations entre différents aspects de la réalité, les douleurs sont en rapport avec par exemple les sensations corporelles, les affects, les représentations de mouvement et les idées. Certains sujets s’amputent d’un aspect à un moment donné, et celui-ci va probablement ressurgir, en négatif, dans leur propre entourage. D’où l’importance de penser une psychopathologie intersubjective en prenant en compte la question du groupe, de la famille et la problématique contre-transférentielle de l’équipe.
On se rend bien compte, par exemple, que travailler en pédopsy ce n’est pas la même chose qu’en CAMSP ou dans un Centre éducatif renforcé (CER) avec des adolescents. Il y a des différences significatives d’un lieu à un autre, la détresse des sujets accueillis se retrouve différemment en négatif chez les soignants. L’expérience des professionnels se trouve selon les cas plus fragilisée du côté de la confusion, de la distanciation psyché-soma ou de la prévalence de l’acte. Le traitement de l’affect n’est pas le même, pour le sujet et son entourage, dans l’autisme, la psychose, les atteintes du corps, l’addiction ou l’agir. Cette approche intersubjective de la psychopathologie nous interdit de la réduire au seul registre de l’individuel. Il y a d’ailleurs des phénomènes individuels tels que la toxicomanie ou l’adhésion sectaire qui sont typiquement des pathologies en rapport avec le socius.
Cela nous oblige à articuler la psychopathologie individuelle au milieu dans lequel elle surgit et aux dispositifs les plus aptes à la contenir. C’est une voie de recherche fructueuse.
À mon tour de vous remercier pour la pertinence de vos questions.