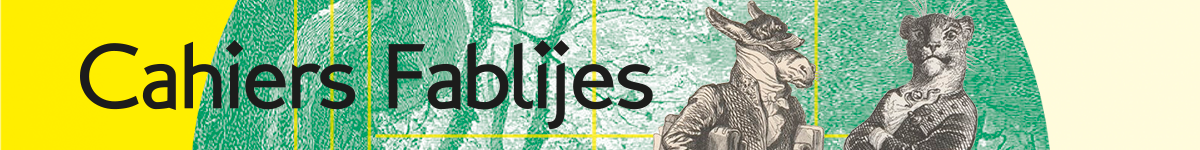Au xixe siècle, la relation des femmes et des jeunes filles à la lecture devient une question d’intérêt public. Objet de débat chez les pédagogues1, les publicistes2, mais encore chez les médecins3, les juristes4, ou les législateurs5, objet de représentation romanesque (la figure de la lectrice de romans se singularise au xixe siècle6), elle engendre des discours foisonnants et contrastés, dont, au fond, les enjeux sont politiques : à travers les débats sur la lecture se joue la question de savoir qui a droit à une place dans la parole et les affaires publiques, ou, pour reprendre la terminologie de Jacques Rancière7, qui a part au commun. En témoigne par exemple le Projet d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes de Sylvain Maréchal, publié en 18018. Le texte est provocateur, mais se présente bien comme un projet de « loi et non comme un simple libelle9 ». La lecture des femmes (et l’écriture) y est dénoncée au nom de la « Raison », pour des motifs qui dépassent largement la bienséance : non seulement la lecture dénature la destination domestique des femmes, mais surtout, elle pourrait les conduire à revendiquer une voix hors des « assemblées de famille10 », dans les assemblées publiques. En leur offrant « la possibilité […] de sortir de la sphère domestique et de revendiquer l’égalité politique […], la Révolution ouvre sur la peur multiforme de tout ce qui semble aller dans le sens d’une dangereuse acculturation11. » Derrière les inquiétudes suscitées par la lecture des femmes se profilent aussi celles de l’aspiration des classes populaires à l’égalité démocratique, augmentées par l’accroissement général de l’alphabétisation12, les lois sur la scolarisation en général, et des filles en particulier13, ou le développement de la presse et de la librairie. Dans la première moitié du xixe siècle, se développe la crainte que la lecture, de romans contemporains en particulier, ne dérègle les hiérarchies sociales en donnant l’envie aux lecteurs et lectrices de sortir de leur condition. À tel point que le député Chapuys-Montlaville en fait l’objet de plusieurs discours à la chambre entre 1843 et 184714. Cependant, par-delà cette inquiétude, ce sont bien les femmes, comme groupe sexué, qui forment l’enjeu de tout un pan des débats sur la lecture, autour d’un paradoxe : la reconnaissance de l’utilité de leur éducation, confrontée au désir de limiter cette éducation. La lecture se présente alors comme un lieu de friction, où s’établissent des rapports de force et où se configurent des identités sociales et sexuées15. En rend compte la manière dont les discours sociaux autorisés (pédagogiques, cléricaux, médicaux, juridiques), mais aussi les stratégies éditoriales, et la littérature, dans ses représentations, s’emparent de la question : leurs articulations et leurs points d’achoppements mettent en lumière des zones de tensions, au sein des discours, par exemple, sur la nécessité d’éduquer les filles, ou ceux qui mettent en garde contre les dangers de la lecture ; entre les normes discriminant les « bonnes » des « mauvaises » lectures ; ou encore, entre les recommandations de lecture, qui dessinent une bibliothèque idéale pour jeunes filles, et les logiques d’appropriation de ces lectures.
Certes, la nécessité d’éduquer les filles – et donc, non seulement de leur apprendre à lire, mais de les faire lire (en dépit des vœux d’un Sylvain Maréchal) – forme un consensus dès le début du xixe siècle, d’autant plus que la lecture devient un « élément clé de la sociabilité16 » : c’est un point de contact et d’échanges important, dont témoignent les correspondances, privées ou « intellectuelles17 » et les représentations fictionnelles. Nombreuses sont les scènes de lecture collective – celle d’Emma au couvent, pour ne citer qu’elle – ou de discussions mondaines autour des lectures, auxquelles participent activement les femmes – entre autres exemples : les poèmes de Lucien de Rubempré dans Illusions perdues, le roman noir Olympia ou les Vengeances romaines dans La Muse du département, le salon de Camille Maupin dans Béatrix. Toutefois, les finalités de cette éducation divergent, même s’il est symptomatique que dans les discours pédagogiques, la référence plébiscitée en la matière soit le traité de Fénelon De l’Éducation des filles (1687), régulièrement réédité jusque dans les années 1860, tandis que Condorcet18 est marginalisé19 : signe que l’éducation des filles, dans ses divergences, demeure majoritairement pensée en fonction de normes de genre (et signe corollaire de la méfiance à l’égard de possibles revendications d’égalité politique). Les filles doivent recevoir une éducation qui leur convienne. Dans son manuel de littérature destiné aux jeunes filles20 (car ceux de Rollin, Batteux, La Harpe ne leur conviennent pas justement), Mme Beaufort d’Hautpoul, par exemple, affirme que la littérature doit préparer les jeunes filles aux sujets abordés dans le monde, sans paraître savantes, c’est-à-dire, sans faire montre d’une « érudition déplacée » ni de « prétention »21. Cependant, cette justification de l’instruction par la nécessité, pour les femmes, d’agrémenter agréablement les conversations se voit concurrencée par d’autres arguments, de l’ordre de l’utilité sociale et civique. Au début du siècle, les guerres napoléoniennes privent nombre de familles de pères. Assurant le rôle de chef de famille, les femmes doivent être capables d’éduquer non seulement leurs filles, mais les hommes et les futurs citoyens. Ce sont désormais majoritairement les mères22 qui assurent l’éducation et l’instruction des jeunes enfants23, et notamment l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. L’ignorance n’est donc plus de mise : « [i]l faut instruire les femmes pour qu’elles puissent mettre au monde, éduquer, et instruire en retour, c’est là un cliché vite usé mais qui perdure et ne cesse d’être invoqué tout au long du siècle24. ». Dans ce contexte, où la demande sociale d’éducation ne cesse d’augmenter, se développe toute une littérature pédagogique à destination des mères éducatrices et des jeunes filles bourgeoises25, alliant conseils pour l’apprentissage, manuels d’instruction et presse pédagogique, qui promeuvent aussi bien les responsabilités domestiques des femmes que l’ouverture intellectuelle, à l’instar d’Alida de Savignac, affirmant que « La lecture est la branche la plus importante de l’éducation des filles ; car c’est par elle que l’intelligence s’éclaire et que le sentiment se développe. Il faut donc qu’une femme lise beaucoup26 », ou d’Amable Testu, qui, dans ses Lectures pour les jeunes filles ou Leçon et modèles de littérature en prose (1840), entend développer le « sens critique27 » de ses lectrices. Pour autant, même si elle est soigneusement encadrée et surveillée, la valorisation de la formation intellectuelle par la lecture n’est pas sans dangers, surtout dès lors que la lecture s’individualise.
Ouvrant les voies de l’imagination, la littérature constitue un péril pour la lectrice solitaire, fantasmée sous les traits d’un « Quichotte féminin » s’adonnant à la rêverie stérile ou à l’onanisme, dans les représentations littéraires et picturales28 aussi bien que dans le discours médical (qui prend alors le relais du discours religieux – la lecture ne pervertit plus, elle rend malade). Marie Baudry a montré que le roman du xixe siècle donnait naissance à une représentation singulière de la lectrice de romans, en féminisant la figure du Quichotte. Elle analyse ce phénomène dans une perspective d’histoire littéraire, comme une stratégie de légitimation du genre romanesque mettant en scène un partage entre lectures « féminines » et « masculines », entre « bonnes » et « mauvaises » manières de lire. « Le personnage de la lectrice appartiendrait ainsi à l’arsenal que construit le roman réaliste pour se démarquer d’une production romanesque dévalorisée et faire apparaître sa nouveauté et son sérieux29. » Au moment du passage du régime des belles-lettres à celui de la littérature :
[…] la différence des sexes, qui suppose également une hiérarchie, offre à l’art un critérium simple : caractériser de masculin ou féminin un genre littéraire, une œuvre, revient à établir une nouvelle hiérarchie des valeurs esthétiques qui, sans plus être fondée sur les principes aristotéliciens, n’en est pas moins efficace pour distinguer les œuvres les unes des autres30.
Cette représentation dévaluée de la lecture et de la lectrice a également une efficacité sociale. Le procès de Madame Bovary en témoigne, lui qui :
fut autant le procès d’un roman que celui d’Emma et de la mauvaise lecture : l’avocat impérial fit de Madame Bovary un livre à ne pas mettre entre les mains des jeunes filles, alors que pour le défenseur de Flaubert, Emma illustrait les déboires d’une jeune femme acculturée qui a trop et mal lu31.
La lecture est considérée comme susceptible de provoquer des états anormaux, de l’exaltation au crime32, qui dérèglent le mariage et donc, l’ordre social. Et c’est là un autre des paradoxes liés à la question de la lecture au xixe siècle : les remèdes viennent du mal lui-même, consistant, d’une part à circonscrire de « bonnes » manières de lire, et d’autre part, à proposer de « bonnes » lectures. Les premières se déclinent en un ensemble de prescriptions émanant des discours médicaux et pédagogiques, qui placent la lecture sous surveillance, en encourageant la lecture à voix haute. Quant au corpus des « bonnes » lectures, il se compose aussi bien de livres éducatifs circonscrivant le rôle social des femmes et valorisant leurs responsabilités domestiques (fictions à thèse ou manuels d’instruction domestique) que les ouvrages publiés par les maisons d’édition catholiques (livres de prières et d’histoire sainte, mais aussi vies de jeunes filles, romans moraux et même romans sentimentaux33), l’Église ayant entrepris dès la Restauration de reconquérir sa place dans la société par les femmes et par les livres, à travers une stratégie très opératoire34.
Pour autant, ce quadrillage du territoire des lectures féminines ne les exonère pas d’ambiguïtés constitutives. En premier lieu le corpus des lectures recommandées est mouvant, et révèle une ambivalence durable à l’égard du roman, dont témoignent par exemple les chroniques d’Alida de Savignac ou encore, à l’autre bout du siècle, celles du journal La Fronde35. En second lieu, même les livres figurant parmi les bestsellers de l’éducation maternelle et représentatifs du corpus féminin par excellence comportent des zones de tension. Bénédicte Monicat montre que l’écriture des livres d’économie domestique est sous-tendue par « une expertise […] fondée sur la maîtrise et la compréhension intellectuelle de la variété des connaissances nécessaires à une vie domestique bien entendue. […] [L]es lois de la physique et de la chimie par exemple régissent divers [de leurs] objets36 ». Autrement dit, autant la lecture de ces livres par leurs destinataires que leur écriture par leurs autrices, en raison des lectures préalables qu’elles suscitent, leur permettent de déborder allègrement les domaines féminins attitrés, et de s’approprier des savoirs réputés masculins. La logique est la même dans le domaine de l’auctorialité littéraire : George Sand, Marie d’Agoult, Clémence Royer, Sophie Ulliac-Trémadeure, Hortense Allart, se donnent des programmes de lecture divers et abondants, dans le cadre de leurs travaux préparatoires à l’écriture. Le rapport des femmes au savoir, et le rapport sexué au savoir s’en trouvent modifiés37. Se crée alors un espace d’émancipation par rapport aux normes de genre, au sein même d’un espace féminisé, précisément parce qu’il est reconnu comme tel38. Si les marges de manœuvre des lectrices sont faibles concernant le choix des livres et les pratiques de lecture, qui restent encadrées par des normes de genre, les logiques d’appropriation de ces lectures accordent pourtant la possibilité de les subvertir.
Dès lors, dans quelle mesure les recommandations, mais encore, les corpus littéraires conseillés aux jeunes filles participent-ils de ces processus de normalisation ou de transgression ? Quels imaginaires éducatifs les œuvres de fiction destinées aux filles dessinent-elles ? Et si elles en offrent, quelles perspectives de subjectivation configurent-elles ? Enfin, quel discours sur le roman se dégage de ces discours et mises en fiction de/sur la lecture féminine ?
C’est à ces questions que s’attache à répondre le présent dossier.
Lucie Nizard s’intéresse aux représentations qui articulent lecture et désir féminin et tout particulièrement à la figure de la « petite lectrice masturbatrice ». Construite par un ensemble de discours pédagogiques (au sens large), cette figure fait de la lecture un risque, avant tout envisagé comme un problème de santé publique – ou de salut des âmes – dont la littérature est à la fois le remède et la coupable.
Tout autre – et contre toute attente – est la conception d’un Flaubert sur la lecture féminine. Confrontant l’éducation prodiguée par l’auteur à sa nièce Caroline à Madame Bovary et Bouvard et Pécuchet, Stéphanie Dord-Crouslé met en lumière une théorie sur l’éducation des filles où la lecture joue un rôle de premier plan. Conçue comme une activité intellectuelle exigeante, elle convient aux jeunes filles, à condition que leur tempérament s’y prête. La réussite de l’éducation par la littérature n’est pas conditionnée par le sexe, mais par les qualités individuelles innées. Cette vision élitiste s’accompagne d’une réflexion sur les « bonnes lectures » : aucun livre ne saurait être obscène s’il est bien écrit. Chez Balzac, comme l’analyse Jérémie Alliet, c’est, en définitive, le rêve d’un lectorat « bi-genré » qui détermine le discours sur la lecture des femmes. La représentation romanesque de la lectrice est paradoxale. À la fois tributaire d’une vision stéréotypée des compétences lectorales et destinataire du roman – donc, habile –, elle contribue à construire un narrataire androgyne, à la fois féminin et masculin.
Cette remise en cause des partages sexués est également affaire d’âge, de classes sociales et de raisons éditoriales.
Comparant les ouvrages destinés aux filles des classes laborieuses de Mme Campan et de Marie Pape-Carpentier au Journal des demoiselles, Béatrice Bloch montre que la littérature des grands auteurs est accordée aux petites filles des classes modestes, tandis qu’elle est refusée aux jeunes filles, à qui sont proposés des récits qui leur sont moralement et socialement utiles. Pour autant, de manière détournée, ces récits se rattachent à une certaine veine romanesque, dans le Journal des demoiselles notamment. Si le roman est refusé aux jeunes filles des classes populaires, il ne le serait pas entièrement aux jeunes bourgeoises.
De son côté, Céline Zaeppfel, montre que l’institutionnalisation scolaire des fables de La Fontaine, au début du xixe siècle, entraîne une vaste production éditoriale de fabliers illustrés, dont tout un pan est exclusivement et explicitement destiné au public féminin. Or, souligne-t-elle, si les fabliers féminins inscrivent l’apprentissage et la lecture dans un enseignement transmis essentiellement par les femmes, ils emploient en fait les mêmes codes et s’appuient sur les mêmes auteurs – majoritairement masculins – que lorsqu’ils s’adressent aux garçons. Cette ambivalence, qui peut laisser envisager des logiques d’appropriation imprévues, est une caractéristique récurrente des ouvrages adressés aux femmes.
Ainsi, Marion Mas souligne les ambiguïtés à l’œuvre dans un corpus d’anthologies de littérature destinées aux jeunes filles. Tout en déployant un discours topique sur la nature féminine et le rôle social des femmes, ces anthologies cartographient un imaginaire pédagogique valorisant l’exercice individuel du jugement et même, à la marge, l’imagination romanesque. Avec une visée plus explicitement émancipatrice, le journal La Fronde, qu’étudie Zoé Commère, révèle les mêmes tensions à la fin du siècle. Exclusivement rédigé par des femmes, le journal radicalise les positions républicaines : défendant des lectures variées, il valorise le rôle d’épouse et de mère, tout en proposant une réflexion sur l’accès des femmes à la vie professionnelle et sur leur place dans l’espace public. Enfin, Caroline Raulet-Marcel analyse la manière dont les nouvelles de Marie Mennessier-Nodier, publiées entre 1833 et 1837, tout en contribuant à les construire, font confiance aux compétences interprétatives des lectrices. Orientés vers le bonheur conjugal, ses récits déconstruisent, dans le même temps, un certain nombre de stéréotypes romanesques que l’autrice attribue à un héroïsme masculin aveugle aux aspirations féminines :
Se déploie ainsi un espace interprétatif permettant aux jeunes personnes de se forger une conscience critique d’elles-mêmes en tant que futures femmes mais aussi en tant que lectrices de romans39.