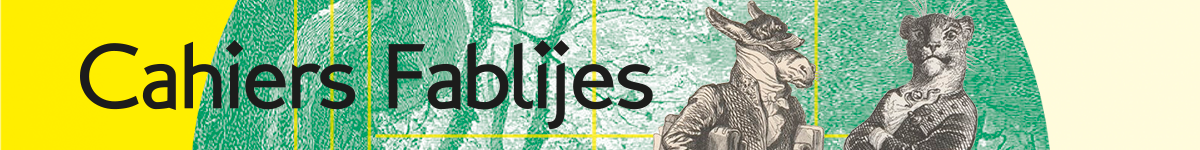Au xixe siècle, selon Martine Reid, la littérature est un lieu d’expression manifeste des consensus sociaux, politiques et religieux, qui divisent en fonction des sexes les sphères d’activité et les domaines de compétences1 : « aux hommes la création artistique et les œuvres de l’esprit, aux femmes, dans la sphère privée, l’exercice de leurs qualités d’épouses et de mères2. » Or, le xixe siècle est aussi celui du développement de l’enseignement des jeunes filles, et de l’enseignement secondaire féminin, qui se met en place dès la Restauration, avec les congrégations et les pensionnats, et se structure hors de l’intervention de l’État dès le Second Empire3. Si le contenu de « l’éducation utile aux femmes » fait débat, en revanche, un consensus existe, dès après la Révolution, sur le sérieux requis par cette éducation, et sur le fait qu’une demoiselle bien éduquée doit être familière des lettres, de l’histoire, des sciences naturelles, des langues étrangères, de la couture et des talents4. Ainsi, Nodier écrit-il, dans la préface du Livre des jeunes personnes :
Il faut cependant que vous lisiez, et que vous lisiez beaucoup, car vous ne pouvez mieux arriver que par la lecture à la perception du beau, et mieux vous préparer que par elle aux épreuves de la vie5.
Il n’est pas étonnant, dans un tel contexte, de voir s’ouvrir, dès les années 18306, un grand marché des manuels7 scolaires, des manuels de littérature et des anthologies à destination de publics spécialisés – les jeunes gens et les jeunes personnes en l’occurrence. C’est aux anthologies que nous nous intéresserons, c’est-à-dire, à des recueils de textes littéraires choisis (et non aux cours de rhétorique ou de lecture courante8), explicitement adressés9, et à vocation éducative tout aussi explicite – cette dimension étant précisée dans la préface, ou visible dans le contenu de l’ouvrage, car présentant des éléments relevant de savoirs sur la littérature.
Discours adressé, les anthologies pour jeunes filles bourgeoises10 dressent, en creux, des portraits de lectrices et cartographient les relations des femmes à la lecture et à la littérature. Cependant, ces anthologies sont également prises dans un mouvement plus général de scolarisation11 de la littérature. Dès lors, on peut se demander si elles déterminent une littérature féminine et une lecture féminine de la littérature, et jusqu’où le cadre scolaire infléchit ou non cette délimitation. Autrement dit, dans quelle mesure ces anthologies sont-elles organisées par un discours de la division et de la hiérarchie des sexes ? Dans quelle mesure en sont-elles l’expression ? Et dans quelle mesure le reformulent-elles ? Ces questions seront abordées au regard d’un corpus s’étendant de la monarchie de Juillet à la Troisième République.
Le choix d’une périodisation vaste s’est imposé à la lecture des sources comportant, logiquement, un nombre beaucoup plus important d’ouvrages pour la Troisième République que pour les périodes antérieures. Or, un premier examen12 a mis en évidence une relative unité dans la composition et le choix des textes des anthologies des années 1880, alors que nombre de celles de la monarchie de Juillet, du Second Empire et des débuts de la Troisième République se démarquent par leur singularité. Il a donc paru intéressant de mettre en relief les contrastes des discours sur la littérature pour jeunes filles, qui, sur le long terme, semblent révéler une tendance à l’homogénéisation13. Cinq anthologies serviront plus particulièrement de jalons à cette étude : Le Livre des jeunes personnes de Charles Nodier (1838) ; les Lectures pour les jeunes filles ou leçons et modèles de littérature en prose d’Amable Tastu (1840) ; le Trésor littéraire des jeunes personnes de Joseph Duplessy14 (1862) ; les Morceaux choisis de littérature française de Jules Grisot (1884) ; et les Morceaux choisis de littérature française de Charles Lebaigue (1887)15. Les auteurs des trois premières – écrivains renommés pour ce qui concerne Charles Nodier et Amable Tastu – présentent leurs ouvrages respectifs comme un cours complet de littérature à partir de longs extraits de textes qui font la part belle à la littérature contemporaine. Les deux livres intitulés Morceaux choisis, qui se présentent également comme un cours, mais à partir d’extraits relativement brefs, sont écrits par des professeurs prolifiques, et ont connu un nombre important de rééditions.
Les anthologies pour jeunes personnes : définition d’une littérature féminine ?
Les auteurs et autrices des anthologies circonscrivent explicitement leur public, par des adresses directes et indirectes, et le caractérisent. Ainsi, les préfaces des anthologies soulignent-elles la haute moralité des ouvrages et leur conformité à la bienséance. Dans son Cours complet de littérature : à l’usage des pensionnats de jeunes filles (1870), une religieuse anonyme avertit par exemple que son corpus de textes et de devoirs a été choisi « avec un soin scrupuleux, une sage prudence. […] rien qui puisse […] offenser les mœurs [ni] donner même des alarmes à la plus sévère modestie16. » En creux, cette déclaration s’arrime au topos des dangers de la lecture, qui seraient plus importants pour le sexe faible, naturellement enclin à glisser sur les pentes périlleuses de l’imagination17. Jules Grisot convoque, lui aussi, la sensibilité particulière aux femmes, mais en lui conférant une signification un peu différente. S’adressant à la fois aux garçons de l’enseignement secondaire spécial et aux jeunes filles dans ses Morceaux choisis de littérature française (1884), il affirme que si certaines subtilités langagières sont interdites à ses élèves, faute de la connaissance du grec et du latin, ils peuvent néanmoins accéder à l’endroit « où se révèlent l’esprit et le cœur de l’écrivain18 » et précise :
Cela est peut-être encore plus vrai pour les jeunes filles. Elles ont un tact naturel, une délicatesse instinctive, qui supplée en mainte occasion aux connaissances acquises. Quelquefois même, l’ignorance des littératures anciennes donne à leurs impressions et à leurs jugements je ne sais quoi de naïf, de frais et de spontané, qui n’est pas sans influence sur la formation du sens littéraire19.
En essentialisant la nature féminine, chez qui le cœur supplée à la culture, il propose aussi une définition de la littérature comme art de la sensibilité, avec qui les jeunes filles entretiendraient des affinités particulières. Toutefois, comme le rappelle Nodier, la lecture de littérature vise la formation du goût dans un but essentiellement mondain : il s’agit pour lui d’initier ses lectrices,
autant que cela convient à des jeunes personnes bien élevées, dans la société où [leur] éducation [les] appelle, aux secrets les plus délicats du bon style et à l’appréciation comparée des plus beaux talents20.
Les discours préfaciels ne sont donc guère originaux : ils coïncident avec les paradoxes relevés par les historiennes de la lecture et de l’éducation des femmes21 sur le consensus global concernant la nécessité de faire lire les filles, mais dans certaines limites : lire de tout, mais peu, variante du « multum, non multa » (lire beaucoup, mais toujours les mêmes livres) qui oriente la pédagogie universitaire aussi bien que privée ou congréganiste, pour les deux sexes, tout au long du xixe siècle22.
La spécialisation du discours se manifeste également à travers les corpus : les genres littéraires proposés à la lecture des jeunes filles et leur définition, mais encore la distribution des auteurs et des autrices en fonction de ces genres, figurent une partition sexuée de la littérature. Or, celle-ci ne coïncide pas toujours avec ce que l’on pourrait attendre.
Bien que les anthologies proposent des textes variés et assez distincts les uns des autres, quelques lignes de force se dessinent : l’histoire, les sciences naturelles, la philosophie et la morale, l’éloquence sacrée ou la poésie dramatique sont essentiellement illustrées par des auteurs masculins. Cette distribution renvoie aux représentations sexuées organisant le champ social et littéraire : les femmes s’illustrent « naturellement » dans des genres subalternes et voués à l’éducation – la littérature de jeunesse ou la littérature pédagogique – tandis que les hommes occupent le terrain de la création et de la pensée rationnelle23. Ainsi, nombre d’anthologies24 réservent aux auteurs les disciplines exigeant un effort d’abstraction ainsi que celles tournées vers la vie publique (philosophie, morale, histoire, sciences), tandis qu’elles cantonnent les autrices dans le genre épistolaire, où Mme de Sévigné a la vedette, et la poésie familière (avec Marceline Desbordes-Valmore par exemple, fréquemment mise à l’honneur).
Cependant, cette tendance ne fait pas loi. Par exemple, dans la section « morale » de ses Lectures pour les jeunes filles, Amable Tastu donne voix à neuf autrices sur vingt-et-un auteurs en tout, chose assez inhabituelle, ce domaine étant généralement illustré par les moralistes du Grand Siècle et les orateurs chrétiens. Rendant visibles des femmes essayistes qu’elle présente implicitement comme des maîtresses à penser, Amable Tastu signale à la fois que les femmes font de la littérature aussi valable que leurs illustres homologues masculins qu’elles côtoient (Pascal, d’Aguesseau, La Bruyère, Bossuet, Massillon), et que cette littérature qui fait penser est valable pour les jeunes filles. Ce parti pris n’est pas majoritaire, et il doit évidemment beaucoup à la personnalité de son autrice. Cependant, il n’est pas isolé. Quelques anthologies estiment devoir faire place « à la plus belle moitié du genre humain25 », ainsi que le revendique le Trésor littéraire des jeunes personnes de Joseph Duplessy, publié chez Mame en 1862, et composé uniquement de textes de femmes. Mais comme l’indique Martine Reid, ce genre de démarche est ambivalent26. Ainsi, le discours préfaciel compare l’ouvrage destiné à « compléter l’instruction littéraire » des jeunes filles à « une gracieuse corbeille de fleurs » réunissant les noms des femmes auteurs « les plus célèbres, depuis le xiiie siècle jusqu’à nos jours27 ». L’image renvoie certes à une longue tradition littéraire (dans l’antiquité grecque, les recueils de pièces lyriques choisies comparaient celles-ci à des fleurs) et à un usage propre du terme « anthologie », qui désigne, en botanique, une collection de fleurs choisies. Cependant, en contexte, dans le Trésor littéraire des jeunes personnes, la comparaison peut également suggérer que la littérature, dès lors qu’elle concerne les femmes – qu’elles la fassent ou qu’elles la lisent –, a un statut d’ornement. En outre, elle inscrit la littérature dans un circuit fermé : les femmes écrivent pour les femmes, et pour les femmes seulement, qui lisent des écrits de femmes – en somme, la littérature faite par des femmes garantirait sa moralité. Peut-être s’agit-il aussi d’une opération stratégique de la part de l’éditeur chrétien28, à une période où l’Église poursuit sa stratégie de reconquête des âmes par la lecture féminine29, avec tous les paradoxes que cela induit, comme, par exemple, la valorisation du roman30.
En effet, par-delà l’ambivalence relevée, l’un des aspects remarquables de cette anthologie est d’offrir aux jeunes filles des textes d’auteurs contemporains et notamment, d’auteurs de romans. Cette singularité est d’autant plus notable que le privilège donné à la littérature contemporaine et au genre romanesque, quasi absent des anthologies masculines, est loin de concerner le seul éditeur chrétien. Charles Nodier, Amable Tastu, Mme Chapelot ou Émile Julliard31 revendiquent de tels choix. Juillard affirme par exemple :
J’ai essayé de me mettre à l’unisson de mon temps et d’offrir aux élèves un cours qui, tout en leur inspirant une vive admiration pour la saine et robuste littérature des classiques, ne leur enseignât pas l’injustice et le mépris envers la littérature si riche et si pittoresque de notre siècle32.
Condamné comme genre dangereux, propre à développer une curiosité malsaine dans le Cours complet de littérature : à l’usage des pensionnats de jeunes filles33, le roman fait au contraire l’objet d’une description poétique et historique chez Amable Tastu34 et Émile Julliard35. Tandis que ce dernier cite en exemple Lesage, Bernardin de Saint-Pierre, François-René de Châteaubriand, Germaine de Staël, Victor Hugo, Alfred de Vigny, George Sand, Honoré de Balzac ou Octave Feuillet, les anthologies de Charles Nodier, Amable Tastu et Joseph Duplessy accueillent des textes de ces mêmes écrivains, mais encore de Jules Michelet, Édouard Laboulaye, Alphonse Karr, Paul de Kock, Prosper Mérimée, Alphonse de Lamartine, Louise Colet, Casimir Delavigne, Jean-Anthelme Brillat-Savarin ou Théophile Gautier, alors que les Morceaux choisis de Lebaigue et ceux de Grisot donnent timidement voix à Lesage, Mme de Staël et Musset, et dans des extraits très courts. En fonction des anthologies, les extraits de romans donnés à la lecture sont très variés dans leur longueur et dans leur teneur (ils peuvent aussi bien servir un discours moral qu’exciter l’imagination romanesque). Ces choix, que nous analyserons plus précisément, tiennent notamment à l’auteur ou à l’autrice de l’anthologie, à la période et au contexte d’écriture. Toujours est-il que les anthologies féminines sont globalement beaucoup plus audacieuses, dans leurs contenus, que celles destinées aux garçons.
Comment l’interpréter ? Et comment comprendre la discordance entre certaines préfaces et le corps des ouvrages – en particuliers ceux de Charles Nodier, Amable Tastu et Joseph Duplessy ? S’agit-il d’une volonté des éditeurs et des auteurs de se démarquer, dans un secteur de plus en plus concurrentiel ? Cette audace tient-elle simplement pour Amable Tastu et pour Charles Nodier, à leur qualité respective de femme et d’homme de lettres soucieux de l’éducation féminine36, et désireux de faire découvrir aux jeunes lectrices l’art littéraire contemporain ? Le caractère relativement conventionnel des préfaces pourrait alors se lire, de manière tout à fait classique, comme la volonté de rassurer les éducateurs, à qui ces textes sont destinés au premier chef, bien que les auteurs élaborent la fiction d’une adresse directe à la jeune fille en apostrophant leur « jeune amie ». Toutefois, le cas reste assez énigmatique pour le Trésor littéraire des jeunes personnes de Duplessy, où l’écart entre les intentions édifiantes de la préface et certains extraits du corpus est criant. S’agit-il là d’inadvertance ? de duplicité ? Ou alors de l’assurance que les pratiques de lecture, à haute voix37 ou dans le cadre scolaire, permettent un contrôle suffisant pour désamorcer les dangers du roman ?
Bien qu’il soit difficile de trancher, il semble en tous les cas certain qu’en l’absence de structuration étatique de l’enseignement secondaire féminin, une assez grande liberté est permise, laissant place à des représentations contrastées. Analysant l’enseignement secondaire féminin sous la Troisième République, Antoine Prost38 constate qu’il est dans une certaine mesure beaucoup plus novateur que celui des garçons en termes de disciplines enseignées et de méthodes pédagogiques. Il semble possible de faire un constat analogue pour les anthologies à destination des jeunes filles sous la monarchie de Juillet et le Second Empire. Non soumises à l’enseignement des humanités, elles peuvent s’écarter du canon des auteurs à imiter39 imposé par les programmes scolaires masculins. En outre, elles peuvent se donner comme « ouvrage[s] d’agrément40 » et proposer des pratiques de lecture relativement libres : incitant très fréquemment à la comparaison de textes entre eux41 ou mettant simplement en relief leur diversité de composition42, elles invitent au feuilletage. Cependant, si elles ne sont pas soumises au même degré de « scolarisation » que les ouvrages pour garçons, les anthologies pour jeunes filles demeurent des ouvrages scolaires et participent d’un discours scolaire sur la littérature, plutôt conservateur. Dès lors, il s’agit d’examiner si et dans quelle mesure les audaces relevées en matière de corpus modifient la définition à l’œuvre de la littérature et si et comment, en retour, sa conception scolaire transforme l’approche genrée que l’on a pu observer, et la définition des « bonnes lectures » féminines.
La littérature des anthologies : littérature pour jeunes filles ou littérature scolaire ?
La lecture demeure un domaine très contrôlé, y compris pour les garçons, comme le rappelle André Chervel : jusqu’à la Troisième République,
le discours scolaire sur la lecture ne se distingue guère du discours de l’Église […] le jeune homme doit se défier de lui-même dans le choix de ses lectures […]. Il faut fuir les lectures qui dépriment la volonté et énervent l’âme43.
De là, la méfiance par rapport au roman et à la littérature contemporaine. Bien que cette dimension appelle des nuances, on l’a vu, pour les anthologies à destination des jeunes filles, celles-ci font valoir une conception de la « littérature-discours », c’est-à-dire, selon Alain Vaillant, une littérature envisagée comme une parole virtuellement adressée à un destinataire et destinée à le convaincre44, tout à fait conforme au modèle scolaire de la littérature, où les perspectives rhétorique et « belle-lettriste45 » restent dominantes. En témoignent les objectifs affichés d’apprentissage des « préceptes de l’art d’écrire, préceptes tirés de l’étude des bons auteurs46 », la référence récurrente à Buffon pour définir la littérature comme modèle du « bien penser, bien sentir et bien rendre », et l’association étroite de la littérature et de la morale dans les discours préfaciels. Ernest Duthar (à l’instar de Joseph Duplessy), affirme par exemple à ses destinataires : « C’est la morale et la religion que vous avez essentiellement en vue […]. / Tout le plan de notre recueil est dans ce peu de mots47. » Cette préoccupation figure également dans les ouvrages destinés aux garçons. Par exemple, Charles Lebaigue affirme que « le système des morceaux choisis [devient] un puissant moyen d’éducation, lorsqu’il réunit et met en lumière les théories morales les plus éloquentes et les plus propres à familiariser les jeunes gens avec l’idée du bien et le sentiment du devoir48 ». Si le principe de l’anthologie obéit à une exigence de perfection permettant de sélectionner le meilleur, il permet également d’écarter les passages et les livres dangereux.
Pour autant, les auteurs d’anthologies créditent également le système des morceaux choisis d’une valeur pédagogique. En premier lieu, ils seraient particulièrement adaptés à un destinataire (fille ou garçon) qui, en raison de son jeune âge, ne serait pas encore capable de soutenir de longs raisonnements ou qui pourrait manquer de culture et de discernement pour apprécier les ouvrages entiers. En second lieu et surtout, dans le corpus pour jeunes filles et jeunes garçons de l’enseignement secondaire spécial, les auteurs mettent l’accent sur la formation intellectuelle permise par leurs recueils : Amable Tastu annonce vouloir « exercer » le « jugement » de ses lectrices « en multipliant les occasions de comparer49 ». C’est la même volonté qui justifie l’absence de notes et de commentaires : il s’agit de laisser la possibilité aux jeunes filles de former leur goût et leur esprit en se demandant pourquoi tel morceau leur plaît ou leur déplaît. Quelques années plus tard, Grisot ne dit pas autre chose, tout en insistant sur la communauté du corpus à destination des garçons et des filles :
Quel motif plausible aurions-nous de ne pas mettre entre les mains de nos filles un recueil de morceaux que le public a jugés dignes d’être présentés à nos fils comme des modèles de raison, de sentiment et d’expression ? Est-il un plus pur et plus puissant moyen d’exercer leur mémoire, leur raisonnement, leur goût, leur imagination et leur sensibilité ? Concentrer leur attention sur des pièces de choix, assez courtes pour être apprises par cœur ou lues d’une seule traite, assez longues pour offrir un développement suivi et achevé, les habituer à en dégager la pensée générale, à saisir la portée et l’effet de chaque détail, en un mot, leur proposer ces fragments comme des sujets de réflexion et des exercices d’analyse, n’est-ce pas les préparer graduellement à lire avec intelligence et avec fruit les ouvrages de longue haleine50 ?
À lire ces extraits de préfaces, la littérature apparaît comme un domaine de savoir particulièrement intégrateur, où s’estomperaient les différences de genre qui organisent pourtant l’espace social et éducatif.
Il est également possible de comprendre dans cette perspective le métissage entre rhétorique, belles lettres et histoire littéraire caractérisant les anthologies féminines, qui suivent en cela les manuels pour garçons et des pratiques scolaires en avance sur les programmes officiels51. Dans le corpus, la littérature fait l’objet de définitions plus ou moins étendues, qui signalent des hésitations entre une conception restreinte, comme « art du bien dire », et une conception large, comme ensemble de connaissances générales sur les textes. Si les anthologies de la monarchie de Juillet semblent privilégier une approche de la littérature comme science fondée sur la poétique et la rhétorique, progressivement, les ouvrages intègrent des notices sur la vie et le style des auteurs. Ainsi, tous les textes du Trésor littéraire des jeunes personnes sont situés dans la production d’ensemble de leurs autrices. Les Morceaux choisis de littérature française de Grisot comportent une série de notices raisonnées des auteurs mentionnés, chacune d’entre elles étant composée de manière identique : quelques notations biographiques, la liste des genres dans lesquels l’auteur s’est démarqué, les titres de ses ouvrages les plus importants, et un commentaire sur les « caractéristiques [de son] talent » et la qualité de son « style ». Or, cette coexistence reflète la bataille qui se joue entre rhétorique et histoire littéraire dans les programmes scolaires et dans les examens pour les garçons52. Autrement dit, les cours de littérature destinés aux jeunes filles suivent l’évolution de l’éducation littéraire proposée aux garçons et leur rendent accessibles des savoirs similaires. Ils déterminent notamment des apprentissages liés à l’écriture et à la composition. Par exemple, en 1860, dans son Cours élémentaire de rhétorique française, Honorine Lèbe-Gigun affirme que son ouvrage est à la fois destiné à mieux lire et à mieux écrire :
On entend dire quelquefois : « À quoi bon faire étudier aux jeunes personnes les principes de la logique et de la rhétorique ? N’est-ce pas pour elles une peine inutile ? elles ne sont pas destinées à parler en public. » Cela est vrai en général, mais non sans exception ; ainsi par exemple, celles qui désirent se vouer à l’enseignement, n’auront-elles pas, dans cette carrière, à développer verbalement divers sujets, à corriger des extraits, des compositions, et ne devront-elles pas exercer leur critique sur la forme et sur le style, comme le fond et la substance des devoirs faits par leurs élèves ? […] Enfin, quand les jeunes personnes n’auraient lieu d’appliquer les préceptes de la logique et de la rhétorique qu’à leurs lettres, à leurs lectures et dans la conversation, elles en reconnaîtront l’utilité : ces préceptes compléteront pour elles l’étude qu’elles ont commencée dès leurs premières années, celle de la Langue française53.
Ce texte montre comment peut être pensé un usage domestiqué de la rhétorique, à la fois comme dérivatif aux mauvaises lectures, et comme perfectionnement d’une éducation mondaine où l’épistolaire et la conversation jouent un rôle important. Pour autant, la prise en compte de la professionnalisation, avec toutes les ambivalences que comporte cette question, et la possibilité, tout simplement, de rendre les femmes aptes à composer des discours, inscrit l’enseignement de la littérature au cœur des « savoirs-frontières » analysés par Bénédicte Monicat54, qui montre comment certaines pratiques de lecture et d’écriture catégorisées comme féminines donnent obliquement accès à des domaines réputés masculins, en l’occurrence ici, l’exercice autonome de la raison et l’art du discours. L’anthologie d’Ernest Duthar, destinée aux « pensions de garçons et de jeunes personnes », semble le confirmer lorsqu’il écrit dans la préface : « de temps en temps, nous avons donné des pièces d’un caractère un peu grave sur les devoirs de l’homme et du citoyen, aussi bien que sur les hautes vérités de la religion et de la morale55. » Cette déclaration, assortie d’un corpus très canonique56, ouvre sur le domaine politique de la vie publique, à une période où la figure de la mère chargée de former des citoyens, prégnante sous Napoléon Bonaparte, a pourtant été remplacée par une focalisation sur les devoirs domestiques de la femme57. De la même façon, dans la section « morale » de son ouvrage, Amable Tastu offre à ses lectrices une série de discours politiques sur la question de la guerre et de la paix :
- Mirabeau, « Exorde du discours sur l’exercice du droit de la paix et de la guerre » ;
- Vergniaud, « Discours sur les massacres de septembre 1792 » ;
- Paul-Louis Courier, « Aux ministres des puissances étrangères58 ».
En donnant à lire une histoire politique toute récente, Amable Tastu excède sans doute le domaine des « connaissances utiles » aux jeunes filles – dont le contenu précis n’est jamais défini mais peut être apprécié à partir des arguments donnés en faveur de l’éducation des filles : la nécessité d’éduquer leurs fils, la nécessité d’orner leur esprit, la nécessité d’être de bonnes partenaires intellectuelles de leur mari59.
Si la forte présence du roman dans les anthologies pour jeunes personnes ne semble pas avoir d’influence novatrice sur la conception générale de la littérature, qui demeure conservatrice, celle-ci, en revanche, a des effets paradoxaux sur le partage sexué des savoirs et des domaines de compétences. En effet, la scolarisation de la littérature par les morceaux choisis revient à accorder une importance étonnante à la formation de l’esprit et de l’intelligence, en dehors de toute considération sur la finalité domestique de cet apprentissage, qui prévaut pourtant dans les discours contemporains sur l’éducation, et au détriment du discours sur les dangers de la lecture. En outre, les anthologies, comme le cours de littérature, se donnent comme de possibles espaces d’appropriation de domaines socialement et symboliquement réservés au masculin.
Les anthologies pour jeunes filles : un espace possible d’émancipation ?
Dans ces conditions, peut-on considérer que les anthologies pour jeunes filles constituent un espace d’affranchissement intellectuel et de subversion des normes de genre liées à la lecture ? La réponse appelle des nuances : outre la difficulté à évaluer l’impact réel des lectures sur les jeunes filles, la tendance, sur le long terme, semble être celle d’un contrôle renforcé sur le contenu des lectures. C’est ce qu’il s’agit d’observer à présent.
La monarchie de Juillet constitue une période de débat important sur les relations familiales et sexuées. Tandis que les plumes féministes remettent en cause les prémisses inégalitaires de l’idéal familial bourgeois, le clergé s’efforce de conférer à la maternité une dimension morale et religieuse ; tandis que s’élabore « un discours moralisateur qui circonscrit le comportement féminin convenable dans un espace spécifique, contribuant à l’établissement de rôles sexués de plus en plus distincts60 », se développe la revendication d’une émancipation par l’éducation et l’accès à certaines professions. En tout état de cause, qu’il s’agisse de préparer les femmes à leurs missions domestiques ou d’améliorer leur condition, la question de l’éducation des jeunes filles est centrale.
Ainsi, en dépit des déclarations de la préface, et en dépit du petit nombre d’autrices sélectionnées, le corpus des deux éditions du Livre des jeunes personnes paraît bien moins relever d’une perspective genrée que de préoccupations esthétiques et culturelles. En effet, Nodier propose un panorama très complet et très moderne de la littérature, qui ne se distingue pas par ses qualités d’édification : les morceaux d’éloquence chrétienne sont peu nombreux et se signalent pour la beauté du style. Surtout, ils côtoient des auteurs contemporains et notamment des auteurs de romans, (Balzac, Mérimée, Hugo, etc.), y compris de romans populaires (Sue, de Kock). Les extraits proposés, souvent longs (une nouvelle entière pour Paul de Kock ou pour Samuel Berthoud par exemple), font la part belle au romanesque et au divertissement et, sans être immoraux, ils ne sont pas particulièrement moraux. L’extrait du Lys dans la vallée relate la mort de Mme de Mortsauf et fait allusion à son amour pour Félix ; dans la nouvelle de Paul de Kock, un homme se sert de son ami pour courtiser sa cousine. Nodier donne également à lire Montaigne, ce qui est tout à fait singulier, ainsi qu’un texte de Jean-Jacques Rousseau sur la condamnation du suicide, sujet peu commun dans une anthologie pour jeunes filles. Ces choix très libéraux dressent le portrait d’une lectrice émancipée.
Plusieurs facteurs peuvent les expliquer : la position de Nodier dans le champ littéraire, sa qualité d’écrivain et ses amitiés littéraires. Surtout, ils semblent tenir à sa réflexion sur l’éducation des femmes, particulièrement importante dans les années 1830. Comme le montre Jacques-Rémi Dahan, ses convictions en la matière, non dénuées de paradoxes, se fondent sur une vision sexuée des rôles sociaux et présupposent une nature féminine dont la destination première est domestique. Cependant, Nodier se distingue de cette représentation commune en affirmant que les femmes sont spirituellement supérieures aux hommes, ce qui implique :
Une instruction plus étendue et plus variée qui les initie jusqu’à un certain point aux jouissances que l’étude des sciences procure, sans les égarer toutefois dans les voies maussades du pédantisme ; c’est [une éducation] qui les porte à exercer assidûment les brillantes facultés d’une imagination plus vive et plus déliée que la nôtre, d’une sensibilité plus délicate, plus fine et plus universelle […]61.
Tout en s’inscrivant dans un argumentaire traditionnel conservateur, Nodier valorise une éducation de l’imagination, qui pourrait peut-être expliquer la part accordée au romanesque dans son anthologie. Par-delà, le soin qu’il accorde à l’instruction et à la formation intellectuelle de sa fille signale que les limites assignées aux jouissances de l’étude, pour les femmes, sont souples. Dans ses mémoires, Marie Mennessier-Nodier écrit en effet que son père la conduit à la Société des belles-lettres et au théâtre des Variétés62, et l’on sait le rôle actif qu’elle joue au salon de l’Arsenal, du reste qualifié « d’écrin féminin63 » par Vincent Laisney.
Comme Nodier, Amable Tastu propose à ses lectrices un ouvrage riche et varié, qui définit en creux les bonnes lectures comme celles qui nourrissent l’imagination et l’intelligence. L’anthologie inclut un nombre important d’autrices, on l’a vu, mais également des auteurs et autrices contemporains, de longs extraits de romans ou de nouvelles (par exemple « L’Église du verre d’eau », de Samuel Berthoud et « Mateo Falcone », de Mérimée), des textes d’histoire, des récits de voyages, des pages de sciences naturelles et même, des connaissances industrielles, comme un long texte de Jules Janin sur les chemins de fer. Plus particulièrement, la section « morale » est consacrée, pour moitié environ, à des textes traitant de la place des femmes dans la société, de leur pouvoir et de leur éducation. Ceux-ci, émanant majoritairement d’autrices, exposent des visions contrastées sur la question. Par exemple, la succession de « Pensées sur les femmes » de Mme Necker, d’un texte de Pauline de Meulan, dite Mme Guizot, intitulé « Sur les femmes » et de « Pensées » de Cécile Fée met en débat l’existence d’une nature féminine, et de devoirs particuliers aux femmes. Alors que le texte de Suzanne Necker adopte une position médiane, postulant que la différence entre hommes et femmes tient essentiellement à l’éducation et à la nature des objets dont on occupe l’esprit des uns et des autres, tout en reconnaissant des qualités proprement féminines, celui de Cécile Fée prône une destinée et un bonheur domestiques, tandis que celui de Pauline Guizot, posant que la différence entre hommes et femmes relève de la culture et des mœurs, propose une leçon de politique féminine : dissimuler pour avoir le pouvoir. Plus loin, un autre texte de Pauline Guizot développe ces principes dans le cadre domestique. Les écrits qui suivent prolongent le débat sur le même modèle, en abordant notamment la question des bornes – ou de l’extension – de l’instruction des femmes. Cette manière de procéder révèle une haute idée de la lecture : grâce à cette savante organisation, Amable Tastu donne à sa jeune lectrice les moyens de prendre part en toute intelligence à un débat d’actualité qui la concerne au premier chef.
Les sources consultées sont beaucoup plus réduites pour la période du Second Empire. Toutefois, le Trésor littéraire des jeunes personnes de Joseph Duplessy, mérite qu’on lui accorde de l’attention : par la dissonance étonnante et amusante qu’elle présente entre le discours préfaciel et son contenu, l’anthologie révèle l’existence possible d’espaces de liberté, à une époque où la valorisation de la figure de la femme au foyer atteint pourtant son apogée. Publiée chez Mame dans la collection « Jeunesse chrétienne », cette anthologie, on l’a vu, affirme vouloir rendre justice aux femmes auteurs. Le discours préfaciel insiste sur la dimension respectable de l’ouvrage, qui, même s’il n’exclut pas « les aimables fictions qui distraient du sérieux et de l’étude64 », a toujours « en vue la religion et la morale, dans lesquelles se résument toutes les connaissances nécessaires à la société, [et] qui doivent surtout occuper la première place dans un livre consacré à la jeunesse65 ». À cet égard, Duplessy indique que les notices de présentation des autrices ont dû faire l’objet d’une censure :
Nous avons cru utile de faire suivre chaque nom d’auteur d’une courte notice qui indique sommairement les faits notables de sa vie, la nature et les sujets de ses œuvres. Malheureusement, il est peu de celles-ci dont la lecture puisse être permise à de jeunes personnes : on le verra au petit nombre que nous avons pu recommander sans restriction66.
Or, la présentation des autrices et des textes attise précisément le goût de l’interdit. C’est le cas par exemple pour George Sand, à qui l’anthologie consacre une longue notice :
Quelques années après, la jeune Aurore épousa le baron Dudevant, et elle habitait le château de Nohant avec son mari, en possession d’une belle fortune et d’une honorable position, lorsqu’un jour, c’était au moment de la révolution de 1830, madame Dudevant quitta brusquement époux, fortune et position, et vint à Paris, sans ressources et sans amis, y commencer cette étrange vie qui devait lui faire plus tard, sous le pseudonyme de George Sand, une grande mais bien funeste renommée. Le besoin la fit écrivain, et l’apparition de ses premiers ouvrages produisit une grande sensation ; mais en admirant un mérite littéraire hors de ligne, il n’y eut qu’une voix dans le public sensé, dans le public religieux ou seulement moral, pour flétrir les principes subversifs et les tendances perverses des livres du nouvel auteur. Un autre roman parut, et cette fois dépassant tellement en immoralité, en préceptes destructifs de tout ce qui constitue la famille et la société, ce que George Sand avait déjà publié, qu’un critique, son admirateur cependant, n’a pu s’empêcher de signaler cet ouvrage comme une tache dans la vie de l’auteur. Du reste, tous ses autres écrits proviennent d’inspirations plus ou moins mauvaises, et il n’est pas un seul de ses livres dont la lecture ne soit dangereuse67.
D’une part, la description de la vie aventureuse de l’autrice, d’autre part, l’insistance sur le danger et le caractère subversif de ses écrits, sans les nommer, semble plus propre à susciter le désir de se procurer ces textes que de s’en garder. C’est d’autant plus vrai que si les institutions perpétuent les interdits séculaires en matière de lecture féminine, les correspondances et les journaux intimes des pensionnaires montrent que ces interdits sont déjoués68. La notice consacrée à Germaine de Staël appelle le même type de remarques. De la même façon, le choix de certains textes du corpus surprend. C’est par exemple l’incipit de Mauprat qui a à charge d’illustrer le talent de George Sand. Ce passage fleure le roman noir et attise la curiosité du lecteur. Ce choix est d’autant plus déconcertant que même les plus audacieuses des anthologies étudiées (celles d’Amable Tastu ou de Charles Nodier par exemple) neutralisent la puissance subversive de George Sand en proposant des extraits de scènes champêtres ou des descriptions issues de récits de voyages. On trouve également un extrait assez long d’Ourika de Claire de Duras, et précisément la scène dans laquelle l’héroïne surprend une conversation entre la marquise et Mme de B., qui lui fait prendre conscience de sa condition de noire, de jeune fille éduquée, et donc, de paria, révélation qui engage une réflexion sur la condition féminine. Ces partis pris étonnants peuvent s’expliquer par les particularités de l’éditeur Mame, on en a dit un mot : ayant vocation à conquérir un public et à diffuser un message chrétien par le livre, la collection « Jeunesse chrétienne » noue des alliances contre-nature entre l’Église, le roman et la culture de masse69. De là, peut-être, la présence importante de textes romanesques, et de best-sellers comme Ourika. Toujours est-il que ces tensions ménagent de possibles espaces d’émancipation pour la lectrice.
La période suivante en revanche est marquée par une homogénéisation des corpus, dont la teneur idéologique est perceptible. Régulièrement rééditées sous la Troisième République, les anthologies de Charles Lebaigue et Jules Grisot, auteurs prolifiques d’ouvrages scolaires, le montrent bien. Le roman y occupe une place congrue, les extraits sont courts et généralement conçus comme des pièces de morale en action. Ainsi, les extraits des Morceaux choisis de littérature française de Grisot louent la clémence des Grands (Musset, Le Fils du Titien nouvelle publiée en 1838 dans la Revue des deux mondes), blâment les jugements hâtifs (Lesage, Gil Blas) ou la vanité (Voltaire, Jeannot et Colin). Ou alors, ils ont une valeur documentaire : le texte de Germaine de Staël le plus fréquemment cité est la description de Pompéi figé par la cendre, dans Corinne, ce qui permet, au demeurant, d’ôter toute puissance subversive à l’autrice. Les genres majoritaires en prose sont le conte, les textes satiriques, les chroniques, les lettres, les portraits (y compris les portraits animaliers de Buffon) et les textes historiques. L’ensemble dessine une réflexion de moraliste sur les vertus privées (l’amitié, la vanité, la piété filiale, l’humilité…) et sociales (la flatterie, la tyrannie, l’honneur, les vertus pacifiques, la charité…). En définitive, les matières sur lesquelles Grisot propose aux jeunes filles d’exercer leur jugement circonscrivent les qualités de la mère républicaine : morale laïque, connaissances nécessaires à l’éducation du futur citoyen, valeurs familiales et qualités proprement féminines. De manière symptomatique, l’une des très rares autrices contemporaines à être convoquée, Louise Colet, l’est pour son poème « La voix d’une mère », qui valorise la douceur, l’humilité et le soin. Rebecca Rogers a montré que la Troisième République réactivait le projet élaboré sous l’Empire de former des « mères françaises70 ». À cet égard, l’anthologie de Charles Lebaigue est exemplaire. Les extraits choisis, qui illustrent les thèmes des sentiments familiaux et de la piété filiale, de l’héritage, de la valeur du travail, de la clémence politique, de l’importance de demeurer dans sa condition, de l’éducation des enfants, et de l’amour de la patrie71, sont assortis de commentaires les mettant en valeur, et même, verrouillent l’explication autour de ce substrat idéologique, au détriment parfois de la plurivocité du texte, et au détriment des commentaires esthétiques. La méthode présidant à la conception de l’ouvrage affermit l’entreprise idéologique : les commentaires et les questions invitent régulièrement la lectrice à effectuer des rapprochements thématiques avec d’autres extraits, en soulignant parfois leurs différences de traitement. Ce dispositif a pour but de faciliter et d’orienter la lecture des textes de la deuxième partie, dépourvus de commentaires, mais reprenant les thèmes développés dans la première.
Ainsi, après Sedan, après la loi Camille Sée, lorsque l’enseignement secondaire se structure, en dépit (ou à cause) d’une demande sociale forte d’accès aux professions libérales et à l’université pour les femmes, la littérature scolaire revêt une fonction essentiellement idéologique, que conforte le commentaire, fonctionnant comme une nouvelle forme de contrôle de la lecture.
Les anthologies pour jeunes personnes contribuent à instituer les discours sur la lecture et la littérature en lieux de tensions et de contradictions, en relation avec la place des femmes dans la société et l’évolution de l’enseignement secondaire féminin. Toutefois, si les recueils étudiés présentent la littérature comme un espace possible d’émancipation, il est très délicat d’en appréhender les pratiques réelles d’usage et d’appropriation : une étude reste à faire en ce domaine. Au demeurant, Rebecca Rogers souligne la relative inefficacité de cette culture scolaire. Il n’en reste pas moins que cet ensemble de textes cartographie un imaginaire pédagogique de la lecture, qui valorise l’exercice du jugement, avec la présentation des morceaux choisis comme méthode, et, somme toute, même de manière marginale, l’imagination romanesque.