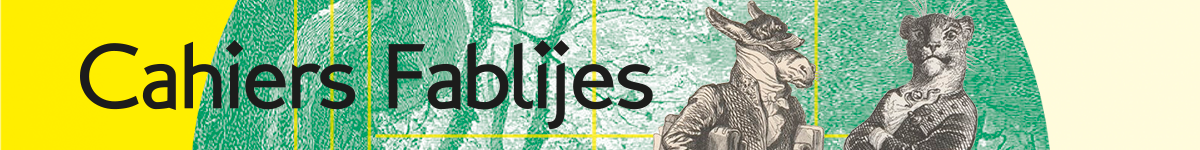Bien que la maturité ait fait sourdre en lui quelques regrets sporadiques1, Flaubert reste dans l’imaginaire collectif le contempteur patenté du mariage et de la famille2. Il suffit de se rappeler son extrême soulagement lorsqu’il lut un beau matin dans une lettre de sa maîtresse Louise Colet le démenti formel d’une hypothétique grossesse3. Pourtant, ce si féroce opposant à toute idée de paternité4 a expérimenté toutes les facettes du rôle de père et d’éducateur à l’égard d’un enfant de substitution : sa nièce Caroline.
Pour mettre en lumière les dimensions constitutives de cet apparent paradoxe, on va voir comment, aux deux extrémités de sa vie d’adulte, les principes que l’homme-Flaubert a professés et mis en pratique dans l’éducation de sa « pauvre chère fille5 » (dans les années 1850) s’articulent avec les recherches documentaires et l’utilisation que l’écrivain a faites (dans les années 1870) des ouvrages de pédagogie consultés pour son ultime roman Bouvard et Pécuchet. Le domaine de l’éducation étant particulièrement vaste, la question de la lecture servira ici de fil conducteur.
L’éducation de Caroline : théorie et pratique
Caroline Hamard naît le 21 janvier 1846. Sa mère, elle aussi prénommée Caroline, est la petite sœur du futur écrivain qui éprouve à son égard « une tendresse particulière6 » jamais ressentie pour le grand frère, Achille, déjà âgé de 8 ans à la naissance de Gustave. Les deux plus jeunes enfants du chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu grandissent ensemble entre les murs de cet hôpital rouennais. La fillette paraît d’abord plus précoce que son aîné de trois ans : elle apprend à lire avant lui alors que les leçons prodiguées par leur mère étaient destinées au cadet. Mais une fois cette étape franchie, Gustave rattrape le temps perdu et se met à instruire Caroline : « il fait d’elle son élève7 ». Cette relation symbolique d’enseignement, doublée d’une profonde affection, se poursuit jusqu’au mariage de la jeune fille en mars 1845. Or, à peine deux mois après la naissance de la petite Désirée-Caroline, sa mère meurt des suites d’une fièvre puerpérale et son père, Émile Hamard, ancien condisciple de Gustave au Collège royal, présente bientôt des signes de démence. La petite fille va donc être élevée par sa grand-mère et son oncle maternels dans la maison de Croisset où ils s’installent alors tous trois, suite au décès brutal du Dr Flaubert quelques semaines avant sa fille.
Gustave s’attache naturellement à une enfant qu’il côtoie quotidiennement et qui lui rappelle, jusqu’au prénom, la jeune défunte tendrement aimée. Tout le pousse à reproduire avec la petite Caroline la relation d’enseignement autrefois expérimentée avec sa propre sœur8, d’autant plus qu’il occupe vraiment cette fois-ci, vis-à-vis de la fillette, la place du père. C’est pourquoi, dès qu’il revient de son long voyage en Orient au début de l’été 1851, Flaubert se met à l’ouvrage, les leçons données à sa nièce lui servant de récréation quotidienne pendant les rédactions successives de Madame Bovary et de Salammbô, comme l’explique Caroline dans ses mémoires :
Mon oncle voulut de suite commencer mon éducation. La gouvernante ne devait m’enseigner que l’anglais ; ma grand-mère m’avait appris à lire, à écrire ; lui se réservait l’histoire et la géographie. Il trouvait inutile d’étudier la grammaire, prétendant que l’orthographe s’apprenait en lisant et qu’il était mauvais de charger d’abstractions la mémoire d’un enfant, qu’on commençait par où l’on devait finir9.
D’emblée, Flaubert avait donc des idées bien arrêtées quant à l’éducation que devait recevoir une petite fille. Caroline donne quelques exemples précis de la manière dont les leçons se déroulaient dans le cabinet de travail de son oncle10, comment il lui fit apprendre « toute l’histoire ancienne, rapprochant les faits les uns des autres, faisant des réflexions à [sa] portée mais restant toujours dans l’observation vraie, profonde11 », et comment il lui enseigna la géographie, non dans les livres, mais grâce aux images qui sont « le moyen d’apprendre à l’enfance12 ». La progression pédagogique semble avoir été soigneusement conçue : bien qu’aucune trace n’en ait été conservée, Flaubert mentionne à plusieurs reprises dans ses lettres les « programmes13 » qu’il établissait régulièrement à destination de sa nièce. Plus tard, il lui enjoignit de prendre des notes et surtout s’occupa de ses lectures. Ses recommandations, telles que les rapporte sa nièce, découlent logiquement des principes esthétiques qu’on lui connaît, en particulier quant à la question de la moralité en littérature :
Il jugeait qu’aucun livre n’est dangereux s’il est bien écrit ; cette opinion venait chez lui de l’union intime qu’il faisait du fond et de la forme, quelque chose de bien écrit ne pouvant pas être mal pensé, conçu bassement. Ce n’est pas le détail cru, le fait brut, qui est pernicieux, nuisible, qui peut souiller l’intelligence, tout est dans la nature ; rien n’est moral ou immoral, mais l’âme de celui qui représente la nature la rend grande, belle, sereine, petite, ignoble ou tourmentante. Des livres obscènes bien écrits, il ne pouvait en exister, selon lui14.
Flaubert interdit en revanche les lectures de simple divertissement15 et, encore plus, le dilettantisme dont son élève pourrait se croire autorisée à faire montre :
Très large certainement dans les lectures qu’il me recommandait, il était cependant fort sévère à ne rien me donner où l’amusement seul eût été mon guide, et ne me permettait jamais de laisser un ouvrage inachevé. « Continue à lire l’histoire de la Conquête, m’écrivait-il, ne t’habitue pas à commencer des lectures et à les planter là pour quelque temps. Quand on a pris un livre, il faut l’avaler d’un seul coup. C’est le seul moyen de voir l’ensemble et d’en tirer du profit. Accoutume-toi à poursuivre une idée. Puisque tu es mon élève, je ne veux pas que tu aies ce décousu dans les pensées, ce peu d’esprit de suite qui est l’apanage des personnes de ton sexe. »
Il tenait à cette discipline intellectuelle, la jugeant fort utile ; son éducation cherchait à l’imprimer le plus possible à mon esprit. Lui, si débonnaire, était sur quelques points très rigoureux ; ainsi il voulait que l’honnêteté d’une femme ne consistât pas seulement dans la pureté de ses mœurs, mais qu’elle y joignît les qualités qu’on exige d’un honnête homme16.
L’esprit humain en devenir doit être pareillement bien formé, qu’il soit celui d’un homme ou d’une femme. Et on peut porter au crédit d’un écrivain, pourtant souvent dénigré pour son apparente misogynie, cette exigence intellectuelle universelle qui refuse d’accorder à une fille – du seul fait de son sexe – une licence d’insuffisance ou un quelconque permis d’ignorance17.
Interlude : les lectures d’Emma
La lecture joue donc un rôle de premier plan dans les principes éducatifs prônés par Flaubert, mais en tant qu’elle est conçue et pratiquée comme une activité exigeante, fort éloignée du simple passe-temps. Aussi la célèbre et emblématique représentante de la lectrice dans la fiction, Emma Bovary, ne ressent-elle aucun des effets positifs attendus d’une fréquentation assidue des livres. Au couvent, les lectures que fait la jeune fille ne nourrissent pas son esprit car le « profit personnel » qu’elle aspire à en retirer, « étant de tempérament plus sentimentale qu’artiste », privilégie « la consommation immédiate de son cœur18 ». Ne cherchant pas dans les livres ce qui pourrait s’en dégager au terme d’une démarche exigeante, Emma est une mauvaise lectrice, elle qui, pendant son adolescence au couvent, a « aimé l’église pour ses fleurs, la musique pour les paroles des romances, et la littérature pour ses excitations passionnelles ». Il aurait peut-être été préférable pour la future madame Bovary qu’elle lise un peu moins – dans la mesure où elle ne pouvait pas lire « mieux ».
En effet, le caractère pathogène de cette consommation littéraire est corrélé avec le « tempérament » d’Emma, qu’aucune entreprise pédagogique n’aurait pu profondément modifier. Telle est la conviction de Flaubert. L’éducation ne peut véritablement porter des fruits que si elle s’applique à des individus dont le tempérament s’y prête – et il était d’emblée évident pour Flaubert que celui de la petite Caroline, fille d’une femme d’exception, devait s’y prêter. Cette conception élitiste ne peut s’appliquer à l’ensemble des individus. C’est pour cette raison que l’écrivain n’a jamais soutenu l’idée qu’il fallait éduquer le peuple, au grand dam de George Sand, devenue son amie en dépit de leurs incessantes joutes épistolaires à ce sujet. La démocrate passionnée n’est jamais parvenue à convaincre le contempteur de la « démocrasserie19 ».
L’éducation de Victorine : théorie et fiction
À la fin du mois de janvier 1880, Flaubert aborde la rédaction de ce qui deviendra – bien malgré lui – l’ultime chapitre de son dernier roman, Bouvard et Pécuchet. Depuis les premiers scénarios, il a prévu d’intégrer l’éducation aux activités que vont successivement pratiquer ses deux personnages20 ; et il apparaît bientôt qu’elle couronnera l’ensemble : elle sera traitée au terme du premier volume, le second étant dévolu à la copie des deux bonshommes et à un court chapitre conclusif21. L’esprit dans lequel Flaubert a construit ce moment particulier de son œuvre ne fait aucun doute. Il constitue une suite logique aux idées pédagogiques qui sont les siennes depuis toujours, comme le révèle la lettre qu’il adresse alors à Maupassant : « Maintenant je prépare mon dernier chapitre : l’éducation. […] Je veux montrer que l’Éducation, quelle qu’elle soit, ne signifie pas grand-chose, & que la Nature fait tout, ou presque tout22 ». Mais il ne suffit pas à l’écrivain de savoir quelle « leçon » le lecteur perspicace devra tirer de son ouvrage, il lui faut également illustrer les tours et détours scientifiques que Bouvard et Pécuchet emprunteront avant d’en arriver à cette conclusion et il lui faut les insérer dans un récit qui va voir les deux célibataires endurcis commencer par recueillir deux enfants prénommés Victor et Victorine. Aussi, dès la période de documentation intensive des années 1872-1874, l’écrivain a-t-il lu de nombreux ouvrages portant sur le domaine de l’éducation ; ils lui ont fourni d’abondantes notes qu’il a serrées dans un épais dossier aujourd’hui conservé parmi d’autres à la bibliothèque municipale de Rouen23.
Dans ce dossier24 dont Flaubert a lui-même dressé le sommaire (fo 168), la plus grande partie des livres, écrite par des hommes, ne semble pas du tout s’intéresser à l’éducation spécifique des filles25 ; ou bien ne pose pas la question de la lecture26 – du moins Flaubert n’en retient-il rien. Quelques ouvrages27, en revanche, composés par des femmes, se préoccupent, à titre principal ou accessoire, de l’éducation des filles sans pour autant – toujours d’après les notes prises par Flaubert – attacher beaucoup d’importance à la lecture. Seuls les écrits de Mme Campan (De l’éducation, fo 180) et de Mme de Genlis (Adèle et Théodore, fos 182-183) ont retenu l’attention du romancier à ce propos. Ainsi, Mme Campan déplore l’« ignorance de l’ancienne éducation des filles » en constatant que « Par le peu qu’exigeait Fénelon, il est aisé de juger du peu qu’on savait ». Chez Mme de Genlis, Flaubert remarque d’abord que l’enseignement prôné « est tout à fait encyclopédique » et, ensuite, que les « lectures graduées » forment un ensemble « considérable ». En effet, la consultation de son « Cours de lecture suivi par Adèle depuis l’âge de six ans jusqu’à vingt-deux » révèle au lecteur curieux une liste de titres fournie, adaptés à chaque étape du développement de la jeune fille.
Enfin, Flaubert a pris en note cinq ouvrages qui laissent attendre un traitement spécifique de l’éducation des filles. Mais les notes prises sur le premier, La Femme de Michelet (fo 171 v°), ne présentent aucun élément relevant de ce domaine, pas plus que celles concernant De l’éducation des mères de famille (fo 170), par Louis-Aimé Martin, continuateur de Bernardin de Saint-Pierre. Ce dernier livre n’est d’ailleurs pas à proprement parler un ouvrage de pédagogie ; il propose une relecture du monde et de l’ensemble des activités humaines à l’aune de la religion dont le vecteur principal se trouve être la femme dans son rôle de mère de famille. De cet ouvrage, Flaubert retient néanmoins une anecdote concernant la lecture, mais masculine :
Un jeune homme, reconnaît le vide de ses plaisirs, à 17 ans, parce que sa mère lui fait lire La Nouvelle Héloïse ! Lecture enchantée, qui le passionne !… Pour se rendre digne de l’amour il entre avec transport dans le chemin de la vertu.
Point n’est besoin de préciser que l’ermite de Croisset, en ce qui le concerne, n’est guère convaincu par l’effet salvateur que pourrait opérer ce roman, pas plus que ne le seront Bouvard et Pécuchet dans la fiction : les deux anciens copistes renonceront en effet à utiliser cette lecture pour combattre l’onanisme présumé de Victor, l’adolescent n’étant « pas capable de rêver un ange28 ».
D’ailleurs, lorsqu’il relit Sophie (fo 176), Flaubert retient presque uniquement l’intérêt que Rousseau porte aux mathématiques élémentaires plutôt qu’à la lecture : « Apprendre à chiffrer avant tout (id. dans Fénelon) car rien n’offre plus d’utilité. » C’est bien Flaubert qui établit la filiation sur ce point entre Rousseau et Fénelon. En effet, l’écrivain avait déjà consigné cet aspect dans les notes prises sur De l’éducation des filles (fo 190) :
Prosaïsme de Fénelon : la femme ne doit pas raisonner.
« J’aime mieux qu’elle soit instruite des comptes de votre maître d’hôtel que des disputes des théologiens sur la grâce. »
En outre, dans l’ouvrage de Fénelon, Flaubert relève également deux extraits qui sont directement reliés à la question de la lecture féminine et dans lesquels celle-ci se trouve expressément incriminée. D’un côté, l’apprentissage de l’italien et de l’espagnol est déconseillé car ces langues « ne servent guère qu’à lire des livres dangereux et capables d’augmenter les défauts des femmes » – motif qui paraîtra « bête29 » à Bouvard et Pécuchet dans le roman ; et d’autre part, l’activité de lecture ne peut s’exercer qu’en étant rigoureusement et aveuglément encadrée : la femme « doit avoir en horreur des livres défendus sans vouloir examiner ce qui les fait défendre ».
La lecture représente donc un danger dont il faut à toute force préserver les femmes. Et c’est dans l’ouvrage de l’abbé Balme-Frézol, Réflexions et conseils pratiques sur l’éducation (fo 193), que Flaubert recopie le plus d’extraits en lien avec la question de la lecture féminine. En effet, cet ecclésiastique, on pouvait s’y attendre, présente comme profondément antithétiques l’activité de lecture et la moralité qu’il s’agit de ne jamais heurter. Flaubert relève une anecdote, racontée dans l’ouvrage, qui souligne particulièrement cette liaison : « Une femme agonisante, comme on l’exhortait à recourir à la foi laissait sortir ces paroles : “Comment… voulez-vous… que j’aie la foi ? – J’ai tant lu !” » Si lire amène immanquablement à perdre la foi, il est du devoir des parents et des enseignants de réduire au minimum l’exercice de la lecture pour les jeunes filles, d’autant plus lorsqu’il s’applique au genre réprouvé des romans dont les titres constituent déjà souvent en eux-mêmes une offense à la pudeur, comme l’assure le Rapport du vicomte de La Guéronnière sur le colportage, datant d’avril 1853.
L’abbé Balme-Frézol donne également une définition du roman que Flaubert recopie dans ses notes. Elle insiste d’abord sur le ressort passionnel qui est propre au genre : ce « n’est ni une histoire, ni un apologue, ni une fable, c’est le récit d’aventures, d’événements inventés à plaisir, et dans lequel on met en scène les passions les plus violentes, afin de remuer et d’exciter celles des lecteurs. » L’ecclésiastique souligne également l’absence de « vérité humaine » de ces publications qui font miroiter un « monde de chimères », et où les femmes sont « extraordinaires, excentriques et […] ne ressemblent [en] rien à la femme véritable ». Les meilleurs de ces livres ont même « fait plus de mal depuis vingt-cinq ans que toutes les productions éhontées de la régence et que tous les ouvrages impies ou libertins du 18e siècle. » Or c’est bien à un développement exagéré des passions de Victorine que le lecteur va assister dans le chapitre x de Bouvard et Pécuchet : « La littérature développe l’esprit mais exalte les passions. / Victorine fut renvoyée du catéchisme, à cause des siennes30. »
Pourtant, si l’on suit précisément le déroulement des événements dans ce passage, il apparaît que la fillette n’a jamais ouvert le moindre roman, du moins à l’instigation et avec la bénédiction de « Mon oncle » et « Bon ami », les noms que les deux pédagogues se font donner par les deux enfants. C’est d’abord en raison de l’échec essuyé par Victor dans l’apprentissage de la musique que les anciens copistes conçoivent l’idée qu’il lui faudrait « savoir au moins trousser une lettre », projet irréalisable puisque, selon un principe digne du dictionnaire des idées reçues – bien qu’il n’y figure pas : « Le style épistolaire ne peut s’apprendre ; car il appartient exclusivement aux femmes. » Se pose alors la question du choix des textes littéraires qui conviendraient à ce jeune esprit. Les suggestions répertoriées par Mme Campan dans son ouvrage (« la scène d’Éliacin, les chœurs d’Esther, Jean-Baptiste Rousseau, tout entier ») sont aussitôt rejetées : « C’est un peu vieux ». Et le recours au genre romanesque est d’emblée écarté : « Quant aux romans, [Mme Campan] les prohibe, comme peignant le monde sous des couleurs trop favorables ». Outre les contes de fées – qui présentent l’inconvénient de laisser « espérer des palais de diamants » à leurs lecteurs, deux romans seulement échappent à la proscription générale : « Clarisse Harlowe et le Père de famille par miss Opie ». Néanmoins, le nom de cette romancière ne se trouvant pas dans la Biographie universelle (qui est la bible de Bouvard et Pécuchet31), la prescription se trouve invalidée et tombe d’elle-même. Donc, si l’on résume, aucun roman n’a passé victorieusement l’épreuve et n’a donc pu être proposé à la lecture.
Or il s’agissait ici de faire l’éducation littéraire de Victor et non celle de Victorine, même si les deux enfants semblent parfois être traités ensemble (ainsi dans la phrase concernant les contes de fées : « Ils vont espérer… »). En tous cas, pour la jeune fille plus particulièrement, la lecture de romans, pas même envisagée, est encore moins représentée. Pourtant, ce sont bien les passions de Victorine qui s’exacerbent et qui motivent son renvoi du catéchisme. Aurait-elle alors pu lire des romans en cachette ? Dans la mesure où Bouvard et Pécuchet vont bientôt s’apercevoir que l’adolescente est parvenue à leur cacher les relations qu’elle entretient avec le tailleur Romiche, spectacle qui les « pétrifi[e]32 », il n’est pas impossible qu’elle se soit aussi – et d’abord – secrètement livrée au plaisir coupable de la lecture d’ouvrages défendus. Les deux pédagogues l’ignorant, ils pourraient donc – en toute bonne foi – continuer à penser et à prétendre au sujet de leur protégée : « Si elle est vicieuse ce n’est pas la faute de ses lectures33. »
Mais on peut formuler une autre hypothèse – qui ne trouve pas plus que la précédente de confirmation dans la lettre du texte : cet épisode de lecture des romans interdits n’aurait-il pas déjà eu lieu, en amont, dans la fiction et Victorine n’en bénéficierait-elle (ou n’en pâtirait-elle) pas au moins symboliquement ? En effet, tout à la fin du cinquième chapitre, qui traite des différentes dimensions de la littérature, est abordée la question de la moralité dans l’art. Lors d’une discussion entre les deux anciens copistes et plusieurs autres personnages, le comte de Faverges fait son apparition en tendant à Bouvard « le second volume des Mémoires du diable ». Il ne s’agit pas d’un ouvrage qu’on lui aurait confié :
Mélie, tout à l’heure, le lisait dans la cuisine ; et comme on doit surveiller les mœurs de ces gens-là, il avait cru bien faire en confisquant le livre.
Bouvard l’avait prêté à sa servante. On causa des romans34.
La petite bonne des deux anciens copistes est une sorte de préfiguration de Victorine. Orpheline, elle a dû gagner très tôt sa vie, travaillant dans la ferme du comte de Faverges alors qu’elle était encore enfant35. De nombreux indices sont également donnés au lecteur qui font signe vers une moralité défaillante : elle est la maîtresse de Gorgu, puis cède aux instances de Pécuchet, et dans les plus anciens scénarios du roman, son évocation faisait voisiner les sèmes de la prostitution et de la nature :
Aux environs, il y a une ville de garnison, et on aperçoit çà et là dans les blés une culotte rouge comme un coquelicot. Leur petite bonne blonde, avec des taches de rousseur, la taille mince et l’air ingénu a des relations avec un lancier36.
Victorine, blonde comme Mélie, et tirant l’aiguille avec la même dextérité, est elle aussi mise en relation avec des fleurs alors que se déroule l’épisode de l’accouplement des paons, et qu’elle se trouve dans une position qui sera celle dans laquelle Bouvard la découvrira, couchée avec le tailleur Romiche : « Un peu plus loin, Victorine étalée sur le dos en plein soleil, aspirait toutes les fleurs qu’elle s’était cueillies37. » Ce jeu de correspondances et de ressemblances autorise et promeut tacitement une circulation et un échange des actions entre les deux personnages féminins au sein de la fiction : ce que l’une a fait, l’autre le fera – vraisemblablement. Point n’est donc nécessaire de montrer Victorine en train de lire un livre dangereux : Mélie l’a fait avant elle, donc Mélie l’a déjà fait pour elle !
Mais qu’on ne s’y trompe pas : Flaubert ne souscrit évidemment pas à cette dénonciation des dangers que la lecture des romans ferait intrinsèquement courir aux jeunes filles. Si les romans sont immoraux, c’est qu’ils sont mal écrits, mal conçus et mal reçus, comme l’oncle l’avait d’emblée expliqué à sa nièce Caroline. La lecture est certainement une activité indispensable pour les jeunes filles, mais c’est le tempérament de chacune d’entre elles qui, dans la fiction aussi bien que dans la réalité, décidera le profit qu’elle pourra en retirer. Pour Flaubert, tout dépend de cette « combinaison de l’innéité & de l’éducation38 » qui, il en était certain, s’était présentée de manière particulièrement favorable chez sa nièce et qui fut l’une des rares sources de bonheur dans son existence, l’art excepté :
C’est une joie profonde pour moi, mon pauvre Loulou, que de t’avoir donné le goût des occupations intellectuelles. Que d’ennuis & de sottises il vous épargne ! Chez toi, d’ailleurs le terrain était propice & la culture a été facile. Pauvre chat ! comme je t’aime ! – & que j’ai envie de t’embrasser. – Quelles bavettes nous taillerons, quand nous nous reverrons39.