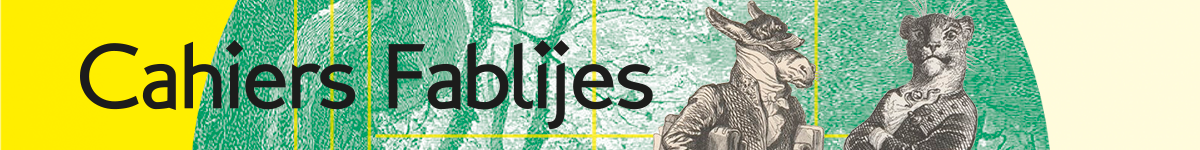Lorsqu’il préface, en 1834, Le Livre des jeunes personnes, recueil de morceaux choisis destinés aux jeunes filles, Charles Nodier fait référence aux publications de sa fille, Marie Mennessier-Nodier, pour le même public :
J’épousai, il y a long-temps, une jeune personne comme vous, aimable et bonne comme vous, et je l’aime aujourd’hui cent fois mieux que je ne l’ai jamais aimée. Nous eûmes des fils que nous perdîmes dans leur berceau, mais une fille nous restait, et vous la connaissez peut-être, puisqu’elle a écrit pour vous des pages qui valent bien mieux que les miennes1.
Qu’il s’agisse du père ou de la fille, on se situe en effet au cœur d’une décennie où la question de l’éducation féminine occupe manifestement la famille Nodier. Charles écrit plusieurs comptes rendus ou introductions sur la question de 1832 à 18362, tandis que Marie écrit à plusieurs reprises des nouvelles destinées aux femmes, parfois plus spécifiquement aux jeunes filles, comme le montrent les recueils ou périodiques où l’on trouve ses textes : « Laura Murillo » est publié en 1833 dans Heures du soir. Livre des femmes ; « Une fausse démarche » et « André Schomberg le mécanicien3 » paraissent tous deux dans le Journal des jeunes personnes, l’un en 1833 lorsque la revue commence à être publiée, l’autre quelques années plus tard en 1837 ; d’abord publié en 1833 dans La Revue française, « La Croix d’or » est repris dans un recueil au titre significatif : Le Livre rose : Récits et causeries de jeunes femmes en 1834. Dans le dernier cas, c’est le contexte de réédition de la nouvelle qui lui assigne explicitement une lectrice. On assiste au même phénomène avec « Un vieux corps pour une jeune âme » initialement publié dans la Gazette de Metz en 1837 et repris dans l’édition de 1838 du Livre des jeunes personnes, toujours avec la préface de Charles Nodier. Du côté de la poésie, signalons aussi en 1832 la publication du poème « À une jeune fille » dans la Revue des deux mondes, l’insertion du « Sonnet. À Mademoiselle *** » dans Le Livre des jeunes personnes de 1838, et surtout la publication en 1836 du recueil La Perce-Neige. Marie Mennessier-Nodier est à l’origine de ce projet collectif4 visant à offrir un « choix de morceaux de poésie moderne » à un public pensé féminin en grande partie. Elle précise dans le texte liminaire :
Je dois dire encore que, femme et mère moi-même5, je n’ai jamais oublié que ce livre s’adressait surtout aux jeunes femmes et aux jeunes filles, et qu’il était bon de rendre leurs lectures aussi chastes que leur vie, et aussi pures que leurs pensées6.
Il s’agit de la seule préface écrite par Marie Mennessier-Nodier. L’idée de lectures aussi « chastes » et « pures » que le sont les jeunes femmes et les jeunes filles – on s’interrogera sur cette distinction – n’est pas neuve et caractérise à bien des égards la rhétorique assez convenue des discours péritextuels encadrant les lectures destinées aux demoiselles. Le discours liminaire du Journal des jeunes personnes, promet, par exemple, des sujets variés propres à instruire et amuser ses lectrices, mais l’accent est mis en premier lieu sur la fonction modélisante des « exemples et des leçons de sagesse7 » proposés.
Qu’en est-il des nouvelles écrites par Marie Mennessier-Nodier ? Quel miroir tendent-elles aux demoiselles lectrices ? Relèvent-elles exclusivement du genre de l’exemplum dans lequel les lectures pour jeunes personnes semblent souvent cantonnées, ou offrent-elles à celles-ci un espace d’interprétation plus émancipateur ? Mis à part « André Schomberg » qui évoque la relation entre les sexes à travers la lutte entre d’étranges poupées mécaniques, les autres nouvelles mettent au premier plan la question de l’amour conjugal. Relevant du genre du récit de formation, ces textes offrent aux lectrices la peinture d’une condition féminine orientée vers l’amour et le mariage. Cela n’empêche nullement l’autrice, dans le même temps, de tourner en dérision certains aspects de la sociabilité galante ou de jouer avec les stéréotypes littéraires sur les femmes, offrant ainsi la possibilité à ses lectrices de se forger une conscience critique d’elles-mêmes en tant que futures femmes mais aussi en tant que lectrices de romans. Nous verrons que se joue ici une double éducation, à la fois sociale et littéraire.
Des récits orientés vers le bonheur conjugal
Marie Mennessier-Nodier écrit très certainement ses nouvelles en songeant au type de public qu’elle est susceptible de toucher. En 1834, sa lettre à Alexis Eymery, directeur de publication de la collection de la bibliothèque d’Éducation, tout juste fondée par sa fille Désirée Eymery, montre que leur collaboration naissante influe sur sa façon d’écrire :
Le genre de travail littéraire qui m’a occupée jusqu’ici est si éloigné de ce qu’il faut faire pour remplir le but de votre excellent livre, que je vous serais reconnaissante, de m’envoyer ce qui a déjà paru, afin de me guider un peu plus dans le sujet que je dois choisir, et dans la manière de le traiter8.
En 1835, « Le Mystère de la mère et de l’enfant, » est publié dans l’un des recueils de ladite collection, Le Conteur de 8 ans. Cette légende pieuse aux accents édifiants est explicitement destinée aux enfants comme le montrent plusieurs adresses au fil du récit9. Dans les récits destinés à un public féminin plus âgé, la dimension morale est moins appuyée, le narrataire est convoqué au moyen d’un « vous » très général, et la voix narrative, quoique présente, est, elle aussi, peu caractérisée10. Les lectrices bourgeoises ou nobles sont toutefois susceptibles de se reconnaître en partie dans les personnages de jeunes filles en âge de se marier11, ou bien de se positionner par rapport à elles. Dans « André Schomberg », ce rôle est assumé par la « charmante présidente de bois peint12 » dont l’agressivité dément rapidement la bonne impression de « jolie personne13 » sage qu’elle fait au départ. Elle fonctionne ainsi comme « repoussoir14 » des véritables lectrices implicitement invitées à la douceur et à l’obéissance, tout comme la propriétaire de la poupée dans l’intrigue. L’étrange marionnette est qualifiée tantôt de « petite fille », tantôt de « jeune fille », preuve sans doute de la relative indétermination qui entoure l’adolescence, âge de transition avant l’entrée dans la sexualité conjugale.
Car être une jeune fille, c’est faire une première expérience de la fugacité du temps. L’adolescence se caractérise à la fois par ce qu’elle n’est plus et par ce qu’elle n’est pas encore. Plusieurs poèmes de Marie Mennessier-Nodier évoquent avec nostalgie le bonheur et la pureté de l’enfance, temps de « douce chimère15 » emporté par l’avancée inexorable du temps. La rupture avec le début de la vie n’est toutefois pas radicale, comme le montre la persistance des amitiés juvéniles maintes fois revendiquée ou bien le flottement lexical pour désigner l’adolescence. Le poème « À une jeune fille » est ainsi tout entier ponctué par l’adresse « Enfant ». On y discerne toutefois l’éveil à la sensualité à travers la référence au « printemps d’amour » et aux « fraîches corbeilles16 », discret renvoi possible au mariage. L’amour pour la musique et la danse, l’élan du « cœur tout entier vers le plaisir17 » semblent eux aussi à même de renvoyer à la découverte des premières formes de sociabilité galante, à la vitalité de cette période d’insouciance où l’on découvre la séduction. Sans doute faut-il voir là une évocation à peine voilée des plaisirs des soirées de l’Arsenal où Marie Nodier occupait un rôle de premier plan. La jeunesse est toutefois elle-même éphémère et peut donner lieu à de profonds regrets, comme c’est le cas chez plusieurs personnages. Pétrie d’inquiétude pour son mari malade, Laura repense avec tristesse à « son charmant passé de jeune fille, ce passé si couvert de fleurs et d’ombrage18 ». En retrouvant sa petite croix d’or, Henriette déclare à son mari :
Sa vue seule, mon ami, me rappelle le temps de nos amours, quand j’étais jeune fille et que vous me faisiez danser dans ce vieux salon de Glennaker, qui est si triste, et que je trouvais si gai19 !
Dans les deux cas, l’insouciance de la jeunesse est, comme dans « À une jeune fille », associée au souvenir de la musique : piano et chant pour Laura, danse pour Henriette.
Bien que les souvenirs de jeunesse soient susceptibles de susciter de la nostalgie, le passage à l’âge adulte n’est pas en soi source de malheur dans les récits de Marie Mennessier-Nodier. Certes, des risques existent pour une jeune fille, celui d’être courtisée pour son argent ou bien enlevée pour être séduite, nous y reviendrons. Mais source d’accomplissement et d’épanouissement naturels, le mariage et la maternité sont en général présentés très positivement aux lectrices. « La Croix d’or » offre le tableau d’un amour conjugal que le temps n’abîme pas. Deux ans après le mariage d’Arthur et Henriette, on lit :
La grâce un peu capricieuse de la jeune fille avait fait place à l’aisance élégante de la femme, de la femme aimée et sûre de plaire, qui sait que toutes ses paroles sont entendues et caressées d’avance par celui qu’elle a choisi, et rien ne donne de l’assurance comme le bonheur ; les gens très timides sont presque toujours les gens très malheureux20.
Au fil des années, la beauté d’Henriette s’altère en partie, mais pas l’amour que lui porte son mari, « attachement […] qui, pour avoir pris plus de racines avec l’âge, n’en était devenu ni moins tendre ni moins doux21 ». Dans « Laura Murillo », la voix narrative insiste sur la félicité domestique de Laura et Armand, félicité procurée par leur amour mais aussi par leur sens de la discrétion et de la mesure :
Le bonheur est chose si rare dans ce monde, qu’il serait fort difficile à décrire. Au surplus celui que s’étaient fait Armand et sa femme se composait plutôt de calme et d’obscurité que de ce luxe passager que les jeunes mariés, quelque peu de fortune qu’ils aient ne manquent pas de se donner pendant la première année du mariage, et qui leur fait sentir plus amèrement ensuite des privations qu’ils n’auraient pas connues sans lui : aussi n’excitait-il l’envie de personne22.
Le mariage suppose ici le sacrifice, volontiers consenti, aux obligations d’une vie sociale trop dispendieuse, contre laquelle la voix narrative met en garde les lectrices. Ce récit est aussi l’occasion de mettre en valeur les « devoirs de mère, si doux à remplir23 ». La naissance d’un enfant et l’amour maternel sont en effet présentés comme le prolongement naturel de l’amour conjugal.
Dans plusieurs passages cités précédemment, l’éloge de la vie conjugale s’appuie sur une énonciation sentencieuse. De façon générale, la dimension axiologique du propos est patente lorsqu’il s’agit de décrire les personnages et leurs actions en guidant l’interprétation qui en est faite. À cela s’ajoute l’usage fréquent du présent gnomique et de tournures généralisantes, qui présupposent l’adhésion du narrateur et de son narrataire à des valeurs partagées. S’ouvre un espace moral commun qui vient en quelque sorte contraindre la lecture et la représentation de la condition féminine. Mais le « geste d’énonciation partagée24 » qui favorise l’implication de la lectrice dans le récit s’appuie également sur l’émergence d’une vibration affective25 fondée, elle, sur la singularité de certaines situations rapportées, en dépit de leur universalité affichée. On l’observe lors de l’évocation de l’amour maternel dans « Laura Murillo » :
Un fils était venu, nouveau lien entre eux, amour nouveau qu’on donne à celui qu’on aime, trésor de pures jouissances caché dans le cœur des mères, acheté quelquefois par de cruelles souffrances, par de plus cruelles inquiétudes, jamais payé trop cher26.
Affleure une conscience sensible, comme si la voix narrative faisait part de son expérience en dévoilant la force d’un attachement qu’une mère garde en général secret. Le texte acquiert une couleur très personnelle, comme si le « on » pouvait se lire en « je ». Un processus similaire sert également le pathétique lorsque la voix narrative semble s’associer personnellement à l’expérience de Laura se remémorant les joies de sa jeunesse :
Une foule de circonstances frivoles, mais bien chères aujourd’hui, se réveillaient dans l’âme de la pauvre jeune femme, et rendaient plus poignant encore l’affreux chagrin qui la dévorait. Eh ! quel est celui qui au moment même où la douleur semblait le plus absorber toutes les facultés de son être, n’a pas retrouvé au milieu des brisements de son cœur quelque doux souvenir frais et pur, endormi, oublié27 ?
Dans « La Croix d’or », lorsque Arthur revient enfin des Indes, l’investissement de la voix narrative dans l’expérience évoquée est rendu manifeste, non seulement par l’exposé d’une forme de doxa, mais aussi et surtout par le commentaire appelé par la joie indescriptible des retrouvailles :
L’âme a des ravissements secrets qui semblent venir du ciel, et qu’un petit nombre comprennent ; il faut les tenir précieusement renfermés en soi-même ; car l’air et la lumière leur font perdre leurs plus doux parfums28.
La mobilisation du destinataire se fait ici sur le mode de l’empathie et repose sur l’élection d’une lectrice sensible, seule à même de comprendre les « ravissements de l’âme » procurés par l’amour. Peut-être peut-on y voir aussi une discrète allusion au fait que tous les mariages ne sont pas aussi heureux que celui d’Henriette et d’Arthur ? Un « petit nombre » de femmes comprennent-elles ces ravissements, parce qu’elles ont la sensibilité nécessaire, ou bien parce que leur mariage les comble, contrairement à d’autres ? Quoi qu’il en soit, ce pseudo-processus de sélection au sein du public donne l’impression d’avoir été « choisie » et favorise l’instauration d’un lien de familiarité entre la véritable lectrice et ce qu’elle peut croire deviner de l’autrice29. Tout encourage ici les lectrices à rêver d’une union idéale fondée sur l’amour réciproque. Cela n’empêche pas Marie Mennessier-Nodier, à d’autres moments, de mettre son art de l’analyse psychologique au service d’une peinture plus railleuse des pratiques sociales qui entourent le mariage. C’est alors l’ironie qui est au service de l’établissement d’un lien de connivence avec la lectrice, à qui il s’agit de dévoiler certains travers du monde social.
La sociabilité de la demande en mariage : une initiation démystifiante
Dans « Laura Murillo », l’amour naît naturellement entre Laura, la nièce du comte Perez Murillo et Armand Dubuisson, jeune peintre français. Les jeunes gens se plaisent et aucune péripétie n’entoure la demande en mariage. Il en va différemment dans d’autres nouvelles, même si le principe du mariage n’est jamais directement remis en question. « Un vieux corps pour une jeune âme » constitue ainsi un conte d’avertissement invitant les jeunes filles à se méfier des séducteurs qui cherchent à profiter de leur innocence. Don Esteban, un vieux moine, décourage Teresita de fuir avec don Pablo et la met en garde contre sa duplicité et les efforts qu’il a déployés pour « gagner [son] cœur tout simple et sans défense30 ». Dans cette intrigue, point d’idéalisation d’un amour absolu, contrarié par les convenances sociales. La mort violente infligée par don Pablo au franciscain en guise de représailles donne pleinement raison à ce dernier. On peut même voir dans ce châtiment cruel un déplacement de la violence guettant non seulement Teresita mais aussi toutes les jeunes filles, potentielles proies de prédateurs fourbes. Donnant une couleur pittoresque à la représentation de la violence masculine, le cadre espagnol peut paradoxalement atténuer la réalité représentée. Reste que don Pablo, et, à travers lui, la sexualité hors mariage, constituent un horizon inquiétant.
Dans « Une fausse démarche », le baron Emmanuel de Chantry, parangon du coureur de dot, paraît plus stupide que dangereux, et ses efforts pour épouser Clotilde de Luz Saint-Sauveur sont tournés en dérision. La nouvelle tout entière donne, quant à elle, l’occasion d’une mise à nu sarcastique plus large des enjeux financiers et sociaux du mariage. Après un début in medias res consacré à l’accueil glacial réservé au baron par la famille de Luz Saint-Sauveur, le narrateur éclaire ses lectrices sur les motifs de la venue du personnage masculin. Le long portrait du jeune homme offre l’occasion de souligner d’emblée son manque d’argent (« vingt-quatre ans, bel âge ! et peu ou point de fortune, voilà le mal31. ») et sa fatuité. L’analyse psychologique a une allure injonctive (« Nous n’avons pas besoin de dire », « Il ne faut donc pas s’étonner32 ») mais permet surtout d’instaurer une complicité avec la lectrice directement interpellée (« Avez-vous vu quelquefois de ces beaux portraits du quinzième siècle, graves et bruns […]33 ? »). La sagacité narquoise de la voix narrative contraste avec le manque de finesse du jeune homme et sa totale absence de clairvoyance. Après la lettre de Gabriel informant Emmanuel du probable héritage de Clotilde de Luz, l’insistance sur les réflexions du baron est teintée d’ironie :
Emmanuel réfléchit beaucoup en lisant cela, et ce fut cette même réflexion, poussée à son dernier période, qui le conduisit le soir même chez la mère de la jeune héritière, qui lui paraissait cent fois plus jolie et plus aimable depuis qu’il la voyait à travers la succession34.
On voit que le ton est également goguenard au sujet des charmes qu’a soudainement soi-disant acquis Clotilde aux yeux du jeune homme. La suite du récit poursuit la dénonciation des faux-semblants. Les efforts pitoyables d’Emmanuel, « prépar[ant] sa plus agréable physionomie35 » pour faire bonne figure au bal sont moqués eux aussi. Le baron échoue à faire sa demande, mais méconnaît les véritables raisons de ses déboires. Le narrateur pointe une nouvelle fois l’absence de lucidité du personnage en opposant de façon comique ses échecs répétés à ses vaines certitudes :
Or donc, après quelques visites infructueuses, après quelques jours d’attente et de réflexion, il se décida à demander mademoiselle de Luz Saint-Sauveur en mariage, et il se doutait si peu qu’elle lui serait accordée sans difficulté qu’une fois la résolution de s’enchaîner bien prise, il chantait du matin au soir : Oui, c’en est fait, je me marie, etc., etc.36
Cette chanson, issue d’un vaudeville, est à elle seule caractéristique de « l’emploi » ridicule du personnage. L’expression « s’enchaîner » utilisée pour désigner le mariage rappelle efficacement l’absence d’appétence du baron de Chantry pour le mariage et la malhonnêteté foncière de sa démarche.
Le récit s’achève sur un échange superficiel entre Gabriel et Emmanuel autour de l’apparence physique de Mlle de Luz, Gabriel faisant observer à son ami qu’il échappe au ridicule d’épouser une femme plus grande que lui. On ignore s’il feint d’aller dans le sens d’Emmanuel pour le consoler, ou si lui-même considère ce détail physique comme important. De façon générale, ce personnage est assez ambivalent. « [B]on, loyal et spirituel garçon37 », doté d’un « excellent cœur38 », il est loué régulièrement dans le texte. Toutefois, son « respect pour le jargon sonore de M. de Chantry », le fait qu’il lui reconnaisse de « l’esprit39 » relativisent cette appréciation positive. Il promet de soutenir son ami dans la recherche d’une dot, mettant à mal l’idéal du mariage d’amour, et on ne peut s’empêcher de s’interroger in fine sur ses véritables motivations à épouser lui-même Clotilde. Que penser du billet où il se plaignait auprès d’Emmanuel de ne pas être fait héritier à la place de la « plus jolie de [ses] cousines40 » ? La mention de la beauté de la jeune fille ne laisse-t-elle pas transparaître une forme d’arrière-pensée sur laquelle s’interroger ? Marie Mennessier-Nodier laisse ses lectrices se faire leur opinion.
Dans « La Croix d’or », Marie Mennessier-Nodier pointe aussi certains travers de la comédie sociale qui entoure le mariage, davantage du côté des jeunes filles cette fois. On a vu combien Henriette et Arthur forment un couple uni, et on ne trouve pas dans le texte de railleries équivalentes à celles mises en évidence par Alex Lascar dans son étude sur les apprêts du mariage dans le roman français de la période41, mais on relève des passages ironiques qui visent sans doute à corriger les jeunes filles d’une éventuelle propension à l’impatience et à la vanité. Lord Glennaker, père d’Arthur et oncle d’Henriette joue ici un rôle déterminant. Plus clairvoyant que sa nièce sur les raisons de sa mauvaise humeur lorsque Arthur est en retard au tout début de la nouvelle, il lui conte une anecdote ancienne au sujet de sa mère pour l’inviter à la patience. Celle-ci, fâchée que son galant – lord Henri Weyland – ait oublié de lui faire envoyer des fleurs, puis vexée de découvrir qu’elle s’était trompée – un magnifique bouquet l’attendait sur son chemin pour Londres –, n’avait pas pris la peine de remercier Henri et lui avait réclamé une autre fleur. Elle avait été punie de ce cruel marivaudage par le départ du jeune homme, dont elle avait cru qu’il l’avait abandonnée alors qu’en réalité il était allé lui chercher la fleur demandée. L’expérience – fugitive mais décisive – de l’abandon et de la perte avait corrigé la coquette de son impatience capricieuse. Des années plus tard, lorsque lord Glennaker rapporte la scène à Henriette, cette dernière, semble avoir compris la leçon : lorsque son fiancé arrive enfin, elle ne lui fait aucun reproche.
Juste avant le mariage, ce sont surtout les compagnes d’Henriette contre lesquelles s’exerce la satire. Dans le chapitre « Un jour de noces », la voix narrative adopte leur point de vue pour insister avec humour sur l’importance des préparatifs de la mariée. L’ironie est manifeste dans l’évocation quasi superlative de la « toilette de mariée, chose importante entre toutes celles du même genre42 » et dans le rôle essentiel attribué au coiffeur. L’arrivée de cet « artiste distingué43 » est toutefois très vite éclipsée par l’arrivée de la corbeille de mariage. La représentation de la superficialité féminine est ici portée à son comble : « […] certainement, si leur jeune amie se fût mariée avant l’arrivée de la corbeille, les jeunes filles du château n’auraient jamais voulu croire à la légitimité de son mariage44. » Véritable assaut, la découverte des parures de la mariée génère une belle pagaille et montre la vénalité des compagnes d'Henriette. Cette dernière est, elle, épargnée par la moquerie. Se retrouvant seule, elle ressent surtout de l’ennui et retrouve avec plaisir son futur époux. Les cadeaux entravent alors ses mouvements, preuve symbolique de leur caractère gênant et inutile. Henriette constitue ainsi en permanence un support d’identification positif pour les lectrices. De façon générale, le texte mobilise avant tout une destinataire en capacité de goûter l’ironie de nombreux passages, une complice des analyses de la voix narrative. Cela contribue à l’éducation littéraire du public visé.
L’art de la parole pour détourner les stéréotypes
Dans « Une fausse démarche », l’opportunisme maladroit d’Emmanuel contraste avec la finesse psychologique de Mme de Luz Saint-Sauveur. L’opposition entre les deux personnages apparaît notamment dans leur maniement du langage. Lorsque le baron revient, attiré par la dot de Clotilde, son hôtesse peine à lui faire entendre entre les mots son déplaisir à le voir, car Emmanuel ne maîtrise pas l’implicite. Il est incapable de saisir la signification réelle des « lieux communs que lui débit[e] depuis un quart d’heure Mme de Luz, pour lui faire comprendre qu’elle n’[a] rien de plus à lui dire45 ». Il quitte le salon en pleine conversation, au mépris des plus élémentaires règles de politesse, et conclut, de façon savoureusement paradoxale, à la « stupidité incroyable46 » de la famille de Clotilde. Plus loin, lorsqu’il ne parvient pas à faire sa demande en mariage, son échec contraste avec le brio avec lequel la voix narrative évoque sa déroute langagière :
M. de Chantry avait arrangé à part lui, pour ce moment-là, une suite de gracieusetés joliment tournées et qui devaient nécessairement amener sa danseuse à quelque réponse qui lui parût décisive ; mais il est à remarquer que lorsqu’une conversation est ainsi toute faite d’avance, la première phrase banale que votre interlocuteur vient, sans aucune mauvaise intention, jeter à la traverse, déroute complètement le plan de campagne, envoie une idée à droite, l’autre à gauche, si vous en avez deux, et passe au milieu le plus tranquillement du monde, pendant que vos beaux projets bien mûris, bien réfléchis, tombent les uns sur les autres comme des capucins de cartes sans qu’il vous soit possible de les remettre en équilibre, et tout ce ravage pour une bêtise, ce qui est mortifiant tout à fait47.
Certes, l’usage généralisant du « vous » associe ici les instances de l’énonciation à l’expérience calamiteuse du baron de Chantry, mais l’amusante référence guerrière qui sert à narrer la scène montre assez la finesse de Marie Mennessier-Nodier ainsi que l’attention subtile qu’elle porte aux mots, les siens et ceux des autres. Le véritable esprit naît très certainement dans la spontanéité d’un échange qui ne doit rien avoir de guindé. On a en tête la lettre à son mari – lettre mentionnant d’ailleurs l’écriture d’« Une fausse démarche » – où elle évoque avec humour le « bagou des plus opiniâtres48 » d’un de ses admirateurs, sa « courtisanerie maniérée49 » :
Ma beauté, mon esprit, ma grâce et ma fraîcheur lui fournissent une foule de comparaisons et d’images plus triomphantes les unes que les autres, et surtout plus mortellement ennuyeuses50.
Les femmes des récits semblent, comme elle, dotées d’un art de la parole et de la communication qui manque à plusieurs personnages masculins. Elles sont aptes à comprendre le babil des enfants, « cette charmante langue qui n’en est pas une et qui les vaut toutes, cette langue qui ne veut rien dire, et que les mères comprennent cependant51 ». Armand et Arthur tentent vainement de protéger leur épouse – l’un de la peur de la peste, l’autre du départ pour les Indes – en adoptant le silence, là où Laura et Henriette se révèlent habiles à déchiffrer les signes inscrits sur le visage de leur époux.
Tout comme les personnages féminins, la lectrice est invitée à interpréter les non-dits. Elle est notamment associée à un jeu sur les stéréotypes littéraires qui structure la distinction entre hommes et femmes dans plusieurs nouvelles. L’absence notoire de finesse d’Emmanuel de Chantry paraît également liée à son incapacité à s’adapter à un événement qui ne soit pas conforme à ce qu’il a anticipé, imaginé. Le bal lui a paru une « occasion admirable pour se déclarer52 », car il envisage la demande en mariage à travers une scénographie préétablie. Lui-même est implicitement comparé à un héros de vaudeville, nous l’avons vu, quand il chante un air typique de ce genre théâtral fondé sur des schémas simplificateurs. Lorsque son portrait est brossé au début de la nouvelle, sa fatuité aveugle est attribuée à son envie de ressembler à un tableau. Le fait que les cheveux blonds du jeune homme soient « dérangés avec beaucoup d’art53 » est à prendre au premier degré. La narratrice prend sa lectrice à témoin pour inscrire le portrait du baron sous le signe d’un rapport dévoyé et ridicule à la peinture, sans doute aussi à la mode moyenâgeuse du roman historique :
Avez-vous vu quelquefois de ces beaux portraits du quinzième siècle, graves et bruns, les cheveux lisses et tombant sur les oreilles, la barbe courte et pointue, les moustaches relevées et le poing sur la hanche ? Eh bien ! c’est là qu’Emmanuel avait pris ses modèles. […] Emmanuel voulait être moyen-âge avant tout. Ce qui avait du caractère tombait nécessairement dans son domaine, et on le surprenait souvent s’extasiant devant sa glace comme devant un portrait de van Dyck ou de Rembrandt54.
Dans une lettre adressée la même année à sa mère, l’autrice avoue précisément son aversion pour ce genre de prose littéraire : « Auguste s’est avisé l’autre jour de me faire coiffer en moyen-âge, à mon grand déplaisir, car tu connais mon horreur pour le caractère55. » De façon générale, le défaut d’intelligence d’Emmanuel est lié à des préjugés romanesques sur l’amour et les femmes. En arrivant chez Clotilde, il se forge une interprétation sentimentale mais fallacieuse des raisons de son absence dans le salon :
Il s’imagina que Clotilde, surprise dans ses études, et peut-être encore en négligé, s’était hâtée de courir réparer le désordre de sa toilette, afin de paraître à ses yeux avec toutes ses séductions, auxquelles l’émotion profonde qu’elle devait nécessairement ressentir en le revoyant prêterait mille fois plus de charmes56.
La voix narrative se plaît à décevoir ce cliché quasi libertin en lui opposant une description plus prosaïque de Clotilde toute à la confection de sa bourse en filet :
[…] celle qui l’occupait faisait dans ce moment-là et le plus posément du monde, une bourse de filet qui n’était vraisemblablement pas pour lui ; […] le son de sa voix, qu’elle aurait pu entendre si elle avait daigné prêter l’oreille, ne l’empêchait pas de compter avec une scrupuleuse exactitude les mailles de la bourse en question […]57.
La couture n’exclut pas la possibilité de l’amour (la bourse n’est pas pour le baron de Chantry mais peut-être pour quelqu’un d’autre…) mais l’inscrit dans un souci de réalisme à rebours des fantasmes d’Emmanuel.
Dans une moindre mesure, Henriette pointe aussi des idées préconçues chez Arthur dans « La Croix d’or » où plusieurs régimes romanesques semblent coexister. Le comte de Val d’Oissy, devenu désespérément amoureux d’Henriette sans même lui avoir parlé, avoue son amour à Arthur qui en conçoit de la jalousie en imaginant que sa fiancée peut avoir été sensible aux charmes de son admirateur. Son raisonnement s’appuie en partie sur une maxime au sujet des femmes :
[…] car enfin un amour si dévoué, si complet, ne se cache pas ainsi qu’il [le comte de Val d’Oissy] le pense, et puis les femmes aiment tant tout ce qui n’est pas naturel, tout ce qui n’arrive pas à tout le monde, que plus il a fait d’efforts pour le dissimuler à Henriette et plus, peut-être il a réussi à l’intéresser58.
Dans la scène qui suit, l’attitude d’Henriette va contredire de bout en bout ce commentaire typifiant. Arthur sonde sa fiancée sur son éventuelle attirance pour un autre homme, en adoptant un ethos sacrificiel pour lui dire de façon assez grandiloquente qu’il la « céderai[t] sans murmure à un autre, si un autre, plus heureux, était préféré par [elle]59 », quoiqu’il en mourrait peut-être. La longue réponse de la jeune fille s’ouvre sur la réfutation ironique d’un préjugé sur l’art de dissimulation des femmes et s’achève sur la revendication d’une histoire d’amour qui n’a rien de romanesque :
On a vraiment bien raison de dire, milord, s’écria Henriette, que les femmes sont adroites et dissimulées. Voilà, sans reproche, six mois que vous avez la bonté de vous occuper de moi d’une manière particulière, et dix-sept ans bientôt que nous occupons la même maison : eh bien, j’ai mis pendant tout ce temps-là assez de retenue dans ma conduite et dans mes paroles pour que vous ne croyiez pas inutile de me demander aujourd’hui, aujourd’hui qui est la veille de demain, mon cousin, ajouta-t-elle avec reproche, si c’est vous que j’aime bien décidément, ou si, victime infortunée, je me laisse traîner à l’autel par des parents barbares, avec un autre amour dans le cœur […] Vous me flattez, milord ; mon histoire est loin d’être aussi intéressante ; je crois fermement que vous m’aimez et quoique vous en disiez, je suis parfaitement sûre que je vous aime ; nous nous marions demain, je ne regrette personne, et personne ne me regrette. Vous voyez bien que tout cela est si simple que c’en est trivial ; pas du plus petit épisode romanesque, pas le moindre désespoir jaloux60.
Plus loin dans l’histoire, Henriette fera observer à Arthur la moindre liberté dont bénéficient les femmes61, mais à ce stade du récit elle revendique son libre arbitre amoureux, loin de l’image mélodramatique de mariage forcé qu’elle convoque plaisamment dans son discours pour s’en détacher.
La suite assez rocambolesque de l’intrigue va démentir la promesse d’une histoire sans le « plus petit épisode romanesque62 ». Toutefois les péripéties se situent toujours dans l’univers masculin (départ pour les Indes, rencontre avec le mystérieux Olivier, mort de celui-ci dans un duel, scène de reconnaissance entre Olivier et Arthur…), tandis que Henriette reste inébranlable dans son amour pour son mari. Lorsque celui-ci lui narre la mort d’Olivier, elle est émue, mais ne peut s’empêcher de s’insurger vivement lorsque Arthur, une dernière fois, l’imagine amoureuse de celui qui n’était autre que le mystérieux comte de Val d’Oissy. Certes, la fidélité amoureuse dont fait preuve Henriette est partie prenante du topos de l’amour idéal, mais on voit ici de quelle manière le personnage de cette jeune femme, vient interférer avec un scénario romanesque davantage fondé sur les péripéties, le hasard, l’héroïsme masculin.
Dès la présentation initiale d’Henriette, Marie Mennessier-Nodier s’emploie d’ailleurs à placer ce personnage sous le signe des nuances et des contrastes, de façon à déconstruire certains clichés romanesques. Si Emmanuel de Chantry est d’autant plus ridicule qu’il ne parvient pas à imiter son modèle moyenâgeux, le charme d’Henriette provient précisément de ses singularités. La voix narrative inscrit la description de la jeune fille sous le signe d’un refus badin du système de personnages manichéen du roman sentimental anglais :
Il n’y avait rien de moins anglais que la beauté de cette jeune fille. En Angleterre, généralement, quand les femmes ne sont pas horriblement laides, elles sont charmantes ; elles ont une peau blanche et rose, et satinée, des cheveux blonds, doux comme de la soie, et qui brillent comme de l’or, quand, par hasard, le rare soleil de leur pays laisse tomber un de leurs rayons sur eux63.
La description d’Henriette prend ensuite le contre-pied de cette évocation initiale, en jouant cette fois d’effets de discontinuités : si le teint de la jeune fille n’est pas « absolument blanc », ses cheveux sont, eux, « absolument noirs64 », faisant contraste avec la blondeur des héroïnes susmentionnées certes, mais introduisant aussi un effet de décalage, là où on attendait peut-être que rien ne soit « absolument » ceci ou cela chez la jeune fille. La suite du portrait met en valeurs plusieurs écarts physiques par rapport à la norme (traits « plus gracieux que réguliers », taille « trop petite », bouche « trop grande65 »…) ainsi que l’absence d’univocité du caractère de la jeune fille à la fois mélancolique, rêveur et « follement66 » gai. La conclusion joue alors d’un nouvel effet de rupture au moyen d’un quasi oxymore : « En somme, toutes ces imperfections composaient une femme charmante67. » Marie Mennessier-Nodier semble ici rechercher une forme de réalisme dans la peinture de son personnage. C’est le seul récit étudié qui offre une description de son héroïne. « Laura Murillo » et « Un vieux corps pour une jeune âme » semblent relever d’un régime plus traditionnel de récit, mais aucune description n’y figure, comme si l’autrice répugnait à enfermer les personnages féminins dans un cadre préconçu. Tout juste sait-on de Laura Murillo qu’elle est une « charmante […] orpheline68 » sans d’ailleurs que l’adjectif renvoie nécessairement à son apparence physique.
L’éducation morale et psychologique des jeunes lectrices se double donc d’une éducation proprement littéraire celle-ci. Tout en ayant recours à des registres variés au sein même du genre de la nouvelle, tout en proposant des récits témoignant d’une culture littéraire avérée – on pense aux probables références intertextuelles aux Contes d’Espagne et d’Italie de Musset ou bien à E. T. A. Hoffmann implicitement présent à travers « André Schomberg69 » –, l’autrice associe à plusieurs reprises son public à la déconstruction de certains stéréotypes littéraires, particulièrement lorsqu’ils concernent les femmes. Ce genre de procédé qui entraîne un décentrement par rapport à des idées trop convenues, peut permettre aux destinataires de prendre conscience d’elles-mêmes en tant que jeunes personnes mais aussi en tant que lectrices capables de pointer les stéréotypes romanesques.
Nous terminerons sur une dernière caractéristique du rapport instauré entre Marie Mennessier-Nodier et son public : la question de la morale à tirer des récits. Il semble que là aussi, l’autrice offre à ses lectrices un espace interprétatif qui leur permette d’exercer leur jugement critique. Nous avons évoqué la dimension régulièrement sentencieuse du propos, l’orientation généralement assez claire de l’intrigue d’un point de vue axiologique. Il faut toutefois observer que la morale de l’histoire – quand il y en a une – est rarement explicite. Pour terminer ses récits, Marie Mennessier-Nodier privilégie des chutes propres à l’art de la nouvelle : l’image saisissante de Laura Murillo folle en train de balancer un berceau vide ; le bon mot adressé par Gabriel à Emmanuel de Chantry ; le discours ferme et magistralement construit d’Henriette prouvant une ultime fois son amour pour Arthur ; le massacre de dix-sept franciscains à la fin d’« Un vieux corps pour une jeune âme ». Soulignant l’obéissance accrue des enfants, la fin d’« André Schomberg » semble avoir une portée didactique plus nette dans une fable consacrée à l’agressivité des bambins par poupées mécaniques interposées. Il est néanmoins à noter que cette docilité nouvelle s’inspire, non pas des injonctions maternelles, mais du rejet provoqué par le combat des marionnettes. Or, au fil du temps, ce conflit a peu à peu pris une couleur merveilleuse dans l’imaginaire collectif, notamment enfantin70. Ce processus ne vient-il pas implicitement affirmer la supériorité des enseignements dispensés à travers la fiction sur ceux dispensés directement par les éducateurs ?
« La Croix d’or » semble également faire le pari de la capacité des lectrices à interpréter le sens d’une intrigue. L’anecdote délivrée par lord Glennaker sur sa sœur nous semble pouvoir être considérée comme une mise en abyme de l’art du récit prôné par Marie Mennessier-Nodier. L’introduction de l’oncle de Henriette rappelle à bien des égards les discours préfaciels des anthologies pour jeunes personnes :
[…] c’est une histoire que je ne vous ai jamais racontée, et qui pourra servir à votre instruction. Vous y verrez comment on entendait l’amour de mon temps, ma belle dédaigneuse, ajouta-t-il avec une espèce de fierté, et vous comparerez. D’ailleurs, si notre tête-à-tête doit encore durer longtemps, comme je commence à le croire, il ne sera peut-être pas inutile de le distraire par quelques récits variés et agréables71.
La longueur de cette entrée en matière contraste toutefois avec la fin abrupte du récit. L’arrivée d’Arthur détourne subitement l’attention d’Henriette et interrompt le souvenir. Lord Glennaker déclare alors non sans humour : « Voilà la morale de mon récit perdue72 ! » On a vu que ce récit second venait assez nettement dénoncer les caprices de la sœur de lord Glennaker. Il n’empêche que l’exclamation finale de lord Glennaker invite les lectrices à chercher la morale de cette histoire enchâssée, partant à se poser la question de la morale de tout récit. Ce procédé, tout comme la mise à nu de certains stéréotypes, incite les jeunes personnes à faire usage de leur esprit critique.
Destinés à un public féminin, les premiers récits de Marie Mennessier-Nodier déploient donc une poétique qui offre un espace interprétatif aux lectrices. Au-delà d’une représentation modélisante du mariage, l’autrice invite son public à se défier de certaines représentations romanesques figées, qu’elle inscrit clairement du côté d’un héroïsme masculin aveugle aux aspirations féminines. L’autrice, par l’intermédiaire de la voix narrative, offre par ailleurs elle-même une forme de modèle aux jeunes personnes par son esprit, sa plume sensible et son maniement d’une ironie railleuse. Marie Mennessier-Nodier se défend fréquemment d’être une « femme auteur73 », elle s’étonne, par exemple, de l’appréciation favorable de son mari sur « Une fausse démarche74 », et adresse à Amable Tastu en 1836 un sonnet où elle oppose le chant poétique de cette dernière à sa propre incapacité à s’exprimer :
Oui, l’avenir est beau, mais sa voix me proscrit :
Je suis poète aussi, lorsque je vous admire,
Sur mes lèvres, pourtant, le chant de l’âme expire
Et s’arrête, et se tait, car il m’est interdit75.
En dépit de ces dénégations, les récits étudiés ici, tous signés du nom de l’autrice, montrent aux demoiselles lectrices en quoi une écriture très maîtrisée peut être mise au service de l’exploration des « parcours méandreux de la Carte du Tendre adaptée aux mœurs de la société louis-philipparde76 », en quoi il est possible pour une jeune fille ou une jeune femme de réfléchir sur sa condition. En 1842, Marie Mennessier-Nodier ira plus loin avec « Lettres d’une Hirondelle à une Serine », ce récit épistolaire lui permettant d’évoquer explicitement la difficile condition de la « femme auteur » dans un monde des lettres essentiellement masculin.