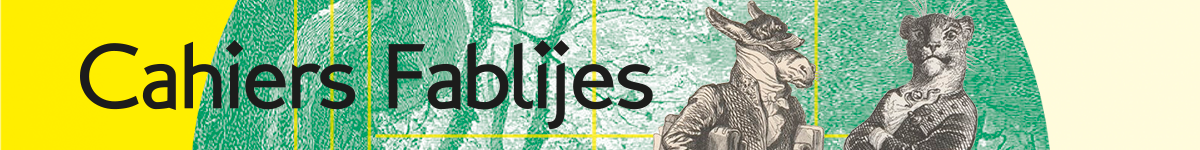Sandrine Aragon a montré que les images de femmes lectrices dans les romans sont souvent des représentations ridicules au xviie siècle, séduisantes au xviiie siècle, tandis qu’elles sont tragiques au xixe siècle où la lecture est considérée comme dangereuse pour les femmes au xixe siècle, surtout du point de vue de l’éducation religieuse, car elle semblait trop inciter à l’amour pour pouvoir être mise sans discernement entre les mains des jeunes filles :
Les images de femmes savantes et de jeunes lectrices en perdition réapparaissent dans les premières années de la Monarchie de Juillet. Dans les années 1830-1840, après l’instauration d’un enseignement d’État pour les garçons, il est question de créer des écoles de filles. Les textes littéraires participent au débat : des auteurs évoquent les possibilités d’ascension sociale des filles du peuple, la nécessité de canaliser leurs esprits et de les détourner des idées révolutionnaires, d’autres insistent sur les dangers des lectures profanes et valorisent les lectures religieuses1.
C’est ainsi que la littérature se diffuse quand même auprès des jeunes filles au xixe, mais dans quelles conditions2 ?
Nous verrons ici quelle place est faite à la littérature dans les livres d’éducation pour les jeunes demoiselles du peuple et de la haute société, surtout dans le premier tiers du xixe siècle. Nous confronterons les conseils à destination des jeunes filles issues des populations laborieuses par Mme Campan en 1830 et le livre de lectures variées visant l’éducation des enfants du peuple, tel qu’il est composé par Marie Pape-Carpantier (réédité entre 1863 et 1878). Puis, nous analyserons ce que lisaient dans les mêmes années, de 1830 à 1850, les jeunes filles de la bourgeoisie, à partir d’un numéro du Journal des demoiselles.
Le livre d’éducation, Conseils aux jeunes filles, d’Henriette Campan (1830)
Mme Campan appartient à la haute bourgeoisie ; elle est en contact avec la maison du roi, et cherche à former des jeunes filles de milieu rural ou artisanal (voire s’adresse à des filles de journalier). En 1830, dans ses Conseils aux jeunes filles (comme à l’autre bout du siècle, Henri Marion, en 1880 qui participa, aux côtés de la République des Jules à la mise en place d’un enseignement secondaire pour jeunes filles3), elle insiste sur le fait que toute éducation doit être liée aux activités qu’auront les élèves en question plus tard, et doit donc être adaptée aux classes sociales et aux métiers leur afférant :
Les filles du laboureur, de l’artisan, du simple journalier, ne pourraient entendre le même langage, recevoir les mêmes préceptes que les enfants du général, du magistrat, de l’avocat célèbre, ou du banquier millionnaire ; il faut à cette partie intéressante de la société une éducation différente,
écrit-elle dans son avant-propos4.
Mme Campan destine son livre de lecture « avant tout aux enfants des classes laborieuses » (p. 5) mais ne pense pas ses préceptes « sans fruit pour les enfants des classes supérieures » (ibid.). Aussi donne-t-elle des conseils plus universels dont le but est de ne pas se satisfaire, pour les filles issues du peuple et du milieu rural, de savoirs religieux, mais de leur faire toucher du doigt « les avantages de l’ordre, de l’économie, du travail, et les dangers du vice » (p. 4).
Je crois du moins qu’on peut leur faire lire avec intérêt, avec utilité, les aventures des Vertueux Orphelins, la petite pièce de la Ferme partagée, et l’histoire véritable qui a pour titre La Vieille de la chapelle. Dans quelques rangs que soient puisés des exemples d’amitié fraternelle, de générosité, de sagesse et de piété filiale, ils ne sauraient manquer de toucher de jeunes cœurs. (p. 5)
Elle évoque ainsi les titres des contes et nouvelles qu’elle a écrits elle-même et qui sont tissés dans le fil de ses Conseils au sein de l’ouvrage.
Le premier chapitre (p. 7-13) de ce livre de Conseils, qui est en fait un livre de lecture où l’autrice s’adresse à ses lectrices en les félicitant pour leurs progrès en orthographe (p. 7), fait alterner les récits et les réflexions argumentées autour de préceptes moraux. Par exemple, elle insiste sur la gratitude due aux parents (aux mères et aux pères) et puis revient sur la permission de manger de la viande mais sur la nécessité de ne pas faire souffrir les animaux, ce qui est blâmable (p. 12-13). Le troisième chapitre est une argumentation pour faire respecter les propriétés. Ainsi, voilà le lecteur pris à partie, mis en scène avec son bonheur de posséder de beaux habits de communion dont il ne voudrait être privé. Le vol de nourriture, de même, risque d’ouvrir « la carrière du vice à de hardis voleurs qui, devenus par suite des assassins, ont péri par la main du bourreau » (p. 19). Et, pour preuve de cet adage, le quatrième chapitre (p. 21-26) du livre de Conseils raconte la mort en place de Grève de Cartouche, le célèbre voleur, pour être allé jusqu’à l’assassinat, après avoir commencé sa carrière par le vol d’une simple pomme, vol qui le conduisit aux pires vices : il témoigne lui-même dans une confession, en aveu public (fictionnalisé par Mme Campan), là où les larcins conduisent. Le cinquième chapitre (p. 27-38) est consacré à la calomnie : cette fois, c’est la narratrice qui prend des allures de conteuse pour narrer où ont conduit les calomnies contre la reine Marie-Antoinette qu’elle a connue. Témoin directe du vécu de la reine, Mme Campan donne du suspense à l’histoire, et une actualité à la lecture à son livre.
Complétant la démonstration sur l’horreur de la calomnie en employant un présent de simultanéité qui mime la concomitance entre la lecture et ce qui est décrit, elle poursuit la démonstration en la transposant dans un autre cadre social :
Vous voyez, mes enfants, jusqu’à quelle respectable et imposante élévation l’atroce calomnie a osé porter ses coups mortels […]. Je vais vous faire quitter les palais où la calomnie s’est tant exercée de nos jours, pour descendre avec vous, non pas dans la chaumière, mais sous le misérable abri du pauvre. (p. 31)
L’autrice, comme le fera plus tard Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires, mime la simultanéité entre l’écriture et le récit de l’événement, propulsant le lecteur sur les lieux qu’elle décrit, le faisant témoin direct de l’action5.
Suit un chapitre sur le mensonge (chap. vi, p. 39-42) et sur l’amour du travail (chap. vii, p. 43-76). De là est inséré dans le livre de lecture une « Histoire d’Henriette et d’Edmond, ou les vertueux orphelins » (p. 45-76), dont l’autrice est Mme Campan elle-même. Dans cette histoire, les petits orphelins garçons sont félicités pour leur bonne orthographe et leurs travaux en calcul tandis que les filles sont citées pour leur conduite et leurs progrès (p. 56). Le huitième chapitre (p. 77-81) s’intitule « La fortune ne peut être égale entre les hommes ».
Enfin, les conseils sont parfois directs pour les jeunes filles dans leurs rapports au mariage, ne passant pas par l’entremise d’une narration :
La qualité la plus essentielle dans une femme est la douceur et l’égalité de caractère. Ne l’oubliez jamais, il n’y a pas un seul homme qui soutienne les contrariétés ; et tous, s’ils sont honnêtes, se rendent à la raison, quand les représentations ne sont mêlées ni d’emportement ni d’aigreur (chap. x, p. 117).
La ressemblance avec ce que dit Rousseau sur ce même sujet est frappante6. À ce destin de femme mariée, peut être substitué celui d’une femme qui reste non mariée et se dévoue à ses parents et aux malades. Quant à celle qui veut fuir le monde, elle peut s’unir à la religion (p. 120-121).
Interprétation du livre de Mme Campan
Finalement, l’adresse orale parcourt la totalité du livre, mimant à l’écrit ce qu’aurait été un cours, mais ce tour narratif est permanent, entraînant le lecteur à l’intérieur de l’ouvrage. On voit que cette non-démarcation entre le récit adressé au lecteur inscrit et le contenu même du cours, fût-il un cours de comptabilité, crée une mimesis d’expérience partagée. Mimesis qui rend la lecture en quelque manière palpitante car elle suspend l’intérêt du lecteur aux lèvres de la conteuse : lecteur et institutrice partagent le même espace et le même temps, un univers identique ; l’action narrée est rendue contemporaine, elle a lieu pendant la lecture même.
Cette technique n’est pas seule remarquable et spécifique. En effet, la variété est à l’œuvre dans le texte : elle se double d’une inclusion de textes courts, tels des contes, ou de récits, des pièces de théâtre, qui viennent s’insérer au reste du discours pédagogique. Ils sont là pour frapper davantage que le pur énoncé moral et pour mettre sous les yeux ce que le texte a énoncé.
Le lien avec la lectrice créé par le livre de lecture est fondé sur une affectivité recherchée : il s’agit presque du discours d’une mère s’adressant à ses enfants, ou d’une institutrice qui apparaît du reste davantage comme une conseillère. Ce lien intime reflète la nécessité pour les écrivaines de l’époque de s’inscrire dans le discours maternel7 : d’ailleurs presque toutes les productions des écrivaines étaient des mémoires ou des discours consacrés à l’éducation. Ainsi, Mme Campan institue une lectrice modèle qui serait une jeune fille dont elle aurait la charge. Mais la douce institutrice y manie également la menace en passant par le biais de représentations effrayantes : à propos de Cartouche par exemple, il ne s’agit pas de créer du suspens pour les lectrices en revenant sur ses aventures passées ni de divertir par ses aventures, mais bien de mettre en garde.
Le lien de l’autrice à la lectrice se fonde sur la confidence maternante et sur la représentation des dangers de vie. Comment peut-elle conserver l’attention du lecteur ? Sans doute en variant les tonalités. Mais aussi parce qu’elle devient d’autant plus intime avec la lectrice qu’elle se mue en conseillère conjugale et prévient les jeunes épouses de ne pas être déçues quant au changement de comportement de leurs maris, une fois qu’ils les auront épousées. Le fond même des Conseils réfute toute velléité de projection dans une relation amoureuse et courtoise. Du roman il ne saurait être question ni dans les Conseils aux jeunes filles ni dans la vraie vie.
Le livre de Mme Campan s’adresse aux jeunes filles surtout de « classes laborieuses ». Qu’en est-il des livres de lecture et d’éducation consacrés aux lectrices plus jeunes, vers 1870, de ces mêmes milieux populaires, et aussi, des lectrices des classes aisées dans les années 1830 ? Nous observerons successivement le livre de Marie Pape-Carpantier destiné aux enfants (de 1863 à 1878) et le Journal des demoiselles (1833-1922), ayant pour lectorat les jeunes filles de la haute société.
Livre de lecture de Marie Pape-Carpantier : Petites lectures variées suivies de leur moralité pratique pour les enfants des deux sexes
Par contraste avec le choix d’Henriette Campan, le livre de lecture proposé par Marie Pape-Carpantier, qui vise le même public, la même strate sociale, mais venant d’une autre énonciatrice, qui appartient à une autre couche sociale que Mme Campan, et s’adresse à des lectrices plus jeunes, est édité six fois entre 1863 et 1878. Il n’est pas constitué de textes écrits par elle-même mais d’extraits des auteurs écrivant pour la jeunesse (Arnaud Berquin, Aimé Martin), ou des auteurs pour adultes (Lamartine, Montaigne…). L’ouvrage s’adresse aux enfants du peuple (ils étaient lus dans des écoles permettant aux ouvrières d’aller travailler en laissant leurs enfants en soin), et ne distingue pas les filles des garçons. Le livre de lecture s’intitule Petites lectures variées suivies de leur moralité pratique pour les enfants des deux sexes8, par Marie Pape-Carpantier, inspectrice générale des salles d’asile. L’ouvrage s’organise en présentant une table des matières en sept livres qui contient des textes courts pris à Berquin, Marmontel, La Presse des enfants, Franklin, Lamartine, Saint-Marc Girardin, Aimé Martin, La Civilité chrétienne, La Bruyère… Les sept parties en sont :
- « Anecdotes et qualités morales » ;
- « Sentiments religieux et de la famille » ;
- « Bonne éducation » ;
- « Mauvaise éducation » ;
- « Phénomènes et beautés de la nature » ;
- « Charme et qualités des animaux » ;
- « Sujets divers ».
Cette fois-ci, le discours conjonctif de l’autrice est réduit. Le texte ne s’adresse pas spécifiquement aux filles mais maintient le ton maternel. À la page 170, se termine un extrait en trois pages de Laurence Sterne, écrivain britannique, narrant le don d’un chien par un pauvre à un mendiant qui avait perdu le sien, écrasé par la voiture d’un riche homme méprisant. La réflexion suivante de l’autrice est imprimée juste en dessous du texte de Sterne, sous l’intitulé « Réflexion » :
[…] que vous dirai-je, enfants, après ce que vous venez de lire ! Rien. Vous sentirez de vous-même combien est admirable cette histoire si simple, et pourtant si touchante que je ne puis jamais la relire sans que mes yeux se remplissent de larmes. (p. 170)
L’émotion supplée à la réflexion car la générosité de l’exemple ne peut que susciter des larmes, remplaçant l’explication intellectuelle. Le livre est ainsi constitué, sans discours conjonctif de l’autrice, par une addition d’extraits de textes de grands auteurs reconnus, suivis d’une interprétation des textes produits par l’autrice en quelques lignes, la morale pouvant être une simple émotion. C’est que l’avant-propos du livre de lecture de Marie Pape-Carpantier précise que la morale écrite y est courte car c’est à l’enfant à se faire sa propre opinion, que les maîtres doivent faire accoucher. Ainsi, l’ouvrage se clôt par un extrait de Rousseau décrivant son bonheur de retourner en Suisse dans sa patrie, après un long éloignement de son lieu de naissance. L’extrait est interprété en quelques lignes dans un bref texte intitulé « Réflexion » par Marie Pape-Carpantier, selon la même structure que dans l’exemple précédent :
Notre patrie n’est pas toujours la plus belle comme pays ; mais elle doit toujours nous être chère comme une maison paternelle où l’on revient avec bonheur, parce que c’est là qu’on aime et que l’on est aimé. (p. 171)
L’autrice du livre de lecture tire de chaque lecture une réflexion concise pour inciter chaque jeune lecteur à tirer sa propre conclusion.
La préface de Marie Pape-Carpantier fustige la lecture d’impressions au profit d’une lecture qui apporte réellement :
Il existe beaucoup de recueils de lecture pour les petits enfants : mais ce genre d’ouvrage a-t-il été suffisamment compris ? A-t-on atteint le but ? Il est permis d’en douter : ceux-là mêmes qui offrent le meilleur choix de morceaux sont restés en deçà du bien que l’on se propose. En général, on cherche à plaire, à charmer l’imagination des enfants, quelquefois même à intéresser le cœur : on y parvient plus ou moins ; mais, la page tournée, le souvenir de la lecture s’évanouit. — Il n’en reste rien, parce que cette lecture n’a produit qu’une simple et fugitive impression.
Ce sont des idées, des idées nettes et précises qu’il faut éveiller chez l’enfant. Ce sont des croyances justes, distinctes, et à son usage personnel, qu’il faut provoquer en lui. On devrait lui poser, à la fin de chaque lecture, cette sage question de quelques anciens catéchismes : Quel fruit doit-on retirer de cette leçon ?
Pour le savoir, il suffirait de chercher ; mais l’enfant n’en prend point la peine, et le fruit ne sort point tout seul de la leçon. C’est pour remédier à ce préjudice que nous avons fait suivre chacune de nos petites lectures tantôt d’un commentaire qui en résume le sens moral, tantôt d’une question destinée à provoquer ses réflexions personnelles, travail d’une valeur incomparable en éducation. (p. 3-4)
Le plaisir n’est pas valorisé mais une lecture utile et démonstrative, au service d’une leçon qu’il sera plus facile de mémoriser par le biais de la mise en situation précise, d’une morale en action.
En ce sens, Pape-Carpantier est plus stricte que les instructions officielles de 1872 qui stipulent : « La bibliothèque n’étant composée que de livres absolument irréprochables au point de vue moral et au point de vue littéraire, vous laisserez aux jeunes gens une certaine liberté dans le choix de leurs lectures9. »
On voit que tous les extraits d’auteurs sont choisis pour être démonstratifs et ne visent pas principalement le plaisir du lecteur chez Marie Pape-Carpantier. Sa conception de la lecture est différente de ce que propose Henriette Campan : pour Pape-Carpantier, il faut présenter aux enfants des extraits d’ouvrages d’écrivains reconnus et non plus des textes constitués ad hoc.
Pour conclure sur cette comparaison, nous dirons qu’une autrice de la haute société, Mme Campan, écrit un livre pour des jeunes filles des classes laborieuses (enfants de laboureurs, d’artisans et de journaliers), en mêlant les conseils éducatifs et maternels, à des fictions ou à des pièces qu’elle crée elle-même et dont elle tire une morale dans le discours conjonctif les accompagnant. Elle s’institue autrice et ne donne pas la parole à d’autres écrivains. En revanche, Marie Pape-Carpantier à la même époque, issue d’un milieu plus pauvre que Mme Campan, et qui vise des publics plus jeunes et mixtes, relevant de la même classe sociale que ceux visés par Mme Campan, mais sans doute davantage ouvriers, recourt directement aux auteurs (pour la jeunesse ou pour les adultes), et se contente d’une légère interprétation morale ou d’une question courte pour son propre discours. À ses yeux, la littérature n’est pas liée au romanesque ni aux risques de relations amoureuses dangereuses. Il s’agit à présent de se demander si l’on observe des différences de contenu en fonction des classes sociales visées.
Du côté de la bourgeoisie, le Journal des demoiselles
Le Journal des demoiselles est une revue mensuelle. Fondé en 1833 par Jeanne-Justine Fouqueau de Pussy (1786-1863), ce journal a pour lectrices les jeunes filles de quatorze à dix-huit ans (il existera avec des périodicités variables jusqu’au début du xxe). Le journal, possédé par la famille Thierry, dont une Donatine (Petit courrier des dames, 1822) et sa fille Coralie (Journal des tailleurs, 1830-1888, La Poupée modèle. Journal des petites filles, 1863-1924), témoigne de ce que les femmes de cette famille ont exercé un pouvoir de chefs d’entreprise10. Les rubriques contiennent en apparence peu d’analyses littéraires mais privilégient la géographie, ou l’histoire de héros ou d’héroïnes.
On évoque par exemple « La distribution des climats », dans le Journal des demoiselles du 15 janvier 183611 , voyant la population du Nord « dans des terriers enfumés » et celle du Sud, « sous l’équateur et au voisinage des tropiques, le ciel ardent, la végétation splendide, la race humaine sans génie et comme accablée sous les feux du soleil» (p. 2). Le texte se réclame alors de Montesquieu montrant que les institutions qui guident les peuples dépendent du climat :
Montesquieu a écrit son plus fameux ouvrage pour montrer que les institutions qui régissent les peuples dérivent en général du climat auquel ils sont soumis, et cette idée, aussi profonde que vraie, ne saurait être contestée. (p. 2)
Le ton, on le voit, ne laisse pas à répliquer. À travers ces descriptions climatiques scientifiques et religieuses à la fois, c’est la providence qui est louée d’avoir construit un système équilibré : les êtres vivants sur la Terre sont protégés des rayons lumineux par l’atmosphère.
Suit une rubrique intitulée « Littérature française » sous-titrée « Revue littéraire » et qui résume quelques ouvrages récemment parus, dont, par exemple, Souvenirs d’un Voyage en Orient de Lamartine (p. 5-8). C’est Alida de Savignac, une des principales rédactrices de la revue, entre 1833 et 1852 qui résume l’œuvre de Lamartine, en insistant sur le rôle des femmes bédouines, toujours consultées par leurs époux, mais travaillant sans cesse à traire et à pétrir les galettes, ou dont la plus belle femme est choisie pour inciter les soldats au combat, placée dans un palanquin en tête de l’armée. La rubrique « littérature étrangère » (p. 8-10) de ce numéro est consacrée à un extrait emprunté à l’auteur anglais Addisson (1672-1719), dont sont donnés à lire en version bilingue, anglaise et française, des fragments d’un récit de rêve narrant la dissection de la tête d’un « élégant ». Addisson ironise sur le fait que ce cerveau ait été uniquement constitué de « fleur d’oranger ». Ironie mordante puisque le rêve d’Addisson se termine par l’allusion au fait que ce « Beau » était tenu pour un génie par certaines femmes.
C’est étonnamment sous le titre « Éducation » (p. 11) que succède à ce texte anglais une rubrique intitulée « Légende », sur six pages (p. 11-17). Dans les légendes et les récits médiévaux, et sous le prétexte de délivrer une connaissance historique, s’insinue pourtant une forme de littérature dans le Journal, encore une fois porteuse d’une valeur symbolique, visant l'éducation des jeunes filles. Ici, c’est le respect de la religion qui leur est enseigné, et la nécessité de la patience, avant une légitimation de l’amour par le mariage qui le sanctifie (le mariage est présenté comme un sacrement). D’où le fait que la légende médiévale ne soit pas placée dans une rubrique intitulée « Histoire », mais sous le chapitre « Éducation », rubrique bien clairement porteuse de sa véritable visée. Dans ce numéro, la légende, écrite par Alida de Savignac, est celle de Richard sans Peur (p. 11-17), qui, lors des croisades, sut affronter l’ennemi sans jamais éprouver la moindre crainte. Interdit de sacrement, Richard ne pouvait plus se marier. Résolu à se libérer de son sang-froid, il affronte alors un sabbat de sorciers, et sauve un bébé éthiopien qui allait être ébouillanté : Richard a donc échoué dans sa recherche de la peur. Désolé de ne pas sentir d’effroi, le paladin se destine à affronter Satan lui-même en allant chercher la dépouille de son ancêtre défunt, son corps non enterré, en état de péché mortel. Mais Richard s’acquitte de reprendre la dépouille sans frémir et lui offre une réelle sépulture, s’opposant au malin sans hésiter. Il revient encore triomphant : « décidément, ni homme ni Démon ne lui feront peur. — Ce sera donc moi, murmura Emmeline » (p. 16), sa fiancée, désespérant de pouvoir jamais l’épouser. Et, préparant son habit de noce, elle demande à Richard de lui tendre un fil noir qui est contenu dans un coffret de verre où elle l’a mis, coffret qui lui est très précieux :
Le coffret était placé sur une planche haute ; Richard le prend, l’ouvre… et deux passereaux, retenus prisonniers par le filigrane, s’échappent, effleurant de leurs ailes la figure du paladin… L’intrépide tressaille, le coffret lui échappe et tombe sur le pavé.
« Mon coffret est brisé ! cria Emmeline avec éclat. — Excusez-moi, ma sœur, c’est que j’ai eu bien peur ! — Peur ! s’écria la châtelaine — Peur, répétèrent les damoiselles. — Peur ! peur ! Richard a eu peur ! » Et ce mot, volant de bouche en bouche, retentit jusque sur les remparts de la forteresse. « Ah bonne sainte Catherine, que je te remercie ! », disait en même temps Emmeline, les mains jointes et les yeux levés vers le ciel.
[…]
« Ceci prouve, dit la sage Hodierne que celui qui a la foi ne doit jamais perdre l’espérance ; car lorsque le Seigneur le permet, où les plus grands moyens ont échoué, les plus faibles réussissent ».
Le dimanche suivant, Richard conduisit Emmeline à l’autel, et par cette alliance il devint seigneur des beaux domaines du Plessis-le-Château. (p. 17)
Cette légende, est proprement littéraire et même romanesque. Alors que l’autrice dit refuser les romans, selon la thèse de Christine Léger12, elle n’en pratique pas moins une écriture qui s’inspire des récits médiévaux, certes, mais donne à lire la puissance de la figure féminine, qui parvient à faire naître la peur dans l’esprit du plus audacieux des paladins. Le Journal des demoiselles offrirait donc aux jeunes filles de la bonne société la possibilité de lire des passages romanesques, sans qu’il s’agisse de romans proprement dits ? S’il s’agit sans doute là de montrer que les femmes peuvent avoir un impact sur la puissance des hommes, mais à condition de patience et de respect des interdits religieux, la morale de l’histoire représentant une forme d’éducation à l’amour tempérant et à la connaissance des croisades, comme le suggère le titre du chapitre (« Éducation »), il n’en reste pas moins que cette morale se diffuse par et grâce au romanesque.
À la légende écrite par Alida de Savignac succède, en huit pages (p. 18-25), un texte de Victorine Collin narrant en une nouvelle brève l’amour absolu d’une sœur pour son frère, fait d’abnégation et renoncement à son propre bonheur, qui ne s’obtient enfin qu’après le détour du service à son frère. Suivent, dans la revue, un poème (p. 26), un « Album des antiquités de Paris » (p. 27-29) décrivant deux hôtels particuliers parisiens (moment historique de la revue, l’occasion d’évoquer des événements de l’histoire de France), puis la « Revue des théâtres » (p. 29) (une page signée par F. D. P., sans doute Fouqueau de Pussy). La littérature est donc encore présente, cette fois sous sa forme poétique, puis sous sa forme dramatique (à travers la revue des sorties théâtrales), et, à la fin du numéro par une chanson (n. p.).
« Le petit joueur de harpe » est le titre du poème succédant aux extraits narratifs. Il est de Paul Lacroix et raconte la complainte d’un pauvre musicien :
O ma harpe ! seul héritage
Que mon vieux père m’a laissé,
Viens attendrir, à son passage,
L’homme opulent au cœur glacé !
Mon âme souffre, à ses regrets en proie,
Et de la faim je ressens les douleurs.
Harpe fidèle, essaie un chant de joie…
La corde, hélas ! se détend sous mes pleurs ! (p. 26)
Le poème, qui occupe toute une page en trois strophes de vers en octosyllabes et en décasyllabes, est là pour susciter la pitié et inciter à la charité. Dans un autre numéro, le poème est composé par Amable Tastu, et intitulé « Le Tems Pascal13 » : il exalte la cloche appelant le chrétien à l’église.
La revue théâtrale dans le numéro du 15 janvier 1836 propose une critique de la pièce présentée à l’Opéra-Comique, La Grande Duchesse de Merville et Melesville, sur une musique de Carafa. La critique Fouqueau de Pussy résume l’œuvre, très romanesque, inspirée d’une nouvelle florentine, où la jeune héroïne ne pouvait épouser celui qu’elle aimait, puisque son père lui en destinait un autre, meurt, est placée dans une crypte mais est ressuscitée par l’amour de son aimé, l’ensemble se terminant par un mariage décidé par la duchesse, outrepassant l’interdit paternel. Le résumé fait, la critique indique les trois airs qui ont eu du succès et qui ont été applaudis (« on a beaucoup applaudi trois petits couplets fort jolis en mouvement de walse »), un duo (« remarquable par un caractère doux et tendre ») (p. 29) et un chœur. La critique théâtrale se fait reflet du succès des passages et du prestige, davantage qu’elle n’émet de position de jugement concernant la mise en scène ou l’œuvre elle-même.
Enfin, sous la bizarre rubrique « Correspondance » (p. 29-31), dans une lettre adressée à une autre jeune fille (auprès de qui la jeune fille narratrice se plaint de la dureté de la période où tout le monde a perdu quelque être cher) se trouvent inclus des conseils de mode, prolongés par un « patron » (n. p.) donnant les formes des pièces de tissu à couper, au milieu duquel se trouve placé une éphéméride (p. 31-32) évoquant un événement historique du Moyen Âge (« 1er juillet 1308. — Jour fixé pour la liberté de la Suisse »). Le numéro se clôt par une partition pour guitare et piano accompagnant une chanson « L’étoile qui brille » dont le thème est le danger de la vie dont seul protège le mariage (n. p.) (sur une musique composée par C. A. Boulanger).
Finalement, Alida de Savignac a beau rejeter le romanesque, elle n’en pratique pas moins l’écriture du conte ou de la nouvelle. Le roman est peut-être perçu comme dangereux parce qu’il viendrait parler d’amour, mais les deux contes inclus dans ce numéro du journal, et appelés « Légende » ou « Éducation » narrent néanmoins des aventures amoureuses, même si elles diffèrent des textes où l’amour charnel se devine comme chez Sophie Cottin s’inspirant de Rousseau, où les fautes amoureuses risquent en effet de damner l’héroïne14. Ici, au contraire, l’amour féminin est épuré. Il est sanctifié à condition qu’il ait pour but la formation des nœuds de l’hymen : sans doute le chapitre « Éducation » s’explique-t-il en ce qu’il montre quelle forme licite de mariage est possible. L’adresse à la lectrice y alterne avec ces formes de récits et des conseils directs en matière de mode et de toilette, mais cette fois-ci la complicité est fondée sur le rapport à une amie à qui l’on feint de s’adresser : « Je te souhaite une bonne année ! En écrivant ces mots, que je dis du cœur mes yeux se mouillent de larmes. Que serait-ce donc si je te les disais de bouche ? » (p. 29). Il est très étrange pour nous que cette rubrique de conseils de couture soit ainsi incluse sous le titre « Correspondance » (fictive).
Ainsi, forme honnie en apparence pour l’éducation, le roman règne pourtant, sous les espèces de légendes ou de récits réalistes d’amour total, voire sous la correspondance entre deux amies chères. Quant aux poèmes et chansons proposés, ils semblent autant désireux de porter des valeurs éthiques, qu’esthétiques, et appellent à la charité ou mettent en garde contre la dureté de la vie tant qu’on n’est pas mariée. La littérature, si censurée en apparence pour la forme du roman incitant à l’amour, est pourtant maîtresse de ce Journal des demoiselles, et emprunte les tours les plus divers au point même d’envahir les conseils de modes.
***
Dans la première moitié du xixe siècle, les pratiques d’éducation à la lecture et d’éducation des jeunes filles sont variées, deux systèmes contradictoires se chevauchant parfois. Y alternent des livres de lecture composés ad hoc par les écrivaines à l’image de ceux de Mme Campan ou de Mme de Necker – et plus tard, ce seront des commandes officielles qui seront passées par les ministères de l’Instruction publique – et des livres constitués d’extraits de grands textes classiques reconnus. Ainsi Campan, en 1830 encore, invente, pour convaincre, des nouvelles, des drames, tandis que Pape-Carpantier, de 1863 à 1878, offre une anthologie d’auteurs reconnus. Tandis que la première a un ton prescriptif et maternel simultanément, la seconde se contente de commentaires brefs. Les deux visent l’utilité et l’instruction. La première cependant, recourt à une énonciation qui établit une sorte de simultanéité entre écriture et lecture, faisant naître la complicité et incitant à considérer l’écrivaine comme une mère ou une conseillère. En tout cas, elle met en œuvre la fiction d’une écriture concomitante à sa lecture et introduit la lecture dans le récit, à défaut de l’introduire dans la fiction.
Dans le Journal des demoiselles en 1836, il s’agit de textes, rédigés par des femmes de la grande bourgeoisie s’adressant, pour leurs loisirs, à des jeunes filles de même rang. Le lien affectif est bien présent, à l’instar d’une énonciation qui, comme chez Campan, transforme les conseils techniques en une correspondance fictive et littéraire entre amies. Chez Campan, il s’agissait de mimer par le livre un rapport entre une mère et une fille, ce qui s’explique puisque Campan était de classe supérieure à ses lectrices qu’elle pouvait considérer comme ses inférieures ou ses enfants, tandis que les rédactrices du Journal des demoiselles sont de même niveau social que leur lectorat si bien qu’elles miment des relations entre amies.
Outre la présence de l’affectivité qui s’insinue même dans les conseils techniques, étrangement, la littérature, alors même que le roman est absent du Journal des demoiselles, envahit l’énoncé (sous forme de légendes et de nouvelles). Ainsi, il apparaît que, si le romanesque est apparemment refusé aux jeunes filles, cependant, la fiction leur est autorisée sous le masque des nouvelles, ainsi que de la poésie et des chansons. La fiction, histoires courtes, récits brefs, inventés par les rédactrices du Journal ou prélevés chez des écrivains et réécrits, figurent dans les journaux de jeunes filles de la haute bourgeoisie ou de la noblesse, sans doute parce que, plus courts que des romans, ils risquent moins d’immerger leurs lectrices ou de les fasciner, et parce que cette brièveté les rend aptes à porter une morale.
On pourrait aller jusqu’à dire que, paradoxalement, le roman étant refusé aux jeunes filles, la littérature, soit sous les espèces de l’énoncé complice, soit sous la forme de narrations et de poèmes, est présente quand même, déguisée ou non, à tout moment. Les écrivains reconnus sont présents, quant à eux, dans les livres de lecture des très jeunes. Ils ne le sont plus pour les lectrices plus âgées, laborieuses ou du grand monde. Les emprunts faits dans les bibliothèques semblent montrer, quant à eux, qu’il est loisible aux femmes, une fois mariées, de lire des romans.