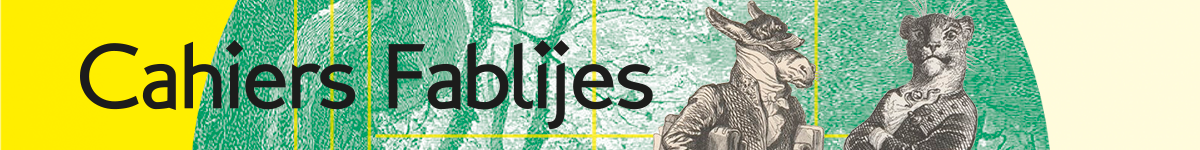Ce dossier est composé de contributions au séminaire « Littérature de jeunesse et éducation des filles au xixe siècle » animé en 2021 et en 2022 par Amélie Caldérone et Marion Mas et d’articles qui complètent celles-ci dans une perspective plus internationale. Le xixe siècle a été celui de l’essor des publications destinées aux jeunes lecteurs. Les contributions offrent différents aperçus sur la diversité des supports et des formes de ces publications. Certaines explorent des succès de la presse enfantine, comme L’Ami des enfants et le Journal des demoiselles. Le premier de ces deux titres est un mensuel de vingt-quatre numéros publiés de 1782 à 1783 par Arnaud Berquin qui a prolongé cette revue composée d’historiettes en faisant paraître les livraisons de L’Ami des adolescents entre 1784 et 1785. Cette publication inspirée par la lecture du périodique allemand Der Kinderfreund a été traduite en anglais et diffusée dans l’Europe entière et aux États-Unis1. L’Ami des enfants a été lu dans diverses versions tout au long du xixe siècle. Repris en volume, il a aussi été remanié sous la forme d’ « éditions anthologiques [qui] coupent, regroupent et récupèrent dialogues, historiettes et saynètes selon l’âge et le sexe du public visé suivant l’utilisation prévue (manuels de morale religieux ou laïcisés, de lecture pour les écoles ou de livres domestiques)2 ». Par-delà les « berquinades » très présentes dans les livres de prix diffusés par les éditeurs catholiques, la revue d’Arnaud Berquin a également influencé de manière durable le roman pour la jeunesse qui « s’invente3 » au xixe siècle en l’invitant à explorer « la banalité du quotidien, au travers d’un goût pour la conversation4 », comme le feront, par exemple, à partir de 1857, la comtesse de Ségur et d’autres romancières de la « Bibliothèque rose illustrée » de Hachette. Le Journal des demoiselles, quant à lui, est, avec le Journal des enfants et le Journal des jeunes personnes, l’un des plus célèbres et des plus pérennes parmi les nombreux périodiques édités au début de la monarchie de Juillet. Découvrant « le parti qu’elle peut tirer d’un jeune et vaste public, fortuné et avide de connaissances5 », une « génération montante d’écrivains, de journalistes et de pédagogues liés au mouvement romantique6 » a participé, au début des années 1830, à la création de près d’une soixantaine de périodiques traitant « de morale, de religion, de littérature classique, mais aussi de théâtre contemporain, du mouvement romantique dans les lettres, les arts, la musique, de modes, de sciences, de géographie, et surtout d’Histoire, présentée de façon moderne, avec ses nouvelles sciences annexes, l’archéologie, la paléographie et la paléontologie7 ».
Des articles de ce deuxième numéro des Cahiers Fablijes portent sur d’autres formes de publications qui, à l’image de cette presse didactique des années 1830, transmettent des savoirs à leurs jeunes lecteurs. Parmi ces publications figure le livre de lecture courante. Ce type de manuel scolaire raconte les aventures et les apprentissages d’un ou plusieurs personnages pour accompagner les élèves dans le perfectionnement de la lecture tout en dispensant des connaissances et en transmettant des valeurs. Le premier succès du genre date de 18188. Publié par Laurent de Jussieu sous le titre Simon de Nantua ou le Marchand forain, il retrace le voyage fictif du narrateur et du personnage éponyme sur les routes de la France depuis la petite ville de Nantua, dans l’Ain, jusqu’à Rennes. Les succès de librairie que représentent les livres de lecture courante se comprennent dans le contexte économique du marché des ouvrages scolaires qui est en expansion tout au long du siècle grâce à la progression de l’école élémentaire. Signé G. Bruno et publié peu avant les grandes lois scolaires dont Jules Ferry a été le promoteur, Le Tour de la France par deux enfants a été un best-seller de l’école républicaine vendu à six millions d’exemplaires entre 1877, l’année de sa première édition, et 19019. Pour Isabelle Nières-Chevrel, le fil directeur du déplacement qui structure les livres de lecture courante invitant les élèves « à faire le tour de la nation10 » à l’instar de ceux de Laurent de Jussieu en 1818 et de G. Bruno en 1877, est hérité des Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse. Ce récit écrit en 1699 par Fénelon pour l’éducation du dauphin constitue l’un des « grands modèles littéraires sur lesquels va se construire le roman pour la jeunesse au dix-neuvième siècle11 ». Pour Francis Marcoin et Michel Manson, 1818 a marqué une date dans cette construction avec la parution de la « première robinsonnade française et romanesque à succès12 » : Le Robinson de douze ans de Jeanne-Sylvie Mallès de Beaulieu qui sera réédité sans interruption tout au long du siècle13. Une partie des contributions du dossier porte sur ce genre qui, sous les formes du roman du quotidien et du roman d’aventures, connaît un âge d’or en Angleterre, en France et aux États-Unis dans la seconde partie du xixe siècle.
Le lien noué entre la littérature de jeunesse, secteur en plein essor au xixe siècle, et l’éducation des filles recouvre trois formes. D’une part, les publications pour la jeunesse offrent des témoignages sur les types d’éducation offerts aux filles de leur temps. L’enseignement au xixe siècle est organisé selon une double séparation, entre classes sociales et entre sexes. L’instruction primaire est destinée aux classes populaires. Les grandes étapes de sa progression au cours du siècle sont, pour les garçons, la loi dite Guizot de 1833, pour les filles, l’ordonnance Pelet de 1836 puis la loi Falloux de 1850, et, pour tous, les lois dites Ferry de 1881 et 1882. L’enseignement secondaire dont le public est composé des enfants des classes aisées diffère selon les sexes. Les garçons peuvent préparer le baccalauréat, qui leur ouvre l’accès aux grandes écoles et à l’Université, dans des collèges et des lycées, publics ou privés, qui leur sont réservés. L’enseignement secondaire des jeunes filles, quant à lui, est d’autant plus divers qu’il est peu encadré par l’État avant la circulaire Duruy de 1867, puis la loi de 1880 dite Camille Sée, du nom de son promoteur. À l’intention des jeunes filles de quatorze à dix-huit ans, la circulaire de Victor Duruy définit un cycle d’étude de trois ou quatre années, composé de cours assurés par des enseignants masculins. Le programme de ces cours s’inspire de l’enseignement secondaire spécial des garçons. Mais, par contraste avec celui-ci, les cours n’offrent pas de diplôme et, à la différence des collèges et des lycées publics, ni leurs locaux ni leurs professeurs ne sont financés par l’État. « Entre 1867 et 1870, environ soixante cours ouvrent à travers la France, un grand nombre d’entre eux connaissant cependant un échec au bout de moins d’un an, tandis qu’en 1870, la guerre franco-prussienne met fin à cette expérience réformatrice libérale. En 1878, ne survivent que dix cours14 », indique Rebecca Rogers. Deux ans plus tard, en 1880, le vote de la loi Camille Sée engage l’État à financer des établissements secondaires réservés aux filles. Ces établissements ne préparent pas au baccalauréat mais ils offrent à leurs élèves un cycle d’études de trois ou de cinq ans dont le programme comprend notamment un enseignement moral, l’étude de la langue française, d’une langue vivante, des littératures anciennes et modernes tout en excluant les humanités (grec, latin et philosophie).
Vu le caractère tardif de la loi Sée, si certaines des sœurs des collégiens et des lycéens du xixe siècle ont fréquenté les « salles de classe » sans rester cantonnées au « salon15 » et à l’enseignement de leurs mères ou de leurs gouvernantes, c’est en tant qu’élèves d’établissements privés, de pensionnats religieux ou laïcs. Entre 1800 et 1830, ces institutions offrent :
un tronc commun comprenant l’écriture, la lecture, l’arithmétique, la littérature française, l’histoire et la géographie. Y figure également la mythologie, ainsi qu’une instruction élémentaire en sciences. Toutes accordent une place importante aux arts d’agrément – dessin, musique et danse – en plus de la couture, illustrant la tension constante entre une éducation qui vise à former de bonnes maîtresses de maison et un programme dont la véritable ambition serait de produire des femmes cultivées à l’aise en société16.
Le nombre de ces établissements, que ceux-ci soient dirigés par des maîtresses laïques ou par des congrégations religieuses, se multiplie sous la monarchie de Juillet puis sous le Second Empire. Alors qu’un décret de décembre 1853 les rattache aux contrôles des écoles primaires, leurs programmes les distinguent de celles-ci. Rebecca Rogers les décrit ainsi :
Dès le Second Empire, les pensionnats s’adressant à la bourgeoisie offrent une gamme relativement établie de cours qui ressemblent par bien des aspects au programme d’enseignement moderne en vigueur dans l’enseignement secondaire masculin, mettant l’accent sur l’histoire, la géographie, la littérature et les langues vivantes. Les programmes d’études des différents établissements témoignent d’un large consensus autour de l’idée qu’une demoiselle bien éduquée devrait être familière avec les lettres, avoir des notions de sciences naturelles, être capable de converser dans d’autres langues, savoir manier le fil et l’aiguille, et posséder un certain nombre de talents17.
Certains des textes pour la jeunesse étudiés dans ce dossier offrent des aperçus sur les établissements qui dispensent des enseignements aux filles de leur temps. Dans Le Troisième Livre de lecture à l’usage des jeunes filles, un succès de l’édition scolaire édité et réédité par Larousse de 1891 à 1922, Clarisse Juranville et Pauline Berger font référence aux maisons d’éducation de la Légion d’honneur, qui datent du Premier Empire et qui offrent le premier exemple d’internats pour les jeunes filles financés par l’État, en rendant hommage à Jeanne Campan, directrice « de la maison d’Écouen, où étaient élevées les orphelines des officiers de la Légion d’honneur18 ». Elles saluent aussi le succès des cours professionnels créés par la saint-simonienne Élisa Lemonnier, ce « legs majeur de 1848 en matière d’éducation19 » qui « ouvre la voie à une prise en considération des femmes comme agents économiques individuels20 ». D’après le bilan dressé au début des années 1890 par ce « couple d’auteurs à la Erckmann-Chatrian21 », les élèves des « six écoles professionnelles Élisa Lemonnier, qui comptent six cents élèves et rendent d’incalculables services22 », peuvent en « sortir aptes au commerce, ou bien couturières, brodeuses, fleuristes23 ».
En délivrant à ses lectrices les informations promises dans son long sous-titre, en assurant la transmission d’un « panthéon d’un tour de la France féminin24 », le livre de lecture courante de Clarisse Juranville et Pauline Berger illustre le deuxième lien tissé entre la littérature de jeunesse et l’éducation des filles. Textes et images contribuent à la formation de leurs lectrices, qu’ils délivrent des leçons de morale et de comportement social, comme c’est le cas dans les pièces qu’Adélaïde-Esther-Charlotte Dabillon de Savignac, Henri Burat de Gurgy et Narcisse Fournier publient dans les années 1830 dans le Journal des demoiselles, ou qu’ils enseignent des connaissances à la manière des récits de science qui comblent les lacunes des programmes jusqu’en 1882 puis qui accompagnent les évolutions de la « leçon de choses ». Conçue à partir des années 1860 comme « une méthode pédagogique générale, coextensive à l’ensemble des contenus d’enseignement25 », celle-ci devient leçon de sciences avec l’introduction d’un enseignement obligatoire des sciences physiques et naturelles à l’école primaire par la loi du 28 mars 1882. Le récit de science constitue un type de livre didactique qui met en œuvre les dispositifs de la vulgarisation en faisant de certains de ses personnages des pédagogues délivrant leurs savoirs par le biais de citations d’ouvrages et de manuels, d’exposés, de conversations et de dialogues. Daniel Raichvarg a distingué cinq groupes parmi leurs auteurs : les publicistes ; les littérateurs comme Zulma Carraud qui publie en 1864 Les Métamorphoses d’une goutte d’eau dans la « Bibliothèque rose illustrée » ou Émile Desbeaux, l’auteur d’une série éditée par Paul Ducrocq entre 1879 et 188626 ; les pédagogues comme Charles Delon ou Marie Pape-Carpentier qui signe Histoire du blé chez Hachette en 1873 ; ceux qu’il nomme les « incertains27 », à l’image de Paul Gouzy, polytechnicien qui fait paraître chez Hetzel en 1888 Promenade d’une fillette autour d’un laboratoire et, enfin, les scientifiques comme Louis Figuier28. En plus de transmettre des connaissances, les récits de science peuvent contenir, implicitement ou explicitement, une critique des programmes de leur temps et des propositions de réforme, à l’image du livre Les Jeudis de M. Dulaurier ou de la série d’Émile Desbeaux. Le journaliste agricole Victor Borie a publié le premier titre en 1865 pour remédier à « l’absence d’un enseignement scientifique en milieu rural29 ». C’est ainsi qu’il met en scène un instituteur qui « emmène ses élèves en promenade scientifique à travers champs, mais les jours sans école (les jeudis à l’époque) puisqu’il n’est pas autorisé à enseigner les sciences les jours de classe30 ».
Plusieurs volumes de la série d’Émile Desbeaux commencent par dresser un état des lieux de l’instruction de leurs personnages. La fillette éponyme de La Maison de Mlle Nicolle connaît de nombreuses dates et figures historiques mais elle ignore « avec quoi est fait ce simple et si utile petit morceau de sucre31 » qu’elle mange tous les jours. Ce déséquilibre entre les disciplines n’est pas réservé aux personnages féminins de la série de Desbeaux. Dans Le Jardin de Mlle Jeanne, Georges, le futur beau-frère de la jeune héroïne, a beau avoir reçu l’éducation « d’un homme du monde32 », il ne sait pas ce qu’est un lombric et croit, à tort, que les crapauds sont nuisibles. Interrogé sur le nom scientifique des vers luisants, il se trompe d’espèce en citant des vers d’Alexandre Dumas : « Parmi les cheveux noirs, le diamant reluit / Comme la luciole illuminant la nuit33 ». Le jeune ignorant jette lui-même une suspicion sur le système scolaire qui lui a décerné des lauriers : « je vois bien que toute mon éducation est à refaire34 ».
Tel est le troisième lien de l’éducation des filles et de la littérature pour la jeunesse. Celle-ci peut adopter un angle critique à l’égard des programmes et de la pédagogie de son temps et offrir des propositions dans ces domaines. Ces propositions ne sont pas univoques. L’un des points traités de manière ambiguë dans les livres pour la jeunesse est celui de l’objectif de l’éducation des filles de la bourgeoisie et de l’intérêt pour celles-ci d’acquérir des compétences leur permettant d’exercer un métier ou une activité rémunérée. Placer l’éducation des filles dans la perspective exclusive d’un horizon d’épouse et de mère35 est un fil rouge qui traverse le siècle et se retrouve à l’œuvre, à la fin de celui-ci, dans la loi Sée et dans sa création d’un cursus qui ne délivre pas de diplôme. Le consensus n’est pourtant pas total à l’intérieur de la société du xixe siècle consciente du risque du déclassement et de la menace pour une jeune bourgeoise comme pour une aristocrate de devenir une femme pauvre obligée de subvenir à ses besoins, voire à ceux de sa famille. Françoise Thérèse Antoinette Le Groing de la Maisonneuve en témoigne dès 1799 en concluant son Essai sur le genre d’instruction qui paraît le plus analogue à la destination des femmes par une réflexion sur la manière de préparer les jeunes filles à un « grand désastre de fortune36 ». Cette réflexion peut être largement partagée par les contemporains de l’essayiste vu l’instabilité sociale et financière suscitée par la Révolution française et les exemples de « désastres » fournis par celle-ci. La suite du siècle offre des témoignages qui prolongent, à leur manière, celui du livre d’Antoinette Le Groing de la Maisonneuve. Par exemple, entre 1850 et 1880, les élèves des pensionnats laïques ou religieux sont nombreuses à se présenter aux examens qui délivrent les brevets permettant d’exercer le métier d’enseignante dans le primaire et le secondaire37. Les livres pour la jeunesse ont donné un large écho à cette inquiétude du déclassement et à l’intérêt d’adapter l’éducation des filles à cette menace. Rebecca Rogers commente ainsi les historiettes et les pièces de théâtre des années 1800 à 1830 :
le traumatisme causé par la période révolutionnaire transparaît à travers le grand nombre de contes où une jeune fille travailleuse et douée se voit dans l’obligation d’utiliser ses capacités pour gagner sa vie38.
Ce discours continue à se faire entendre et à nourrir les fictions tout au long du siècle y compris sous la plume d’auteures relativement conservatrices. Dans Eugénie ou le monde en miniature, un roman signé en 1854 par l’auteure de traductions, de livres de vulgarisation, de romans et de manuels pour la jeunesse, Sophie Ulliac-Trémadeure, une mère rappelle à sa fille :
tu as déjà assez vu et assez lu, ma chère enfant, pour savoir que les talents et l’instruction sont des choses de grande valeur qu’on ne peut pas perdre comme on perd son château, sa fortune39.
Dans Cousine Marie, Julie Gouraud, directrice du Journal des jeunes personnes et romancière qui a notamment publié vingt-deux titres dans la « Bibliothèque rose illustrée » entre 1864 et 188840, fait de sa jeune héroïne l’élève d’« une femme que des revers de fortune avaient amené à prendre la direction d’un pensionnat41 ». Elle la dote d’une éducation faite d’« études sérieuses [auxquelles] s’ajoutait celle des langues, de la musique et du dessin42 » qui lui permettent de gagner de l’argent quand son père, un officier blessé pendant la conquête de l’Algérie, est placé en retraite. Dans une mise en abyme, Julie Gouraud fait de l’héroïne de ce roman paru en 1878 chez Hachette et réédité l’année suivante, une romancière enrichie par la publication d’« un petit livre rose43 ». À l’instar de celles de la lecture féminine étudiée dans le premier numéro des Cahiers Fablijes, les représentations de l’éducation des filles et de ses objectifs (le foyer, une activité rémunératrice) constituent ainsi « un lieu de friction44 », de « tension45 » du xixe siècle.
C’est dans cette perspective que ce dossier composé de six articles interroge l’éducation des filles selon et par la littérature pour la jeunesse : quelles conceptions et quels imaginaires de l’éducation féminine celle-ci dessine-t-elle ? Quels savoirs et quels destins assigne-t-elle aux filles ? Dans quelle mesure rencontre-t-elle des discours, notamment politiques, contemporains ? Quels dispositifs énonciatifs, théâtraux et narratifs construit-elle ?
Béatrice Ferrier et Barbara Cooper ouvrent la réflexion en étudiant des pièces de théâtre parues dans la presse, dont les jeunes personnages évoluent dans des situations du quotidien : une vingtaine de petits drames publiés dans L’Ami des enfants et L’Ami de l’adolescence entre 1782 et 1785 puis réédités tout au long du xixe siècle, pour la première ; une charade en action et des proverbes d’Adélaïde-Esther-Charlotte Dabillon de Savignac, Henri Burat de Gurgy et Narcisse Fournier édités dans le Journal des demoiselles dans les années 1830, pour la seconde. Toutes deux analysent la dimension métalittéraire et métathéâtrale de ces pièces destinées à être lues et jouées en famille ou en société. En s’adressant à leurs lectrices ou, mieux, en faisant de celles-ci des actrices amenées à répéter et à interpréter un personnage, les différents auteurs se font pédagogues pour montrer et pour faire jouer aux filles le rôle qu’elles devront incarner sur le théâtre que constitue la société de leur temps. Ce rôle peut cependant ménager des surprises. Le théâtre de Berquin compense l’infériorité numérique de ses personnages féminins en réservant à ceux-ci des rôles valorisants et structurants qui débordent les stéréotypes de la figure maternelle et de la fille soumise à son père. Les pièces parues dans le Journal des demoiselles ne se contentent pas d’inculquer aux filles que leur rôle familial et social est genré. Après Catherine Woillez et son roman Emma ou le Robinson des demoiselles qui date de 1835, Adélaïde-Esther-Charlotte Dabillon de Savignac fait affronter à un personnage féminin la solitude d’une île déserte, situation inspirée par celle du héros masculin de Daniel Defoe et censée, selon Jean-Jacques Rousseau, fournir « l’amusement et l’instruction d’Émile46 », son élève fictif.
En s’appuyant sur une série de livres de lecture courante dont la parution s’échelonne des années 1850 à la fin du siècle, Christine Prévost montre que les modèles féminins proposés aux élèves de l’école primaire s’inscrivent entre une soumission à l’ordre social et une certaine émancipation apportée par une activité professionnelle synonyme d’indépendance économique. Elle fait ainsi écho à Mona Ozouf pour qui les manuels d’éducation civique destinés aux jeunes filles à la fin du xixe siècle envisagent « souvent avec réalisme la nécessité du travail pour celles qui étaient pauvres, qui devenaient soutiens de familles ou qu’attendait le célibat47 » et enseignent que « le travail à l’extérieur pouvait n’être pas conflictuel avec l’ordre domestique48 ».
Anne-Claire Husser et Isabelle Guillaume explorent les représentations qui circulent à l’époque de l’adoption de la loi Camille Sée, la première en étudiant la place que les républicains Jules Ferry, Ferdinand Buisson et Henri Marion réservent aux questions de la mixité et de l’accès des femmes à des études prolongées, la seconde en analysant les romans que Joséphine-Blanche Colomb a fait paraître chez Hachette et la série des Vies de collège publiée par André Laurie chez Hetzel entre 1881 et 1904. Pour réfléchir à de possibles changements dans l’éducation des filles, les trois réformateurs républicains et les deux romanciers proposent un détour par les États-Unis présentés, à des degrés divers, comme le territoire de la modernité dans ce domaine et comme un exemple dont la France pourrait peut-être s’inspirer. Ce détour américain révèle l’ambivalence des discours républicains sur l’éducation féminine, leurs hésitations entre positivisme social et rationalisme hérité de Condorcet, entre dynamique universaliste et logique différencialiste, et la prudence d’André Laurie au moment de faire traverser l’Atlantique au type de la femme qui acquiert des diplômes pour travailler. De plus, dans les romans, il se déroule dans un territoire vide des controverses suscitées aux États-Unis par la mixité et le rôle social des femmes49.
Claudia Nelson et Mary Nelson éclairent la pluralité des conceptions américaines en matière d’éducation des filles en lisant Eight Cousins publié à Boston en 1875 par Louisa May Alcott et The Girls of Flaxby signé en 1882 par l’Anglaise Christabel Rose Coleridge. Entre Jo March, l’héroïne de Little Women (1868-1869) à laquelle s’identifiera Simone de Beauvoir50, et Nancy Harding, le personnage de Little Men (1873) et de Jo’s Boys (1886) qui devient médecin51, Alcott a créé en 1875 avec Rose Campbell un personnage qui peut sembler peu « américain » à un lecteur français : l’éducation et l’horizon de l’adolescente sont cantonnés à un espace domestique ; Rose n’apprend pas le latin à la différence d’héroïnes de Joséphine-Blanche Colomb et d’André Laurie mises à l’école américaine. Claudia et Mary Nelson montrent précisément que, si les auteures d’Eight Cousins et The Girls of Flaxby font bien de leurs fictions des démonstrations pour inviter à réformer l’éducation de leurs jeunes compatriotes, leurs propositions ne calquent pas cette éducation sur celle des garçons. En prônant l’apprentissage par la pratique, en valorisant le développement d’une structure mentale capable d’intégrer des éléments d’information plus que l’accumulation de savoirs, en mettant l’accent sur l’importance de créer des communautés d’apprentissage bienveillantes, les deux romancières, de part et d’autre de l’Atlantique, accompagnent ou anticipent des théories sur l’éducation et sur le classement de l’information, comme la « Social Learning Theory » du psychologue Albert Bandura ou comme le système de classification décimale avec lequel Melvil Dewey a révolutionné durablement la bibliothéconomie américaine en assignant une localisation relative aux documents. Par un apparent paradoxe, ces propositions novatrices s’inscrivent dans la logique d’une vision traditionnelle qui fait de la formation morale le domaine des femmes. Eight Cousins et The Girls of Flaxby montrent ainsi que la réussite de l’éducation de leurs héroïnes ne se mesure pas à l’aune de leurs connaissances. Elle s’évalue en fonction de leur capacité à trouver leur place au sein d’une communauté et à progresser en faisant progresser les autres.
Ce qui, dans l’éducation de Rose Campbell, devait cependant sembler peu traditionnel à un lecteur français, c’est la pratique de la natation. À la différence de The Girls of Flaxby, qui n’a jamais été traduit en France, Eight Cousins a été adapté dès 1885 par l’éditeur Hetzel et Jeanne Lespermont sous le titre La Petite Rose, ses six tantes et ses sept cousins52. Dans le texte original comme dans son adaptation française, Rose apprend à nager53 comme l’héroïne de Mon oncle d’Amérique (1890) de Joséphine-Blanche Colomb et comme les petites Américaines de Gypsy (1887) et de Miss Linotte (1893) de Jeanne Lespermont qui, en plus, pratiquent l’équitation, le patinage, le canotage, les jeux de barres, le vélo et le tennis. Pour Jeanne Lespermont, signer du pseudonyme Jacques Lermont, qu’elle a elle-même choisi, des adaptations et des romans mettant en scène l’éducation de jeunes Américaines sportives, consacre la réussite de sa propre formation. Dans une lettre envoyée à Pierre-Jules Hetzel en 1876, l’apprentie romancière définissait ainsi une ambition féminine partagée, de chaque côté de l’Atlantique, par Louisa May Alcott, Joséphine-Blanche Colomb et bien d’autres : se former au métier d’écrivaine pour gagner des droits d’auteur, se « suffire à » elle-même grâce aux « progrès » de sa plume54.