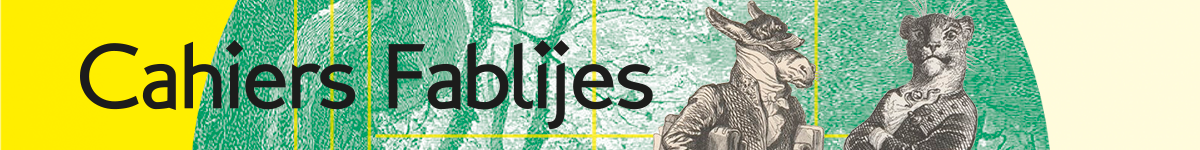Joséphine-Blanche Colomb et André Laurie ont représenté l’éducation des filles de leur temps dans des œuvres écrites et publiées pour la jeunesse. La première a inscrit ces représentations dans les romans de formation qu’elle a fait paraître pendant vingt ans à la Librairie Hachette et qui, pour la plupart, racontent des destinées féminines. Plus discrètement, le second fait apparaître des jeunes filles aux côtés des lycéens qui peuplent ses Vies de collège, une série en quatorze volumes construits autour de la présentation du système éducatif d’une société. Dans un contexte marqué par l’adoption de la loi du 21 décembre 1880, dite « loi Camille Sée », qui ouvre aux jeunes filles l’accès à un enseignement secondaire public, les deux romanciers se sont servis de leurs fictions pour élargir l’horizon de leurs lecteurs par le biais d’une comparaison entre l’éducation des jeunes Françaises et celle des Américaines. À une époque où plusieurs observateurs français consacrent à la mixité américaine et à l’éducation des filles Outre-Atlantique des pages de leurs relations de voyage ou de leurs rapports de mission adressés au Ministère de l’Instruction publique, Joséphine-Blanche Colomb et André Laurie effectuent, eux aussi, un détour par les États-Unis pour aborder, chacun à sa manière, deux questions : celle des savoirs à inculquer aux jeunes Françaises, celle de la finalité de l’enseignement de ces savoirs1.
Françaises et Américaines chez Joséphine-Blanche Colomb et André Laurie
Joséphine-Blanche Colomb a écrit une œuvre abondante composée essentiellement de romans et de nouvelles. Née en 1833 dans une famille protestante, elle a été l’un des principaux auteurs pour la jeunesse de la Librairie Hachette pendant les vingt ans qui ont suivi la guerre de 1870-1871. Elle s’est fait connaître avec Le Violoneux de la sapinière publié en 1873 puis avec La Fille de Carilès qui a reçu un prix Montyon en 1875. Ces deux romans ont paru dans Le Journal de la jeunesse, la revue créée par Louis Hachette en 1872 « pour les enfants de 10 à 15 ans2 ». La romancière donnera « vingt feuilletons3 » à cet hebdomadaire, un nombre qui la place en tête des collaborateurs de celui-ci. Après Le Violoneux de la sapinière et La Fille de Carilès, dix-huit autres titres paraîtront successivement dans cette revue puis, en volumes, dans la « Nouvelle collection pour la jeunesse ». La romancière a également publié vingt-cinq récits dans la « Bibliothèque des écoles et des familles » et un volume intitulé Souffre-douleur dans la célèbre « Bibliothèque rose illustrée ». Son genre de prédilection est celui du roman d’apprentissage centré sur la formation d’un(e) enfant ou d’un(e) adolescent(e). Joséphine-Blanche Colomb a fait entrer dans son univers romanesque des jeunes filles éduquées à l’américaine avec Mon oncle d’Amérique publié en 1890 et réédité jusque dans les années 1930 et avec Hélène Corianis, paru en 1893, l’année de sa mort. Ce roman fait partie des titres que l’éditeur a fait reparaître entre 1935 et 1937 dans une collection à trois francs, avec des gravures inédites qui les rajeunissent. Le roman est ainsi réédité chez Hachette en 1937 avec des illustrations de Georges Grellet.
La première des deux jeunes filles éduquées à l’américaine se nomme Lucette Mauversé. Elle a été élevée à New-York par son grand-père, un Français qui a fait fortune aux États-Unis. Quand celui-ci meurt, après avoir fait faillite, Lucette traverse l’Atlantique pour retrouver les membres de sa famille restés en France. Elle va notamment trouver refuge auprès d’une tante nommée Julie Morineau. La romancière construit un face-à-face et un contraste entre la vieille demoiselle française, rentière et oisive par préjugé de classe, et la jeune fille élevée à l’américaine, qui sait le latin, nage « comme un garçon4 » et aspire à travailler pour gagner sa vie. Ce roman de formation présente l’originalité de raconter l’apprentissage, non seulement de la jeune Américaine qui s’adapte progressivement à la société française, mais aussi de la vieille demoiselle provinciale qui va commencer à comprendre le point de vue de sa nièce. Quand Julie Morineau est ruinée par un escroc, Lucette travaille pour subvenir à leurs besoins avant d’épouser un médecin. Trois ans après Mon oncle d’Amérique, Hélène Corianis propose un nouveau détour par les États-Unis pour présenter une jeune fille forte et autonome et pour montrer la nécessité pour une femme de s’assurer un métier rémunérateur. Hélène est la fille aînée d’une famille qui a connu autant d’enrichissements que de faillites et qui est désormais ruinée. Quand le roman commence, elle est âgée de dix ans. Pour gagner de l’argent, elle aide des pêcheurs à remonter leurs filets, loue son âne à des touristes étrangers, vend des fleurs à l’occasion du carnaval et apprend l’anglais pour devenir interprète sur le marché de Menton. La rencontre des Granby lui permet de partir vivre à New York. La jeune Française passera huit ans aux États-Unis dans cette famille américaine qui la considère comme une fille adoptive. C’est là qu’elle commence à produire et à vendre son œuvre de sculptrice, une activité qu’elle développera, ensuite, en Angleterre et en France.
À la différence de l’auteur de Mon oncle d’Amérique, André Laurie, le nom de plume utilisé par Paschal Grousset pour signer son œuvre éditée par Hetzel, n’a jamais construit de roman autour de destins féminins. Mais il a, lui aussi, organisé un face-à-face romanesque entre Françaises et Américaines. Paschal Grousset a été un opposant au Second Empire, puis un membre du comité exécutif de la Commune de Paris. Condamné à la déportation en septembre 1871, embarqué à destination de la Nouvelle-Calédonie en juin 1872, il a fait partie du petit groupe de prisonniers qui a réussi à s’enfuir du bagne. En passant par les États-Unis, il a gagné l’Angleterre où il a vécu de juin 1874 jusqu’au printemps 1881 où il est rentré à Paris. Il a proposé sa collaboration à Pierre-Jules Hetzel pendant son exil à Londres. En plus de deux volumes des Voyages extraordinaires signés par Jules Verne, Les Cinq Cents Millions de la bégum paru en 1879 et L’Étoile du Sud publié en 1884, cette collaboration a pris la forme de traductions, de romans d’aventures géographiques et d’anticipation scientifique ainsi que de la série romanesque d’abord intitulée Scènes de la vie de collège, puis La Vie de collège dans tous les pays et, enfin, La Vie de collège dans tous les temps et tous les pays. Dans cette série qui compte quatorze volumes parus entre 1881 et 19045, le romancier présente le système éducatif d’une société par le biais d’une intrigue plus ou moins riche en rebondissements.
En 1898, dans L’Oncle de Chicago, sous-titré Mœurs scolaires en Amérique, André Laurie emmène son lecteur aux États-Unis qu’il a traversés, du port de San Francisco à celui de New York, entre mai et juin 18746. Ce parcours d’ouest en est n’a duré qu’une dizaine de jours mais, dans une lettre envoyée à Hetzel le 18 mars 1881, l’écrivain s’appuie sur cette expérience pour se présenter en spécialiste de l’éducation des jeunes Américaines et pour défendre ainsi la vraisemblance de l’héroïne de L’Étoile du Sud7. L’Oncle de Chicago, qui est le onzième volume des Vies de collège, commence rue de Trévise, à Paris, alors que la famille Bertoux s’apprête à dîner. Le repas est troublé par l’arrivée d’un télégramme. L’oncle du père de famille, devenu un riche industriel Outre-Atlantique, demande à son neveu de se rendre à Chicago pour assurer l’intérim à la direction de son entreprise. Voici les Bertoux et leurs deux enfants, Marguerite, l’aînée, et Jean-Charles, le cadet, prêts à traverser l’Atlantique pour découvrir la société américaine. À la différence des héroïnes de Joséphine-Blanche Colomb, à l’image de toutes les jeunes filles des Vies de collège, Marguerite est un personnage secondaire dans le roman. Mais l’un des enjeux de celui-ci consiste bien à confronter l’adolescente à des modèles féminins inconnus en France et présentés dès la gravure en frontispice signée Léon Benett comme les autres illustrations du volume : lycéennes qui apprennent le latin et qui assistent aux mêmes cours que les garçons, enseignantes qui dispensent des cours de chimie, de droit international ou de sciences politiques.
André Laurie, en retraçant le séjour d’une jeune Parisienne à Chicago, Joséphine-Blanche Colomb, en dotant deux de ses héroïnes d’une éducation américaine, offrent un point de vue sur les savoirs à inculquer aux filles.
Quels savoirs pour les filles ?
Avec La Vie de collège en Angleterre et Axel Ebersen, le gradué d’Upsala, L’Oncle de Chicago fait partie des volumes des Vies de collège construits sous la forme d’une expérience pédagogique fictive. Dans ces volumes, des adolescents se transforment en expérimentant un système éducatif où se pratiquent les sports ou les travaux manuels. Dans L’Oncle de Chicago, Jean-Charles Bertoux devient ainsi l’élève d’un lycée de Chicago où les étables, les jardins et les ateliers jouxtent les salles de classe. L’intrigue, ainsi que celle d’À travers les universités de l’Orient qui raconte la suite des aventures de Jean-Charles, prouve l’utilité de développer de telles compétences, y compris pour les enfants de la bourgeoisie. De plus, le séjour de Jean-Charles à Luttrell School, établissement imaginaire peut-être inspiré par une école pilote fondée par John Dewey en 1896 à Chicago, montre que la pratique du travail manuel favorise les progrès de l’élève dans les disciplines traditionnelles : humanités, sciences et langues vivantes.
Tout en représentant de manière favorable l’enseignement dispensé aux jeunes filles à Luttrell School, le romancier n’inscrit pas Marguerite dans cet établissement mixte et représentatif, à cet égard, du contexte américain dans les années 18908. En montrant la mixité pratiquée dans la plupart des établissements secondaires américains, André Laurie aborde l’une des spécificités de l’enseignement primaire, secondaire et, même, supérieur, qui frappent le plus les observateurs français des États-Unis. Ceux-ci ont enregistré et évalué ce qu’ils nomment la « coéducation » dans différents rapports et témoignages parus dans le dernier tiers du siècle9. Globalement favorables à la coéducation au niveau primaire, ils sont plus réticents au niveau de l’enseignement secondaire. Pour Célestin Hippeau, qui s’exprime sur ce thème en 1870, la coéducation est synonyme de « concorde10 » sociale. Elle donne « le plus haut degré d’instruction au plus grand nombre d’élèves avec le moins de dépenses possible11 ». Selon Ferdinand Buisson, elle représente en raccourci « le type vrai de la société américaine, avec cette égale liberté d’allures des deux sexes qui est, au jugement des Américains, une des gloires de leur civilisation12 ». Pour Marie-Casimir Ladreyt, elle s’impose à l’école primaire dans la mesure où elle est « destinée à remplacer l’éducation de la famille13 » et, dans l’enseignement secondaire, elle a le mérite de tremper le caractère des filles et des garçons. Paul Passy lui attribue la pureté des mœurs des jeunes gens des deux sexes tout en soulignant la dimension paradoxale de l’argument pour un point de vue français. Mais Passy fait aussi entendre cette réticence :
Il est permis de se demander si ces études sont bien propres à préparer une jeune fille à l’accomplissement de ses devoirs de femme : la direction d’un ménage, l’éducation des enfants14.
Cette réticence se retrouve sous la plume de Marie-Casimir Ladreyt qui défend le principe d’une éducation moins ambitieuse pour les filles que pour les garçons et qui préconise des établissements secondaires séparés pour un enseignement distinct. De même, pour Marie Loizillon que le thème de la mixité dans le secondaire amène aussi à évoquer la question de programmes communs aux filles et aux garçons, « les études masculines, que font avec tant de succès les femmes américaines, semblent les éloigner de leur vrai domaine15 », c’est-à-dire de « l’art de conduire une maison, de la rendre agréable, d’en faire le centre d’une société choisie16 ».
Dans le sillage de ces réserves, André Laurie cantonne dans une éducation à la maison sa jeune Française qui séjourne à Chicago. Il conforme ainsi son personnage aux codes sociaux en vigueur en France. Mais il peuple son roman de femmes américaines contredisant l’appréhension des parents de Marguerite qui incarnent, dans la fiction, les normes sociales françaises. Les Bertoux redoutent que leur fille se transforme en « une sorte de garçon déguisé en demoiselle17 ». Plusieurs personnages de L’Oncle de Chicago prouvent au couple parisien et aux lecteurs qu’une femme aussi diplômée qu’un homme ne se transforme pas en « une sorte de garçon » : Miss Atkins, un médecin réputé qui a l’allure d’« une petite personne mince, blonde, bien tournée et bien mise » (OC, 87) ; Mrs Morton, titulaire d’une chaire de droit international et « femme du monde accomplie » (OC, 31) ; Miss Phillips, diplômée de l’Université et « vrai type de beauté américaine, mignonne et délicate » (OC, 69). De plus, à rebours de Marie Loizillon ou Marie-Casimir Ladreyt qui défendent le principe d’une éducation différente pour les filles, André Laurie fait apprendre à Marguerite le latin, matière considérée comme « masculine » y compris dans les États-Unis de la fin du xixe siècle18. En apprenant cette langue ancienne sous la conduite de Miss Phillips, Marguerite se rapproche de Clélia, une autre jeune Française des Vies de collège, qui a été éduquée par son père.
Tout naturellement, et par le simple effet de ce contact de tous les jours, elle avait reçu une éducation de garçon, ou du moins une éducation comme il serait à désirer que les garçons en reçussent. Elle avait appris à fond le grec, le latin, l’histoire et les langues vivantes19,
écrit André Laurie en 1885 dans Tito le Florentin.
Hélène Corianis offre très peu d’informations sur les enseignements dispensés aux six enfants des Granby. Tout au plus le roman signale-t-il que les quatre filles suivent, à la maison, les cours d’une institutrice qui leur apprend le français, l’anglais et l’italien. La jeune héroïne de Mon oncle d’Amérique, en revanche, a appris le latin aux États-Unis, comme Marguerite Bertoux. À la différence d’André Laurie, Joséphine-Blanche Colomb ne met pas en débat la question de savoir s’il convient, ou non, d’enseigner cette matière aux filles. Mon oncle d’Amérique contient, cependant, des considérations pédagogiques générales. Lucette découvre ainsi avec surprise et réprobation les cours parisiens où ses cousines se contentent de prendre des notes avant de les apprendre par cœur. Ce n’est pas la première fois que la romancière évoque, pour le critiquer, l’enseignement dispensé aux jeunes Françaises. Sous sa plume, cet enseignement se résume à la prise de notes et la mémorisation d’un savoir superficiel. Elle dénonçait déjà les cours secondaires où les filles n’apprennent qu’à « penser à la mode20 » en 1875, dans Deux mères. En 1884, dans Pour la muse, elle raillait les pensions où les élèves deviennent des « perroquets21 » en perdant « l’habitude de réfléchir22 ». Entre la publication de Deux mères et celle de Pour la muse et de Mon oncle d’Amérique, les « établissements publics d’enseignement secondaire23 » se sont ajoutés aux cours secondaires payants et aux pensions. Si elle prend pour cible de ses attaques les cours et les pensions, Joséphine-Blanche Colomb n’assure pas explicitement la promotion des établissements publics créés en 1880. Ceux-ci dispensent aux filles un enseignement qui comprend l’étude de la langue française, d’une langue vivante, des littératures anciennes et modernes et qui exclut les humanités (grec, latin et philosophie)24.
Pas plus qu’André Laurie, elle ne commente l’une des spécificités de ces établissements conçus par des législateurs républicains : un enseignement moral prend la place de l’enseignement religieux qui devient facultatif. La finalité que ces législateurs assignent à l’enseignement secondaire explique cette substitution qui vise à détruire la domination du clergé dans le domaine de l’éducation des filles. En 1870, Jules Ferry, défendant la nécessité de réformer l’enseignement féminin, situait cette finalité dans un cadre conjugal et familial.
Mais à quoi bon toutes ces connaissances, tout ce savoir, toutes ces études ? […] Je pourrais répondre : à élever vos enfants, et ce serait une bonne réponse, mais comme elle est banale, j’aime mieux dire à élever vos maris25,
déclarait alors le futur ministre de l’Instruction publique en soulignant l’enjeu civique et politique de la réforme et en plaçant celle-ci dans une logique républicaine. La loi du 21 décembre 1880 traduira cette conception : l’enseignement dispensé par les établissements publics pour les filles ne conduit pas au baccalauréat.
Ni André Laurie, ni Joséphine-Blanche Colomb ne font de leurs jeunes filles de papier l’exacte incarnation de cette conception républicaine. Les deux romanciers s’appuient sur le détour par les États-Unis pour présenter à leur lecteur un modèle féminin nouveau, voire impensé en France, celui d’une femme de la bourgeoisie qui acquiert des compétences pour travailler et pour s’assurer ainsi des revenus en dehors du cadre familial. À partir de cette représentation commune, les deux écrivains divergent. André Laurie cantonne ce modèle aux États-Unis tandis que les héroïnes de Joséphine-Blanche Colomb mettent à profit leur éducation américaine pour travailler en France.
S’éduquer pour travailler ?
Leur séjour à Chicago, cette ville où l’on rencontre « à chaque pas, une femme médecin, une femme professeur, une femme conseiller municipal » (OC, 86), réserve bien des surprises aux Bertoux. Visitant Luttrell School dans la perspective d’inscrire Jean-Charles dans cet établissement, ceux-ci découvrent ainsi que l’épouse du directeur enseigne le droit international. Quant au cours de chimie, il est dispensé par une jeune professeur baptisée Miss Phillips qui assure aussi l’enseignement du latin. André Laurie apporte ce commentaire :
Le docteur Morton n’avait rien fait d’extraordinaire en choisissant une jeune fille pour enseigner la chimie à ses élèves. Il eût chargé un homme du cours de couture et une femme du cours d’histoire militaire, si l’un ou l’autre lui avait paru le plus apte à sa fonction (OC, 43).
Quant au titre de « meilleur médecin du voisinage » (OC, 87), il est décerné à une autre jeune fille, Miss Atkins. Dans une certaine mesure, André Laurie met sa jeune voyageuse française à l’école américaine. Marguerite se révèle meilleure latiniste que son frère. Quand elle participe incognito à un concours littéraire réservé aux garçons, elle remporte le premier prix en présentant un roman d’aventures maritimes. « [I]ls ont pris […] [mon histoire], et à l’unanimité encore, parce que c’est une œuvre vraiment virile, dit le rapport » (OC, 216), commente ironiquement la lauréate.
À l’image de Mrs Morton, de Miss Phillips et de Miss Atkins, Marguerite prouve, elle aussi, que ni les savoirs, ni les aptitudes n’ont de genre spécifique. Mais l’élève et l’admiratrice de Miss Phillips ne tirera aucun parti concret des connaissances en latin qu’elle a acquises aux États-Unis et qui, en France, pourrait lui ouvrir l’accès au baccalauréat. Au début d’À travers les universités de l’Orient, qui fait suite, en 1901, à L’Oncle de Chicago, les Bertoux sont rentrés à Paris. Quand le volume s’ouvre, pour fêter le baccalauréat de Jean-Charles, ils donnent une réception au cours de laquelle Marguerite montre aux invités la photographie que lui a dédicacée son enseignante américaine. Cette photographie conservée par Marguerite suggère que le destin des Américaines représente, pour la jeune Parisienne, un souvenir de voyage, et non pas un avenir envisageable pour elle-même. Et d’ailleurs, André Laurie n’invente pas d’avenir à la jeune fille qui a séjourné à Chicago. Au début d’À travers les universités de l’Orient, celle-ci a désormais 20 ans et le romancier n’offre aucune précision sur les activités ou sur les projets de cette ancienne lauréate d’un concours littéraire.
Créer et confronter des personnages de Françaises et d’Américaines, dans L’Oncle de Chicago, permet à André Laurie de dégager une loi générale : de part et d’autre de l’Atlantique, hommes et femmes partagent des aptitudes équivalentes, qu’il s’agisse de latin, de couture, d’histoire militaire ou de médecine. En revanche, le romancier est plus prudent quand il s’agit de trouver une application sociale à ce principe. L’auteur des Vies de collège ne propose pas d’importer en France le modèle américain de la femme diplômée qui s’épanouit dans l’exercice d’une profession qualifiée. Son roman reste ouvert, à l’image du débat qui a opposé, dans les pages de celui-ci, Mme Bertoux et Miss Phillips. La jeune Américaine se présente comme la fille de modestes exploitants agricoles du Wyoming. Comme ses deux sœurs, elle a acquis, par son travail, des diplômes et des compétences respectées. Loin d’être admirative en écoutant ces preuves d’indépendance et d’énergie, la mère de Marguerite se met à pleurer de pitié avant de promettre à son interlocutrice qu’un mariage mettra fin à son labeur. En retour, Miss Phillips s’indigne à l’idée qu’une femme puisse se marier dans la seule perspective de ne plus travailler. Elle confie à la mère de famille française son vœu et son ambition : devenir professeur à Wellesley, l’université où elle a poursuivi ses études. En donnant la parole à Miss Phillips, André Laurie fait entrer dans le roman français un personnage récurrent sous la plume d’Elizabeth Williams Champney. Cette romancière américaine a construit les onze volumes de la série Three Vassar Girls parus à Boston chez Estes and Lauriat entre 1883 et 1892, puis les neuf volumes de la série Witch Winnie publiés à New York de 1891 à 1898, autour des voyages et des aventures de jeunes étudiantes. Elle présente ainsi à ses lectrices le type social étudié par Sara M. Evans de « la femme nouvelle, de formation universitaire, souvent célibataire et gagnant sa vie seule […] [dont la] première génération se forma après la guerre de Sécession, dans le monde plein d’enthousiasme des colleges féminins26 ».
Plus audacieuse qu’André Laurie, Joséphine-Blanche Colomb crée des héroïnes françaises qui « gagnent leur vie » à l’américaine, une référence qui apparaît dans Mon oncle d’Amérique et dans Hélène Corianis. Certes, aucune de ses jeunes filles ne pourrait rivaliser avec Clélia Raynal, le personnage des Vies de collège qui connaît « à fond le grec, le latin, l’histoire et les langues vivantes27 ». Mais tandis qu’André Laurie ne donne aucune application pratique à de tels savoirs, auxquels s’ajoute un talent de peintre, et qu’il restreint le destin de Clélia à un cadre purement domestique, l’auteur d’Hélène Corianis oriente la réflexion sur l’éducation des filles vers la question de sa finalité pratique et professionnelle. La romancière envisage ainsi l’éducation des filles sous un angle individuel et pragmatique, dans la perspective d’acquérir de l’argent. En 1882, un personnage des Étapes de Madeleine invite ainsi les lectrices à comprendre que le travail est un moyen d’accéder à l’indépendance : « L’argent est à moi ; je l’ai gagné avec mon fuseau et ma quenouille, je puis bien le dépenser à ma volonté28 », précise-t-elle. En invitant les jeunes bourgeoises à adopter ce point de vue d’une femme du peuple, la romancière conteste la norme qui fait de l’oisiveté féminine le marqueur positif de la distinction sociale.
L’auteur de Mon oncle d’Amérique inscrit ainsi plusieurs de ses romans dans le cadre du débat suscité par l’accès des femmes à l’enseignement secondaire et résumé ainsi par Françoise Mayeur :
le travail peut-il être autre chose pour les femmes qu’un signe d’infériorité économique ? Peut-il, doit-il être un moyen d’accès à l’indépendance personnelle29 ?
La romancière répond à cette question par l’affirmative et, dans ses récits, elle fait du travail un instrument d’indépendance et, même, d’épanouissement pour les hommes comme pour les femmes. « Nous travaillons tous, c’est le moyen d’être heureux30 », professe ainsi Valentine, l’une des héroïnes de Feu de paille. Ce roman paru en 1881 démontre l’intérêt pour les femmes d’exercer un travail lucratif. Après avoir bénéficié d’un héritage inattendu qui a disparu comme un « feu de paille », Valentine fonde un cours pour jeunes filles et cette entreprise familiale se révèle durablement prospère. Peu diplômée, l’héroïne de Feu de paille n’aspire pas à entrer au service de l’État ou dans une institution privée comme institutrice, sous-maîtresse ou professeur, ni à devenir l’une de ces pionnières qui, à la suite de Madeleine Brès, ont exercé la médecine dans le dernier tiers du xixe siècle. Valentine se caractérise, non pas par l’étendue de son instruction, mais par son « aptitude pour les affaires31 ». Celle-ci lui permet de réaliser le projet énoncé très précisément par sa cousine : « […] nous fonderons ici une institution et je serai ta sous-maîtresse. Nous aurons beaucoup de succès, beaucoup d’élèves, nous deviendrons très riches32[…] ! »
En 1890, l’héroïne de Mon oncle d’Amérique se fixera le même programme d’enrichissement.
Je pourrais monter un petit magasin où je vendrais mes ouvrages et où je donnerais des leçons de broderie aux dames. À New York, il y a beaucoup de magasins comme cela qui gagnent beaucoup d’argent (OA, 54),
explique ainsi Lucette à sa tante. Trois ans plus tard, Hélène nourrit, à son tour, la même ambition de « gagner beaucoup d’argent33 » grâce à son talent de sculptrice. Dans Mon oncle d’Amérique et dans Hélène Corianis, qui font partie de ses ultimes publications, Joséphine-Blanche Colomb construit ses jeunes héroïnes sur le modèle des self-made-men américains dont Horatio Alger a peuplé ses romans à succès. En exprimant leur ambition de « gagner beaucoup d’argent », Lucette et Hélène prennent exemple sur les self-made-men qui les ont élevées. Le grand-père de la première s’est installé aux États-Unis où il a fait fortune ; le père adoptif de la seconde est un riche banquier qui doit sa réussite à son travail. Seule Hélène, cependant, parvient à exécuter complètement son programme. Lucette ne devient pas une femme d’affaires, comme son grand-père l’avait prévu. Elle ne fait pas fortune en ouvrant un magasin « de mode et de broderies » (OA, 261), comme elle-même l’avait imaginé. Hélène, en revanche, réalise son projet de gagner beaucoup d’argent en gérant habilement son œuvre de sculptrice et en rachetant, grâce aux revenus qu’elle en tire, un vaste domaine agricole qui appartenait autrefois à sa famille. Cette « fille pratique34 » qui entend « les affaires35 » transpose ainsi le principe énoncé par son père adoptif. « Le véritable homme d’affaires est passionné comme un artiste36 », affirmait ce banquier new-yorkais. La jeune Française élevée dans une famille américaine prouve, quant à elle, qu’une véritable artiste peut être aussi avisée qu’un homme d’affaires.
Conclusion
Protestante, comme les principaux réformateurs qui ont fondé l’école républicaine, Joséphine-Blanche Colomb a situé ses propositions sur l’éducation des filles, non pas sur le terrain de la formation intellectuelle, mais sur celui de la conquête d’une indépendance financière. La romancière a ainsi incité les jeunes filles de la bourgeoisie à acquérir des revenus par leur travail. Elle a transmis ce point de vue en créant des personnages qui suscitent l’identification et en transformant leurs visées professionnelles en aliment du rêve, à la manière des écrivains américains du self-made-man. Ses deux romans qui proposent un détour par les États-Unis pour promouvoir le modèle de la femme qui s’assure une autonomie financière grâce à un travail rémunérateur s’inscrivent ainsi dans la logique de son œuvre. Avec leurs études universitaires, leurs diplômes et leurs carrières professionnelles prestigieuses, les Américaines diplômées de L’Oncle de Chicago s’inscrivent, non pas en continuité, mais en rupture, par rapport aux personnages féminins qui peuplent les Vies de collège et les autres romans d’André Laurie. Cette rupture ne se situe pas au niveau des savoirs. Tout au contraire, l’auteur des Vies de collège fait de l’instruction de ses personnages féminins l’indice, non pas d’une modernité, mais d’une permanence. Réformer l’éducation des filles en introduisant l’enseignement du latin, voire du grec, serait conforme, selon le romancier, à une certaine tradition nationale. Tandis qu’un personnage de L’Oncle de Chicago rappelle que Mme de Sévigné, « le type achevé de la Française » (OC, 63) selon lui, « savait le latin » (OC, 60), cinq ans plus tard, L’Escholier de Sorbonne, un volume situé au xvie siècle, comprend des femmes qui ont étudié le latin. Pour remercier la famille parisienne qui l’a adopté, le héros baptisé Thibaut Le Franc enseigne le grec et le latin à leurs filles. Les Américaines diplômées de L’Oncle de Chicago surprennent cependant dans un univers romanesque où les études sont dépourvues d’application pratique pour les jeunes filles. L’avenir des héroïnes d’André Laurie s’inscrit ainsi entre les « potages37 » confectionnés par Clélia Raynal dans Tito le Florentin et les « confitures38 » et les « pantoufles39 » brodées qui sont les activités qui conviennent à une épouse française d’après L’Héritier de Robinson, un roman d’aventures coloniales paru en 1884. Ainsi le détour américain témoigne-t-il de la prudence d’André Laurie quand il s’agit de réformer l’éducation des filles : sous sa plume, le type de la femme qui acquiert des diplômes pour travailler demeure exotique et, à la différence de Joséphine-Blanche Colomb, l’auteur des Vies de collège n’en propose pas l’importation en France.