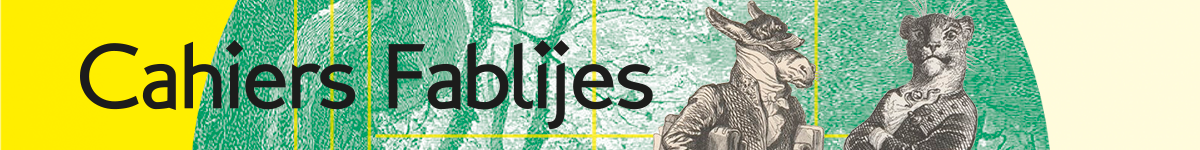La question de l’éducation féminine constitue un point d’observation intéressant des tensions et dynamiques qui travaillent le discours républicain de la fin du xixe siècle et le conduisent à envisager sa propre réforme, perspective qui n’avait guère été envisagée par les républicains de 1789 ou de 1848 parce que la République n’avait jusque-là pu s’installer de manière durable dans les institutions françaises.
Si l’on peut assurément distinguer différentes phases du républicanisme français sur la base de l’histoire des institutions politiques, l’expression de « discours républicain » au singulier constitue en elle-même un raccourci qu’il convient d’expliciter pour préciser la manière dont nous l’entendons. Il n’y a en effet, pas plus sur la question des femmes que sur les autres questions sociales, de position républicaine absolument homogène, ce qui suppose d’envisager ce discours républicain avant tout comme un tissu de textes qui se répondent, non sans tensions, mais en donnant néanmoins à voir certains motifs récurrents se déclinant selon toute une palette de variations.
À défaut de pouvoir prétendre à l’exhaustivité, nous nous concentrerons sur l’argumentaire développé par trois figures emblématiques de la réforme scolaire sous la Troisième République afin de faire ressortir à travers elles les lignes de force des discussions de l’époque : Jules Ferry, qui présida aux grandes lois scolaires des années 1880 en tant que ministre de l’Instruction publique puis président du conseil ; Ferdinand Buisson, appelé par celui-ci en 1879 pour piloter la laïcisation de l’école publique et qui survécut politiquement une dizaine d’années à son ministre en qualité de directeur de l’Instruction primaire, et, enfin, Henri Marion, premier occupant de la chaire de science de l’éducation à la Sorbonne et idéologue majeur de la pédagogie républicaine1.
En dépit du fait que les femmes demeurent exclues de l’exercice de la souveraineté, tous trois se rejoignent pour faire de l’éducation féminine un enjeu politique majeur dans un contexte de lutte contre le cléricalisme mais aussi du fait de la volonté de pérenniser les bénéfices de l’instruction dans la famille. Les modalités de cette éducation, tout comme sa justification, apparaissent cependant marquées par une profonde ambivalence, les argumentaires de Ferry, Buisson et Marion peinant souvent à articuler une dynamique universaliste, tendant à mettre en avant une certaine égalité de droit entre hommes et femmes, et une logique différencialiste visant au contraire à conforter les femmes dans un rôle social subalterne.
L’éducation féminine dans la politique scolaire républicaine des années 1880
Les républicains de la génération Ferry font preuve d’un net volontarisme en faveur du développement de l’instruction féminine primaire comme secondaire même s’il faut bien distinguer les enjeux de l’un et l’autre dans la mesure où ils obéissent à des logiques distinctes du fait de la sociologie contrastée de leurs publics2.
S’agissant de l’instruction primaire, les républicains établissent une symétrie quasi complète entre les filles et les garçons : l’obligation d’instruction s’applique aux deux sexes de six à treize ans et les programmes sont identiques à l’exception des travaux manuels, les travaux d’aiguilles étant maintenus pour les filles, les garçons faisant, pour leur part, du jardinage et de la menuiserie3. Les écoles normales d’institutrices4 connaissent un développement considérable sur la période afin de remplacer à terme les religieuses qui constituaient dans les années 1880 le gros du personnel enseignant dans les écoles de filles. Pour chapeauter la formation dispensée dans ces écoles normales, est créée en 1880 l’École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses pour former les directrices et professeures d’écoles normales.
L’action des républicains s’étend également à l’enseignement secondaire. La loi Camille Sée, dont la proposition a été déposée le 28 octobre 1878, instaure un enseignement secondaire féminin, réforme qui s’inscrit dans le prolongement des « cours secondaires » créés par Victor Duruy sous le Second Empire. Par rapport aux cours secondaires de Duruy qui constituaient un dispositif décentralisé dont le développement demeurait fragile en dehors de Paris, la loi Camille Sée donne une plus grande pérennité à cet enseignement secondaire féminin en conférant aux collèges et lycées de jeunes filles le statut d’établissements municipaux subventionnés par l’État avec leurs locaux spécifiques et des programmes nationaux. Même si bon nombre de ces établissements continuent de faire appel au personnel des lycées de garçons, les républicains créent, en 1881, l’École normale de jeunes filles de Sèvres qui a vocation à former les professeures des lycées féminins en préparant au certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire des jeunes filles et aux agrégations de cet enseignement créés en 1882 et 1883. « Grande politique menée avec de petits moyens5 » ainsi que la qualifie l’historien Antoine Prost, la mise en place de cet enseignement secondaire féminin repose largement sur la contribution des villes et des familles et connaît de ce fait un développement très inégal, tributaire des contextes locaux (pas nécessairement corrélé à la strate démographique des villes) et marqué par la grande variété des types d’établissement.
Si l’on s’intéresse à présent aux discours justifiant ces politiques menées en faveur de l’instruction féminine, force est de constater qu’ils mêlent des considérations de nature assez différente.
L’argumentaire ferryste, entre universalisme juridique et différencialisme instrumental
Sous la plume des républicains, il n’est pas rare de voir se côtoyer un argumentaire de type universaliste, axé sur l’égalité du droit à l’instruction (que nous qualifierions probablement aujourd’hui de « républicain ») et des considérations plus pragmatiques relevant de la stratégie politique, ainsi que des analyses relatives à l’étude des mœurs, des dynamiques sociales et économiques à l’œuvre dans la France de l’époque. Ces différents argumentaires ne sont pas sans entrer en tension, ce que Mona Ozouf fait bien remarquer s’agissant de Jules Ferry :
On le voit marier sans cesse les deux thèmes : celui du service particulier que les femmes rendent à la société, celui de l’égalité des lumières chez les êtres humains, qui doivent ouvrir à tous les mêmes droits6.
D’un côté, Ferry se pose en héritier de Condorcet et voit dans l’éducation un bien essentiel dont il serait pour le moins problématique de priver la moitié de l’humanité, de l’autre, son positivisme le porte à s’intéresser à la différence spécifique des femmes, dans une logique instrumentale cette fois, en montrant comment leur instruction peut contribuer au progrès de la société du fait de leur statut de femme. Cette tension est patente dans le célèbre Discours sur l’égalité d’éducation qu’il prononce à la salle Molière en 1870 et qui se clôt précisément sur l’affirmation de l’égalité des femmes et des hommes devant l’instruction. Fait notable, Ferry y affirme l’égalité d’intelligence entre les hommes et les femmes avec plus d’énergie que bon nombre de républicains de son temps. Il recommande ainsi à ses auditrices la lecture du livre de Stuart Mill De l’assujettissement des femmes : « il vous apprendra que vous avez les mêmes facultés que les hommes. Les hommes disent le contraire, mais en vérité comment le savent-ils, c’est une chose qui me surpasse7. »
Allant contre le discours naturaliste dominant, Ferry récuse l’approche essentialiste de la féminité qu’il juge sans fondement scientifique et en déduit l’illégitimité d’une restriction des potentialités de développement des femmes :
Apprenez qu’il est impossible de dire des femmes, êtres complexes, multiples, délicats, pleins de transformations et d’imprévu, de dire : elles sont ceci ou cela ; il est impossible de dire, dans l’état actuel de leur éducation, qu’elles ne seront pas autre chose, quand on les élèvera différemment. Par conséquent, dans l’ignorance où nous sommes des véritables aptitudes de la femme, nous n’avons pas le droit de la mutiler8.
À l’assignation essentialiste d’une identité féminine, Ferry préfère, en bon positiviste, une compréhension historico-sociale de leur condition. Il invoque ainsi à l’appui de sa démonstration l’exemple des femmes américaines qui se sont montrées « très propres à certaines fonctions » réservées aux hommes en Europe telles que l’exercice de la médecine ou du professorat, ceci prouvant bien, estime-t-il, que « du moment où les femmes auront droit à une éducation complète, semblable à celle des hommes, leurs facultés se développeront, et l’on s’apercevra qu’elles les ont égales à celles des hommes9 ».
Ferry ne renonce pas tout à fait cependant à l’idée d’une nature féminine : sans en faire un argument pour amoindrir leur rationalité, il reconnaît en effet aux femmes une supériorité du sentiment et ne conteste pas non plus l’idée selon laquelle le rôle des femmes serait prioritairement de se consacrer à la vie domestique et à l’éducation des enfants. Au-delà de ce qui peut relever du poids des stéréotypes de genre, cette inscription des femmes dans la domesticité se comprend à la lumière du pragmatisme de Ferry qui le porte à composer avec les logiques sociales en présence pour mieux parvenir à ses fins : favoriser le progrès de la raison dans la société. La logique est ici analogue à celle qui le conduit à se montrer conciliant avec les spiritualistes dans la rédaction des premiers programmes laïcs de morale en autorisant qu’y figurent les devoirs envers Dieu alors que lui-même est un athée convaincu : il estime que c’est une concession nécessaire à l’opérationnalité de la réforme scolaire qu’il s’efforce de promouvoir10.
Cette logique instrumentale transparaît bien d’ailleurs dans la boutade finale du discours :
Je sais que plus d’une femme me répond, à part elle : Mais à quoi bon toutes ces connaissances, tout ce savoir, toutes ces études ? à quoi bon ? Je pourrais répondre : à élever vos enfants, et ce serait une bonne réponse, mais comme elle est banale, j’aime mieux dire : à élever vos maris11.
Derrière cette plaisante mise à l’honneur des femmes, Ferry reprend en fait un argument formulé très sérieusement par les républicains depuis Condorcet, à savoir l’idée selon laquelle en milieu populaire, la femme instruite est la gardienne des laborieux acquis de l’instruction élémentaire dont elle permet l’entretien au sein du ménage. Ferry reprend également l’argument condorcetien du lien entre égalité d’instruction et bonheur dans le couple : le vrai mariage, c’est le « mariage des âmes » qui suppose un accord sur des manières de penser et de sentir relativement à des choses essentielles12. « Élever les maris » s’entend enfin en un sens plus politique, l’éducation féminine constituant un enjeu stratégique dans la lutte contre le cléricalisme. Il en va, estime Ferry, de la survie de la démocratie : « il faut que la femme appartienne à la science ou qu’elle appartienne à l’Église13 ».
L’argumentaire ferryste illustre de manière frappante les tensions inhérentes au discours républicain lorsqu’il s’attache à promouvoir l’éducation féminine : celui-ci oscille entre un discours universaliste mettant en avant l’égalité des intelligences et l’égalité des droits d’une part, et un discours différentialiste plus ou moins naturalisant qui cherche au contraire à identifier une spécificité féminine justifiant des politiques plus ciblées. Cette tension se manifeste concrètement dans le traitement de deux questions institutionnelles qui cristallisent les discussions relatives à l’éducation féminine entre 1870 et 1914 : la première est celle de la coéducation, c’est-à-dire de la mixité sexuée dans les établissements scolaires ; la seconde celle de l’enseignement secondaire féminin.
La question de l’éducation des femmes au travers des discussions relatives à la coéducation. Le rapport de Ferdinand Buisson à l’Exposition universelle de Philadelphie (1876)
Rappelons pour mémoire que dans la France républicaine, la séparation reste la règle à tous les degrés, la co-instruction étant tolérée dans les écoles de campagne depuis la loi Guizot pour des raisons économiques. En tant qu’idéal pédagogique, la coéducation à l’école primaire a cependant ses partisans chez les républicains : sans en faire leur priorité, Ferry, Buisson et Marion y sont favorables.
L’exemple américain est là encore souvent invoqué à l’appui de la démonstration : délégué en 1876 à l’Exposition universelle de Philadelphie pour y récolter des données sur le système scolaire américain, Buisson ne manque pas dans son rapport14 de mettre en évidence les bénéfices intellectuels et moraux de l’éducation conjointe des enfants des deux sexes : « Tous ceux qui se sont occupés d’éducation aux États-Unis attestent qu’ils ont toujours vu la réunion de filles et de garçons dans les classes primaires profiter aux uns et aux autres15. »
Une telle organisation présente d’abord un bénéfice intellectuel, Buisson mettant en avant la saine émulation résultant de la coexistence au sein de la classe de deux groupes d’élèves de sexes différents. Plus fondamentalement encore, il estime qu’il n’y a pas lieu de séparer des enfants qui doivent recevoir la même instruction parce qu’ils ont les mêmes besoins et les mêmes aptitudes. À l’exception des travaux d’aiguille, « travail féminin par excellence » dont Buisson regrette l’abolition par les Américains, la parité s’impose en matière d’instruction élémentaire :
Lire, écrire, compter, dessiner, apprendre à se servir correctement de la langue maternelle, acquérir quelques notions d’histoire naturelle, de géographie, d’histoire, de sciences usuelles, c’est là un programme qui convient également aux deux sexes, et nous ne voyons pas le moindre inconvénient à ce qu’une fille de douze ans soit tenue aussi bien qu’un garçon du même âge de savoir les quatre règles et de mettre l’orthographe. C’est un fait d’ailleurs universellement attesté et qui, dans le cours de nos visites scolaires aux États-Unis et au Canada, nous a été cent fois confirmé de vive voix par des professeurs américains et étrangers, qu’il est impossible de découvrir une inégalité intellectuelle quelconque entre les enfants des deux sexes ; que, pour peu qu’on s’attache à les cultiver, les facultés de raisonnement, n’ont pas plus de peine à éclore chez les filles que les facultés d’imagination chez les garçons […]16.
Buisson ne récuse pas l’idée que la nature ait donné « un tour d’esprit propre » à chaque sexe, mais il estime que « ce ne sont pas là des diversités assez profondes pour qu’il soit nécessaire de s’en préoccuper dès l’enfance, tant qu’il s’agit des premiers rudiments de l’instruction17 ». Il restreint ainsi par avance la portée de son éloge de la coéducation à la seule instruction élémentaire en suggérant d’emblée la nécessité d’une différenciation des programmes au-delà de cette dernière.
Se plaçant ensuite sur le terrain des mœurs, Buisson observe dans les écoles américaines une forme de contamination vertueuse d’un sexe par l’autre : « les garçons prennent des manières plus douces, moins grossières, moins turbulentes ; les filles y gagnent en sérieux, en retenue, en assiduité au travail ». La fréquentation scolaire des deux sexes durant l’enfance permet en outre, estime-t-il, d’atténuer la violence des troubles de l’adolescence résolvant ce faisant « un des plus graves problèmes de l’éducation morale » :
Habitués à vivre côte à côte, ils ne sont pas plus en danger que frères et sœurs dans la famille. Moins on affecte de les séparer, de les cacher les uns aux autres, moins il y a de mystère et partant de curiosités inquiètes. Enfants, ils ne s’étonnent pas d’avoir en commun le travail et le jeu ; adolescents, ils continuent de se trouver ensemble sans surprise et sans trouble : ce commerce, aimable autant qu’innocent, ne leur étant pas nouveau, n’éveille pas chez eux d’émotions nouvelles18.
Fait notable, ce dernier argument vaut également pour l’enseignement secondaire américain, Buisson soulignant le risque qu’il y aurait à séparer les jeunes gens habitués jusque-là à vivre côte à côte :
Des rencontres fortuites, à la dérobée, à de longs intervalles, entre jeunes gens et jeunes filles jusque-là camarades de classe, rencontres inévitables dans le régime de vie américain, auraient de bien plus graves inconvénients que leur constante et régulière réunion aux mêmes heures dans les mêmes cours19.
En toute logique, un tel argument conduit à penser que la mise en œuvre de la coéducation à l’école primaire implique, pour des raisons morales, sa poursuite dans l’enseignement secondaire mais il faut bien saisir ici la nature contextuelle de l’argument de Buisson en faveur de la coéducation dans le secondaire : si celle-ci est préférable à la séparation des sexes, c’est avant tout parce qu’elle fait système avec les mœurs américaines qui assurent aux femmes une large mesure de liberté effective : « L’Américaine qui n’est jamais sortie de son pays ne connaît, ne soupçonne pas le grand nombre de contraintes et de petites servitudes que les convenances imposent ailleurs aux femmes20. »
Cette liberté morale se décline sur le terrain professionnel, ouvrant à la femme un éventail de carrières bien plus vaste qu’en Europe et lui donnant par conséquent plus d’instruments d’indépendance. Buisson s’efforce ainsi de montrer que la coéducation reflète l’état de la société américaine où la condition féminine tend à plus d’égalité avec celle des hommes, mais est également liée à l’idéal du self-government qui imprègne jusqu’aux relations familiales : moindre autorité du père de famille sur les enfants, moindre valorisation des vertus d’obéissance, de timidité et de réserve au profit de celles de libre initiative. On se soucie moins dans cette perspective d’entourer les enfants en général et les jeunes filles en particulier d’un système de protection morale.
Buisson développe en somme une argumentation sociologisante qui tend à déconstruire une approche essentialiste de l’éducation féminine mais peut également dans le même temps constituer une manière habile de conforter le statut quo en laissant entendre que ce qui est bon pour les Américains ne l’est pas forcément pour les Français :
Il n’y a rien dans un pays qui puisse moins que l’école se comprendre et s’apprécier isolément. Détachée de l’ensemble des institutions et des mœurs qui l’ont faite ce qu’elle est, l’école est inintelligible, on n’en voit plus que le cadavre. C’est pour cela même qu’il est souverainement chimérique de rêver un type d’école uniforme et cosmopolite ou de prétendre juger d’après un code unique les procédés et les usages scolaires de tous les pays.
Le système de la coéducation des sexes en Amérique n’est ni un bien ni un mal, c’est un fait, c’est une nécessité21.
S’il ne condamne pas l’évolution de la société américaine et s’attache même à montrer qu’elle constitue un développement de la logique égalitaire inhérente à la démocratie, Buisson semble penser qu’il y a peu de chances qu’on en arrive là en France. S’agissant de la condition féminine, il semble en outre peu enclin à faire de l’école un instrument de transformation des mœurs alors qu’il se montre plus offensif sur la question de la décléricalisation des esprits.
Pour ce qui est de l’enseignement secondaire, Buisson voit en outre certains inconvénients au système de coéducation qu’il prend soin d’exposer assez longuement. Il se fait d’abord l’écho d’une controverse lancée par un certain docteur Edward Clarke de Boston ayant mis en avant le caractère antihygiénique du principe d’un curriculum commun aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Un système exigeant « de la jeune fille une suite ininterrompue d’efforts laborieux, une attention, une régularité de travail, une persistance d’application22 », telle que celle qui est demandée dans les lycées de garçons ne peut, selon le docteur Clarke, « être obtenue qu’au détriment de sa santé », la nature n’ayant « pas accordé à la femme la même puissance et surtout la même continuité de travail que l’homme peut s’imposer » :
Qu’un garçon de quinze ans passe six ou sept heures par jour courbé sur ses livres et sur ses cahiers, c’est un effort qui lui coûte, mais qu’il peut faire, car quelques heures de boxe, de gymnastique, de course ou d’exercice musculaire suffiront à rétablir l’équilibre ; mais il n’est jamais bon d’imposer plus de quatre heures d’études à une jeune fille, et il peut être parfois très fâcheux de lui imposer, à tel jour donné, fût-ce une seule heure de travail intellectuel.
Tout en reconnaissant l’excellence des étudiantes américaines Buisson ne manque pas ensuite de s’interroger sur l’utilité sociale des études poussées pour les jeunes filles :
Nous avons tant de fois entendu de jeunes demoiselles, en concurrence avec des étudiants de leur âge, expliquer Virgile à livre ouvert, résoudre une équation au tableau noir, démontrer un théorème de géométrie ou écrire une formule de réaction chimique, que nous ne saurions concevoir le moindre doute ni sur l’intérêt qu’elles y prennent, ni sur les solides qualités d’esprit qu’elles y déploient ; mais nous n’avons pas bien compris, faut-il l’avouer, à quoi l’on veut arriver en les poussant dans cette voie. Bien des fois, après avoir fait au professeur, qui est ordinairement une dame, les compliments les plus sincères sur ce que nous, venions d’entendre, nous nous sommes permis de risquer cette question finale : « À quoi sert-il d’apprendre à ces demoiselles tous ces éléments de géométrie, de trigonométrie, de grec, etc. ? » On nous répondait avec quelque vivacité « mais les garçons l’apprennent bien ; pourquoi les filles ne l’apprendraient-elles pas ? » Raison péremptoire, paraît-il, car nous n’en avons guère obtenu d’autres23.
S’il salue le respect que les institutions américaines témoignent au « droit des minorités », Buisson ne se montre guère satisfait d’une réponse formulée en termes d’égalité des droits. D’une manière qui contraste avec l’engagement qui fut toujours le sien en faveur des libertés individuelles, tout se passe comme si, dans le contexte du rapport de 1878, Buisson privilégiait, sur la question des femmes, une approche utilitariste de la politique scolaire. On ne peut qu’être frappé à la lecture de ce texte par la juxtaposition de logiques argumentatives qui se trouvent en tension entre elles (discours de l’égalité des droits versus discours de l’utilité sociale, insistance sur la fragilité congénitale des femmes versus reconnaissance de leur capacité égale à celle des hommes) ; tensions que Buisson ne cherche ni à évacuer ni à dépasser dans une synthèse dialectique. La posture qu’il adopte est celle d’un observateur faisant preuve de sympathie à l’égard de la société américaine, sans pousser cette sympathie au point d’alimenter un discours subversif sur la société française.
Il y a, de ce point de vue, une nette évolution du discours buissonien entre les années 1870 et les années 1900-1910, où Buisson prendra fait et cause pour les suffragettes. Dans les années 1870-1880, la priorité en matière de transformation des mœurs pour les républicains est clairement la décléricalisation, programme qui s’accommode tout à fait du maintien de programmes d’enseignement distincts pour les jeunes gens des deux sexes au-delà de l’instruction primaire. Ajoutons qu’en 1878, les républicains n’ont pas encore véritablement de majorité leur permettant de gouverner (ils ne l’auront qu’en 1879) et qu’ils doivent rester prudents dans leur communication et veiller à ne pas donner d’arguments au camp adverse. Cette prudence sur la question de l’éducation des jeunes filles perdure cependant au-delà de 1879, conduisant l’historienne Mona Ozouf à souligner le contraste entre la politique scolaire républicaine relative à l’instruction primaire et celle portant sur l’enseignement secondaire : « hardie pour l’enseignement du peuple, la réforme composait prudemment avec les exigences et les habitudes de la bourgeoisie24 », sa clientèle de référence, s’agissant du second.
La question de l’enseignement secondaire féminin
Le contenu de l’enseignement secondaire de jeunes filles instauré par la loi Camille Sée et les discussions qu’il occasionne révèlent eux aussi les tensions qui traversent le camp républicain sur la question du droit des femmes à l’éducation. Françoise Mayeur a bien montré que par comparaison avec le lycée classique qui constitue l’horizon de référence pour l’éducation masculine bourgeoise, l’enseignement secondaire féminin créé par la loi Camille Sée fait figure de parent pauvre : la durée de la formation y est plus brève (cinq ans contre huit pour le lycée classique) ; il ne comporte ni latin ni philosophie (le premier apparaissant comme le fondement de l’enseignement secondaire classique et la seconde comme son couronnement) mais intègre des enseignements domestiques (couture et économie domestique) ; enfin il ne donne pas accès au baccalauréat mais à un diplôme de fin d’études. Les jeunes filles se trouvent, autrement dit, écartées des études spéculatives et de l’accès à l’université25.
Dans un article de 2007, Antoine Prost met toutefois en avant d’autres caractéristiques de la réforme Camille Sée permettant de discuter une vision par trop négative de cet enseignement secondaire féminin. Pour lui, celui-ci reflète en effet le pragmatisme des républicains ainsi que d’authentiques préoccupations pédagogiques issues d’une réflexion critique sur le lycée classique :
le Conseil supérieur de l’Instruction publique (CSIP), qui définit concrètement le nouvel enseignement, est animé par des préoccupations plus complexes. À ses yeux, l’enseignement secondaire masculin présente de graves défauts, dont il veut préserver l’enseignement féminin. Il n’est donc pas parti de l’enseignement masculin pour en retrancher les éléments jugés inutiles ou inaccessibles aux femmes ; il a cherché à construire un enseignement spécifique, avec la volonté qu’il soit à la fois formateur, novateur, cohérent, et adapté à la clientèle prévisible26.
Tout au long du xixe siècle, l’enseignement secondaire a souffert de son décalage par rapport aux attentes de sa clientèle soucieuse de distinction sociale sans pour autant être férue d’études spéculatives (de nombreux lycéens abandonnaient leurs études en cours de route). La conscience de ce décalage est précisément à l’origine de la création en 1865 de l’enseignement secondaire spécial masculin qui deviendra par la suite l’enseignement moderne. Filière plus courte que le lycée classique et sans langues anciennes, l’enseignement spécial combinait instruction littéraire générale, étude des langues vivantes et enseignement scientifique appliqué à l’industrie, au commerce et à l’agriculture. C’est cet enseignement secondaire spécial ou moderne, estime Antoine Prost, et non l’enseignement classique, qui constitue la référence implicite des créateurs de l’enseignement secondaire féminin, l’un et l’autre étant au reste structurés de la même façon en cinq ans avec deux périodes successives. La grande originalité des réformateurs de 1880, conclut Antoine Prost, est d’avoir cherché à concilier demande sociale et exigence éducative en imaginant un enseignement de culture qui soit court. Il estime à cet égard que les contenus de l’enseignement secondaire féminin traduisent une conception large et innovante de l’éducation bien plus que des considérations de genre (« une conception large de l’éducation, qu’on retrouvera mutatis mutandis dans les classes nouvelles de Gustave Monod à la Libération27 »). Une place, il est vrai assez modeste, y est faite aux sciences avec l’enseignement de l’arithmétique et des sciences naturelles (zoologie, botanique, géologie, physiologie rattachée à l’économie domestique et à l’hygiène) ainsi que celui de la physique et de la chimie. Il comporte un programme assez lourd d’histoire et de géographie ainsi qu’un programme d’histoire de l’art. À défaut d’enseignement de la philosophie, l’enseignement littéraire, par le choix des auteurs mis en avant, semble inviter à la réflexion davantage qu’à la culture de la sensibilité (pas de poésie mais les œuvres de Voltaire, Boileau, Fénelon…) ; quant au programme de morale, sa teneur s’avère en substance assez philosophique (Kant, Épicure et des éléments de psychologie appliquée à l’éducation). Sur le plan de l’organisation, un système de cours optionnel permet aux jeunes filles une forme d’autonomie dans la définition de leur parcours de formation. Finalement, les programmes de ce nouvel enseignement secondaire esquissent bien un modèle d’éducation moderne et libéral enraciné « dans le patrimoine littéraire et philosophique des humanités28 », libéré du latin qui mobilisait une part considérable du temps d’enseignement disponible, et visant à préparer à la vie contemporaine sans visée professionnalisante.
Antoine Prost met ici en somme en avant l’effectivité de la visée universaliste du programme éducateur républicain en matière de formation des jeunes filles. Le discours des droits ne reste pas en cela tout à fait lettre morte ; il se manifeste dans une inspiration pédagogique qui transcende la destination sociale respective des hommes et des femmes et qui nourrit bel et bien les politiques publiques.
Cela n’empêche nullement, force est de le constater, la mobilisation d’argumentaires fortement genrés pour justifier les différences existantes entre l’enseignement secondaire masculin et son homologue féminin. On trouve à cet égard une illustration frappante de ce type d’argumentaire dans les deux cours de science de l’éducation qu’Henri Marion a consacrés aux questions de la psychologie féminine et de l’éducation féminine à la Sorbonne entre 1883-1896, cours publiés de manière posthume en 1900 et 190229.
Rappelons que Marion était membre depuis 1878 du Conseil supérieur de l’instruction publique, où il avait participé à l’organisation de l’enseignement secondaire des jeunes filles. C’est donc également son œuvre qu’il défend lorsqu’il traite de l’éducation des jeunes filles. Lorsqu’il prononce ces cours à la Sorbonne, il se trouve pris entre deux feux, se devant de répondre, d’une part, au parti clérical qui conteste l’existence d’un enseignement secondaire consistant (« fort, complet, méthodique30 » selon les termes de Marion) ; et ayant, d’autre part, à défendre cet enseignement secondaire contre les féministes qui lui reprochent de ne pas être identique à celui des garçons.
Cherchant à justifier la spécificité de l’enseignement secondaire féminin, Marion mobilise un argumentaire fortement différentialiste : il s’agit de « former les femmes dont notre société a besoin. De vraies femmes, très femmes, non pas extraordinairement instruites, mais vraiment élevées, ne faisant pas peur aux hommes, n’ayant aucune envie de leur porter ombrage et d’entrer en concurrence avec eux31 » ; propos qui font écho à ceux de Camille Sée se défendant de vouloir former des femmes savantes32. La destination domestique des femmes rend utile un certain degré d’instruction mais cette instruction n’a nullement vocation à ouvrir à ces dernières les carrières masculines, ce qui aurait pour effet de mettre en péril leur mission naturelle de gouvernantes de la maisonnée. À la rigueur, elles peuvent, lorsque leur situation économique exige qu’elles aient un métier, être institutrices ou artistes. Très virulent à l’égard des « récriminations » des suffragettes qui vont à l’encontre de « toute la nature et tout l'ordre non seulement traditionnel, mais intelligible des choses »33 et mettent ce faisant en péril la stabilité du foyer et leur propre bonheur, Marion défend en outre très fermement le principe de subordination des femmes, subordination qu’il caractérise comme une protection fondée sur la prise en considération de la vulnérabilité impliquée par la maternité, fut-elle virtuelle.
Ainsi que le souligne Nicole Mosconi34, l’argumentaire de Marion révèle une sorte d’embarras pour concilier le maintien des femmes dans une position sociale et politique subordonnée avec le principe d’égalité qui constitue par ailleurs un levier de la critique républicaine de l’Ancien Régime. Cela conduit Marion à mobiliser le syntagme d’« égalité dans la différence » par lequel il entend reconnaître aux femmes une dignité égale à celle des hommes sans pour autant lier celle-ci à la reconnaissance de droits politiques et sociaux.
Cette tension se résout tout autrement chez Buisson, ce dernier étant amené au tournant du siècle à soutenir le mouvement féministe en faveur du droit de vote des femmes, soutien contemporain de son engagement en faveur de l’unification des ordres d’enseignement. Ces deux combats participent l’un et l’autre du tournant social que prend alors son républicanisme, la reconnaissance du droit politique des femmes apparaissant manifestement à ses yeux comme une des facettes de l’aboutissement de la logique républicaine. Tout en ayant une vision de la femme assez déterminée socialement35, il lui reconnaît plus volontiers que Marion un rôle politique : dès les années 1890, il soutient ainsi la création d’associations féministes et correspond avec Hubertine Auclert36. En 1900, il est membre de la commission d’organisation du congrès international de la condition et des droits des femmes (Paris) ; il participe au congrès national des droits et du suffrage des femmes à Paris en 1908, puis au congrès de Stockholm de l’alliance internationale pour le suffrage des femmes en 1911. La même année, il fonde avec Justin Godart la ligue d’électeurs pour le suffrage des femmes.
En tant que président de la commission du suffrage universel durant la législature 1906-1910, il rédige un rapport sur le suffrage féminin37 où il propose une synthèse détaillée des arguments formulés en sa faveur depuis Olympe de Gouge jusqu’aux suffragettes anglaises en passant par Condorcet et Stuart Mill. Buisson entend ainsi mettre en lumière l’injustice fondamentale faite aux femmes, souligner l’enracinement du principe d’égalité des droits dans le projet de la Révolution française et montrer que l’accession des femmes à la souveraineté politique s’inscrit dans le sens de l’histoire universelle.
Il prend ainsi soin de réfuter les objections classiquement formulées à l’encontre du droit des femmes à commencer par l’invocation des spécificités physiologiques de la gent féminine (« la grossesse et ses indispositions passagères ») à laquelle il oppose la réponse de Condorcet : « A-t-on jamais imaginé de priver de leurs droits civiques les hommes “qui ont la goutte tous les hivers” ? »38. Avec Mill, il souligne la dimension socialement et historiquement construite du « type légendaire de la femme ultra impressionnable » sujette aux « attaques de nerfs » et aux « évanouissements »39, un type passé de mode à mesure que les femmes ont été élevées pour gagner leur vie. Il répond même au Buisson du rapport de 1878 qui se demandait à quoi bon donner aux jeunes filles une instruction très poussée :
quel avantage en recueillerait la société ?
L’avantage d’abord […] de faire cesser une injustice : tant pis pour ceux qui ne comprennent pas que l’humanité y gagne toujours. Quand on aura modifié la mentalité générale du garçon, du jeune homme, du mari à l’égard de la femme, on aura simplement fait la même révolution qu’on aurait produite en amenant le seigneur à ne plus se considérer comme au-dessus de ses vassaux parce qu’il s’est donné la peine de naître, ou le monarque absolu à ne plus se croire irresponsable vis-à-vis de ses sujets parce qu’ils sont nés sujets et lui roi40.
La considération de l’utilité sociale s’efface désormais devant, ou plutôt se confond, avec l’exigence éthique de mettre fin à l’inégalité des droits entre hommes et femmes, inégalité de même nature, estime Buisson, que celle qui privait le peuple de l’exercice de la souveraineté sous l’Ancien Régime. Attentif aux évolutions apparues dans le monde économique où les femmes ont conquis le droit d’être représentées dans les instances collectives (conseils du travail et du commerce), Buisson constate que l’évolution sociale a d’ores et déjà contribué à faire émerger une conception plus juste du rôle de la femme qu’il s’agit désormais d’assumer pleinement41. Buisson demeurant minoritaire au sein de son propre parti (radical-socialiste), ses efforts resteront vains pendant plus de trente ans.
Conclusion
Au-delà de l’agacement que l’on peut éprouver rétrospectivement à la lecture des clichés que ne manquent pas de charrier les discours de la Troisième République sur l’éducation des femmes, on ne peut qu’être frappé par leur commune ambivalence. Ces textes apparaissent en effet traversés par une hésitation constante entre une approche naturalisante du féminin et une approche historicisante, plus ouverte à l’idée d’une construction sociale de la condition féminine et des rôles qui lui sont assignés. Cette ouverture sur l’historicité n’appelle cependant pas automatiquement des propositions de transformation sociale. Ils sont ensuite travaillés par une tension manifeste entre la dynamique universalisante du discours de l’égalité des droits mis au service de la lutte contre l’Ancien Régime et la volonté de cantonner les femmes dans la sphère domestique. Ces tensions sont éclairantes parce qu’elles montrent qu’on ne peut pas réduire l’histoire de l’éducation féminine et plus généralement l’histoire des droits des femmes à un affrontement net entre des progressistes et des conservateurs. D’une part, parce que les argumentaires égalitaristes et différencialistes coexistent à l’intérieur de chacune des positions en présence, d’autre part, parce que le développement de l’instruction féminine obéit aussi à des préoccupations instrumentales comme la lutte contre le cléricalisme ou la volonté d’entretenir le bénéfice de l’instruction élémentaire au-delà de la scolarité.