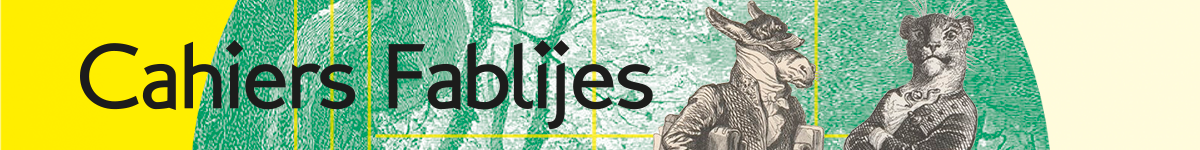En 2011, un numéro des Cahiers Robinson, dirigé par Guillemette Tison et Francis Marcoin, résumait en son titre le problème de typologie posé par les livres de lecture courante, ces manuels que l’on va nommer au xxe siècle des « romans scolaires » : ils se situent entre la littérature et la pédagogie1. Au xixe siècle, les « livres de lecture courante », terme utilisé dans les arrêtés rédigés à l’occasion de l’organisation de concours d’écriture de manuels scolaires2, correspondent au niveau de lecture que nous désignons aujourd’hui comme celui de la « lecture fluente », c’est-à-dire un stade atteint théoriquement, à l’époque, pendant le cours élémentaire, et consolidé à la fin du cours moyen, donc pour des enfants entre 9 et 13 ans3.
Ces manuels ont la particularité de suivre le même personnage tout au long d’un récit chronologique. Ce personnage est masculin ou féminin en fonction du public scolaire auquel il s’adresse, supposant que l’identification du lecteur au personnage de fiction est simplifiée par la proximité d’âge et l’identité de genre, respectant par la même occasion la commande institutionnelle qui veut, comme on dirait aujourd’hui dans le langage commercial, « segmenter » le public scolaire. En effet, dès la Première République, il était annoncé un concours ouvert à tous les citoyens afin de composer des livres de lecture réservés au premier degré d’instruction, et dans un projet de décret annexé à un rapport de Condorcet, il est recommandé que ces livres soient « différents pour les âges et les sexes », et qu’ils rappellent « à chacun ses droits et ses devoirs, ainsi que les connaissances nécessaires à la place qu’il occupe dans la société4 ».
Même si le livre de lecture courante adopte une forme romanesque, l’enjeu reste pédagogique avec une définition de la pédagogie comme art d’éduquer moralement l’enfant. Mais au-delà de l’enfant, le projet éducatif du xixe siècle entend toucher toute la société, les parents et les familles. À partir de 1860 et de la création dans chaque école d’une armoire bibliothèque destinée au prêt, il est clairement indiqué, dans le code des bibliothèques destiné aux instituteurs à qui est confiée la gestion de cette armoire, qu’elle a pour fonction de :
[…] sauvegarder les manuels scolaires et particulièrement ceux que l’école pourra prêter aux élèves nécessiteux, dispensés de payer la contribution scolaire. Elle doit également être utilisée pour le prêt de livres. On y range ainsi des livres destinés à être prêtés aux écoliers et à leurs parents5.
La forme romanesque aide à atteindre le public des parents, et rapproche finalement le livre de lecture des romans « de formation », « d’apprentissage », dont le point commun est ce que Jean Cabriès, dans le Dictionnaire des genres et notions littéraires nomme « l’épaisseur du vécu » :
Ainsi verra-t-on dans la quotidienneté d’un monde pacifique et travailleur, des individus non exceptionnels, mais de bon vouloir et sensibles, rechercher le bonheur et la justice avec un sens des réalités illustré par Robinson Crusoé et selon le programme de L’Émile. Il faut apprendre : c’est la loi des Lumières6.
Cette définition du roman de formation s’applique particulièrement à nombre de livres de lecture courante, dont ceux que nous avons choisi d’évoquer dans le cadre de cet article : La Petite Jeanne de Zulma Caraud7, Suzette puis Le Ménage de Mme Sylvain de Marie-Robert Halt8, Tu seras ouvrière de L.-Ch. Desmaisons9, et enfin Le Troisième Livre de lecture à l’usage des jeunes filles, de Clarisse Juranville et Pauline Berger10. Cette sélection n’est bien sûr pas exhaustive, mais elle illustre ce choix d’une génération d’auteurs de puiser dans « la quotidienneté » d’un « monde travailleur » pour reprendre les termes de Jean Cabriès. Les héroïnes sont presque toutes issues de la petite paysannerie. Dans les premiers chapitres de l’histoire, elles ont l’âge des lectrices, entre 8 et 12 ans. Mais elles grandissent et on découvre pas à pas leur destin d’adulte. Elles ne sont pas dotées d’une intelligence exceptionnelle, mais d’un solide bon sens, et d’une sensibilité qui apparaît tellement liée à la nature féminine que cela n’est pas commenté par la voix omnisciente, alors que la différence entre sensibilité et sensiblerie est parfois clairement expliquée. « Individus non exceptionnels », ce ne sont pas pour autant des petites natures, et elles savent surmonter les épreuves. Ces épreuves ne sont pas extrêmes, ou cumulées comme dans les mélodrames, mais des événements ordinaires qui mettent en danger la sécurité matérielle que ces femmes recherchent, parce que cette sécurité est la première condition du bonheur. Dans La Petite Jeanne de Zulma Carraud, par exemple, c’est un veuvage qui complique le travail agricole, puis la naissance d’un enfant simple d’esprit dont il faut assurer l’avenir dans une société qui n’a rien prévu d’autre que les solidarités villageoises. Au-delà des leçons de courage, de vertu, le roman se fait témoignage, il attire l’attention sur ce qui va nourrir les débats de société et les débats pédagogiques. L’un de ces débats concerne le travail féminin comme le note Françoise Mayeur dans L’Éducation des filles en France au xixe siècle :
Il a suffi d’une quarantaine d’années pour que se posent avec une acuité nouvelle deux problèmes latents tout au long du siècle : le travail peut-il être autre chose pour les femmes qu’un signe d’infériorité économique ? Peut-il, doit-il être un moyen d’accès à l’indépendance personnelle ? Le débat pédagogique est bien en définitive un débat de société11.
Ces quarante années évoquées par Françoise Mayeur sont celles qui séparent la publication du livre de lecture de Zulma Carraud, en 1852, des autres livres que nous avons retenus, publiés entre 1891 et 1895. Les débats pédagogiques formulés par Françoise Mayeur ont inspiré notre problématique : comment les livres de lecture de cette période participent, par le biais de la fiction romanesque, aux débats sur la place économique et sociale du travail dans une vie de femme ?
Le manuel de lecture courante interroge les typologies du genre romanesque. Il est soumis, d’une part, à des commandes institutionnelles dans un cadre de plus en plus balisé au fil du siècle, qui impose des chapitres incontournables, des mises en fiction plus ou moins artificielles de ce que contiennent les programmes scolaires, des leçons d’économie domestique narrativisées qui n’ont rien de romanesque, et d’autre part, il lui arrive de retrouver ici ou là la liberté de la fiction. Entre soumission et échappées romanesques, ce sont les axes que cet article veut illustrer par des exemples de quelques figures féminines ancrées explicitement dans une typologie sociale qui domine les manuels, en commençant par la paysanne aux champs, qu’il faut éduquer, puis la couturière à la ville à qui il faut laisser entrevoir une réussite professionnelle individuelle possible, et en terminant par deux figures plus ambiguës, celle de la jeune bourgeoise qui voyage et celle de l’institutrice.
Éduquer la paysanne aux champs
Nulle ambition littéraire n’est exprimée par les auteurs de livres de lecture courante, majoritairement des femmes, qui se présentent d’abord comme des pédagogues avant d’être des femmes de plume. C’est le cas de Zulma Carraud. Dans une lettre reproduite dans un numéro du Courrier balzacien, elle précise les circonstances qui l’amènent à écrire le roman La Petite Jeanne : il s’agit avant tout de combler un manque pour enseigner la lecture à un niveau de compétences précis :
Jetée en 48 par des revers de fortune dans un petit village du Cher perdu au milieu des terres, privé de routes, d’école et de curé, je trouvai un jour en me promenant une jolie petite fille à qui je demandai si elle voulait apprendre à lire ; sur sa réponse affirmative, je l’engageai à venir chaque jour chez moi à midi. Dès la troisième leçon, elles se trouvèrent deux, et je les fis lire sans la moindre observation. À la fin du mois, j’en avais douze, s’étant faufilées avec la persuasion naïve que je ne m’apercevais pas de leur intrusion. […]
Quand mes fillettes surent lire, je cherchai, mais en vain, quelque ouvrage qui pût leur donner de bonnes idées pratiques et dont le vocabulaire leur fût compréhensible, et je n’en trouvai pas. […]
C’est ainsi que je fus conduite à faire ces dix petits volumes qui, tous sauf deux, sont exclusivement pour les enfants des écoles primaires, désolée que des auteurs plus autorisés que moi dédaignassent de faire l’aumône de leur talent à cette classe déshéritée des plaisirs de l’intelligence […]. Je n’ai jamais eu la moindre prétention littéraire et […] je me range humblement parmi cette partie de la population pour laquelle j’ai écrit et au milieu de laquelle je vis12.
La lacune que Zulma Carraud veut combler tient au fait que les manuels dont on annonce régulièrement la composition ne voient pas le jour, et le problème va ressurgir pendant tout le xixe siècle. D’après une lettre de la sœur de Balzac, Laure Surville, la première version du récit de Zulma Carraud était un roman berrichon dans la lignée des romans paysans de George Sand. C’est l’éditeur, Hachette, qui demande des corrections dans un sens plus pédagogique et moralisateur13. En 1852, La Petite Jeanne devient La Petite Jeanne ou le Devoir, ouvrage couronné par l’Académie française et réédité jusqu’en 191314. Comme l’absence de livres de lecture courante se fait sentir aussi bien pour les garçons que pour les filles, Zulma Carraud publie en 1853 Maurice ou le Travail. Livre de lecture courante à l’usage des écoles primaires, qui est considéré comme le pendant masculin de La Petite Jeanne15. En effet, les deux livres ont à peu près la même structure : ils commencent par exposer l’enfance des personnages principaux, marquée par la souffrance de perdre une mère, puis vient la rencontre avec une mère de substitution qui apporte affection, sens du travail, valeurs morales et foi en Dieu. L’éducation intellectuelle est due, dans le cas de Jeanne, à la charité d’une famille bourgeoise qui la prend sous son aile, et dans le cas de Maurice, à un instituteur. Ils ont appris à lire et écrire. Ils possèdent quelques notions d’économie et de gestion agricole, et des savoirs pratiques comme la couture pour Jeanne, ou l’entretien d’un matériel agricole pour Maurice. Armés de cette formation basique, Jeanne et Maurice fondent chacun une famille et vient alors la partie la plus explicitement pédagogique de chaque roman, la partie centrale, celle où devenu parent à son tour, le personnage doit transmettre ce qu’il a reçu, et même pousser ses enfants plus loin que lui-même qui a tout juste réussi à sortir de la misère pour s’installer dans une relative sécurité matérielle, laquelle peut être remise en cause du jour au lendemain, par une mauvaise récolte par exemple. Veuve, Jeanne réussit à faire fructifier un bout de vigne, et se fait construire une maison. Elle apprend à lire, écrire et compter à ses quatre enfants. Le plus instruit, Sylvain, entre chez un notaire, sa sœur devient femme de chambre dans une maison bourgeoise. Les deux derniers fils, dont Louis, handicapé mental, reprennent la ferme de leur mère. Maurice est manœuvre dans le bâtiment. Il entreprend un tour de France, se marie, puis fonde sa propre entreprise de construction, ce qui lui permet d’envoyer Charles faire des études. Maurice devient adjoint au maire. Dans les deux romans, les enfants, élevés avec un sens aigu de la valeur du travail et un respect pour le savoir scolaire, réussissent à s’établir et donnent toute satisfaction à leurs parents, sans renier leur famille, sans devenir des « bourgeois » donc. C’est toute une vie qui est couverte par le livre de lecture. Jeanne a huit ans au début du livre, elle est une vieille dame aimée et entourée à la fin. Même chose pour Maurice.
Le peu de différences entre le destin de Jeanne et celui de Maurice, tient au fait qu’ils restent tous les deux, avant d’être homme ou femme, des paysans attachés à leur village. Si les références berrichonnes sont gommées, c’est pour pouvoir distribuer le livre partout en France, mais l’environnement naturel des personnages est rural ce qui a pour effet de réduire les différences de contenus pédagogiques à transmettre : certes Jeanne, en tant que femme, a davantage besoin d’apprendre à coudre, mais Maurice apprend aussi davantage de savoirs pratiques que de contenus savants. Jeanne a un horizon géographique plus limité que Maurice qui fait son tour de France comme apprenti maçon, mais il revient s’établir dans le bourg où il est né. Quand les personnages voyagent, c’est pour s’informer sur d’autres manières de travailler, de construire sa maison, d’élever son bétail, et d’importer dans le Berry ce qui marche ailleurs, comme le fait Maurice pour sa communauté.
Quarante ans après la publication des livres de lecture de Zulma Carraud, à partir de 1880, la France s’organise pour devenir une « République scolaire ». Les éditeurs privés doivent obtenir l’inscription des livres de lecture courante qu’ils proposent sur la liste départementale officielle, qui est établie sur la base des choix des enseignants. La préface d’un catalogue de 1891 indique à l’instituteur quelles doivent être ses priorités :
Avant tout, il inspirera le goût de la lecture à l’école même, par des lectures à haute voix, bien choisies, habilement suspendues, dont il se chargera lui-même et dont il fera la récompense du travail. Il invitera ensuite les élèves à faire des emprunts à la bibliothèque ; il indiquera les lectures pour la maison ; il saura les graduer et les diversifier selon l’âge, la capacité, les besoins, les loisirs, les saisons, les travaux des champs, ou de l’atelier, les événements du dehors16.
La segmentation genrée est implicite, mais la mention des besoins, des loisirs, des travaux des champs ou de l’atelier suppose de tenir compte d’une répartition des rôles traditionnels masculins et féminins qui n’est pas remise en cause17. Ce n’est donc pas la forme, la conception de ces ouvrages, ni même les matières enseignées, qui diffèrent entre les manuels pour garçons et les manuels pour filles. La forme qui s’impose est la même : une mise en page avec du texte et des illustrations insérées comme autant de planches pouvant servir à l’enseignement de la géographie, de l’histoire, ou des sciences, mêlées à d’autres illustrations qui ont une fonction plus récréative et font écho aux faits du quotidien, ou aux péripéties qui émaillent le destin des héros. Les manuels de lecture de Marie Robert Halt en sont un exemple. On retrouve l’importance de la durée chronologique comme dans les romans de Zulma Carraud et, en substance, le même message : des enfants bien éduqués font de meilleurs parents une fois adultes. Le premier livre, Suzette, raconte l’enfance de l’héroïne, puis Suzette se marie, devient Mme Sylvain, et le volume intitulé Le Ménage de Mme Sylvain raconte la suite de sa vie. L’incipit de Suzette présente une famille, chien et chat compris. Dès la troisième page, des exercices sont proposés : questions de compréhension du texte, mais aussi calcul, questions de sciences naturelles. Les illustrations se font de plus en plus informatives et la partie « devoirs proposés » plus présente. Mais les situations narratives reproduisant les rôles traditionnels masculin et féminin, les leçons sont contextualisées différemment et, surtout, la soumission à la répartition des rôles est plus souvent la conclusion explicite d’un nouvel apprentissage côté féminin. Dans Le Ménage de Mme Sylvain, par exemple, on trouve l’incontournable chapitre sur l’hygiène. La structure est un modèle du genre. Il s’agit d’abord de justifier une tâche ménagère, féminine par tradition, celle de la chasse à la poussière, par une gradation d’arguments : le premier, c’est le simple confort esthétique, une maison propre est plus accueillante. Puis vient la justification scientifique pour expliquer la bonne façon d’épousseter, en évitant de répandre les poussières dans l’air car elles contiennent des microbes :
Ce sont autant d’ennemis qui dorment sur les meubles et dessous, dans les coins, derrière les cadres, sur les parquets des chambres, dans les rideaux, sur les étagères, et que ces ennemis, il ne faut pas s’amuser à les disperser à coups de plumeau ou de balai […] Les poussières sont si bien les véhicules de germes dangereux qu’à Paris il vient d’être interdit de cracher dans les omnibus et les bateaux, les crachats pouvant contenir des microbes qui, desséchés, mélangés aux poussières qui voltigent dans l’air, se propagent facilement18.
Vient ensuite la confirmation par l’expérience avec la comparaison de ce qui se passe lorsqu’un champ de blé pourrit sur pied à cause de champignons parasites, parallèle exprimé par une voix masculine qui confirme l’utilité d’approfondir un savoir scientifique sur la question :
Il y a quelque vingt ans, la rouille du blé envahit mes céréales, plusieurs années de suite, et faillit me ruiner. J’appris que cette maladie est causée, comme celle dont vous parliez tout à l’heure, par un minuscule champignon, visible seulement aux ravages qu’il fait19.
Voilà donc une tâche ménagère triplement justifiée, par l’esthétique, par la science, par l’expérience. Mais qui réunit aussi les conditions d’un discours de culpabilisation : ne pas se soumettre à cette tâche, c’est refuser le progrès, et mettre la santé de sa famille en danger, d’où la conclusion du chapitre :
Voilà pourquoi j’estime que les femmes attentives à la propreté de leur maison doivent être encouragées, et que nous, pères, maris ou fils, nous leur devons toute notre reconnaissance pour leur sollicitude à entretenir un milieu favorable à notre santé et à notre force20.
Émanciper la couturière des villes
À côté de cette figure de la femme au foyer parfaite ménagère, dont l’image est incontestablement très présente dans les manuels de lecture, il est un autre modèle féminin, celui de l’ouvrière qui participe au travail productif, couturière, lingère, modiste, blanchisseuse, domestique, ou ouvrière de fabrique. Françoise Mayeur note qu’on s’y résigne sans trop de peine : « […] comme le labeur multiséculaire de la paysanne, c’était une nécessité jugée inéluctable pour les classes pauvres21. » Pour les élèves de dernière année d’école primaire, qui, à 13 ans, vont quitter l’école et choisir un apprentissage, l’éditeur Armand Colin publie une série de livres de lecture dont l’objectif est de promouvoir les valeurs du travail : Tu seras agriculteur22, Tu seras commerçant23, ou encore Tu seras soldat24 car on n’oublie par les valeurs patriotiques. Cette série ne comporte qu’un seul manuel pour les filles, car le choix de profession est restreint : Jeanne, l’héroïne de Tu seras ouvrière, sera couturière.
Les garçons ont davantage de choix, mais surtout, ils ne font pas ce choix dans les mêmes conditions. Dans le chapitre d’ouverture de Tu seras commerçant, Pierre vient de passer son certificat d’études, et son orientation se décide dans une conversation entre l’instituteur et le père de Pierre, dans la cour de l’école. Dans l’incipit de Tu seras ouvrière, Jeanne vient aussi « d’obtenir son certificat d’études25 », et elle décide de son avenir dans la maison familiale, en bavardant avec sa grand-mère qui l’élève26. Pour Pierre, le choix est fait au terme d’un passage en revue de toutes les possibilités qui s’offrent à lui : typographe, clerc chez un huissier ou un notaire, dessinateur technique chez un ingénieur, fonctionnaire dans un service public. Il faut trois chapitres pour trouver un métier à Pierre, quand il ne faut que trois pages pour en trouver un à Jeanne. L’institution scolaire est sollicitée dans le choix d’orientation des garçons, celui des filles est une décision familiale. Mais à partir de là, leurs destins sont strictement parallèles : Jeanne, comme Pierre, suit la voie de l’apprentissage et non celle de l’école de couture, par ailleurs première école professionnelle pour jeunes filles créée par Élisa Lemonnier en 186227. Mais, payante, cette école reste inaccessible aux jeunes paysannes de province. C’est récurrent dans les livres de lecture courante : le héros est trop pauvre pour passer par la voie scolaire. C’était également le cas pour Maurice, le personnage imaginé par Zulma Carraud, qui ne va pas à l’École des Arts et Métiers comme le lui suggère son instituteur, mais apprend chez un forgeron du village. Jeanne est d’abord apprentie près de chez elle, puis dans différents ateliers de couture, modestes au départ, mais toujours dirigés par des patronnes honnêtes, courageuses et bienveillantes. Puis elle quitte la province pour Paris, comme Maurice, mais, contrairement à lui, elle ne revient pas au village. Elle gravit les échelons et dirige, à la fin du roman, sa propre maison de couture. Le fait d’armes de Jeanne est de rester fidèle à sa patronne, alors que celle-ci a une conception vieillissante de son atelier, concurrencé par des ateliers plus modernes. C’est là un autre thème incontournable des livres pour garçons et pour filles : le petit commerce contre les grands magasins. Jeanne va empêcher l’une des employées, Marie, de subtiliser le carnet d’adresses des clientes au profit de la concurrence.
Pierre se forme chez un modeste épicier, qui lui conseille de partir pour Paris quand il estime ne plus rien avoir à lui apprendre. Il découvre la hiérarchie des grands magasins, mais il la trouve pesante et préfère entrer chez un grossiste, dont il reprend l’affaire quelques années plus tard. Malgré son ascension sociale, Jeanne n’oublie jamais de revenir régulièrement en visite chez ses parents. De même, Pierre retourne voir ses parents après ses voyages. Dans le dernier chapitre, Jeanne se marie. Même chose pour Pierre. Ces deux ouvrages sont représentatifs de l’ambiguïté avec laquelle la fiction romanesque doit composer : d’un côté elle se nourrit de réalisme social et montre les injustices et les manques d’un système éducatif où les écoles spécialisées sont sélectives par l’argent, mais en même temps il n’est pas question, dans un manuel scolaire, d’inciter à des revendications collectives de justice sociale. La réussite, ou l’échec, doit donc relever clairement de la responsabilité individuelle, que l’on soit homme, ou femme.
Les deux structures narratives sont interchangeables, bien que ce soit deux auteurs différents, parce qu’elles sont une mise en fiction de la façon dont la Troisième République veut construire les destins. Les programmes scolaires du premier degré stricto sensu (calcul, lecture, leçons de choses, histoire et géographie) sont communs. La couturière coud des vêtements en laine mérinos, le commerçant vend des pièces de tissus en mérinos, on peut donc faire exactement la même leçon de choses sur les moutons mérinos dans les deux manuels28. Toutefois, les chapitres abordent davantage de notions spécialisées dans le manuel pour les garçons, comme si diriger une maison de couture ne nécessitait pas de se former à la comptabilité, à la gestion ou au droit commercial, autant que pour diriger une épicerie.
Cependant, en perdant en contenu technique formateur, le manuel pour les filles gagne sur le plan de l’intrigue romanesque. Une rapide comparaison entre les titres des chapitres dans les deux manuels suffit à en rendre compte. Le personnage de Pierre est un fil conducteur prétexte à une mise en fiction du programme de gestion29. La fiction peine à se glisser entre les chapitres et n’en paraît que plus ténue. Ainsi le chapitre 38, intitulé « Une idylle au magasin », est coincé entre un chapitre juridique sur les contentieux avec les débiteurs, et la différence entre circuit court et circuit long. En comparaison, le manuel Tu seras ouvrière tient beaucoup plus du vrai roman. Jeanne, libérée d’avoir à apprendre des contenus arides et desséchants, a une vie sociale, ce qui permet une mise en route de petites intrigues avec des péripéties. Alors que Pierre ne rencontre que des clients, silhouettes rapidement esquissées, qui disparaissent dans les chapitres suivants, Jeanne rencontre des personnages qui ont une certaine épaisseur psychologique, et avec lesquels elle entretient des liens au long cours. L’objectif est bien sûr d’exalter un trait de caractère jugé féminin : le souci des autres. D’autres stéréotypes sont évidents, comme les comportements d’apprentissage : Jeanne anticipe ce qu’on attend d’elle, elle sait d’instinct se comporter avec le personnel, avec les clientes. C’est dans les relations humaines qu’elle développe des compétences comme gérer du personnel avec diplomatie, la main de fer dans un gant de velours en somme. Pierre est d’abord rebelle et prêt à envoyer promener les clients casse-pieds. Jeanne est attentive et obéissante, Pierre est plus égoïste et indiscipliné. Jeanne travaille pour l’amour du travail bien fait et trouve sa récompense dans les compliments et la satisfaction des clientes. Pierre a besoin d’entendre des arguments plus pragmatiques, en monnaie sonnante et trébuchante. Son mariage avec la fille du patron est moins la conclusion d’une intrigue amoureuse que la récompense qui attend tout bon apprenti. Le mariage de Jeanne est davantage affaire de sentiments, elle n’épouse pas un héritier, mais un représentant en soieries qui, comme elle, vient d’un milieu modeste et a gravi les échelons.
Parce qu’il permet de représenter une partie de la société, ce qui était l’une des ambitions du roman réaliste, le stéréotype féminin du souci des autres est ce qui rattache le plus le manuel au genre du roman. Bien sûr les rencontres que fait Jeanne remplissent la fonction de contre-exemples de bonne conduite, de faire-valoir, comme la perfide Marie, mais elles permettent d’élargir l’espace de la fiction qui semble alors faire écho aux romans de l’époque. Ainsi, en arrivant à Paris, Jeanne rencontre le couple Dupont. Monsieur est plombier zingueur, madame est blanchisseuse. Monsieur a un penchant pour la boisson. Pour Jeanne, c’est facile à régler : si monsieur boit, c’est qu’il n’est pas bien chez lui. Elle explique donc à Mme Dupont qu’elle doit se montrer une meilleure épouse. Elle doit cuisiner de bons repas, rendre son foyer accueillant, et s’intéresser à M. Dupont, à sa journée de travail. Ce discours de culpabilisation porte ses fruits. Mme Dupont fait des efforts, le mari devient sobre. L’harmonie conjugale règne chez les Dupont. Après la réécriture, à hauteur d’écolière, du roman de Zola, Au bonheur des dames30 paru six ans plus tôt, avec cette figure de petite employée qui s’épanouit dans l’univers du commerce et y trouve l’amour, voici donc une réécriture de L’Assommoir31 qui finit bien, où le couple Gervaise et Coupeau se ressoude. Il suffit de rappeler aux femmes que l’harmonie conjugale dépend d’elles seules. Eh bien non car « Qui a bu, boira ». Quelques chapitres plus loin, M. Dupont reprend ses mauvaises habitudes. Cette péripétie vient annuler la responsabilité de l’épouse. Précisons qu’après sa chute, M. Dupont a le bon goût de mourir, il n’est plus à la charge de sa femme qui va s’en sortir puisqu’elle a un bon métier, que sa blanchisserie est viable et bien gérée. On a donc bien une fin satisfaisante mais pas dans les conditions attendues, et la leçon de vie se nuance.
L’éditeur est conscient que le travail féminin remet en cause l’image traditionnelle de la famille et de la maternité. Une préface est ajoutée, écrite par Jules Simon, et qui est une argumentation en faveur du travail féminin. Il s’agit de convaincre les jeunes filles de milieu populaire qu’elles ont tout intérêt à avoir un salaire. Le propos illustre une volonté de maintenir les classes laborieuses dans le labeur. Laissons l’oisiveté aux riches ; d’ailleurs l’oisiveté est un péché, c’est la mère de tous les vices. Bien sûr l’argumentaire ne va pas jusqu’à expliquer aux jeunes filles qu’elles peuvent se passer d’un homme et du mariage, homme dont elles doivent gagner le respect par une attitude irréprochable, et sans viser au-delà de leur classe sociale. Enfin, si le travail féminin est présenté positivement, comme une façon normale pour une jeune fille d’envisager son avenir, il va de soi qu’il n’est pas question de partager les tâches ménagères avec le mari. Donc le modèle à éviter, c’est l’usine. Le modèle défendu, c’est celui de l’artisanat, avec la liberté des horaires. On lit cet argument aussi dans Le Ménage de Mme Sylvain : Lucie, une amie de Suzette, qui veut se mettre à travailler et s’est vu présenter deux offres, décide de choisir le travail qui lui rapporterait le moins uniquement parce qu’il s’agit d’un travail à domicile :
Vraiment, 60 centimes par jour gagnés chez moi, soit 200 francs par an, me donneront un profit beaucoup plus clair et plus certain que 1 200 francs gagnés au dehors.
Et je ne parle pas des douces joies du foyer, de la vie de famille, qui fait la moralité des unions, et permet d’élever sainement les enfants32.
Dans Tu seras ouvrière, ni le mariage, ni la maternité, n’empêchent Jeanne de continuer à diriger l’entreprise. Jeanne est donc plus émancipée que Lucie.
Voyager, enseigner… une émancipation ?
Les héroïnes du manuel de Clarisse Juranville et Pauline Berger, Le Troisième Livre de lecture à l’usage des jeunes filles, sont d’une origine plus favorisée socialement. Elles vivent à Dunkerque. Mais leur père, veuf, subit des revers de fortune qui vont l’obliger à envoyer l’une de ses filles chez une amie dans les Vosges, l’autre à Avignon chez une tante. Le départ est un premier prétexte pour évoquer la Flandre, son histoire, sa géographie, son économie. Comme le montre Patrick Cabanel33, le livre est un héritier du célèbre manuel, Le Tour de la France par deux enfants, paru en 1877. Sur la couverture, le chemin de fer apparaît en bonne place, ainsi qu’un bateau en médaillon. Le père se charge ici de l’instruction scolaire de ses filles, en parallèle d’une éducation aux bonnes manières. Patrick Cabanel trouve moderne l’hommage rendu par Clarisse Juranville et Pauline Berger aux femmes célèbres de l’Histoire, ce qui n’existe pas dans les manuels pour les garçons. Elles rendent hommage aux éducatrices : Françoise de Maintenon, Félicité de Genlis, Henriette Campan, Marie Pape-Carpantier, pionnière de l’école maternelle fondée en 1845, et Élisa Lemonnier34. Mais cette modernité est à relativiser. Ici le travail au féminin est un pis-aller pour jeune fille sans ressources. À propos des écoles professionnelles, M. Vieuville dit à ses filles :
Pour mettre en état de gagner honorablement leur vie [,] les jeunes filles qui n’avaient pas d’autres ressources que le travail, elle [Élisa Lemonnier] fonda à Paris une école professionnelle où, tout en instruisant les élèves, on leur apprenait un métier. À leur choix, elles en pouvaient sortir aptes au commerce, ou bien couturières, brodeuses, fleuristes35.
Le voyage des filles de M. Vieuville leur fait acquérir un savoir destiné à rester gratuit. En effet, le dernier chapitre montre M. Vieuville de retour à Dunkerque, accueilli par ses ouvriers qui attendent de lui qu’il reprenne l’entreprise de textile grâce à un prêt octroyé par sa sœur, reconnaissante d’avoir pu employer ses deux nièces comme négociantes. Rien n’est dit sur le rôle que joueront ses deux filles après leur retour, alors même qu’elles ont appris, pendant leur périple, à transmettre des ordres d’achat et à acheter au bon prix des tissus pour la maison de blanc de leur tante qu’elles représentent. Ces compétences semblent avoir été acquises pour les protéger en cas de revers commercial de l’entreprise paternelle. Bien que le père se dise fier des nouvelles compétences de ses filles, il n’est pas dit explicitement dans les dernières pages qu’elles seront associées désormais aux décisions.
On retrouve la même ambiguïté avec une autre figure féminine qui aurait pu apparaître comme un modèle d’émancipation : l’institutrice. Le roman qui donne un rôle central à ce personnage est Suzette, avec Mme Valon, qui apparaît assez vite au début du livre, dès le chapitre 4. Mme Valon est encore jeune, et son mari est l’instituteur de l’école des garçons. Suzette est une fillette de 13 ans qui a perdu sa mère. Elle a besoin des conseils de son institutrice, sorte de mère de substitution, qui l’aide à tirer parti de ses erreurs, lesquelles sont nombreuses. Ainsi Suzette provoque une infection en soignant une plaie avec de la fiente de pigeon pour suivre les conseils d’une bohémienne par superstition. Heureusement, Mme Valon et sa science réparent les dégâts. Mais elle et son mari n’envisagent pas pour leurs élèves un autre destin que celui de paysan. Alors que Jacques, le frère aîné, hésite entre l’école agricole et le lycée, M. Valon lui conseille l’agriculture, et le devoir donné aux élèves en bas de page est : « Quels services rendent les professions manuelles36 ? », conformément d’ailleurs aux programmes scolaires de 1882. Et ce n’est pas dans la salle de classe que Mme Valon délivre ses conseils, mais dans sa salle à manger, dans l’intimité du foyer :
Elle la fit entrer dans la salle à manger. Qu’elle était propre, jolie et animée, cette salle à manger !
Deux jolis bébés y jouaient sous les yeux souriants de leur grand-mère, Mme Liénard. […] Le buffet, les chaises brillaient, le carreau était rouge, éclatant de netteté. Une appétissante odeur de bonne cuisine sortait de droite. M. Valon, le mari, dont la classe venait aussi de finir, entra, sourit à la bonne grâce des choses et des gens réunis là. C’était certainement le sourire de l’homme des vieux temps à l’aspect de sa caverne fleurie37 !
Peu de temps avant cette scène, Mme Valon avait en effet lu à ses petites élèves un texte sur la famille aux temps préhistoriques qui se terminait par ces mots à la gloire du génie féminin du ménage : « Car c’était la femme qui venait de créer la première délicatesse du nid familial, pour adoucir l’homme et le charmer, pendant qu’au dehors hurlaient les loups et les autres ennemis38. » Le typographe a placé l’illustration représentant la salle de classe, cette salle de classe qui pourrait être, pour les filles, porteuse d’émancipation par les études, sous le titre du chapitre, « La femme de la caverne39 ». Ironie involontaire que ce rapprochement qui renvoie les filles à une représentation de la femme vouée à ne pas sortir des limites du foyer depuis la grotte préhistorique. Atténuer l’image d’émancipation qui pourrait être incarnée par Mme Valon passe par l’effacement de sa fonction d’éducatrice au profit de son rôle d’épouse et de mère. La boucle est bouclée, l’école elle-même se met en scène et se rend désirable pour les parents, rassurés par un discours de l’école qui ne prétend pas éloigner d’eux leurs enfants, ni révolutionner les rôles dans un couple.
Conclusion
En conclusion de ce parcours, sans prétention exhaustive, mais représentatif du contenu des livres de lecture courante de forme romanesque, on constate qu’ils témoignent d’une priorité, celle de commencer par faire accepter le principe de l’école à des familles encore peu convaincues de son utilité, à plus forte raison quand il s’agit des filles. Les savoirs doivent être mis en scène dans des situations concrètes, pour en révéler le pragmatisme, et la forme romanesque est le moyen de cette mise en scène. Mais un moyen qui reste artificiel la plupart du temps, la chronologie des événements d’une vie tenant lieu de fil conducteur ténu pour passer d’un chapitre au suivant. Cependant, quand la dimension romanesque se fait plus présente, quand la fiction reprend ses droits, il arrive alors que le manuel laisse entendre aux jeunes filles un discours sur l’autonomie, la prise en charge de son destin sans l’aide d’un homme, et des possibilités de réussite au féminin quel que soit son milieu social d’origine. Des possibilités qu’il semble plus facile d’explorer lorsque l’héroïne doit survivre économiquement, alors que des jeunes filles de la bourgeoisie sont confrontées aux résistances de leur milieu. En quarante années, entre les manuels de Zulma Carraud et ceux des années 1890, la fiction romanesque continue de mettre au centre du destin des jeunes filles la notion de devoir. Qu’il s’agisse d’apprendre des compétences manuelles pratiques, ou des savoirs scolaires basiques, on apprend pour prendre une place active dans une société, qu’il s’agisse d’une communauté rurale, ou du tissu économique d’une grande ville. Cependant, l’idée que le travail, en apportant l’indépendance économique individuelle, donne des droits et peut être source de bonheur, autant, voire davantage, qu’une vie de couple harmonieuse, a progressé.