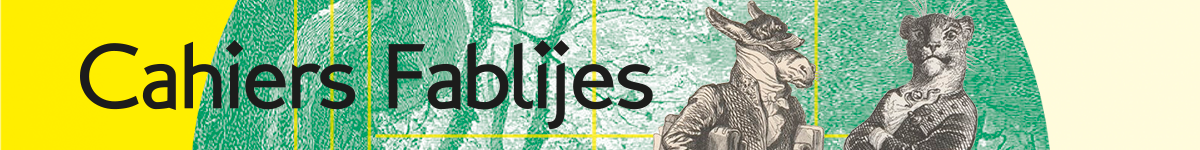Selon les recherches déjà établies, le théâtre scolaire poursuit des objectifs communs, tels que le maintien en société ou la diction, dans l’éducation des filles comme dans celle des garçons. Toutefois, il n’est pas considéré de la même manière : outil cathartique qui protégera les jeunes hommes contre les mauvaises passions dans les collèges, il fait courir aux demoiselles de Saint-Cyr les risques de la séduction et de l’orgueil. Qu’en est-il dans la seconde moitié du xviiie siècle lorsque se développe le théâtre d’éducation ? Les petits drames d’Arnaud Berquin – courtes pièces en prose dont les personnages enfantins évoluent dans des situations du quotidien pour dispenser des leçons morales – qui se répandent dans les familles via les deux périodiques que sont L’Ami des enfants (1782-1783) et L’Ami de l’adolescence (1784-1785) donnent matière à réflexion à plus d’un titre. Il s’agit en effet de pièces principalement mixtes que Berquin conçoit en partie pour l’éducation des fillettes de l’imprimeur Panckoucke, âgées d’environ huit à treize ans lorsque paraît L’Ami des enfants1. Le précepteur et journaliste intervient donc « dans le débat sur l’éducation à un moment où le problème de la formation des filles au rôle que la société leur destinait s’avérait pressant2 », remarque John Dunkley. L’intérêt de la démarche est d’ailleurs souligné par le prix d’utilité publique délivré par l’Académie française en 1784. Ce corpus enfin est significatif du fait de sa postérité au xixe siècle, Francis Marcoin relevant des rééditions jusqu’en 19353, et de sa diffusion importante en France comme à l’étranger, dont font état Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval4 et Denise Escarpit5.
La préface de L’Ami des enfants annonce que l’« ouvrage convient également aux deux sexes6 », laissant supposer une équivalence numérique entre personnages féminins et masculins. Or parmi les vingt-sept pièces de théâtre recensées, trois sont entièrement masculines7 et les vingt-quatre autres8, que nous analyserons au fil de l’article, présentent globalement moins de personnages féminins que de personnages masculins. Ces pièces mixtes nous permettront donc d’examiner les rôles féminins à la lumière des rôles masculins. Il s’agira d’interroger une éventuelle spécificité de l’éducation des filles dans les valeurs transmises, dans les rôles attribués et dans la mise en jeu. Nous organiserons le propos selon trois axes en dressant tout d’abord un état des lieux de cette disparité entre filles et garçons ; ce qui nous permettra dans un second temps d’examiner une certaine modélisation des rôles féminins pour réfléchir enfin aux rôles structurants de ces éducatrices en herbe.
Un théâtre genré : état des lieux autour de la disparité entre filles et garçons
D’après un rapide constat numérique, les personnages masculins dominent largement les pièces de Berquin. Pas plus de neuf drames affichent un nombre presque équivalent entre filles et garçons. La Sœur-Maman est le seul parmi les vingt-quatre drames mixtes recensés où les personnages féminins sont les plus nombreux. Du point de vue quantitatif, presque deux tiers des pièces accordent donc plus de place aux garçons qu’aux filles9.
Le fait est que ces pièces s’organisent en deux catégories : les unes corrigent un défaut ; les autres dispensent une morale à partir de situations souvent pathétiques. Or, les premières désignent les personnages masculins comme principales cibles, aboutissant généralement à leur transformation. Ce sont les jeunes garçons qui se montrent orgueilleux10, malhonnêtes11, sujets à la passion du jeu12 ou à la méchanceté13. Ils sont jugés « méchants » par la figure paternelle14 ou par les autres enfants15. Ils adoptent ainsi des attitudes dédaigneuses envers les domestiques ou les individus de condition inférieure à la leur16 et ne se privent pas de propos ou de gestes grossiers17. L’impolitesse évolue même vers la violence dans Colin-Maillard où Frédéric et Robert se battent sur scène18.
Certains garçons, présents dans les deux catégories de pièces, sont quant à eux simplement « imparfaits » – pour reprendre le terme de Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval19 – en l’occurrence moins vertueux, plus turbulents que les enfants modèles : ils sont spontanés ou espiègles, parfois considérés comme « crédule[s] » et « bouillant[s] »20. Ces garnements sont incarnés par Frédéric qui s’assoit sur la table dans Colin-Maillard21 ou encore par Constantin qui « traîn[e] de force Geneviève22 » dans Les Pères réconciliés par leurs enfants. Ils affichent donc des aspérités visibles sur scène de sorte que les gestes masculins ne correspondent pas toujours au modèle du bon comportement attendu en société. En somme, comme l’indique la préface, ils « s’abandonnent à la franchise des mouvements de leurs petites passions23 ». Berquin se sert de ce naturel plus agité des garçons dans une visée cathartique. Les filles, a contrario, semblent dotées d’un bon naturel inné ; ce que Denise Escarpit notait déjà dans le numéro de Nous voulons lire24 de décembre 1991.
Certes, frères et sœurs se chamaillent régulièrement sur scène, mais les portraits de filles demeurent très monolithiques. Aucune fillette ne se risque à des gestes déplacés. Leurs seuls défauts, qui surgissent à titre exceptionnel dans trois pièces, concernent la jalousie et la futilité. Dans Les Étrennes, Victorine se moque de son frère qui doit partager ses présents avec son ami pour respecter une parole donnée25. Elle en avertit son père moins par obéissance que par jalousie. Mais il s’agit d’un personnage secondaire qui ne paraît que deux fois sur scène sans faire l’objet d’une condamnation ni recevoir de leçon. La futilité, quant à elle, est incarnée par le personnage d’Hortense, une amie qui intervient dans une seule scène de La Sœur-Maman comme contre-modèle26, et par l’un des personnages principaux de L’Éducation à la mode, celui de Léonor qui est victime d’une éducation décalée et superficielle, le seul personnage principal féminin négatif de ce corpus théâtral. La leçon qui en résulte concerne alors la bonne éducation des filles.
Ce dernier exemple – un hapax dans le théâtre de Berquin – mérite l’analyse car il suppose un jeu féminin outré qui sans doute prête à rire, dénonçant d’emblée un tel comportement. L’action se déroule lors de la visite qu’un vieux tuteur, M. Verteuil, rend à ses deux pupilles, un frère et sa sœur, deux orphelins qui reçoivent chacun une éducation différente, Léonor chez sa tante, Didier en pension.
L’adolescente fait ainsi une entrée sur scène remarquée, accoutrée d’un costume inapproprié, parée de plumes, pour accueillir son tuteur27. Ce déguisement correspond d’ailleurs à son comportement théâtral : elle utilise des formules toutes faites et doit se mettre en scène pour donner à voir ou à entendre ses talents lors d’un concert ou d’une leçon de danse. Les spectateurs adultes, le tuteur et la tante, adoptent deux attitudes différentes, la réserve de M. Verteuil contrastant avec les applaudissements enthousiastes de Mme Beaumont28. Afin de conforter le message, cette pièce de construction binaire oppose les manières affectées de la sœur aux élans de son frère qui, ayant échappé aux méfaits d’une mauvaise éducation, se présente dans un costume simple et se précipite joyeusement vers son bienfaiteur29. Cette attitude naturelle est valorisée par le vieil homme qui soutient « les grâces de la pudeur et de la modestie30 » et condamne le fait de « s’attifer comme une poupée31 » ou de se donner en spectacle dans des danses de théâtre32.
Cette référence au théâtre nous interpelle car elle souligne la spécificité des petits drames de Berquin qui sont destinés à la famille et aux proches sans relever du spectacle. Ce sont des drames utiles aux enfants : « Nous jouons aussi de petits drames avec ma sœur et mes amis. Vous ne sauriez croire combien cela nous exerce à parler avec aisance, et à nous bien présenter33 », explique Albert dans Les Joueurs, en écho avec les propos de Berquin lui-même dans son avertissement34. En d’autres termes, le théâtre de Berquin ne vise pas à entretenir la futilité ou le goût de l’apparat pour « briller dans la société35 », ainsi que le soutient la tante de Léonor et de Didier dans L’Éducation à la mode. C’est d’ailleurs par le biais d’une saynète que Leonor se convertit par contagion36, émue de la vertu de son frère Didier qui veut lui offrir sa part d’héritage. Elle prend conscience des lacunes de son éducation au-dessus de sa condition37. Elle se rend compte qu’elle n’a que de « vaines perfections38 » qui entretiennent sa vanité au détriment de la générosité et de savoirs essentiels39 comme la géographie, l’histoire, le calcul, la lecture, l’écriture et les travaux domestiques. L’expérience théâtrale de la pièce de Berquin lui permet de retrouver son bon naturel grâce au miroir que lui tend son frère. Contrairement aux personnages masculins dits « méchants », Léonor n’est pas humiliée, elle se métamorphose face au modèle de vertu que représente Didier.
Par conséquent, L’Éducation à la mode offre une sorte de mode d’emploi de ces petites pièces qui sont destinées à une utilité immédiate pour les garçons comme pour les filles. Si la catharsis transforme parfois les garçons immatures, c’est davantage la force émotionnelle du tableau qui agit sur les filles, voire la force mimétique de certains rôles féminins.
Des rôles féminins modélisants
Dans le Discours pédagogique féminin au temps des Lumières, Sonia Cherrad souligne que les éducatrices du xviiie siècle visent un « apprentissage par l’expérience40 », une méthode qui est également adoptée par Berquin grâce aux jeux de rôles proposés dans la sphère familiale, la fiction entrant en interaction avec la réalité.
Filles et garçons partagent certes les mêmes jeux, dansent parfois sur scène ou jouent de la musique, deux activités mixtes qui sont d’ailleurs légitimées dans L’Éducation à la mode41. En revanche, certaines activités sont spécifiquement féminines comme les travaux d’aiguilles ou l’entretien de la maison. Dans les Pères réconciliés par leurs enfants, les fillettes évoquent avec nostalgie leurs travaux dans un bosquet42. Dans L’Épée, Henriette propose astucieusement à son petit frère « querelleur43 » de coudre un « beau nœud bleu et argent44 » pour orner cette épée qu’il arbore dangereusement, sans éveiller le moindre soupçon, tant la tâche paraît habituelle. Dans L’École des marâtres, les activités des filles consistent à « coudre, broder, faire du filet45 ». De même, « tricoter » fait partie des travaux spécifiquement féminins qu’un vieux soldat refuse avec mépris dans La Suite de l’école militaire46, une pièce dont la scène d’exposition présente d’ailleurs les jeunes filles occupées à « lire » ou à « broder » tandis que leurs frères s’emploient à « dessine[r]47 » ou à mimer une bataille. Dans L’Éducation à la mode, une bonne éducation est aussi transmise par la lecture quotidienne à haute voix des ouvrages de Louise d’Épinay ou de Stéphanie-Félicité de Genlis, lecture durant laquelle les autres fillettes « travaillent au linge du ménage et à leurs ajustements48 ». L’oisiveté et les occupations superficielles sont donc soigneusement évitées, des principes éducatifs qui correspondent sans surprise au tableau historique que brosse l’étude de Martine Sonnet49.
Par ailleurs, ces fillettes tiennent parfois le rôle de maîtresses de maison en l’absence des parents pour organiser les festivités50. Elles font preuve de sens pratique quand il s’agit de mettre en ordre une pièce51 ou de ranger des fraises sans les abîmer52. Il leur arrive de se trouver confrontées à des situations difficiles quand elles sont responsables des autres enfants53. Ce sont elles également qui sont chargées des soins à apporter aux petits blessés dans L’Incendie54 ou dans Les Pères réconciliés par leurs enfants55. Elles paraissent généralement plus empathiques que leurs frères, versent plus de larmes56 et se montrent plus spontanément charitables57 ; ce qui met en valeur les qualités maternelles.
Cette tendresse innée de la mère est particulièrement visible dans L’École des marâtres et son rôle est clairement défini dans un rapport de complémentarité au père : la mère « tendre veille sur les besoins de l’enfance58 » tandis que le père s’occupe de leur offrir une position sociale. C’est donc à la mère qu’appartiennent la bonne éducation des enfants et l’harmonie du foyer. Ses défaillances entraînent la démission du père dans La Sœur-Maman59 ; ce qui justifie le retour de la sœur aînée, Agathe, âgée de 20 ans, bien décidée à prendre en charge le foyer paternel après le départ de sa mère.
La figure maternelle peut ainsi s’incarner dans une belle-mère ou une sœur aînée, l’amour légitimant son autorité auprès des enfants. La bonne éducatrice n’hésite pas à se sacrifier pour ce rôle qui lui procure de la joie60. Même si les mères ou les éducatrices occupent moins l’espace scénique que la figure paternelle61, leur présence est diffuse, sans cesse rappelée par le bon comportement de leurs enfants62 ou par des paroles rapportées63. Les mères pauvres enfin, qui paraissent sur scène, se sacrifient pour leurs enfants et sont reconnues comme des héroïnes dûment récompensées dans La Petite Glaneuse64 ou dans Le Page65 car elles transmettent des valeurs essentielles telles que l’honnêteté, le respect des autres, etc. En revanche les mères de la bourgeoisie ou de la noblesse sont mises en garde contre le risque de faiblesse, le manque de sévérité ou d’objectivité dans La Vanité punie ou encore dans L’Éducation à la mode.
En cela, la figure maternelle n’échappe pas au stéréotype de la douceur extrême. Ce sont d’ailleurs les mères qui fondent en larmes66, s’évanouissent sur scène67 ou s’abandonnent au désespoir de la femme « échevelée68 » sous l’influence de l’esthétique du drame69. Au contraire, certains pères sont présentés comme colériques, ne reculant pas devant les vexations publiques lorsqu’il s’agit de punir l’enfant. Dans le corpus théâtral, une seule éducatrice est confrontée à la nécessité de sanctionner un enfant qui a commis un vol, dans Le Sortilège naturel, mais elle fait preuve de clémence pour éviter toute humiliation dans un pardon final70.
Outre cette dimension moralisatrice, l’écriture invite à une lecture au second degré dont témoignent quelques apartés complices que Berquin adresse aux éducatrices en jouant de ce qu’on appellerait aujourd’hui des stéréotypes de genres. Ainsi, au sujet des tâches ménagères, les soldats sont considérés comme les « meilleurs maris » qui soient dans Le Déserteur71. De même, les jeunes filles apprennent très tôt à développer leur sens de l’observation pour choisir un bon mari : « il faut bien qu’on étudie ceux qu’on voudrait servir72 », justifie la jeune Adélaïde dans Les Joueurs. Cette tonalité humoristique permet également de discréditer certains clichés qui sont affichés comme tels. « On reproche aux femmes de ne savoir pas se taire73 », rappelle ironiquement Séraphine à son frère qui éprouve le plus de difficultés à ne pas divulguer le secret dans La Levrette et la Bague, une inversion des rôles qui remet en question un défaut supposé de la gent féminine.
Ces propos à double entente établissent une connivence entre l’auteur et le prescripteur adulte, particulièrement perceptible dans les procédés de mise en abyme. Mme de Fleury, qui lit les contes de Berquin dans L’École des marâtres, obéit aux principes d’une bonne éducation74. Cette mise en scène ludique de Berquin par lui-même, comme l’« ami » des enfants, apparaît aussi dans Les Joueurs dans les propos de M. de Floris, personnage senti comme porte-parole de l’auteur : « Un père qui n’est pas le meilleur ami de ses enfants, ne remplit que la moitié de ses devoirs75 », explique-t-il à ses deux enfants avec lesquels il établit une relation de confiance. Au-delà du jeu d’auteur, ces interventions sont l’occasion de fournir quelques notices servant de mode d’emploi de ces journaux qui visent à éduquer par le plaisir et à instruire les enfants au sein de la famille dans l’harmonie et la bonne humeur ainsi que le développe Agathe dans une tirade de La Sœur-Maman76. Berquin s’adresse de la sorte régulièrement aux parents à qui « le livre […] enseigne à enseigner77 », selon la formule de Francis Marcoin.
Pour compléter le tableau, Berquin se situe explicitement dans le mouvement des éducatrices auxquelles il rend hommage, valorisant leur « esprit, aussi juste que pénétrant » et « leurs voix persuasives78 » dans le dialogue entre M. de Favières et ses enfants qui sert de suite au Retour de croisière, en accord avec la diffusion des Lumières. Il justifie un enjeu essentiel de ces drames qui confient aux filles un rôle premier dans la mission d’éducation.
Des éducatrices en herbe : des rôles structurants
Par conséquent, bien que les filles ne soient pas majoritaires, elles n’en occupent pas moins des rôles importants, ce qui prouve cet esprit « juste » et « pénétrant » qui est le leur.
En effet, excepté dans L’Éducation à la mode et dans Les Étrennes, elles font partie du groupe des enfants vertueux et indiquent d’emblée aux lecteurs et spectateurs la voie à suivre, que ce soit par leur empathie immédiate avec la victime ou bien par leur franc-parler. Henriette perçoit dès le premier regard l’honnêteté de la petite Émilie, accusée à tort79, dans La Petite Glaneuse. Dans Le Petit Joueur de violon ou Les Pères réconciliés par leurs enfants, la sœur démasque les mauvais penchants de son frère. De même, la fille de M. de Valcourt dresse le vrai portrait de son frère opposé à celui de son cousin80 dans Un bon cœur fait pardonner bien des étourderies. Dans Colin-Maillard, c’est la sœur qui, la première, s’oppose verbalement au méchant Robert pour protéger ses invités81. Dans L’École des marâtres, les jeunes sœurs révèlent à leur frère aîné, trompé par un domestique mécontent, toutes les qualités de leur belle-mère82.
Le fait est que la parole féminine n’est pas soumise au doute au même titre que celle de l’enfant pauvre et orphelin, une figure récurrente incarnant dans les pièces de théâtre les valeurs essentielles telles que la bonté et l’honnêteté. La voix des fillettes est suffisamment légitime pour qu’elles proclament des maximes relatives aux principes éducatifs défendus : « Il y a tant de plaisir à soulager ceux qui souffrent ! » s’écrie Séraphine dans La Levrette et la Bague83.
Cette sagacité permet aux personnages féminins de jouer parfois un rôle central dans des pièces majoritairement masculines dont ils deviennent un rouage. Les filles contribuent à dessiller le père et à dispenser la leçon. Dans L’Épée, Henriette soustrait habilement à son frère la dangereuse épée que vient de lui offrir son père84. Dans Les Joueurs, la sœur met tout en œuvre pour éviter à son frère trop naïf de perdre son argent dans un jeu de hasard en essayant de le raisonner85 puis en devenant la complice de son père lors de la mise à l’épreuve.
La seule pièce qui présente plus de rôles féminins que masculins, La Sœur-Maman, a trait à l’éducation des enfants et à la bonne tenue d’un foyer. Elle dépasse le simple jeu de rôle et s’apparente à une véritable leçon délivrée au père défaillant qui, grâce aux multiples saynètes organisées86 par sa fille aînée, se convertit aux joies du foyer où il accepte de reprendre ses responsabilités. Les rôles entre père et fille s’inversent. Or le père devient le « compagnon87 » de jeux de ses enfants qui le considèrent comme un « frère88 ». Il leur promet par ailleurs de leur dispenser des enseignements avec le « tendre intérêt de l’amitié89 ». Il apparaît donc en quelque sorte comme l’ami de ses enfants, un double de l’auteur sur scène ; ce qui pourrait bien signifier que Berquin, figure de l’éducateur, passe le relais, à travers le personnage de la jeune Agathe90, aux éducatrices et futures éducatrices qui choisissent de lire son périodique.
C’est pourquoi il n’est guère surprenant que certains personnages féminins remettent en question l’autorité de la société patriarcale. Se dresse ainsi le portrait de filles courageuses qui contestent un pouvoir ou des décisions injustes, allant jusqu’à désobéir à leur père.
Le Congé fait paraître deux personnages de fillettes accompagnés de leur frère qui dénoncent l’injustice des lois militaires que subit leur père91. Toute l’action repose sur la conversation entre les enfants et le prince qui se fait passer pour un soldat. Eugénie, la plus âgée, remet en cause la guerre92 et pleure en songeant au départ de son père, le soir même. Mais elle fait preuve de civilité et de bonnes manières. En revanche, Cécile, plus jeune, n’hésite pas à dire en toute franchise ce qu’elle pense : elle refuse que le prince s’invite au dîner d’adieu et elle rejette tout présent qui pourrait provenir du pillage93. Cette maturité en fait un personnage porte-parole qui invite chaque lecteur, en particulier adulte, à réfléchir en soulevant la question du devoir à rendre, de la loyauté à respecter envers son pays ou envers sa famille : « à quoi pense le roi […] ? Croit-il que nous n’avons pas besoin d’un père pour nous élever94 ? » Finalement, le congé militaire est octroyé au père qui n’avait pas osé le demander et qui en retire une leçon sur la « mauvaise honte de soldat95 ». Toute la réflexion porte donc sur l’équilibre entre le bien familial et l’honneur militaire, une question également soulevée dans La Suite de l’école militaire.
Dans Un bon cœur fait pardonner bien des étourderies, M. de Valcourt, furieux, s’apprête à bannir son neveu, Frédéric. Il est aveuglé par les fausses accusations de son fils. Or sa fille et sa nièce intercèdent en faveur de Frédéric qu’elles savent innocent. Elles n’hésitent pas à désobéir et à cacher Frédéric dont elles se font les avocates jusqu’à ce que le père s’aperçoive de son erreur. De même, dans Les Pères réconciliés par leurs enfants, c’est la fille de M. de Clermont, Adélaïde, qui répare une injustice commise par son père et lui en fait prendre conscience96. Elle s’oppose à son frère, Constantin, trop obéissant et hypocrite pour agir selon son cœur. Le père se transforme en assistant au spectacle de la bonté de la fillette97, qui veut compenser les méfaits du caractère « vindicatif »98 grâce à l’argent que sa mère lui a laissé en héritage. La leçon porte alors sur le droit à la désobéissance, quand désobéir revient à faire le bien conformément à la volonté divine : « lorsque les ordres de leurs parents sont injustes, c’est à leur devoir, c’est à Dieu qu’ils doivent d’abord obéir99 », explique M. de Clermont à son fils. En somme, la fille est ici garante du salut moral de son père. Comme dans La Sœur-Maman, ce personnage de la fille modèle, donne une leçon d’éducation à son propre père qui reconnaît sa sagesse et lui accorde une confiance absolue, y compris dans la gestion autonome des biens matériels100. Par conséquent, ce rôle que les jeunes filles jouent sur le théâtre reflète celui qu’elles devront jouer dans la société dont elles assureront les fondations.
Conclusion
Ces petits drames mixtes reposent donc sur une disparité entre rôles féminins et masculins, sur des stéréotypes de genre dont Berquin n’est pas dupe comme il le souligne dans des apartés complices avec ses lectrices, en particulier. Mais il tend surtout à valoriser le rôle fondamental que peuvent jouer les futures éducatrices, grâce à leurs qualités de jugement, dans une société en pleine mutation.
Les pièces enfantines de Berquin dépassent le simple jeu de rôles pour permettre, aux enfants comme aux parents, de prendre la distance nécessaire « à réfléchir sur [soi]101 » tout en traversant des émotions fortes pour aider à se transformer dans la lignée des théories de Diderot102. La mixité offre aussi l’occasion aux filles de jouer avec les garçons qui seront leurs partenaires selon une complémentarité des rôles visant à transmettre les mêmes valeurs de la « morale universelle103 » que sont la vertu, le sens du devoir, la justice, l’honnêteté, la solidarité mais aussi le plaisir de vivre ensemble. Il ne s’agit pas de construire une société fondée sur l’égalité mais sur le respect de chacun, dans une forme de communion naturelle, pour garantir les bonheurs simples de la vie familiale considérée comme microcosme de la société.