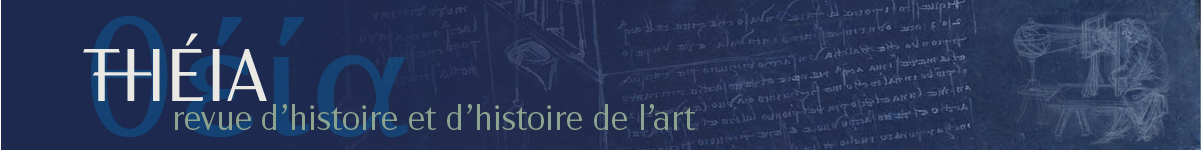Pour son premier numéro, et dans une démarche autoréflexive, la revue Théia souhaite interroger la pratique même de l’édition numérique. Depuis plusieurs années, les éditions Chrétiens & Sociétés portées par l’axe Religions & Croyances du LARHRA (Laboratoire de Recherches Historiques Rhône-Alpes, UMR 5190) se sont lancées dans la publication de livres en ligne via les outils de la Science Ouverte, ainsi que dans l’édition numérique de sources visant à valoriser le document imprimé en le traitant comme une base de données insérée à un réseau d’informations. L’Axe de Recherche en Histoire Numérique, quant à lui, encourage l’encodage sémantique des données notamment par le développement de l’environnement de recherche Geovistory qui permet de construire des bases de données tout en les reliant à l’édition numérique de la source textuelle.
Sous cet angle, l’édition numérique invite à réfléchir sur les potentialités nouvelles offertes par un tel outil au traitement de l’information historique. La mobilisation des connaissances permise par le croisement d’une source textuelle ou iconographique et des bases de données externes offre aux chercheuses et chercheurs de penser une méthodologie de dépouillement et de mise à disposition des données qui va bien au-delà de la seule lecture du document et que l’outil numérique permet de valoriser par la masse des informations qu’il peut traiter. Ces possibilités nous rappellent que base de données et sources sont complémentaires pour le travail de recherche en Histoire et en Histoire de l’Art.
Une Journée d’Études s’est tenue sur ce sujet le 22 juin 2023, et nous souhaitons publier les communications faites pour l’occasion. Les articles qui vont suivre sont le fruit d’une mise en relation des historiennes et des historiens travaillant sur l’édition numérique pour confronter leurs projets, leurs questionnements, leurs réussites et leurs échecs. Alors que de tels projets voient le jour maintenant depuis de nombreuses années, ces textes apparaissent comme des jalons, entre bilan et prospective. Ils mettent en regard plusieurs entreprises éditoriales pour en mesurer les proximités et les divergences. Plusieurs de ces articles sont des retours d’expérience sur des projets inachevés mais qui sont autant de réflexions sur la manière de s’emparer des humanités numériques dans l’édition de texte. Les auteurs ont accepté un cahier des charges thématique de manière à pouvoir faire émerger des éléments de comparaison. Les articles qui vont suivre répondront tous aux quatre interrogations suivantes :
Le choix de la source
Qu’est-ce qui préside au choix de telle ou telle source pour en faire une édition numérique ? Y a-t-il une singularité à ce type d’édition ou les choix se font-ils selon les mêmes critères que pour une édition papier ? Les contraintes législatives et financières jouent-elle un rôle particulier ?
Le choix technique
Il s’agira ici de questionner le choix fait par les historiens de privilégier telle ou telle solution technique par rapport au corpus de(s) source(s) sélectionné pour le projet d’édition. Quels sont les critères de décision concernant l’utilisation ou non d’une reconnaissance de texte (HTR/OCR, Transkribus, eScriptorium, Tesseract…), le recours à la XML/TEI, LaTeX ou d’autres langages, ou la reconnaissance d’entités nommées ? Comment les données tirées de la source interagissent-elles avec la source elle-même ?
Le rendu final
Cet aspect prolonge les deux précédents et permet de mieux cerner la singularité de l’édition numérique. Les outils techniques permettent des possibilités de visualisation du document et des informations qui lui sont associées. L’historien et l’historien de l’art font ici alors un choix dans le rendu de leur travail : qu’est-ce qui apparaît – ou non – à l’écran ? Comment révéler les informations complémentaires qui viennent éclairer le document grâce à sa mise en réseau avec d’autres bases ? Comment rendre à l’écran des informations thématiques que l’on peut tirer d’une analyse globale du document ? Dans le cas des images, comment intégrer les métadonnées et les choisir afin qu’elles soient interopérables ? Comment lier l’image et son commentaire, ainsi que l’image et son contexte, et permettre de dépasser le simple stade de l’illustration ?
Ce choix a-t-il influencé le choix de la méthodologie ? Cet aspect est le plus complexe, mais aussi celui qui est le plus en lien avec les résultats de l’analyse historique. Il s’agit ici de se questionner sur la visualisation d’une ou plusieurs données historiques contenues dans le document.
Le devenir de ce travail d’édition
Que faire de ce travail une fois qu’il est achevé ? La question posée ici sera celle de la diffusion du savoir historique, entre outil scientifique et outil de valorisation du savoir historique adressé à un plus large public. Au regard de ces différentes questions, les expériences d’éditions numériques menées dans des cadres différents proposeraient une base d’expériences multiples promettant un dialogue fructueux.