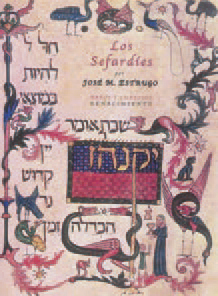Le CADIST de langues, littératures et civilisations ibériques et ibéro-américaines, créé en 1991, est rattaché aux SCD des universités Toulouse‑II et Bordeaux‑III. Le partage entre les deux sites est réalisé par aires géographiques : la péninsule ibérique à Toulouse, l’Amérique latine à Bordeaux. Le CADIST de Toulouse s’inscrit dans une université héritière d’une longue tradition ibérique d’enseignement et de recherche qui remonte à 1886 avec la création de la 1re chaire française d’espagnol et à 1943 pour l’enseignement du portugais. Un potentiel important de quelque 500 chercheurs (littéraires, historiens, sociologues, anthropologues, géographes, lexicologues, philosophes) travaillent sur l’aire ibérique au sein de deux équipes de recherche et d’une école doctorale. Par leur nombre et leur notoriété, les publications témoignent de la vitalité et du foisonnement de la recherche du domaine. Le CADIST est devenu, en 1995, pôle associé de la Bibliothèque nationale de France. La politique documentaire mise en œuvre offre aux chercheurs les moyens de comprendre la production intellectuelle ibérique telle qu’elle s’est enrichie au fil des temps. L’objectif est de rassembler en priorité les grands corpus de sources, les collections savantes, les instruments bibliographiques spécialisés, les colloques, les mélanges, de maintenir les abonnements à un haut niveau, avec une attention particulière à la documentation électronique. Le plan d’acquisition est validé au cours de deux réunions annuelles réunissant enseignants et chercheurs. Les collections couvrent les domaines suivants :
- langues et littératures ibériques : castillan, basque, catalan, galicien et portugais ;
- civilisations ibériques : art, histoire, géographie, ethnologie, philosophie…
Elles rassemblent 33 000 ouvrages, 872 abonnements, 56 périodiques électroniques, 67 bases de données sur cédéroms ou en ligne, 6 500 microfiches, deux importantes collections de sources de littérature espagnole du siècle d’or sur microfilms et un fonds patrimonial constitué par le don de quelque 2 500 ouvrages du couvent des Capucins de Toulouse, parmi lesquels 550 livres anciens de littérature religieuse ibérique d’Ancien Régime. Confronté à un nouvel environnement marqué par l’explosion des ressources électroniques, le CADIST développe de nouvelles missions : il assure une veille documentaire renforcée dans sa discipline. Le projet de service présenté dans le cadre du contrat d’établissement 2003/2006 prend en compte ces nouvelles missions. Il propose l’amélioration des services offerts aux chercheurs à travers quatre axes : l’organisation et le signalement des collections, leur valorisation, le développement de l’offre électronique et la construction d’outils d’aide aux chercheurs. Parmi les actions réalisées, il faut noter la numérisation des catalogues manuels d’ouvrages publiés après 1970 des trois bibliothèques complémentaires, la valorisation du fonds patrimonial avec la numérisation de 18 livres anciens du fonds du couvent des Capucins, la constitution d’un corpus de 67 cédéroms bibliographiques et de texte intégral, l’accès à 56 périodiques électroniques, enfin, la construction d’une base de données de 200 signets rigoureusement sélectionnés et commentés. Dès la rentrée 2004, les fonds du CADIST vont rejoindre l’espace public qui leur est dévolu en rez‑de‑jardin, au 2e étage de la nouvelle bibliothèque centrale, au même niveau que les services de prêt entre bibliothèques et de recherches documentaires. Cet espace stratégique équipé de postes de travail et offrant en libre accès d’importantes collections spécialisées, valorisera ce pôle d’excellence de l’université.
Los Sefardíes, José M. Estrugo Editorial Renacimiento, Sevilla 2002.
Collection Biblioteca de Raros y Curiosos, nº 2, 172 pages, 15 X 22 cm
L’entrée dans le Sudoc
Les universités de Toulouse ont fait partie de la 1re vague de déploiement du Système universitaire de documentation. Dès le 2 mai 2001, le basculement avait lieu. Pour le SCD de Toulouse-II, étaient concernées la bibliothèque universitaire centrale et les quatre bibliothèques d’UFR informatisées, dont la bibliothèque du département d’études hispaniques et hispano‑américaines. L’opération a nécessité un fort investissement de chacun. Elle s’est globalement bien déroulée. En raison de la diversité des sources qui à l’origine ont constitué le Sudoc, il faut cependant noter un important travail de corrections et de liens à créer sur les notices. Les statistiques donnent un très bon taux de recouvrement (85 %) pour la production éditoriale française ainsi que pour la production éditoriale étrangère du domaine anglo-américain récupérable dans les bases externes ; en revanche, pour les ouvrages du CADIST, ce taux tombe à 10 %. En effet, ces ouvrages très spécialisés à 90 % en langues espagnole et portugaise exigent un important travail de créations de notices bibliographiques, d’autorité, de collections et de propositions RAMEAU. Nous rêvons d’une baguette magique qui nous permettrait de dériver dans le Sudoc, les notices de REBIUN, le catalogue collectif des BU espagnoles et celles de Porbase, le catalogue collectif des bibliothèques portugaises ! Il n’en reste pas moins que, tant pour les usagers que pour les bibliothécaires, le Système universitaire de documentation est un outil unique d’identification et de localisation de tous les documents détenus par les bibliothèques de l’enseignement supérieur.