La mission, les activités et l’organisation de l’INRP ont été précisées (BO n° 4) en janvier 2000. Sous la tutelle des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur l’ensemble du territoire national, notamment avec les instituts universitaires de formation des maîtres – IUFM –, en liaison avec le Centre national de documentation pédagogique – CNDP –, l’INRP assure, entre autres, la conservation et le développement de ses collections muséographiques et bibliographiques ; il les met à la disposition du public, en particulier par l’intermédiaire du Musée national de l’éducation, de la bibliothèque et de ses centres documentaires.
La bibliothèque et les centres documentaires assument les missions de collecte, traitement, conservation et mise à disposition des outils d’appui à la recherche que représentent les fonds documentaires de l’INRP. La gestion et l’accroissement des actuels 580 000 volumes et 5 000 titres de périodiques, dont 800 vivants, sont assurés par moins de 30 titulaires et une dizaine de contractuels. Au‑delà de sa vocation à servir les équipes de chercheurs implantées ou associées à l’INRP, l’ensemble documentaire dessert aussi l’ensemble du public national et international des chercheurs en éducation et les acteurs du monde éducatif, tutelle comprise. La bibliothèque, depuis une dizaine d’années, s’est restructurée autour de ses spécialisations et s’est impliquée dans les réseaux documentaires nationaux : déjà dépositaire du dépôt légal relatif à l’éducation et à la formation depuis 1926, la bibliothèque est plus récemment devenue centre d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique, CADIST, en sciences de l’éducation en 1991 ; elle participe au prêt entre bibliothèques et avait intégré le réseau du catalogue collectif national des publications en série en 1991. L’INRP adhère au réseau BN-Opale depuis 1994 et est pôle associé à la Bibliothèque nationale de France depuis 1996.
Une nouvelle étape a été amorcée en 1997 avec la mise en place de l’informatisation intégrée au sein des services documentaires, via le système informatisé de gestion de bibliothèque Loris.
Parallèlement, l’offre bibliographique s’est enrichie de 20 cédéroms, et plus d’une cinquantaine de périodiques spécialisés sont aujourd’hui consultables en ligne sur l’intranet de l’établissement. Sur de nombreux points, il s’est agi d’un saut direct du XIXe au XXIe siècle, sans l’étape des modernisations classiques de bibliothèques au XXe siècle. L’INRP1 est ainsi passé directement de la fiche cartonnée au catalogage partagé en réseau…
La jeune institutrice : historiette morale et récréative dédiée aux jeunes personnes, par Mistriss HOFLAND, traduite de l’anglais, Paris, 1827.
Le local et le réseau
L’articulation entre le travail sur nos fonds spécialisés et leur mise à disposition au sein des réseaux se trouve au cœur de nos préoccupations et de nos collaborations. Organisation interne, formation des personnels, aménagement du circuit des documents, acquisition et traitement des collections, informatique locale, mise en valeur des fonds, services aux publics : la majorité des tâches quotidiennes sont partie prenante, par un biais ou par un autre, de la réflexion sur les liens entre le local et le réseau.
À l’heure du basculement dans le système universitaire de documentation des bibliothèques cataloguant dans BN‑Opale, une occasion d’envergure nous est par exemple donnée de revisiter l’ensemble des questions concernant le signalement commun et à distance de nos fonds.
Élargir l’accès commun aux références bibliographiques, et par-là aux documents eux-mêmes, nous paraît indissociable de l’effort parallèle fourni pour étoffer notre propre catalogue local en ligne. Le catalogue commun des ressources documentaires de l’INRP propose actuellement d’accéder aux 44 000 notices couvrant les documents en magasins traités depuis 1995, tous les documents en libre accès répartis dans trois salles et environ 70 % des titres de périodiques. Ce catalogue s’accroît quotidiennement au-delà des nouvelles acquisitions, puisque tous les ouvrages demandés en communication y sont aussi saisis de manière brève, en attendant leurs signalements plus développés issus des conversions rétrospectives.
Élargir l’offre de signalement
La bibliothèque et les centres documentaires de l’INRP ont en effet entrepris leur première conversion rétrospective en 1999 dans le cadre d’un marché diligenté par la sous-direction des bibliothèques et de la documentation. Les notices, dérivées de la BNF ou créées par le prestataire sont ainsi versées directement dans le catalogue local ainsi que dans le système universitaire de documentation.
Ce chantier, mené sans fermeture des locaux, a concerné 40 000 notices. Nous avons privilégié les tranches chronologiques permettant d’opérer la jonction avec les notices déjà informatisées, afin d’assurer une continuité de la couverture de notre OPAC. C’est ainsi qu’il donnera bientôt accès aux notices traitées depuis 1970 pour la bibliothèque et depuis 1960 pour un des centres documentaires.
Les résumés succincts des années 70 et 80 propres à la bibliothèque sont saisis par nos soins dans une zone de donnée locale des notices rétroconverties, afin de conserver les indications supplémentaires qu’ils apportent généralement sur la nature du document, sa structure ou son dépouillement par chapitre. Les suites de cette rétroconversion nous amènent aussi à approfondir notre travail de corrélation entre les différents systèmes d’indexation cohabitant dans l’ensemble documentaire. En effet, selon leurs strates chronologiques et géographiques, les fichiers sur papier utilisaient des indexations diverses, spécialisées ou plus généralistes, hiérarchisées ou plates, spécifiques à l’INRP ou non. Certains de ces systèmes d’indexation sont représentatifs de la construction des sciences de l’éducation et recèlent une portée historique non négligeable.
Ce travail de longue haleine a été initié lors de l’adoption du langage RAMEAU à la bibliothèque et se poursuit entre d’autres systèmes d’indexation au gré des évolutions informatiques des accès matières.
La réflexion sur les passerelles que nous pouvons bâtir entre indexations utilisées hier et aujourd’hui à l’INRP, grâce par exemple à un système local de renvois, est sous-tendue par un double objectif : d’une part, conserver la mémoire linguistique structurelle d’un établissement, pour témoigner de l’état d’avancement d’un champ spécialisé de recherche à une époque donnée ; d’autre part, faciliter la continuité des recherches documentaires de nos lecteurs, en leur proposant des points de rebond sur les accès d’indexation.
Diversifier les accès : décrire, indexer, résumer…
Dans le même esprit, une de nos orientations actuelles repose sur la multiplicité et la complémentarité des accès aux notices, sans pour autant altérer leur sens ni nuire à leur cohérence. En tant qu’ensemble documentaire d’un établissement de recherche, nous souhaitons ainsi mettre l’accent sur le lien entre documentation, recherche et valorisation de la recherche. C’est dans cet objectif que nous valorisons les notices que nous produisons ou que nous intégrons dans le catalogue de l’INRP, via notamment l’adjonction d’une indexation spécialisée en éducation et d’un résumé.
Afin de protéger ces informations lors des imports de notices provenant des réseaux, nous avons paramétré des zones de données locales spécifiques dans le bloc 9 du format UNI-MARC, en veillant à ne pas utiliser celles déjà destinées à d’autres desseins par nos partenaires. Il ne s’agit bien sûr pas d’enrichir toutes les notices des documents que nous traitons, mais d’opérer un choix à partir de critères relevant notamment de « l’actualité » du document, de sa typologie et de sa nature. Nous conservons par exemple un nombre important de documents scolaires et parascolaires : ces documents primaires nourriront une part de la recherche de demain, comme ceux d’hier nourrissent en partie celle d’aujourd’hui. Les documents primaires ne jouent donc pas dans nos fonds le même rôle que les documents secondaires, eux-mêmes produits d’une recherche.
La plupart des notices valorisées sont exportées vers la banque de données Émile 1 gérée par la bibliothèque et certaines d’entre elles s’intègrent sous forme abrégée dans la partie bibliographique de la revue Perspectives documentaires en éducation, éditée par l’INRP. Mais quelle que soit leur destination finale, toutes les valorisations de notices effectuées par l’équipe de l’ensemble documentaire depuis 1998 sont saisies dans un logiciel unique, le SIGB Loris, et sont consultables sur le web du catalogue commun des ressources documentaires de l’INRP.
Lorsque nous valorisons des notices, nous utilisons en complément de RAMEAU l’indexation hiérarchisée du Thesaurus européen de l’éducation (TEE) : thesaurus multilingue spécialisé, le TEE constitue le langage commun à toutes les bases de données de l’Institut.
Les résumés produits sont de type informatif. Des recommandations relatives notamment à leur taille et à leur facture sont émises pour veiller à une cohérence d’ensemble. Il est ainsi préconisé d’employer des noms propres et une terminologie du langage naturel qui n’apparaisse nulle part ailleurs dans la notice bibliographique, afin de pouvoir aussi utiliser ces termes comme critères d’interrogation. Cela aide à élargir le spectre de la recherche documentaire dans le catalogue informatisé et peut en partie pallier certaines limites inhérentes à l’indexation.
Dans notre esprit, le signalement des fonds documentaires dans les réseaux constitue la première des mises en valeur des collections de l’établissement. L’objectif des enrichissements de notices vise ensuite à compléter en l’affinant la description intellectuelle du document, pour in fine proposer des outils supplémentaires grâce auxquels le public décide de consulter, d’emprunter ou de demander l’envoi du document.
Il s’agit par conséquent de développer en aval les services aux publics sur place et à distance, en renforçant notamment le prêt entre bibliothèques et en mettant en œuvre des services personnalisés, telle que par exemple la diffusion sélective d’information.
Les questions liées au projet de délocalisation totale des sites parisiens nous plongent au cœur des questions d’avenir.
Nous sommes conscients que l’équilibre de nos missions repose sur la résolution d’équations auxquelles est confrontée la majorité des bibliothèques et services documentaires. Citons pour conclure celles d’entre elles qui nous tiennent particulièrement à cœur actuellement : comment penser conjointement la globalité de notre travail, qui se développe à l’échelle de décennies, et la réalité quotidienne de tâches et de services qui s’évaluent au jour le jour ? Comment résoudre l’équation des ambitions et des moyens sans hypothéquer les notions d’avenir et de qualité ?
Jeu du coquelicot - Gravure dans « Les jeux champêtres des enfans » par Mme la COMTESSE DE GENLIS, Paris, [vers 1825] - INRP

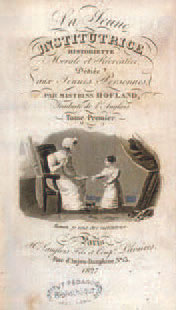
![Jeu du coquelicot - Gravure dans « Les jeux champêtres des enfans » par Mme la COMTESSE DE GENLIS, Paris, [vers 1825] - INRP](docannexe/image/4143/img-2.jpg)