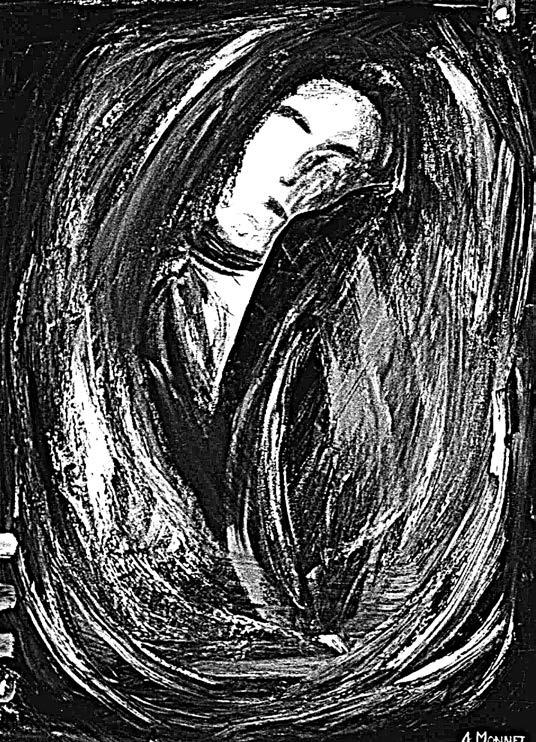Les chiffres rapportés ici sont tirés d’une enquête commanditée et financée principalement par le Secrétariat d’État aux droits des femmes, enquête en chantier depuis plus de trois ans pour permettre de fournir des statistiques enfin fiables sur la question, en France, des violences envers les femmes. En effet, jusqu’à présent, les chiffres disponibles portaient sur les seules violences déclarées à la suite d’une démarche, soit de plainte auprès des institutions, soit de demande d’aide envers les associations militantes, que ce soit dans le domaine des violences sexuelles et conjugales ou dans celui du travail. La production de données valides, obtenues sur un échantillon représentatif en population générale, devrait permettre de prendre la mesure réelle des violences subies et permettre un meilleur traitement social de la question. Car la question intéresse, et les chiffres noirs régulièrement produits par les médias n’aident d’ailleurs pas à un éclaircissement de la question : ainsi le chiffre de « Deux millions de femmes battues en France », chiffre fantaisiste mais toujours repris, a en tout cas eu le mérite de faire émerger le problème.
La violence est, quels qu’en soient les manifestations et les protagonistes, une atteinte à l’intégrité physique et psychique de la personne. Si cette définition, qui se réfère à la notion des droits de la personne humaine, semble opérationnelle aux plans juridique et politique, sa quantification s’avère complexe. Ce phénomène, essentiellement vécu au quotidien, reste la plupart du temps, de l’ordre du privé, circonscrit à une affaire personnelle. L’approche des violences envers les femmes s’inscrit dans des relations interindividuelles fondées sur un rapport de force ou de domination, souvent occultées voire déniées par les victimes elles-mêmes. Or pour compter les violences, il faut les dire et pour les dire il faut les nommer : deux impératifs auxquels doit répondre la quantification des violences faites aux femmes et qui nécessitent une conceptualisation et une méthodologie appropriées (cf. encadré).
Afin de cerner le phénomène dans ses aspects multiformes, la recherche Enveff prend en compte l’ensemble des violences envers les femmes, quel qu’en soit l’auteur (et son sexe), et quel que soit le cadre de vie où elles s’exercent. Les situations de violences y sont repérées par des actions, actes, faits, gestes, paroles dont l’assemblage permet de construire des indicateurs diversifiés. Si les agressions physiques et sexuelles peuvent être considérées, dès leur première occurrence, comme une atteinte à l’intégrité de la personne, d’autres actes comme les injures ou le dénigrement, les critiques et autres pressions psychologiques sont perçus comme violents dans la répétition. C’est pourquoi plusieurs indicateurs combinant le nombre, la nature des faits cités et leur fréquence permettent d’obtenir une mesure graduée des violences. Ainsi, dans la vie de couple ou au travail, le harcèlement, constitué d’actes insidieux, de paroles humiliantes, répétés, cachés, mesure le degré maximal de contrainte psychologique.
Les femmes ont été interrogées dans leurs différents cadres de vie : espace public, travail, couple, relations avec la famille et les proches. Le questionnement commun, et cependant adapté à chaque cadre, implique la reconnaissance de formes et de significations différentes des atteintes aux personnes selon l’organisation des rapports sociaux au sein des sphères considérées. Dans chacune des sphères, des indicateurs aussi proches que possible, portant sur l’année écoulée, ont été construits pour toutes les violences psychologiques, verbales, physiques ou sexuelles.
Les chiffres à l’état… « brut »
Ces premiers chiffres ont été présentés à la presse le 6 décembre 2000 et publiés officiellement dans le numéro de janvier 2001 de Population et sociétés (INED). Je reprends là les principaux résultats pour ouvrir sur la réflexion méthodologique qui est actuellement la nôtre, puisque nous sommes à mi-parcours d’un travail qui ne sera terminé qu’en décembre 2001. En premier lieu, ce qui a été diffusé par les médias dans une formule choc : une femme sur dix est victime de violences conjugales.
L’Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff)
La collecte des données a été menée de mars à juillet 2000, auprès d’un échantillon représentatif de 6 970 femmes âgées de 20 à 59 ans et résidant, hors institution, en métropole. Elle a été effectuée par téléphone, selon la méthode cati (collecte assistée par téléphone et informatique). Les procédures d’appel des enquêtées et la gestion des fichiers de numéros de téléphone assuraient le respect de l’anonymat total, la confidentialité et la sécurité des personnes interrogées. En raison de la sensibilité du sujet et afin de prévenir d’éventuels risques pour les répondantes, le protocole de collecte prévoyait de nombreuses précautions ; un dispositif de relais associatif a été mis en place.
La passation du questionnaire durait en moyenne 45 minutes. Afin d’établir une relation de confiance avec l’interviewée, les questions sur les actes de violence ne viennent qu’à l’issue d’un module recueillant des données contextuelles (caractéristiques familiales, économiques, sociales, résidentielles…), des éléments biographiques et d’état de santé. Sa structure est conçue pour faire émerger progressivement les situations de violence et autoriser la remémoration d’événements parfois très anciens. La violence n’est jamais nommée, seuls des faits – non qualifiés de violents – sont évoqués. Le même questionnement se décline dans les différents cadres de vie : espaces publics, sphère professionnelle ou étudiante, consultations, couple, ex-conjoint, famille ou proches. Chaque module recueille, pour les douze derniers mois, l’occurrence de faits décrits de façon similaire selon la sphère. L’investigation porte également sur les circonstances, réactions et recours des femmes auprès de l’entourage ou des institutions, ceci pour le fait le plus grave selon l’avis de l’enquêtée. La dernière partie du questionnaire mesure les agressions physiques endurées depuis l’âge de 18 ans et les agressions sexuelles subies au cours de la vie. L’âge, les auteurs, les circonstances, et les recours judiciaires sont enregistrés. En cas de répétition, elles sont prises en compte pour le premier et le dernier événement.
Violences conjugales
Terminologie usuelle des organismes internationaux, la violence domestique cantonne l’univers féminin au huis clos du foyer ; l’approche de la violence conjugale élargit le concept à la relation de couple, avec ou sans cohabitation. Les indicateurs de violences conjugales proposés dans le premier tableau sont construits à partir de 21 questions regroupées en quatre thèmes : les agressions et menaces verbales incluent les insultes, les menaces, et le chantage affectif (s’en prendre aux enfants, se suicider) ; les pressions et atteintes psychologiques comprennent les actions de contrôle, d’autorité, les attitudes de dénigrement, de mépris ; les agressions physiques, en plus des coups et autres brutalités, tentatives de meurtre, prennent en compte la séquestration ou la mise à la porte ; les agressions sexuelles se limitent ici aux gestes sexuels imposés et au viol. La notion de rapport forcé, fondée sur le non-consentement, utilisée dans les autres sphères, apparaît ici moins appropriée, aussi la formulation de cette question insiste-t-elle sur l’usage de la force (cf. Tableau 1).
L’ensemble des résultats concerne toutes les femmes qui ont eu une relation de couple dans les douze derniers mois. Parmi elles, les femmes qui ne sont plus avec leur partenaire au moment de l’enquête, en particulier les divorcées avec ou sans enfants, ont déclaré environ 4 fois plus de violences que les autres, notamment pour les degrés d’atteinte maximale ; cependant les pressions psychologiques occasionnelles sont très nombreuses, même parmi les personnes toujours en couple. Dans l’ensemble, les femmes les plus jeunes (20-24 ans) sont environ deux fois plus touchées que leurs aînées. Dans une moindre proportion, le fait d’être au chômage semble un facteur aggravant.
Tableau 1 : Proportion (en %) de femmes ayant subi des violences conjugales au cours des 12 derniers mois selon la situation de couple au moment de l’enquête
| Type de violence conjugale | Au moment de l’enquête | Total | |
| En couple | Plus en couple | ||
| N = 5793 | N = 115 | N = 5908 | |
| Agressions et menaces verbales | 4,7 | 17,5 | 5,0 |
| - dont insultes | 4,0 | 14,8 | 4,3 |
| - insultes répétées | 1,6 | 8,1 | 1,8 |
| - dont chantage affectif | 1,7 | 8,2 | 1,8 |
| Pressions et atteintes psychologiques | 36,5 | 59,4 | 37,0 |
| - dont atteintes et pressions fréquentes | 23,5 | 52,4 | 24,2 |
| -dont harcèlement moral | 7,3 | 27,3 | 7,7 |
| Agressions physiques | 2,3 | 10,2 | 2,5 |
| -dont agressions répétées | 1,3 | 6,9 | 1,4 |
| Viol et autres pratiques sexuelles imposées | 0,8 | 1,8 | 0,9 |
| Indice global de violences conjugales | 9,5 | 30,7 | 10,0 |
Violences au travail
L’approche des violences au travail décline l’usage de la force sous ses diverses manifestations, physique, verbale, psychologique et sexuelle. L’indicateur de violence physique inclut les coups et blessures et menaces avec une arme mais également destructions du travail et de l’outil de travail. Les injures ne sont pas les seules formes d’humiliations repérables dans le cadre de l’activité professionnelle comme le souligne l’accent aujourd’hui mis sur le harcèlement moral. L’indicateur de pressions psychologiques construit regroupe trois questions : « imposer des horaires, des tâches, des services ; critiques répétées et injustes ; être mise à l’écart ». Cependant les critiques occasionnelles n’étant pas de même nature que les critiques chroniques un deuxième indicateur d’échelle de contrainte prend en compte la multiplicité des faits et leur intensité. Enfin, en matière de contraintes sexuelles, le Code pénal et le Code du travail ont adjoint depuis 1992 des dispositions relatives au harcèlement sexuel. Nous avons opté pour une mesure du phénomène plus large que les termes de la loi (en conformité avec notre approche globale des atteintes sexuelles) : le fait « d’obliger à voir des images pornographiques » est inclus dans l’interrogation, et, l’ensemble des auteurs d’agressions sont recensés – supérieur hiérarchique, collègues, subordonnés, clients et usagers, autres personnes – indépendamment de la seule notion d’autorité introduite par la loi.
Pour l’ensemble des faits étudiés, les femmes mariées actives sont les moins concernées, en revanche le phénomène atteint davantage les femmes les plus jeunes.
Moins de 3 % des femmes ont été confrontées aux violences physiques dans le cadre du travail – quel que soit l’auteur. Dans la majorité des cas, la violence physique s’est traduite par la destruction du travail ou des outils de travail. Près de 17 % des femmes ont été objet de brimades ou mises à l’écart dans leur travail au moins une fois dans l’année écoulée. Deux phénomènes doivent être distingués : un phénomène touchant l’ensemble des salariés constitutif de formes de gestion du personnel dans un environnement fortement concurrentiel, d’une part, et d’autre part une pression psychologique à forte connotation sexuelle – connotation que souligne les liaisons entre l’intensité des pressions psychologiques et le harcèlement d’ordre sexuel. Les femmes les plus jeunes subissent davantage ces pressions mais les femmes les plus diplômées les déclarent plus souvent et comme des incidents répétés. Cependant les situations s’inversent selon l’âge, pour les femmes les plus jeunes ce sont les femmes sans diplôme qui connaissent le plus souvent les situations de brimades et mises à l’écart. À l’inverse parmi les femmes les plus âgées (plus de 45 ans), ce sont les femmes les plus diplômées qui sont plus souvent mises à l’écart.
En ce qui concerne les injures et les violences verbales subies au travail, on constate globalement les mêmes situations que pour les contraintes psychologiques. Les femmes les plus jeunes sont le plus souvent injuriées dans le travail : 12 % pour les 20-24 ans pour 6 % pour les femmes de plus de 45 ans. Mais là encore, les femmes les plus jeunes et sans diplômes déclarent davantage avoir été injuriées, et au contraire, parmi les femmes les plus âgées, les femmes les plus diplômées sont les plus touchées. Harcèlement moral et injures sont également liés au mode de vie. Les femmes divorcées, vivant en couple ou non, sont celles qui connaissent le plus d’injures et de pressions psychologiques.
La plus grande partie des faits de harcèlement sexuel rapportés consistent en avances sexuelles et « pelotage ». Viol et tentative de viol représentent 3 % de cet ensemble. Parmi les contraintes sexuelles au travail, il importe de distinguer, comme le fait la loi, si l’auteur de l’agression est ou non un supérieur hiérarchique. Au cours de l’année passée, environ 2 % de femmes ont subi une agression sexuelle et, dans un cas sur quatre environ, il s’agissait d’un supérieur hiérarchique. Le phénomène appréhendé dépasse ainsi largement le rapport d’autorité défini par la loi.
Nuances
Le rapport final (publication prévue à la Documention française) portera sur les croisements, qui permettront de répondre aux hypothèses qu’on peut d’ores et déjà poser au vu de ces premiers chiffres. Croisements qui dépassent les critères habituels, travail/non travail, situation matrimoniale, etc. Ainsi la question de la répétition, qui intéresse ô combien le psychologue. La dernière partie de l’enquête portait sur les violences subies pendant l’enfance, et une hypothèse banale semble se trouver confirmée : les femmes qui enfants ont subi de tels traitements ont été quatre fois plus que les autres victimes d’agressions au cours des douze derniers mois. Il faudra préciser le type d’agression dont il s’agissait, du type d’agresseur, les recours utilisés ou non, les recours possibles à l’époque, etc., pour essayer de penser la question de la répétition en termes psychologiques. À ce titre, les éléments biographiques seront plus précisément pris en compte.
Autre aspect de la question de la répétition : la notion de harcèlement, sous ses multiples facettes, psychologique et/ou « moral », doit être travaillée avec prudence, à l’heure où cette question est trop souvent posée en termes de victimation, voire de victimisation.
Tableau 2 : Proportion (en %) de femmes ayant subi des violences au travail au cours des 12 derniers mois
| Injures et violences verbales | 8,5 |
| dont injures répétées | 2,2 |
| Contraintes psychologiques | 16,7 |
| dont harcèlement moral | 3,9 |
| Agressions physiques | 2,7 |
| dont destruction du travail, de l’outil de travail | 2,2 |
| dont agression physique directe | 0,6 |
| Agressions sexuelles | 1,9 |
| dont agressions par supérieur hiérarchique | 0,4 |