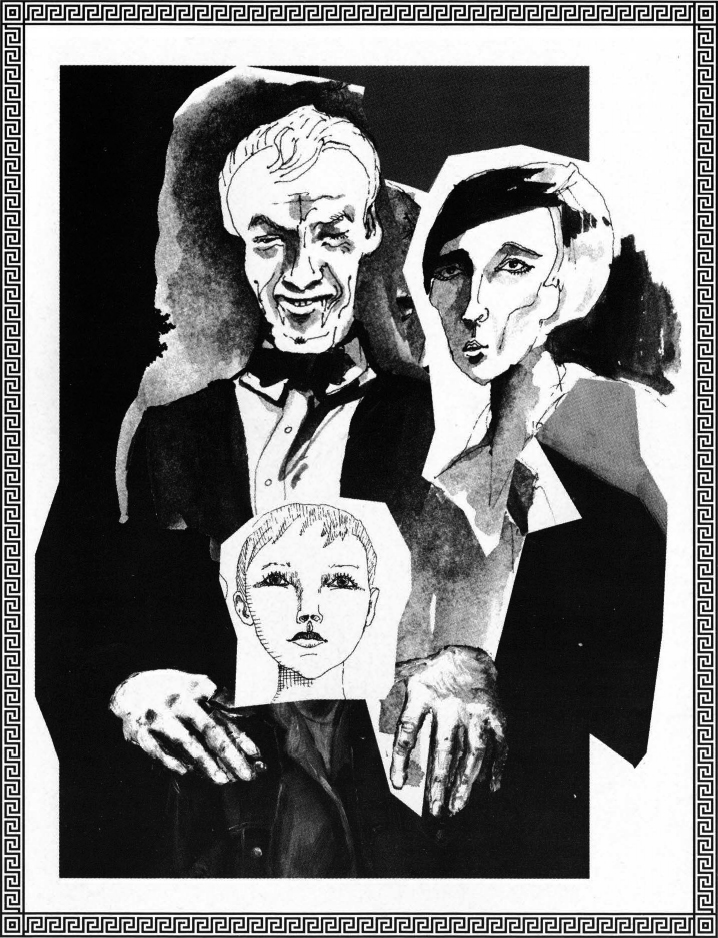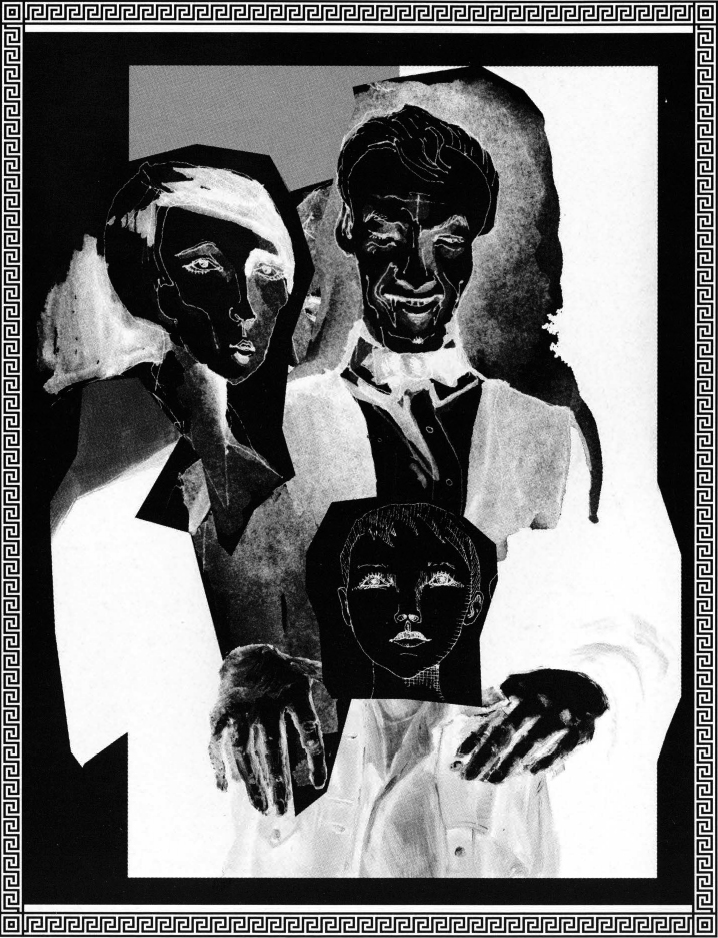Ces trente dernières années, l’introduction de la thérapie familiale psychanalytique et ses développements actuels sur le plan international ont permis d’élargir d’une part le champ conceptuel de la relation d’objet et d’autre part d’affiner celui du lien intersubjectif initié dans la recherche sur les groupes (R. Kaës, 1988). Les aspects narcissiques de ce lien ont été développés entre autres par A. Eiguer (1983), J.-P. Caillot, G. Decherf (1982), tandis qu’A. Ciccone (1999) a proposé des modèles de compréhension de la transmission psychique inconsciente entre les générations. La thérapie familiale psychanalytique constitue également un point d’appui théorico-clinique pour proposer des dispositifs d’accueil et d’accompagnement aux familles en souffrance au sein des institutions.
Appuis conceptuels de la thérapie familiale psychanalytique
Les travaux des groupalistes et des théoriciens du moi primaire
À l’origine, la thérapie familiale psychanalytique est fondée sur la théorie des groupes et les travaux de l’école française (D. Anzieu, R. Kaës et al.). La théorie des groupes est née aux États-Unis pendant la dernière guerre mondiale avec J. Moreno, K. Lewin, C. Rogers pour n’en citer que quelques-uns. Depuis la guerre, l’école hongroise avec M. Bàlint, l’école anglaise avec S.H. Foulkes, W.R. Bion, eux-mêmes héritiers de M. Klein et de D.W. Winnicott, P. Federn en Amérique, et l’école argentine avec J. Bleger, E. Pichon Rivière, influencent le courant groupaliste et familialiste en France. Les théories familiales et groupales s’enracinent sur la théorie freudienne (S. Freud, 1909, 1913, 1921, 1929, 1930). J. Lacan, en 1938, énumère les complexes familiaux dans la formation de l’individu.
La théorie des systèmes : la thérapie familiale systémique
L’intérêt pour le groupe familial s’est d’abord développé et notamment dans la pratique américaine à partir du modèle systémique (G. Bateson, dès 1956, P. Watzlawick, 1967). Il s’est originé sur la base d’un « malaise dans le cadre », malaise à la fois nosographique, institutionnel et thérapeutique provenant du constat concernant la raréfaction des névroses classiques, l’incertitude des thérapies institutionnelles et l’efficacité relative des traitements chimiothérapiques et psychothérapiques individuels appliqués aux souffrances d’ordre psychotique. La thérapie systémique s’est d’abord intéressée aux aspects comportementaux et interactionnels des difficultés présentées par les familles tandis que la thérapie familiale psychanalytique s’appuiera sur le pôle psychanalytique groupal, à l’écoute de l’inconscient et des fantasmes du groupe familial ainsi qu’aux éléments transféro-contre-transférentiels présents dans la situation de cure établie.
Ainsi, à partir des années 1970, en France, la théorie et pratique de la thérapie familiale psychanalytique se constituent en se différenciant fortement d’avec la théorie des systèmes. L’ouvrage princeps La thérapie familiale psychanalytique, de A. Eiguer (Paris), A. Ruffiot (Grenoble), et al., publié en 1981, pose les bases de la conceptualisation de la thérapie familiale psychanalytique : A. Ruffiot propose un cadre analytique pour la famille en souffrance : la notion d’Appareil Psychique Familial vient en écho à la conceptualisation de l’Appareil Psychique Groupal proposé par R. Kaës. A. Eiguer publie en 1983 Un Divan pour la famille. Puis en 1984, A. Eiguer, A. Ruffiot et al. publient La thérapie psychanalytique du couple. De nombreux analystes de la Société Psychanalytique de Paris (SPP), pratiquent également la thérapie familiale psychanalytique et apportent leur contribution à sa conceptualisation. J.-P. Caillot et G. Decherf avec Thérapie familiale et paradoxalité en 1982, puis, Psychanalyse du couple et de la Famille en 1989. S. Decobert, C Pigott, J.-P. Caillot publient en 1998 un Vocabulaire de psychanalyse groupale et familiale. P.C. Racamier, G. Haag et bien d’autres développèrent cette approche analytique groupale et familiale en rupture avec le modèle classique de la cure individuelle puisque plusieurs analystes sont en présence de la famille. L’écoute n’est plus centrée sur un seul patient, mais sur le groupe familial tout entier de même que le rêve n’est plus seulement considéré dans sa trame associative individuelle mais entendu dans sa dimension de communication à l’autre et dans une fonction de holding onirique (A. Ruffiot, 1981). Cette dimension du rêve est développée actuellement par R. Kaës dans son ouvrage sur La polyphonie du rêve. À Aix-Marseille, E. Granjon et al., travaillent autour de la transmission psychique inconsciente et publie dans Gruppo, Dialogue et dans la Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe. De nombreux travaux continuent à prospérer : ouvrages, thèses, et actuellement deux revues sont entièrement consacrées à la conceptualisation et au développement des pratiques de la thérapie familiale psychanalytique : la revue Groupal (du Collège de psychanalyse groupale et familiale) qui a également publié en 1998 le tome I du Vocabulaire de psychanalyse groupale et familiale et Le divan familial aux éditions, In Press (de la Société française de thérapie familiale psychanalytique). De nombreux analystes, en Argentine, travaillent avec les familles, parmi lesquels Berenstein (1984), R. Losso (2000, Psychanalyse de la famille) et J. Puget. Actuellement cette pratique est en plein essor en Europe et dans le monde. Un premier congrès international a vu le jour à Paris en mai 2004, organisé par la Société française de thérapie familiale psychanalytique. Une Société internationale est en projet de création.
Champs de pratiques concernées
Le champ institutionnel se tourne aussi vers la prise en compte de la souffrance familiale. Depuis une trentaine d’années les institutions se sont intéressées au travail avec les familles, à la fois sous la pression des textes de l’annexe 24, et dans la remise en cause de la prise en charge individuelle, exclusive, des patients. Le courant des thérapies familiales, véritable révolution épistémologique, vise à prendre en compte l’individu dans son réseau relationnel, l’engouement également pour la thérapie institutionnelle et les thérapies de groupe sont à l’origine de la demande pour un cadre de travail avec les familles au sein des institutions. En 1997 paraît un collectif Parents, famille, institution, à Lyon, sous la direction de l’Association pour le Développement de la Thérapie Familiale Psychanalytique (F. André-Fustier, et al.). En 1995, M. Berger, publie Le travail thérapeutique avec la famille. De nombreux cliniciens s’intéressent actuellement au travail thérapeutique avec la famille en institution et publient leurs recherches.
Le champ gériatrique et géronto-psychiatrique s’ouvrent également à cette pratique. P. Charazac publie en 1998 Psychothérapie du patient âgé et de sa famille et en 2001 Introduction aux soins géronto-psychiatriques. Ch. Joubert rend compte du travail avec les familles ayant un parent dément et publie entre autres, en 1995, Famille et gériatrie, l’ancêtre insuffisamment bon. En 2000, L’ancêtre dément : un traumatisme dans les liens de filiation. En 2002, « Le processus du vieillissement et la démence : résonances familiales », dans la revue Le divan familial.
Le champ du handicap : les effets du handicap sur le fonctionnement familial sont posés en 1985 par Francine André-Fustier dans son ouvrage sur L’enfant insuffisamment bon et se poursuivent par des recherches sur différents handicaps et notamment la surdité en ce qu’elle occasionne dans le groupe familial et les institutions chargées de la traiter (J.-L. Dorey, in Le divan familial sur les métamorphoses familiales à paraître).
Le champ pénitentiaire avec les recherches de B. Savin (thérapies familiales effectuées en prison avec les agresseurs sexuels ou les criminels) et A. Ciavaldini (les deux articles étant dans Le divan familial, n° 6, printemps 2001, « Justice et écoute familiale »).
Vers une définition de la thérapie familiale psychanalytique
« C’est une thérapie par le langage du groupe familial dans son ensemble, fondée sur la théorie psychanalytique des groupes. Elle vise, par la réactualisation, grâce au transfert, du mode de communication le plus primitif de la psyché, par le rétablissement de la circulation fantasmatique dans l’appareil psychique groupal (familial) à l’autonomisation des psychismes individuels de chacun des membres de la famille » (A. Ruffiot, 1981).
Pour E. Granjon (1989), la TFA fonctionne comme un processus de réétayage groupal grâce au néo-groupe composé des thérapeutes et des membres de la famille. La TFA prend soin de l’appareil psychique familial. Cette notion d’appareil psychique familial est une « fiction efficace » empruntée au champ groupal pour rendre compte de l’articulation de l’être ensemble familial avec les fonctionnements individuels de chacun des membres de la famille. En thérapie, cet appareil est observé sous l’angle de ses dysfonctionnements c’est-à-dire lorsqu’il manque à ses fonctions de contenance des angoisses archaïques, de liaison intra et intersubjectives, de transformation des éprouvés bruts en représentations et de transmission. La transmission met en jeu la capacité pour un groupe familial de mettre à la disposition des sujets ce qui leur est nécessaire pour se construire et avoir accès au monde. La TFA est un soin particulièrement adapté pour travailler la transmission psychique entre les générations.
Sylvie Sédillot
Les indications
La TFA s’adresse aux familles en souffrance (événements traumatiques, deuils, maladie somatique ou psychique d’un des membres, violences, addictions…). Elle s’appuie sur une écoute groupale reposant sur un double présupposé :
- Un présupposé théorique selon lequel sera considéré comme groupal-familial ce qui apparaît au niveau de fonctionnement le plus archaïque, là où s’est noué le dysfonctionnement et où se sont installées des défenses radicales entretenant confusions et indifférenciations entre les êtres, les générations, les sexes, voire même entre vivant/non-vivant et humain/non humain.
- Un présupposé méthodologique selon lequel tout ce qui est dit ou produit en séance par chacun est considéré comme venant de l’ensemble de la famille puisque nous nous intéressons à la part transindividuelle ou syncrétique (selon Bleger, 1967) ou indifférenciée du psychisme et non aux parties névrotiques de chacun. La souffrance familiale telle que nous l’entendons, concerne en effet les aspects non différenciés du lien, aspects générateurs de confusions et d’empiètements et obstacles à l’individuation des sujets. L’indication va porter sur le fonctionnement groupal familial : il est donc fondamental que toute la famille soit réunie lors des consultations. Les consultations et les entretiens préliminaires permettent à la famille d’élaborer la demande. Plus ou moins longs dans le temps (ils ne doivent pas excéder quelques séances), ils sont à différencier de l’engagement de la famille dans le processus thérapeutique. Cadrés, avec un certain nombre de questions, ils permettent de faire un diagnostic du fonctionnement familial (F. Aubertel). Ce diagnostic prend en compte l’état des relations à l’objet (lien familial), les mécanismes de défense prévalents, le type d’angoisse prévalente, et le mode de fonctionnement par rapport à l’extérieur. À l’issue des consultations, une indication est donnée à la famille et sera soit individuelle, soit groupale, ou familiale selon les cas. À l’issue des entretiens préliminaires, lorsque l’indication familiale est posée, le cadre est explicité et le contrat proposé à la famille. Celle-ci donnera son accord après un délai de réflexion. Il est précisé que tous doivent être d’accord pour ce type de prise en charge et si possible s’engager à venir régulièrement.
Dans la famille en crise, tous les liens sont en souffrance : liens d’alliance, ou liens fraternels, liens de filiation, liens aux familles d’origine, lien généalogique, et relations avec l’extérieur de la famille (problématique dedans-dehors). Ces liens sont de nature indifférenciée dans des modalités de collage associées à des mouvements de rupture ou bien marqués par le paradoxe et la perversion. Les liens narcissiques sont au premier plan (part indifférenciée de la famille, « le Soi familial ») par rapport aux liens libidinaux objectaux (liens différenciés) (A. Eiguer, 1984).
Une grande excitation règne alors dans la famille, avec des agirs et de la violence.
Le type d’angoisse prégnante est l’angoisse de mort, d’effondrement, de morcellement que l’on retrouve dans un fantasme présent en cours de thérapie nommé « fantasme de mort collective » (A. Ruffiot, 1983). Ce fantasme, très archaïque et parfois proche de l’agir, tente de juguler les angoisses d’effondrement par une recherche de vécus symbiotiques, imaginés dans la mort de l’ensemble de la famille. Les mécanismes de défense prévalents sont l’oscillation de la position narcissique paradoxale (J.-P Caillot, G. Decherf, 1982) où « vivre ensemble nous tue, nous séparer est mortel », le clivage, les dénis (de la temporalité, des cycles de la vie familiale, de la différence des êtres, des sexes) ainsi que le déni de la différence entre les vivants et les non vivants, (F. Aubertel, F. André-Fustier, 1986). La peau ou enveloppe familiale, en référence au Moi Peau de D. Anzieu, (1974) est soit rigidifiée, de type carapace, donc peu contenante et peu fonctionnelle dans la gestion des angoisses de séparation : le fonctionnement familial est autarcique et parfois persécutoire par rapport au dehors. L’enveloppe peut être au contraire déchirée, éclatée, sans différenciation dedans-dehors. Ces problématiques sont apparentes mais pas exclusivement dans les affections psychosomatiques de la peau : allergies, eczéma etc. Les contre-indications à la thérapie familiale concernent les familles fonctionnant en prévalence sur un mode différencié (liens libidinaux objectaux au premier plan), avec des mécanismes de défense plutôt névrotiques (refoulement, dénégation) et dans lesquelles la conflictualité s’organise autour du désir et des angoisses de castration.
L’enveloppe familiale est suffisamment souple pour permettre les échanges avec le dehors.
Cependant, l’équilibre de toute famille dépend de la bonne articulation entre les liens narcissiques (parties indifférenciées du lien) et les liens objectaux libidinaux, signant quant à eux la différenciation.
Sylvie Sédillot
Le cadre et le dispositif
Nous distinguons le cadre (cadre interne et invariant du thérapeute) du dispositif qui peut être adapté selon les lieux de soin. À partir du cadre initial de la psychanalyse, écran invariant sur lequel se déroule le processus (J. Bleger, 1966), A. Ruffiot (1981) conceptualise le cadre de la thérapie familiale psychanalytique, avec la règle d’association libre en famille et à propos de la famille et son corollaire la règle d’abstinence, (impliquant l’interdit d’agir pour la famille et l’interdit de porter jugement et de donner des conseils pour les thérapeutes). Une consigne spécifique est donnée à la famille : venir si possible tous ensemble en séance. J.-P. Caillot et G. Decherf (1984) en définissent trois fonctions : contenante (maternelle), limitative (paternelle), transitionnelle symboligène.
Le dispositif : c’est un dispositif de face-à-face
Les thérapeutes (dont le nombre varie entre deux et cinq) sont assis en demi-cercle et la famille occupe comme elle le souhaite le demi-cercle restant à sa disposition. Les séances se déroulent dans un lieu neutre, toujours le même, pendant une heure, généralement au rythme d’une séance par quinzaine. Les séances sont suivies d’une post-séance d’une demi-heure afin d’analyser les contre transferts et l’intertransfert (entre les thérapeutes). Il y a souvent un thérapeute principal et des cothérapeutes en formation, qui participent aux séances. Des notes sont prises (seul ce qui est verbalisé est noté), à tour de rôle par les cothérapeutes et constituent la mémoire du néo-groupe.
La famille a la possibilité de consulter ces notes sur place si elle le souhaite.
Les séances sont soit payantes (environ 70 euros) soit prises en charge avec participation de la famille ou non, selon les lieux de soin. Les modalités de paiement sont toujours discutées au départ de la thérapie ainsi que la question des absences qui seront dues en cas d’annulation trop tardive.
Il s’agit d’un long travail dans le temps qui nécessite que les thérapeutes s’engagent à être là aussi longtemps que la famille en aura besoin, la durée d’une thérapie variant d’une à deux ou plusieurs années selon les cas. La séparation, en fin de travail, se prépare, les séances peuvent être espacées. Un arrêt prématuré est toujours élaboré.
Le processus
Il concerne l’avancée du travail de représentation et de symbolisation de la famille. Il vise à permettre ou à rendre à la famille sa capacité de métaboliser les angoisses qui la désorganisent ou l’organisent de manière pathologique et coûteuse pour l’individuation de ses membres. Le processus se construit à travers l’écoute de la trame associative groupale de la famille et au sein de la dynamique transféro-contre-transférentielle et intertransférentielle, (analyse de la séance durant les post séances et en « intervision » avec d’autres thérapeutes extérieurs au processus).
En début de thérapie, le « transfert sur le cadre » (A. Eiguer, 1982), encore appelé « transfert matriciel » par A. Ruffiot (1981) met en scène l’indifférenciation. La famille en mal de contenance, se répand au sein du cadre analytique. Le sensoriel, les éprouvés sont au premier plan : la famille fonctionne en prévalence, sur le registre de l’originaire : pictogrammes, signifiants formels groupaux tenus dans des ritualisations spécifiques à telle ou telle famille (É. Grange-Ségéral, F. Aubertel, 2003).
Les objets bruts (E. Granjon, 1990), l’importante l’excitation accompagnée de vécus incestuels (P.C. Racamier, 1992), ainsi que les agirs et la violence sont une préfiguration de « l’impensé généalogique ». Ces différents éléments constituent la transmission transgénérationnelle qu’E. Granjon qualifie de « véritables traces sans mémoire ».
Les cryptes et fantômes dans la lignée (N. Abraham, M. Torok, 1978), les secrets familiaux (S. Tisseron), provoquent un désétayage généalogique (manque de contenance généalogique) et une grande souffrance intrafamiliale et individuelle (Ch. Joubert, 2003), observables sous forme de traumatisme généalogique (Ch. Joubert, 2002). Les pactes dénégatifs, ensemble de représentations inconscientes concernant ce qui doit être laissé de côté, refoulé dénié, (R. Kaës, 1989) sont à la base de tout lien, mais en principe restent muets. Le contrat narcissique (P. Castoriadis-Aulagnier, 1986) est une forme positive de tout lien puisqu’il offre une place au nouveau venu dans la famille en échange d’une reprise des pactes dénégatifs (le pacte dénégatif prend appui sur le contrat narcissique et en est « le complément et la contre-face »). Ce contrat narcissique peut cependant devenir un véritable étau, enserrant chacun dans une place assignée sans transformation possible, modalité qu’E. Granjon nomme alors « contrat psychotique ». Lorsque les pactes dénégatifs au fondement de tout lien familial et jusqu’alors muets se trouvent dénoncés par l’existence d’un « porte-symptôme », jouant le rôle d’un véritable « cryptophore », la famille se trouve confrontée à des angoisses d’éclatement et de désorganisation contre lesquelles elle va tenter de se défendre. La fonction contenante des thérapeutes est au premier plan (il y a souvent des agirs sur le cadre de la part de la famille : retards, absences non signalées, tentatives d’acting en séances, violences verbales avec des mots qui tuent).
Les modalités de lien de type « pervers narcissique » (A. Eiguer, 1989, 2001) se déploient parfois avec leur cortège d’alliances perverses : « famille anti-couple, couple anti-famille » (J.-P. Caillot, G. Decherf, 1989).
Les thérapeutes analysent en postséance leurs « co-éprouvés », (F. André-Fustier, F. Aubertel, 1997) ce qui leur permet d’une part de supporter ici et maintenant ce qui se vit pour chacun et entre eux (intertransfert) et d’autre part favorise l’accès à un début de représentation.
Puis le transfert sur le processus (A. Eiguer, 1982), signe l’acceptation de la dépendance à l’égard du cadre sur le plan transférentiel et l’implication de la famille dans le travail psychique.
Enfin le transfert sur les thérapeutes (A. Eiguer, 1984) des images généalogiques signe un début de différenciation au sein de la famille et rend possible la mythopoïése du néo-groupe famille-thérapeutes (capacité de mise en récit, de fabriquer de l’histoire, du mythe rendant compte des origines de la famille et de chacun).
La mythopoïése (A. Ruffiot, 1981) s’élabore ici et maintenant dans la dynamique transféro-contre-transférentielle et intertransférentielle. Le holding onirique familial (A. Ruffiot, 1981) fait partie de la chaîne associative familiale. Comme le souligne E. Granjon, l’important n’est pas la recherche d’une histoire à jamais disparue (effacée par le traumatisme), mais la réappropriation d’une autre histoire possible, co-construite dans l’espace thérapeutique par le néo-groupe et en post séance par le groupe des thérapeutes. Le processus n’évolue pas de façon linéaire, comme le rêve, il est un ombilic.
En conclusion, nous citerons cette phrase de P. Mérot, écrivain : « Chaque famille classique se doit d’avoir un raté : une famille sans raté n’est pas vraiment une famille, car il lui manque un principe qui la conteste et qui lui donne sa légitimité » (P. Mérot, 2003). N’oublions pas non plus cette célèbre phrase de Goethe « Ce que tu as hérité de tes pères afin de le posséder, conquiers-le ! » Dans la transmission en effet il faut tenir compte de la part active du destinataire en ce qui concerne la transformation de ce qui lui aura été donné ou imposé.