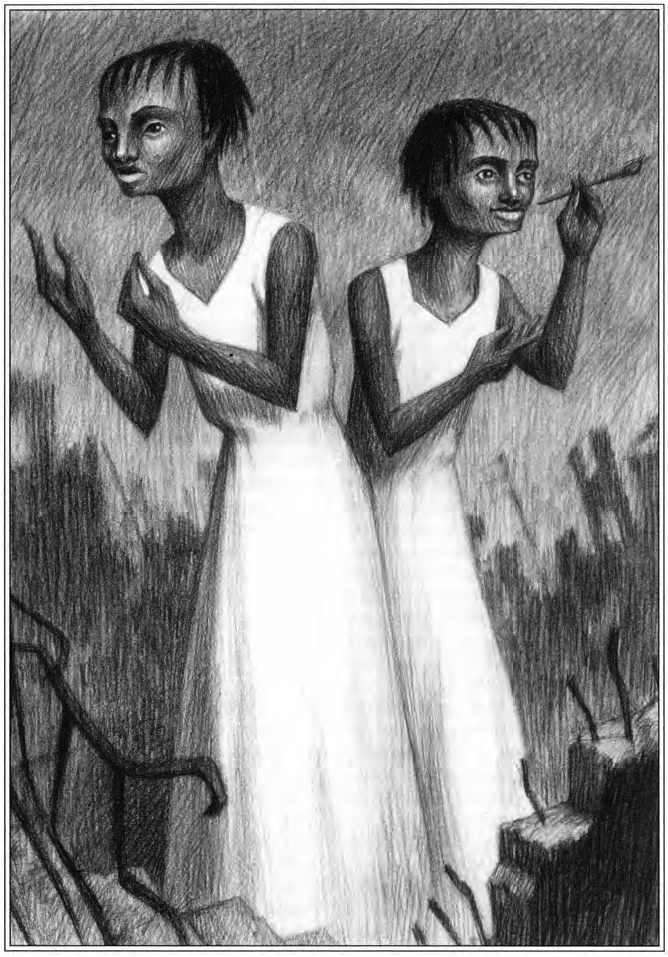Dans le cadre du projet ANR RECREAHVI « Résilience et processus créateur chez les enfants et adolescents haïtiens victimes de catastrophes naturelles » nous avons organisé deux séminaires interdisciplinaires et internationaux qui ont eu lieu à Lyon le 25 janvier et le 29 avril 2011 respectivement sur « Croyances, résilience et processus créateur en Haïti » et « Séismes et processus psychiques en Haïti : Apport de la recherche interculturelle en contexte humanitaire ». Nous donnerons ici un aperçu du contenu de ces deux séminaires.
Du traumatisme à la résilience : le religieux et le groupal
Le premier séminaire a eu pour objectif général de présenter l’objet et les objectifs de la recherche en général en interrogeant particulièrement le statut des croyances et de la création dans la résilience. Le croisement interdisciplinaire et interculturel des expériences et des théories a constitué la base d’une réflexion sur les rôles complexes des tuteurs de résilience, au niveau individuel, mais aussi groupal et national, dans la reconstruction psychique de la population haïtienne après le séisme.
Après les propos de bienvenue de la directrice du CRPPC (Pr A. Brun) et la présentation des objectifs globaux du projet RECREAHVI par le responsable scientifique D. Derivois, la journée a commencé par la présentation de Laennec Hurbon1 sur le thème « Croyances religieuses et tremblement de terre en Haïti », mettant l’accent sur le caractère complexe du sujet et de son abord. La complexité principale est celle des croyances nombreuses (catholicisme, protestantisme, pentecôtisme, islam, armée céleste, Témoins de Jéhovah, vodou, etc.), toutes alimentées par les traces du vodou comme fonds commun. Le séisme aurait en effet rendu visible la présence de croyances et de pratiques vodou, créant ainsi une synergie entre les croyances et les pratiques religieuses. Le phénomène religieux aurait vu un changement avant/après le séisme. Comme marqueur temporel, il représente la première scène dans laquelle se déroulent les réactions. Le Religieux devenant dès lors l’espace pour vivre, exprimer puis organiser le traumatisme collectif et individuel. En écho à ces réflexions, Bernard Chouvier2 a abordé la question du traumatisme, en développant la notion de névrose collective de « destin », en tant que celle-ci définit le rapport fatal à la mort. Ce rapport s’exprime dans des « pratiques destinales » souvent groupales. Cette première partie du séminaire s’est achevé par une réflexion sur le lien, chez un peuple, entre croyance et créativité : les modes de créativité d’une société ont en ce sens été envisagés comme étant directement liés aux cadres, aux supports religieux de celle-ci, comme reflet même du contenu des croyances sociétales. C’est ainsi que Denis Poizat3 a présenté le vodou comme à la source de l’art en Haïti, sous des formes particulièrement sensorielles et imagées (peinture, sculpture, danse…).
En seconde partie de la journée, plus axée sur la question du traumatisme et des processus de résilience, Marie Anaut4, dans son intervention « L’importance de la famille et de l’école dans la résilience des enfants » développe l’idée selon laquelle la péri-famille, autant que la famille élargie, a un rôle d’étayage dans la résilience des enfants. Elle reprécise à cet égard la place indéniable de la famille dans la résilience des enfants, mais aussi des adultes. Cette famille qui, en tant que groupe, s’appuie néanmoins sur d’autres entités, en particulier dans le contexte post-séisme où elle peut se trouver elle-même « amputée », confrontée à des deuils, à de nouvelles parentalités, des adoptions et des exigences de reconstructions familiales et sociales.
Sur le thème « Croyances et groupalité », Claudine Vacheret5 explique quant à elle que le groupe peut être à l’origine du processus créateur, au travers son rapport à la croyance. Ce rapport est basé sur une logique de l’idéal, elle-même portée par le groupe et le définissant tout à la fois. Le groupe, dans sa dimension contenante, en tant qu’enveloppe maternelle assure une fonction de pare-excitation qui serait un point de départ et de développement de l’accompagnement à la résilience. C’est dans ce sens que, en lien avec la groupalité interne et sa place importante dans l’identité singulière et religieuse de l’individu et du groupe, les croyances peuvent être considérées comme des tuteurs de résilience à part entière. Plus largement, le groupe se définit à l’échelle du peuple, de la nation dont l’identité même et les repères en Haïti ont été bousculés par le séisme. Rommel Mendes-Leite propose de penser les médiateurs qui accompagnent la résilience d’un peuple. Ont été en particulier évoqués les groupes réels dans leurs dimensions diverses comme espaces potentiels de réactivation des « groupes internes » et comme base à la reconstruction psychique des individus et des groupes. Le rôle des médiations et des groupes de parole a en ce sens été souligné, en tant qu’il est porteur de possibilités d’échanges d’expériences, d’imaginaires, d’identifications et de paroles pour pallier les traumatismes et laisser émerger les nouvelles possibilités créatrices…
Jérémy Moncheaux
Méthodologies de la recherche et méthodes d’interventions en contexte interculturel et humanitaire
Le deuxième séminaire a mis l’accent sur les méthodologies et les processus de la recherche, dans les contextes d’urgence et de reconstruction. Il a été l’occasion de réfléchir sur les processus psychiques à l’œuvre dans le traumatisme, sur les méthodes d’analyse de ces mêmes processus, ainsi que sur l’élaboration et le dépassement de celui-ci dans des contextes humanitaires et culturels différents.
Après une entrée en matière sur le modèle parasismique de la psyché et sur la nécessité de penser le processus sur la longue durée en tenant compte de la mémoire du traumatisme (Daniel Derivois6), Ronald Jean Jacques7 a dressé un « bref état des lieux sur la recherche en Haïti après le séisme, avec un regard particulier sur les enquêtes sociales ». Il a précisé que la recherche a pris de l’ampleur après le séisme du 12 janvier, et principalement à l’extérieur du milieu universitaire (association, études de terrain, évaluation de la situation…).
Près de 500 recherches sont en cours sur les domaines suivants : éducation, santé, protection de l’enfance, mobilité, handicap... Par ailleurs, les problèmes psycho-sociaux ne sont pas étudiés de façon systématique elles s’intègrent dans de nombreuses recherches.
L’aide internationale est présente de façon très importante au niveau des recherches, mais surtout autour des interventions, dont l’impact sur la résilience de la population et des institutions de l’État est à prendre en considération. L’aide internationale touche cependant à certains problèmes psycho-sociaux accentués après le séisme (violences, viols...).
La recherche ANR vient dans ce carrefour de recherches et de projets de soutien, pour stimuler la réflexion sur les questions des processus psychiques et sociaux en lien avec le séisme et la situation sociopolitique, sanitaire, économique.
Dans une deuxième intervention, Nadja Aciloly-Régnier8 a présenté la « méthodologie de la recherche en psychologie interculturelle » avec une réflexion, nécessaire, sur un au-delà de la méthode scientifique. Il s’agit d’adapter la méthodologie à l’objet de l’étude et non l’inverse. Dans ce cadre, l’identité du chercheur ne se détache pas du processus de la recherche. Ce n’est pas l’outil d’évaluation seul qui va changer, mais la façon même du chercheur de vouloir étudier son objet de recherche. Comme le rapport à la perte, par exemple, qui n’est pas le même dans les toutes les cultures. Ainsi, sans tomber dans un réductionnisme culturel, plus que la culture, c’est l’interculturalité de la recherche elle-même (objet, méthode, chercheurs, populations…) qui est à considérer comme une ressource intrinsèque pour la construction dynamique du processus de recherche, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique.
Francis Maqueda9, dans son intervention « L’intervention interculturelle en contexte humanitaire » a abordé le travail du psychologue dans l’humanitaire, traitant en particulier de la question de l’idéologie compassionnelle, du rapport complexe qu’entretient le professionnel avec la victime. Dans les situations d’urgence post-catastrophes, la position d’accompagnement première serait d’écouter la parole de l’autre. Cette écoute a une fonction clinique de holding et de handling (Winnicot, 1971), qui crée des possibilités de liens avec l’autre après le traumatisme et permet ainsi d’instaurer une continuité spatiale, temporelle et surtout psychique. Les processus psychiques à l’œuvre dans les traumatismes relèvent à certains égards de ceux en jeux dans la clinique des psychoses au sens où les environnements primaires peuvent être démantelés et les limites perforées, provoquant un « danger de l’être ». L’aide humanitaire prend donc sa légitimité dans les contextes traumatiques à partir de l’acceptation de chacun de l’état de fragilité et parfois de déconstruction de la pensée qui par la suite pourra être reconstruite, repensée, re-connue. Dans ces cadres-ci, à partir du partage affectif des événements traumatiques vécus par le sujet, l’intervenant peut se trouver aux prises avec ses propres illusions de « sauveur » alors qu’il est face à des sujets dont les liens sont rompus et avec lesquels la relation d’aide peut développer un sentiment d’endettement psychique et de haine…
La deuxième partie du séminaire a vu l’émergence de débats autour des méthodes spécifiques de la recherche en Haïti et ailleurs, ainsi que la présentation de quelques outils. Le premier outil présenté est le QGE Questionnaire Guide d’Évaluation en Haïti, élaboré par Yoram Mouchenik10. Le deuxième outil, le LCE Liste des Comportements de l’Enfant est présenté par Michel Dugnat11. Il s’agit d’une échelle d’« évaluation de la souffrance précoce à l’épreuve du trauma » qui mesure le degré de retrait de l’enfant et qui a été mise en place par Joëlle Rochette12 dans le cadre de recherches sur la dyade mère-enfants. Cet outil a été soumis à une validation au niveau transculturel et son utilisation paraît pertinente dans l’évaluation de l’impact traumatique et des processus adaptatifs au sein de la dyade mère-enfant.
Suite à cette présentation des méthodes et des enjeux de l’évaluation, ont d’autre part été développés les approches d’intervention psychosociale et éducative après le séisme, et notamment avec des populations d’enfants et de jeunes vulnérables. C’est en ce sens que la présentation des ateliers de l’association Philosoph’art (Émeline Carment13 et Héléna Hugot14) – avec l’intervention « Dispositif d’atelier d’art et de philosophie avec des enfants vulnérables en Haïti » – est venue proposer un dispositif articulant art et philosophie dans des ateliers éducatifs pour des enfants en Haïti. Ces ateliers sont pensés comme un espace d’élaboration possible de la pensée, d’expression émotionnelle, les deux s’articulant à travers la transposition de la philosophie sur les productions artistiques groupales. Ces réflexions ouvrent le débat sur la référence aux médiations artistiques, comme voie possible d’accès au plaisir et comme ouverture à un espace transitionnel permettant une élaboration, par la mise en mouvement de la pensée, du vécu traumatique.
L’intervention de René Roussillon15 sur les « Méthodes d’analyse des Rêves post-traumatiques » a quant à elle rappelé le modèle théorique des rêves (Freud, 1916). En soulignant l’importance de situer le rêve post-traumatique par rapport à la traversée du sujet et à sa dynamique intrapsychique, René Roussillon a mis en évidence les réserves épistémologiques d’une telle méthodologie d’analyse, en particulier dans le rapport spécifique du sujet avec son rêve, en fonction aussi de son organisation psychique, de son âge, de son histoire singulière… Là où la fonction principale du rêve est de protéger le sommeil et de permettre un travail de métabolisation, le rêve traumatique signe, quant à lui, un échec de la fonction du rêve, car ne pouvant plus être gardien du sommeil. Cette approche du rêve formerait donc un cadre pour l’analyse des rêves recueillis auprès d’enfants haïtiens.
Le passage du rêve à la parole est un passage de la représentation de chose à la représentation de mot, c’est une concrétisation (parallèle au dispositif de Philosoph’art, passage du concept à la création artistique, rapprochement à faire aussi avec les dessins d’enfants dans lesquels celui-ci se saisit de ce qui a été dans ses rêves).
L’intervention suivante fait écho à la méthode d’interprétation des rêves et aux approches interculturelles dans la recherche. Jude Mary Cénat16 a présenté « Les méthodes projectives à l’épreuve du vodou » en posant le problème des épreuves projectives dans une culture différente du pays où le test est construit. L’utilisation du Rorschach dans un contexte de vodou rend compte de biais méthodologiques au moment de la passation et de l’interprétation (normes, banalités, etc.). En effet, les croyances vodouïques influencent les croyances et pratiques personnelles, sociales et même politiques et judiciaires. Elles sont à l’origine d’un rapport spécifique (sacré) à l’image qui n’est jamais neutre dans le vodou. Il a souligné l’importance du relativisme culturel afin de considérer les contextes particuliers de chaque situation dans laquelle le test projectif est appliqué.
Une autre réflexion sur la méthode a été présentée avec l’intervention de Hadrien Munier17 « Méthode d’observation ethnographique translocale des religions : le vodou haïtien dans un monde globalisé ». Afin d’observer la pratique actuelle du vodou, il expose une pratique ethnographique particulière. Il s’agit d’un réseau de terrain appelé « terrain multisitué » qui se différencie de la combinaison de plusieurs terrains, utilisée pour la méthode comparative par exemple. Cette approche anthropologique a amené à réfléchir sur la nécessité de constructions méthodologiques actualisées et adaptées à l’interculturalité dans un contexte mondial de plus en plus globalisé, communiquant, et où la culture n’est plus à localiser selon des repères spatiaux. L’importance de l’interculturalité a été appuyée également par Raphaël Colson18 qui a présenté un contexte différent d’analyse de l’imaginaire à travers son intervention « Méthodologie de l’étude de l’imaginaire post-catastrophe au Japon ». Les réactions post-catastrophe dépendent en effet étroitement de l’imaginaire d’un peuple et de son rapport à l’environnement (nature, terre…).
Ces séminaires de recherche ont une place importante dans la dynamique du projet ANR RECREAHVI. De par l’espace d’échange qu’ils offrent aux chercheurs et intervenants de tous les horizons, ils permettent à chaque fois de relancer la réflexion, d’ajuster les méthodes et les hypothèses, de penser l’interculturalité et l’interdisciplinarité. Éléments importants du processus de la recherche, les séminaires sont l’occasion d’une décentration de la recherche-propre ainsi que d’un travail de distanciation constructive permettant une sollicitude tempérée et un rapport suffisamment bon avec l’objet et le processus de recherche.
La rencontre interdisciplinaire et interculturelle continue avec le troisième séminaire qui va se dérouler le 18 octobre 2011 et qui portera sur la santé scolaire et la santé mentale en Haïti.