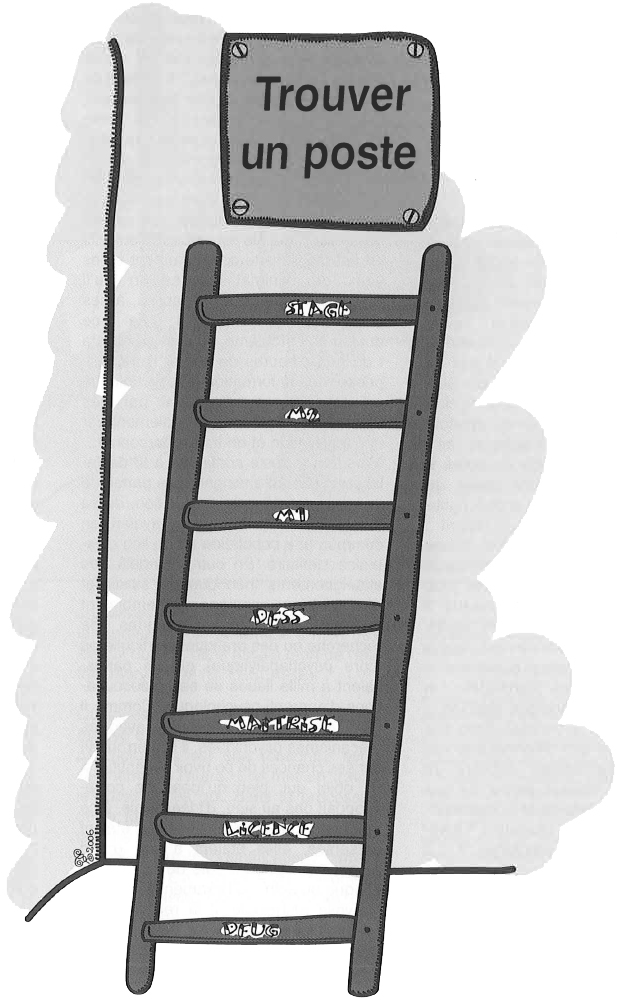À l’heure de la mise en place progressive de la réforme LMD, Canal Psy nous a proposé d’effectuer un retour sur notre cursus de formation, notamment sur l’année de DESS, pour tâcher d’en dégager les enjeux essentiels mais aussi les limites, à l’aune de notre brève expérience de psychologue clinicien. Ces quelques réflexions sont donc nées de nos propres observations sur les différents terrains sur lesquels nous sommes, ou avons été, engagés (hôpital psychiatrique, CATTP, CMPP-CAMSP, IME-IMPRO, analyse de la pratique) ainsi que des échanges que nous avons pu avoir avec nos collègues. Nous allons donc tenter, à notre manière, de retracer le processus de formation du psychologue clinicien à travers ce qui nous apparaît comme l’élaboration d’une identité trouvée-créée.
Comment devient-on « un psychologue » ?
Passionné par les cours de philosophie, où il a découvert l’inconscient avec Freud, Anatole décidait de s’inscrire en psychologie. Il avait hésité avec la faculté de médecine, pour devenir psychiatre, mais le long cursus l’avait découragé. À l’époque, il ignorait que la formation de psychologue n’est pas un court fleuve tranquille dont on sort nécessairement diplômé au bout de cinq ans… Quelques mois après, Anatole poussait fiévreusement la porte de l’amphi où se tenait la réunion de rentrée des étudiants de première année de psychologie. Des idées de la plus haute importance traversaient son esprit : avait-il bien fait de ne prendre qu’une pochette avec des feuilles, délaissant son cartable du lycée pour faire plus « fac » ? Où se trouvait la bibliothèque ? Allait-il pouvoir écrire sur des tables aussi petites ??? Heureusement, face à toutes ces angoissantes questions, il avait également des certitudes : il voulait devenir psychologue clinicien… ou psychanalyste. Il abordait donc ses études à l’affût des informations qui allaient lui être livrées, tâchant de décrypter dans chaque parole de ses enseignants les clefs de la compréhension de cette question cruciale : « comment devient-on un psychologue ? ». Il avait déjà quelques idées sur la question mais n’était pas persuadé que le récent achat d’une pipe et d’un canapé qui passerait bien pour un divan le moment venu, suffirait à faire de lui un psychologue.
Quelques semaines plus tard, confronté à la diversité des enseignements tout autant qu’à celle des enseignants, Anatole commençait à douter. La lecture minutieuse du code de déontologie des psychologues, malgré une certaine obscurité pour ne pas dire une obscurité certaine – il ne savait pas alors qu’il se livrait à la dénégation –, lui avait amené quelques éléments de réponse. De même, il avait certes été un peu sidéré par une étrange expérience, lorsqu’un enseignant était entré dans la pièce, avait salué les étudiants lui faisant face, et avait gardé le silence pendant d’interminables minutes, jusqu’à ce qu’une petite brune délurée se mette à jacasser avec sa voisine. Ceci l’avait finalement rassuré dans la mesure où cela constituait à ses yeux un premier modèle : pour devenir « un psychologue » il suffisait de regarder intensément son interlocuteur, tout en gardant le silence. Sa petite amie, ne semblant pas vraiment apprécier son nouveau comportement, l’avait sommé de cesser et il avait dû se contenter de s’entraîner avec son cochon d’Inde, avant d’abandonner ses exercices ayant décelé quelques éléments dépressifs dans le comportement et les yeux de l’animal, dépression qu’il attribuait, empreint de culpabilité, à ses exercices. L’élaboration de ce douloureux problème, croisée au constat du peu d’heures de cours, l’amena à penser que la formation du psychologue ne passait pas seulement par des apports théoriques, mais également par une implication et un travail personnel.
Mais tout le reste continuait à le déstabiliser : pas un enseignant ne parlait de la même manière de sa position, de sa fonction, y compris ceux qui avaient en commun une population ou un lieu d’exercice similaire. En outre, au-delà des enseignements théoriques, il saisissait que certains enseignants semblaient engagés dans des pratiques de recherche ou des pratiques particulières (cure psychanalytique) qui lui paraissaient à mille lieues de ses préoccupations d’apprenti-psychologue. Comme il commençait à être familiarisé avec les mécanismes psychiques, il s’interrogeait sur ses chances de pouvoir s’identifier à un objet qui, bien qu’idéal, ne correspondait pas au sien, d’idéal. Mais, à ce moment-là, si les identifications étaient présentes, elles étaient à son grand étonnement plus du côté de la pathologie que du soin : à l’examen de chaque nouvelle pathologie, il la reconnaissait systématiquement en lui ou à travers ses proches, ayant réussi à diagnostiquer sa cousine comme hystérique, sa concierge comme voyeuriste et son boucher comme ayant des pulsions sadiques. Il avait aussi remarqué que ses rapports avec ses amis avaient changé. Si certains s’étaient éloignés de lui, par méfiance pensait-il, d’autres au contraire, commençaient à lui raconter systématiquement leurs rêves.
Qu’est-ce qu’un psychologue ?
Heureusement, les années passant, il avait été confronté à sa première expérience de stage de Licence et malgré les doutes liés à son implication personnelle, il avait trouvé nombre de repères grâce à son maître de stage et les choses lui parurent plus simples. Les cours prenaient alors une autre dimension, plus parlante, au regard de ses stages. De plus, il avait enfin rencontré des « fous », population qu’il avait par ailleurs redoutée, par peur de la contamination peut-être. Il les qualifiait maintenant de « psychotiques chroniques », ce qui les maintenait à une distance acceptable. En tout état de cause, absorbé par la dimension heuristique de l’année de Maîtrise, il n’avait pas eu beaucoup de temps pour s’interroger sur la fonction de psychologue, son projecteur à imagos étant prioritairement orienté vers les chercheurs en psychologie.
Pourtant, il avait bien fallu remettre sur le tapis ses interrogations concernant la fonction de psychologue pour constituer son dossier d’entrée au DESS : la motivation, il l’avait maintes fois remise en question pour arriver jusque-là ; il en avait, il en était certain, quant à la coucher sur le papier ! L’analyse du processus de formation ne fut pas plus simple à élaborer : devait-il aborder ses vacances de Terminale à vocation gérontologique durant lesquelles il avait accompagné chaque jour sa grand-mère à son Club, ou devait-il se limiter à son dernier remplacement d’éducateur ? Fallait-il qu’il soit dans le « trouvé-inventé » d’une longue expérience d’analysant auprès d’un descendant direct de Freud ? Parler de lui de manière intime en faisant preuve de réflexivité et de capacité d’élaboration était, malgré la difficulté, une expérience fort enrichissante. Enfin, l’analyse d’une situation clinique lui avait permis de mettre en lumière toute la complexité des nœuds transféro-contre-transférentiels dans lesquels il s’était trouvé piégé… Après un premier refus, Anatole s’était beaucoup impliqué cette année dans l’élaboration de son dossier, mais surtout dans des stages supplémentaires, qui lui avaient conféré un enrichissement certain. Si ces deux ans de Maîtrise avaient été très éprouvants, il en était finalement arrivé à s’approprier sa question initiale, aboutissant à :
Quel psychologue pourrais-je devenir ?
C’est évidemment avec une certaine satisfaction qu’Anatole découvrit son nom au beau milieu de la sacro-sainte liste des « Admis à la préparation du DESS ». Il repensait avec nostalgie à ses camarades qui avaient progressivement arrêté la psychologie pour devenir éducateur, infirmier, professeur des écoles… mais aussi à ceux qui avaient été arrêtés par la psychologie. Pour autant, il se sentait loin d’être arrivé et de nombreux questionnements l’amenaient à douter. Si lors de son inscription initiale, le quinquennat lui semblait démesurément trop long pour se former, il se demandait maintenant comment un psychologue pourrait naître en seulement neuf mois. Le temps de gestation lui paraissait décidément trop court ! Il cherchait sans cesse au-dehors, ne voyant pas tout ce qu’il avait petit à petit accumulé au-dedans.
Pour l’heure, alors que sa copine Élodie, en clinique du somatique, tâtonnait dans la recherche de ses stages, laissant fantasmer un avant-goût de ce qu’ils vivraient une fois diplômés, Anatole trouva un stage à côté de son domicile. Sa tutrice lui assura qu’il était préférable pour sa formation de se confronter à l’inquiétante étrangeté d’une institution « quelque peu en souffrance », selon elle ; Anatole, quant à lui, avait quelques doutes, surtout après avoir rencontré le directeur, également thérapeute, qui lui demandait d’animer un atelier cuisine le vendredi, jour de RTT du cuisinier. Ses premiers cours théoriques sur la dynamique institutionnelle renforçaient son inquiétude et Anatole se demandait à quelle sauce il allait être mangé. Ce n’est que par l’intermédiaire de l’élaboration du dossier institutionnel qu’il commença à prendre conscience de ses lacunes, mais aussi de son profond intérêt pour cette dimension jusqu’ici négligée. Même si R. Kaës et P. Fustier avaient séjourné de longues semaines sur sa table de nuit, il avait eu besoin de présenter cette situation dans le groupe d’analyse de la pratique. Il avait dû attendre son tour, Josiane, ayant monopolisé la parole pour parler de sa jeune maître de stage phobique, qui restait enfermée dans son bureau-forteresse. Cette semaine d’attente avait été insupportable pour Anatole qui pensait stagner malgré l’approche du mois de juin. Plus le temps passait, moins il se sentait prêt. Son premier dossier lui faisant beaucoup de soucis et sa tutrice lui ayant fait recommencer deux parties, il pensait présenter en septembre.
Laurence Chassard
Malgré tout, Anatole était satisfait de sa formation, qu’il estimait concrète avec des outils méthodologiques, comme le Photolangage®, qu’il aura dans sa trousse du psychologue de Lyon 2. De plus, pour la première fois, les cours lui semblaient vraiment destinés à des psychologues et non plus à des psychanalystes. En effet, il lui avait toujours paru difficile de se fonder une identité de psychologue, étayée par les supports identificatoires fournis par une institution largement composée de psychanalystes. S’il lui paraissait évident que le référentiel analytique fournissait un éclairage clinique pertinent à la pratique du psychologue, le fait que la dimension clinique soit quasi exclusivement abordée sous le prisme de la métapsychologie, rendait difficile l’identification. À la fin de sa formation, il aurait le titre de psychologue clinicien, mais comment pourrait-il se définir ? « Métapsychologue », psychologue freudien, psychothérapeute, clinicien, testeur, psychopathologue… ? ? ?
Au cours de son deuxième stage, il fit petit à petit le deuil du psychologue idéal, du moins celui conforme à la théorie infantile du psychologue qu’il avait lors son inscription à l’université. Il percevait enfin que soigner, n’était pas guérir et cette distinction lui permit d’élaborer plus avant son identité. De même, lorsque le groupe d’« intervision », qu’il avait créé avec quatre de ses collègues, lui renvoya que le but de l’interprétation, telle qu’il la pratiquait, apparaissait plus comme une défensive mise à distance du patient par le psychologue stagiaire qu’il était, que comme une manière de faire lien et d’ouvrir le champ associatif, Anatole fut surpris de constater combien l’élaboration dans l’après-coup était nécessaire. Sa seconde présentation, dans le groupe d’analyse de la pratique, l’avait encore éclairé sur d’autres enjeux sous-jacents. Il se mit à écrire son deuxième dossier sur cette situation clinique et enchaîna sur son dernier dossier, celui qui lui paraissait le plus simple car le plus « technique ».
Il put ainsi soutenir en juin, pour être disponible plus rapidement sur le marché du travail. Cette soutenance lui permit de prendre du recul par rapport à cette année de formation et plus généralement depuis son inscription à l’université. Après quelques moments un peu difficiles, son tuteur n’étant pas toujours tendre avec lui, il comprenait et surtout vivait « crise, rupture et dépassement », bien au-delà de la théorie… C’est avec plaisir qu’il repensait aux derniers mots du jury de sa soutenance : « cher collègue ». Il était enfin diplômé, enfin psychologue, il ne lui manquait plus… qu’un travail.
Quel psychologue puis-je être dans cette place ?
À son grand étonnement – il avait toujours entendu que le marché du travail des psychologues était complètement saturé –, il trouva rapidement un poste de psychologue à mi-temps dans une petite institution recevant des adolescents ayant des troubles du comportement. Désormais, il n’avait plus de maître de stage, il était seul, livré à lui-même ce qui le rendait fier, mais l’angoissait également. Il se rendait bien compte qu’on ne devient réellement psychologue qu’à partir du moment où l’on n’a plus le statut de stagiaire. Au bout de deux mois, une situation de crise au sein de l’institution lui permit de commencer à asseoir sa place et d’être plus intégré par l’équipe : son intervention, sous la forme du Photolangage®, ayant favorisé la reprise d’un lien entre les professeurs des écoles et les éducateurs, alors pris dans des conflits ancestraux. Il analysa cette situation dans son groupe d’intervision et constata combien la technique avait été étayante pour lui. S’il trouvait petit à petit sa place au sein de cet établissement, c’était évidemment en s’appuyant sur l’analyse et la manière dont il parvenait à penser les processus, tant institutionnels que lors de ses rencontres avec les patients, mais aussi grâce au cadre théorique qui lui servait de garant. À l’inverse, il se sentait moins à l’aise avec les comptes rendus qu’il devait effectuer à destination de structures qu’il méconnaissait. Sa formation ne lui avait pratiquement pas apporté de méthodologie sur ce type de travail. S’il savait ce qu’était un cadre, il ignorait ce qu’était être un cadre supérieur. Il souffrait également d’une méconnaissance des structures en réseau avec son institution. Malgré tout, il put rapidement se documenter, puis participer à une session de la « CDES Commission Départementale d’Éducation Spéciale plénière » et se faire son idée sur son fonctionnement.
Au bout de quelques mois, le psychiatre, chef de service, avait confié à Anatole quelques suivis, ce qui dépassait ses compétences, pensait-il. Il entreprit alors une formation en thérapie familiale, qui lui apporta davantage d’outils pour penser sa clinique, mais surtout plus de confiance. Il expérimentait et s’appropriait progressivement différentes théories du soin, pour se construire la sienne propre : la catharsis, l’interprétation puis la fonction de contenance étaient venues tour à tour occuper son esprit et ses lectures avant qu’il puisse introjecter sa propre théorie du soin, celle avec laquelle il se sentait à l’aise pour travailler. En outre, sa participation à des colloques et à des conférences, ainsi que la lecture d’ouvrages spécialisés fournissaient à Anatole des outils supplémentaires pour tenter de mener au mieux sa pratique de psychologue. Si son employeur reconnaissait l’importance de ces démarches, il ne lui permettait pas pour autant de bénéficier d’un temps de travail à l’extérieur de l’établissement, ce qu’Anatole interpréta, étant donné son jeune âge, comme de l’anti-rides : Recherche Information Documentation Évaluation Supervision.