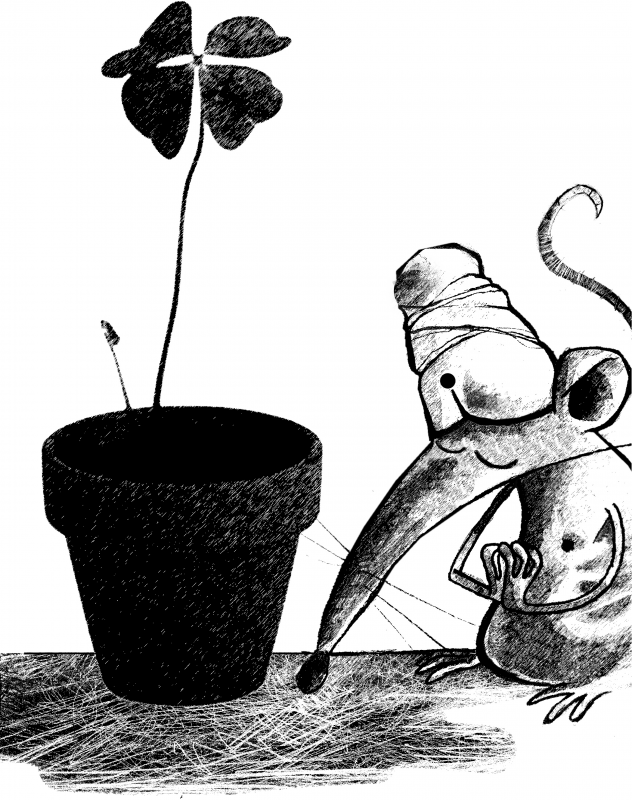« Moi je ne joue pas pour gagner ou pour perdre. Je joue pour savoir si je vais gagner ou perdre »
(Alfred Capus, 1890)
D’après l’Insee, en 2006, près de 30 millions de personnes en France, soit trois sur cinq en âge de jouer, ont tenté leur chance au moins une fois par an à un jeu d’argent. En outre, les mises engagées dans les divers jeux proposés par la Française des jeux sont en progression constante depuis 1977, ces dernières se montaient à 9,3 milliards d’euros en 2007, alors qu’elles n’atteignaient que la « modique » somme de 0,43 milliard d’euros en 1977.
La question que se sont posée les chercheurs à propos des conduites de jeu de hasard et d’argent peut être formulée assez simplement : comment se fait-il que l’on joue alors que la probabilité de perte est nettement supérieure à celle de gain ? En effet, la caractéristique des jeux de hasard et d’argent est que même si l’on additionne l’ensemble des gains, le total sera, globalement, toujours inférieur à la somme des mises, ce qui rend la valeur économique du jeu négative. À titre d’exemple, un « Banco » - un jeu de grattage dont la mise initiale est de « 1 € » - offre au joueur 1 chance sur 45 000 de gagner « 1 000 € », pour une valeur attendue de ce jeu de « 0,73 € » (moyenne des gains et des pertes pour l’ensemble des joueurs). Un joueur qui achète régulièrement un tel ticket perd donc, en moyenne, « 0,27 € ».
Une explication des conduites de jeu de hasard et d’argent, largement répandue dans la vie quotidienne, mais aussi dans la littérature scientifique, est l’attrait du « gros lot » (Brenner & Brenner, 1982). Ce paramètre objectif, basé sur une considération économiquement rationnelle, ne peut toutefois constituer une explication suffisante au fait qu’autant de personnes acceptent de jouer, et de perdre, à des jeux si inéquitables, chaque semaine et pendant des années (Rogers, 1998). Peut-on vraiment expliquer par un critère uniquement rationnel l’engagement dans des activités dont l’espérance de gain est négative, même si l’obtention d’un gros lot peut modifier une existence ?
Alors que la plupart des études investissent la situation de jeu selon une dynamique intra-individuelle, le présent travail a pour objectif de montrer que de telles conduites sont sensibles aux influences sociales. En premier lieu, quelques travaux en psychologie sociale ont investi les conduites de jeu par rapport à une perspective d’apprentissage social. Cette théorie de l’apprentissage social, proposée par Bandura (1977), accorde un rôle prépondérant à l’observation et à l’imitation dans l’acquisition et le maintien d’un comportement, aussi bien socialement désirable que socialement indésirable. Ainsi, plusieurs études suggèrent que la participation à des jeux de hasard et d’argent est implicitement renforcée par des facteurs tels que l’influence des pairs et de la famille. En d’autres termes, les parents et les amis serviraient de modèles. Le lecteur intéressé par cette piste d’une potentielle transmission sociale des conduites de jeu de hasard trouvera cette hypothèse développée dans un article à paraître dans la revue électronique du Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (Martinez, 2009).
En second lieu, si les gens pariaient uniquement en fonction du « gros lot », pourquoi les 38 700 points de vente de la Française des jeux afficheraient-ils des publicités indiquant que Monsieur « tout le monde » vient de gagner un gain tout à fait honorable, pouvant alors être considéré par les joueurs comme possible (par exemple au Banco : Ici, un gagnant à 1 500 €) ? Pourquoi les journaux locaux publieraient-ils les photos des gagnants qui vivent tout près de chez nous ? Pourquoi existerait-il une rubrique « joueurs et gagnants » sur le site internet de la Française des jeux avec des sous-rubriques telles que « palmarès des gagnants » ou « histoires de gagnant » ? De telles publicités reposent manifestement sur l’hypothèse d’un impact de l’annonce du gain d’autrui. D’une part, ces proclamations semblent, doper l’attirance envers les jeux de hasard et d’argent. La moitié des 182 participants (âge moyen 32,5 ans) d’une étude de Mushquash (2004), interrogés via internet, indiquent qu’ils ressentent l’envie de jouer lorsqu’ils savent que quelqu’un a gagné ; peu importe, d’ailleurs, que cette information provienne d’un proche, d’une vague relation ou d’un simple affichage. D’autre part, ces publicités pourraient accentuer le niveau de risque assumé par les joueurs. En effet, les résultats expérimentaux de Rockloff et Dyer (2007) ont montré que les participants qui recevaient des messages stipulants que d’autres joueurs pariant au même jeu de hasard qu’eux, à savoir une machine à sous, dans des salles adjacentes avaient gagnés, prenaient plus de risque en misant davantage que les participants qui l’ignoraient. Néanmoins, ces travaux laissent intacte une question cruciale : pourquoi cette annonce produit-elle un tel effet ?
Dans la perspective théorique de Langer (1975), il paraît plausible que cette annonce accentue la perception d’adresse et, corollairement, une perception d’un contrôle illusoire. En effet, si les gens reconnaissent généralement que les résultats des jeux de hasard et d’argent reposent strictement sur le hasard, la majorité des joueurs élabore néanmoins des stratégies et croit, alors, de façon illusoire, contrôler le jeu. Dans son article princeps, Langer (1975) définit l’illusion de contrôle comme « une surestimation de la probabilité de succès personnel par rapport à la probabilité objective » (Langer, 1975, p.311). Autrement dit, il s’agit d’une « perception de réussite qui dépasse les espoirs légitimes que prescrivent les lois de la probabilité » (Ladouceur & Mayrand, 1983, p.83). Selon Langer (1975), cette illusion est à attribuer au fait que les joueurs pensent que le jeu de hasard est un jeu d’adresse, dans lequel il est possible d’investir des connaissances pertinentes afin de maximiser ses chances de réussite. Cette croyance erronée en la possibilité de prédire avec justesse le prochain événement aléatoire, est d’ailleurs dominante chez la plupart des personnes en situation de jeu. En effet, de nombreuses études (pour revue, Ladouceur, Sylvain, Boutin, & Doucet, 2000) indiquent que 70 % des verbalisations, émises pendant la situation de jeu, sont erronées. Une verbalisation est qualifiée d’erronée lorsque le joueur fait référence à d’autres facteurs que le hasard pour justifier le choix de sa mise. En raison de son importance dans les comportements de jeu, la question de l’origine de l’illusion de contrôle devient cruciale. Selon Langer (1975), le degré de l’illusion de contrôle serait influencé par les caractéristiques du jeu. Ce chercheur a ainsi montré expérimentalement que, plus une situation de jeu de hasard et d’argent possède des caractéristiques inhérentes (ou du moins pouvant être reliées) à une situation d’adresse, plus les joueurs croient qu’ils peuvent y investir des connaissances pertinentes afin de maximiser leurs chances de gagner. La compétition, la possibilité de faire un choix, la familiarité et la participation active représentent des éléments d’adresse susceptibles d’accentuer l’illusion de contrôle des joueurs. Une autre perspective défendue par Wohl (2008) considère que l’origine de l’illusion de contrôle pourrait résider dans une représentation erronée de la chance. Plus précisément, certaines personnes se représenteraient la chance d’une manière « rationnelle », en la considérant comme aléatoire et instable, d’autres au contraire la verraient comme une force stable pouvant influencer les événements en leur faveur. Cette croyance en la chance, réactivée par des opérations publicitaires (par exemple, en France, la cagnotte du vendredi 13), cette illusion de choix véhiculée par la quasi-intégralité des jeux de hasard et d’argent (par exemple, le choix de ses numéros de loto, le choix du type de jeu dans une machine à sous) ne sont pas les seules « armes » pour amener les joueurs à considérer le gain comme possible et non illusoire. En effet, des travaux récents ont tenté de mettre en lumière une cause plus « sociale » en montrant qu’en situation de jeu, l’annonce d’un gain notable d’autrui induit cette perception selon laquelle il est possible et non-illusoire de gagner à condition de trouver les « bonnes » stratégies comme dans un jeu d’adresse. Ainsi, les données d’une étude de Martinez, Le Floch et Gaffié (2005) sont concordantes avec le modèle causal selon lequel l’annonce d’un gain notable d’autrui accentue une perception illusoire de contrôle, engendrant alors une augmentation de la prise de risque. Dans cette étude, les participants jouaient à un jeu de roulette française et disposaient tous d’un capital initial de 100 points. Avant le début du jeu, les participants étaient aléatoirement répartis dans l’une des deux conditions expérimentales suivantes : une condition sans annonce du résultat, une condition annonce d’un gain notable d’autrui (750 points). Il existait d’autres conditions de jeu que nous ne détaillerons pas ici pour la clarté de l’exposé. Les données expérimentales validaient le modèle causal selon lequel l’effet de l’annonce d’un gain notable d’autrui accentue la croyance en la possibilité d’utiliser des stratégies qui permettent d’augmenter la probabilité de gain, engendrant à son tour une hausse de la prise de risque. La roulette française est en apparence un jeu complexe. En effet, le joueur a le choix entre six types de paris possibles, présentant des probabilités de gain et des valeurs de retour différentes. Or, l’information sur les gains d’autrui porte essentiellement sur des jeux plus élémentaires, principalement les jeux de tirage (Loto, Euro Million) et les jeux de grattage. Dans cette optique, les résultats d’une autre étude de Martinez et Le Floch (2008) valident, dans un jeu d’apparence moins complexe, ce modèle causal selon lequel l’annonce d’un gain notable d’autrui accentue l’illusion de contrôle, mesurée selon la définition princeps de Langer (1975) par le niveau d’attente de réussite personnelle, engendrant alors une hausse de la prise de risque. Dans cette étude, les participants devaient piocher une carte dans un jeu classique de 32 cartes, du sept à l’as. Il y avait donc huit cartes cœur, huit cartes carreau, huit cartes pique et enfin huit cartes trèfle. Ils devaient parier sur le type de carte qu’ils allaient piocher. Si cette carte était du type sur lequel ils avaient parié, ils gagnaient deux fois leur mise. Avant le début du jeu, les participants étaient aléatoirement répartis dans l’une deux conditions expérimentales suivantes : une condition sans annonce du résultat, une condition annonce d’un gain notable d’autrui (750 points). Les résultats validaient le modèle causal selon lequel l’annonce d’un gain notable d’autrui accentue la perception subjective de réussite personnelle, engendrant alors une augmentation de la prise de risque. Les résultats de la présente étude confirment que les conduites de jeux de hasard sont sensibles à l’insertion sociale du gain d’autrui. Ils permettent également d’étayer les résultats précédents en indiquant que dans un jeu, présentant une structure plus élémentaire, la connaissance d’un gain notable engendre également une hausse de la prise de risque. Une dernière question subsiste alors : pourquoi l’annonce d’un gain notable d’autrui induit-elle une illusion de contrôle ?
Les joueurs évalueraient d’une manière biaisée le gain d’autrui en l’attribuant à ses compétences et non au hasard, comme ils le font pour les leurs. En effet, les joueurs pensent que les gains dans les jeux sont à attribuer aux stratégies plutôt qu’à la chance, et qu’au contraire les échecs résultent du hasard et non de l’inefficacité des stratégies employées (Gilovich & Douglas, 1986). Ce n’est donc pas en soi la connaissance du gain d’autrui qui accentue la prise de risque dans un jeu de hasard et d’argent, mais la croyance que ce gain émane du contrôle d’autrui. Il peut être donc supposé que l’accentuation de la prise de risque suite à une telle annonce est inhibée, en rendant expérimentalement saillant le fait que le hasard est le seul responsable de ce gain. Afin de tester cette hypothèse, une récente expérience (Martinez, Le Floch, Gaffié & Villejoubert, soumis) consistait à jouer à la roulette française. Avant le début du jeu, les participants étaient aléatoirement répartis dans l’une des trois conditions expérimentales suivantes : une condition sans annonce du résultat, une condition annonce d’un gain notable et une condition annonce d’un gain notable non contrôlé. Dans cette dernière condition, l’expérimentateur ajoute : « mais il m’a dit qu’il ne contrôlait pas la situation, qu’il avait joué au hasard et puis voilà 750 points ». Les résultats ont montré que les participants exposés à un gain notable d’autrui, mais qui estimaient après une manipulation expérimentale que le bénéficiaire du gain notable ne contrôlait pas la situation, ne manifestaient pas une accentuation de leur perception illusoire de contrôle ; l’accentuation de la prise de risque était alors supprimée. S’il est possible de diminuer la prise de risque consécutive à l’annonce d’un gain, il importerait alors de joindre, aux multiples promotions du gain d’autrui, un communiqué sur l’absence de contrôle d’autrui sur son gain, afin de prévenir les accentuations de prises de risque provoquées par ce type de promotion.
Ces résultats mettent en exergue l’intérêt d’inclure certains paramètres sociaux, tels que la connaissance des gains d’autrui, dans l’étude des mécanismes impliqués dans le développement et le maintien des conduites de jeux de hasard et d’argent. En accord avec la théorie des perspectives (Kahneman et Tversky, 1979 ; Tversky et Kahneman, 1992), les comportements de prise de risque ne semblent donc pas préexister dans l’esprit des joueurs, mais seraient plutôt construits au cours du processus décisionnel, en fonction de la connaissance d’un gain notable d’autrui.