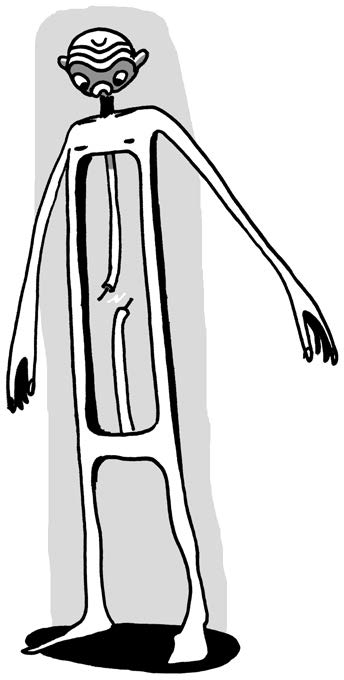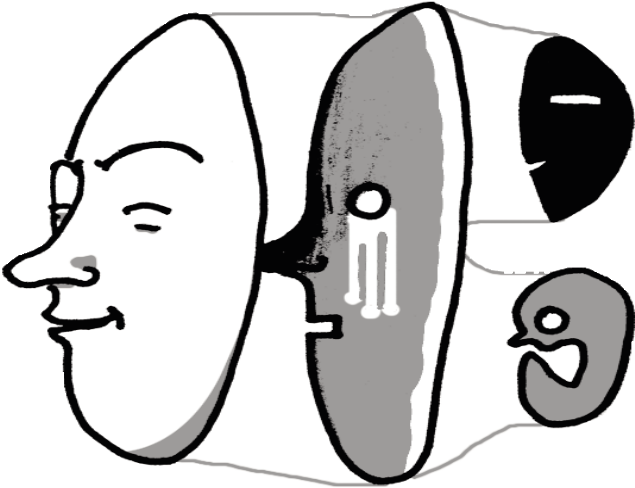« J’ai toujours eu la sensation qu’il y avait en moi un être assassiné. Assassiné avant ma naissance. Il me fallait retrouver cet être assassiné. Tenter de lui redonner vie. »
S. Beckett
La maison d’accueil psychothérapique (MAP) est un dispositif de soin de l’association Santé Mentale et Communautés, centré sur l’accueil et l’accompagnement de la crise. La MAP s’est construite dans l’héritage d’une théorie et d’une expérience des soins centrée sur l’« accompagnement de la vie ordinaire » et le partage des effets de ce « vivre avec » comme permettant une élaboration partagée des enjeux psychiques mobilisés. La MAP se présente comme une maison ordinaire composée au rez-de-chaussée d’espaces communs et à l’étage de 7 chambres pouvant accueillir les patients. L’ensemble donne l’impression troublante d’être dans un (presque) chez soi, tant la configuration des lieux nous interpelle dans ce registre. La MAP propose à des personnes en période de crise des séjours séquentiels d’une durée de deux mois. Du lundi au samedi midi, les patients ont la possibilité de vivre dans « la Maison » où ils disposent d’une chambre. Le quotidien s’organise entre-temps formalisés – entretiens, groupes, repas – et informels où chacun est libre de vaquer à ses occupations dans l’espace de la MAP ou à l’extérieur. L’équipe, composée de deux infirmières, de deux psychologues et de trois psychologues stagiaires partage la vie quotidienne des patients. Une psychiatre et un psychologue interviennent dans une position d’extériorité pour interroger, pour les soignants et les patients, ce qui se joue au quotidien. L’injonction sous-jacente du dispositif pourrait être ramenée à un paradoxal « faites comme chez vous » ; paradoxal car reposant sur une ambiguïté structurelle – lieu de soin/lieu de vie – qui provoque, que l’on soit soignant ou patient, une sensation d’inquiétante étrangeté. Cette ambiguïté rend possible l’investissement du lieu comme espace de transitionalité, comme « espace scénique. » Il ne s’agit plus, dès lors, uniquement d’un accueil de la crise, mais d’une re-création dans une autre scène. À charge pour les soignants de se laisser happer par les enjeux transférentiels mobilisés par les patients et par l’ambiguïté, de travailler dans et avec les scènes recrées, à l’intérieur d’un espace de jeu parfois réduit à sa plus simple expression.
Accueillir un négatif de la crise ?
Romain est un jeune homme d’une vingtaine d’années, aîné d’une fratrie de deux enfants, venu à la MAP suite à une hospitalisation. Après une enfance et une adolescence peu évoquées, sinon le fait qu’il a perdu son père dans un accident de la route quand il avait six ans, il rapporte que ses difficultés ont débuté quand il a voulu quitter le domicile familial. Il a fait de nombreuses tentatives pour s’inscrire dans un cursus de formation, puis a arrêté ses études pour effectuer des remplacements dans une banque. Il disait vouloir y travailler dans la « gestion de patrimoine ». Il a pris un appartement à la suite de son frère cadet mais est vite retourné chez la mère. Quelque temps après, sa mère l’a trouvé, dans la nuit, effondré dans la salle de bain et il a été hospitalisé dans un état décrit comme « quasi-catatonique ». Le psychiatre a insisté sur un mouvement dépressif marqué et le climat de violence envers sa mère. La crise de catatonie a assez vite évolué dans le cadre hospitalier, si bien qu’il a été orienté vers la MAP. Ancien stagiaire de ce lieu, je venais cet été-là en tant que psychologue pour un remplacement ; or il se trouvait que nous avions des prénoms en résonance et un âge proche. D’emblée, ce qui m’a étonné dans la rencontre avec lui c’est le décalage apparent entre l’intensité de la crise décrite et l’espèce de « banalité » dont il faisait preuve au quotidien. Il était poli, discret, semblant se fondre dans les murs. S’il était assez blessé narcissiquement, la crise paraissait absente, non seulement de son discours mais aussi de ce qu’il donnait à voir. À nos sollicitations, à notre regard, il répondait par une sorte de réduction de sa présence, de ses regards, de ses mots. Il semblait fuir à l’intérieur. Par la suite, il décrira avoir vécu cette longue période dans une « bulle », figurant une enveloppe sans aspérité. Outre l’a-conflictualité, cette première période de son séjour reste pour moi marquée par une certaine atemporalité, rien ne semblant venir faire véritablement scansion. Face à lui, j’avais continuellement l’impression d’être mis en échec, « désarmé », démuni, ce qui me mettait en colère. Nous semblions parler « de la pluie et du beau temps », dans un lieu « quelconque ». Il était difficile en équipe de penser quelque chose de lui et d’en parler. L’interprétation de ces mouvements en termes de résistances au soin, de défenses perverses, voire de réponse à notre désir de soigner par la neutralisation et l’attaque du dispositif est possible. Je voudrais plutôt faire l’hypothèse qu’il venait mettre en scène non pas la crise mais son absence, voire son impossibilité – renvoyant sans doute à une autre scène. Une hypothèse complémentaire serait que la MAP, en accueillant ce négatif de la crise est devenue un dispositif en crise dont les fonctions de transitionalité et de symbolisation sont neutralisées : la crise d’ordinaire contenue par le dispositif devenait contenue dans le dispositif.
Le monde clos et le père mort
Des entretiens familiaux ont eu lieu, vers le milieu de séjour, à la demande de Romain, pour, disait-il, « crever un abcès ». Romain a introduit ces entretiens auxquels j’ai participé en compagnie d’une psychologue stagiaire, en parlant d’un sentiment de colère dont il ne restait que les traces sensorielles, qu’il organisait a posteriori comme étant le fruit d’une enfance malheureuse. Il se souvenait d’une mère parfaite sur le plan matériel mais absente sur le plan affectif. La mère de Romain m’a semblé assez jeune, séduisante, me faisant penser à une « mère-adolescente ». Elle a pu dire qu’elle était elle aussi très en souffrance vis-à-vis de ses parents et disait avoir fait ses enfants « dans une tentative de réparation » mais ne s’être jamais sentie capable d’être mère. Cela me rappelait un entretien individuel où Romain évoquait une « fragilité » héritée de la mère. Il semblait souligner son propos en arborant un T-shirt « Téléthon » et une posture molle qui m’évoquaient la myopathie et une difficulté d’accès à la verticalité. Le père de Romain, était décrit par la mère comme absent, et cela dès avant sa mort réelle. La mère de Romain disait tenir « les deux rôles de père et de mère », et être, selon son expression, « parent(s) ». Le décès semblait avoir eu peu de conséquences dans ce contexte ; « comme s’il n’avait jamais vraiment existé, mort avant d’être mort » pensais-je alors. D’ailleurs, au-delà de la place du père, c’est toute place d’homme auprès de la mère qui semblait déniée. J’avais ainsi de grandes difficultés à exister en face d’elle, et avais l’impression qu’elle tentait d’occuper pendant l’entretien à la fois la place de mère et de psy. En arrière-fond se trouvait un secret familial douloureux – d’où les références chez Romain à l’abcès et à la gestion de patrimoine ? – dont nous imaginions qu’il pouvait avoir trait à l’homosexualité possible du père. Romain évoquant son enfance, se décrivait comme « jamais seul », sa mère étant « toujours sur son dos ». De son côté, sa mère parlait d’un « moule » imposé à ses enfants où ceux-ci devaient être parfaits, sans doute dans une fonction anti-dépressive. L’ensemble donnait à penser à un écrasement des générations et à un espace psychique pour deux : un « monde clos ». D’ailleurs quand Romain a évoqué son départ de la maison à la suite de son frère cadet, sa mère se disait « réjouie » – tout en me faisant ressentir, dans une forme de communication paradoxante, une profonde détresse. Romain, lui, me donnait l’impression de fuir un « danger » imprécis. Dans les deux cas, l’ambivalence était exclue et l’ensemble donnait à imaginer une séparation incomplète et douloureuse, impossible. Or, ce que Romain et sa mère nous rapportaient au cours des entretiens familiaux trouvait une certaine résonance dans des scènes vécues antérieurement à la MAP. Dans ces scènes étaient sensibles la tentative d’échapper au désir maternel et de construire un pôle de conflictualité et d’identification avec un tiers potentiel. Je pense ici à une patiente qui, ayant un fils de l’âge de Romain qui avait un prénom proche, tentait de « jouer » avec lui quelque chose d’une relation mère-fils teintée d’écrasement des générations et de séduction. Pris, à son corps défendant dans ce mouvement transférentiel, il s’est tout de même prêté au jeu, jusqu’à ce qu’à l’occasion d’un conflit avec elle, il lance un cinglant : « Vous me faites halluciner ! ». Une apostrophe qui m’avait interpellé quant à la qualité du lien mère-fils. Par ailleurs, un jour Romain m’a proposé une partie d’échecs. Il m’a expliqué qu’il avait appris avec ses oncles, mais qu’il n’y avait plus joué depuis qu’il était enfant. Plutôt, je venais à la suite d’un psychologue plus âgé parti en vacances alors qu’ils étaient à une victoire chacun. Plus qu’en remplacement, je me sentais à une place de « sparring partner » en prévision de l’affrontement à venir – rivalité à laquelle j’étais identifié au point de commettre un lapsus en parlant au psychologue : « c’est pour préparer “mon” – je voulais dire “son” – affrontement avec toi ». Le style de jeu de Romain, tout en prudence et en maîtrise, semblait paralyser mon jeu, et me rappelait son mode de relation au quotidien. Si ces parties d’échecs proposaient une médiation sur le terrain de l’affrontement et de la transmission – donc de la recherche d’une position paternelle – le plaisir ludique, le ludique même, semblaient absents tant les enjeux paraissaient se situer ailleurs, dans les couples maîtrise/soumission ou meurtre/survie. Aussi, après un premier temps de fonctionnement en miroir – en double – où je masquais les affects que ces parties suscitaient en moi et ne les laissais s’exprimer qu’une fois seul dans le bureau, je me suis mis petit à petit à les théâtraliser devant lui.
L’absence du père au cœur du dispositif
Jérôme Dupré-Latour
J’ai évoqué plus haut l’hypothèse selon laquelle la crise avait migré dans le dispositif. Nous verrons ici comment ce travail se poursuit à l’approche de la fin de séjour. À l’évocation d’une réunion de groupe, Romain parlera de sa difficulté à entendre un psychologue parler de ceux qui sont partis, et du temps qu’il reste aux présents. M’est alors venue une image étrange et énigmatique : j’ai imaginé ce psychologue habillé en « faucheuse », cape noire, faux et sablier, venant égrener le nom des morts. Cela ne prendra sens qu’à la fin de son séjour quand Romain, dernier patient entré, s’est retrouvé seul à la MAP – reproduisant le « seul à seul » avec la mère. Dans cette configuration le dispositif est généralement aménagé en n’ouvrant plus qu’en journée. Dès lors, le fantasme que « la MAP va mourir si son dernier patient s’en va » – donc d’une dépendance en double – semblait sous-jacent à la fois pour Romain et pour l’équipe. Obligé de rentrer chez lui le soir, il mettait en scène sa déréliction, ne se réveillant plus le matin, tombant de sommeil dans la journée, provoquant chez moi l’idée d’un effondrement possible. Il a alors avancé l’idée qu’il aimerait prolonger son séjour car il avait trouvé une mission intérim et avait peur de reproduire la situation initiale. Bien que chacun perçoive le caractère étrange et transgressif de cette demande, il semblait impossible de « trancher » et une semaine de prolongation fut accordée. Par association avec une patiente qui parlait de la sortie comme renaissance, je me disais que celle de Romain nécessiterait une césarienne, donc que nous nous trouvions dans un registre archaïque et violent – proche du corps à corps et du déchirement – de la séparation. Comme il faisait sa demande à un homme et une femme, j’ai proposé l’idée qu’il faudrait que « papa MAP » et « maman MAP », entendus comme composantes du dispositif, conflictualisent pour lui cette question. Reste que cela ne semblait pas fonctionner, tant nous semblions pris dans « l’impossible » du départ. La crise du dispositif semblait située cette fois dans l’accès à cette place paternelle, ce qui nous renvoyait au « père absent/mort » et à l’impossibilité pour lui de s’ériger. Comme si le groupe au lieu de représenter des composantes parentales était devenu différentes parties de la mère archaïque – le « parent(s) ». De fait, la castration et la séparation signifiées par la fin semblaient ne pouvoir être symboligènes mais provoquer la menace d’un effondrement subjectif.
Du hors champ à l’exposition
La crise, après avoir semblé absente, puis contenue dans le dispositif, mise en scène avec une patiente, reviendra à l’occasion de la fin de séjour sur le devant de la scène. Au cours d’un des derniers repas, Romain a annoncé qu’il ne se sentait pas bien et a demandé à sortir. Quelques temps plus tard, surpris de ne pas le voir revenir, je suis allé voir. Je ne l’ai pas trouvé et j’ai pensé qu’il avait disparu. Inquiet, j’ai poursuivi ma recherche et l’ai trouvé allongé dans l’herbe, complètement figé. Ma première pensée fut : « il est mort » et je fus traversé par un mouvement de détresse. Il ne semblait pas accessible mais je sentais confusément qu’il fallait lui parler. Il répétait en larmes : « mon cerveau lâche » et « je veux mourir ». J’ai essayé de mettre des mots sur son vécu puis j’ai dit qu’il ne pouvait pas rester comme ça dans l’herbe humide. Il s’est alors levé, m’a suivi et est monté dans sa chambre. J’ai pensé, à nouveau plein d’effroi, à la possibilité du suicide et suis retourné le voir en lui expliquant que je ne « voulais pas le laisser seul avec ça » – ou me laisser seul avec ça ? J’avais l’impression de me « raccrocher aux branches ». J’ai fait plusieurs mouvements d’aller-retour entre lui et le groupe, jusqu’à ce qu’il nous rejoigne à table. Dans l’après-midi, il m’a expliqué que le regard d’une patiente l’avait fait « craquer » ; il se disait persécuté par le regard de ceux qui « ne se sont pas débarrassés du regard des autres », ce qui les rend fragiles. Il faisait référence à cette patiente, à une stagiaire et une infirmière qui lui évoquaient sa mère. Cela l’amenait à vivre dans une intranquilité continuelle, les autres, et donc la mère, étant toujours présents à l’intérieur de lui, via leur regard et une voix qui juge ce qu’il fait/est. Il se demandait comment vivre sans être coupé du regard des autres, comme au début du séjour, sans non plus être écrasé par ce regard. Il m’a alors demandé comment moi je faisais. Mal à l’aise d’être amené sur un terrain intime, j’ai fini par lui dire que ce qu’il amenait était une problématique assez universelle. De pointer la dimension « humaine » de son vécu a semblé lui permettre de poser des mots et des affects à la place d’un vécu de honte et de solitude.
Jérôme Dupré-Latour
Une de mes premières élaborations concernant cette scène fut que j’étais interpellé là de manière disproportionnée. Comme si je n’étais pas spectateur, mais inclus dedans, « pris dans le cauchemar de quelqu’un d’autre ». En témoignent mes vécus de solitude, de détresse, qui semblent renvoyer aux siens. J’ai évoqué plus haut la proximité de nos âges et de nos prénoms qui amenaient certains à nous confondre. Que cette scène ait été vécue avec moi tient peut-être au fait que nous étions également pris dans une même temporalité. En effet, je terminais mon remplacement le jour même de son départ ; nous avions donc en partage la difficulté de la séparation. Le travail en double sensible dans les parties d’échecs se poursuit dans la scène ci-dessus, quand mon élaboration et mes actes semblent procéder autant de sa survie que de la mienne. Dans cette situation, je me retrouvais en position de lui montrer, plus ou moins consciemment, « comment je faisais avec ça ». La pensée qu’il est « réellement » mort souligne, à mon sens, que nous étions dans un espace archaïque, d’où la dimension transitionnelle est absente ; réel et imaginaire de la mort sont accolés dans un mouvement qui serait, dans la continuité du « Je pars, vous mourrez » évoqué plus haut, un « Je pars, je meurs ». Les angoisses de mort et de séparation semblaient accolées et la crise étroitement liée à un impossible de la séparation. On pourrait situer cette « agonie », dans le passage de « je suis le sein » à « je perds le sein », ramené ici à un je suis la MAP/je perds la MAP, soit un vécu d’agonie primitive d’avant la constitution d’un espace transitionnel et l’introjection de l’objet perdu. Une hypothèse complémentaire consisterait à dire que quand il « fait le mort » il vient signifier la place du père et me faire vivre d’abord l’absence, puis la disparition, et enfin la découverte brutale de la mort. Le passage de l’état de détresse à une conversation adulte m’a amené à penser que l’adolescence était absente de la scène, comme elle l’était de son histoire et de son séjour. Le « danger » éprouvé dans le seul à seul avec la mère pourrait être rapporté au caractère massif et indépassable des enjeux œdipiens, entre autres du fait de l’absence/déni de la position paternelle. La crise de catatonie aurait alors une fonction d’emprise pare-excitante en immobilisant le corps – la possibilité de réalisation des enjeux pulsionnels – et la psyché. Un paradoxe se dessine selon lequel l’impossibilité à entrer en crise serait constitutive de la crise. La constitution d’un fond sécure au début du séjour, quand la crise était contenue par/dans le dispositif, quand notre désir de soigner s’est relâché, semble avoir permis la remise en jeu de la crise et son passage du hors champs à l’exposition au regard de l’autre. En partant, Romain parlera de ces événements comme de sa « dernière crise », quelque chose semblant s’être décalé pour lui dans la répétition, passant de l’impossibilité à la figurabilité.