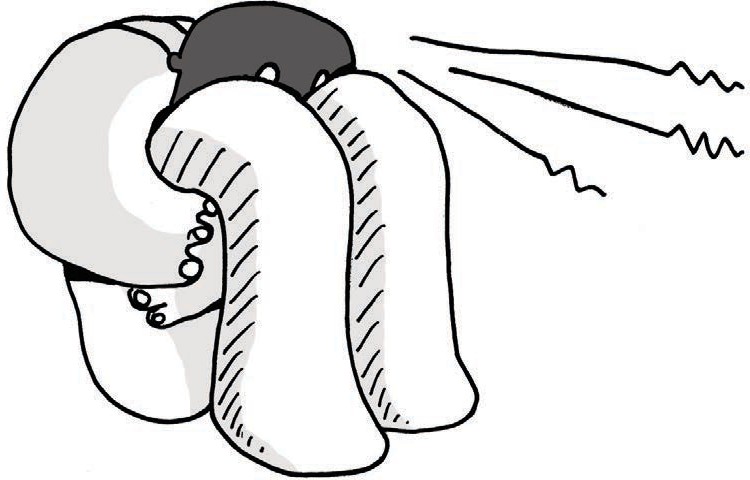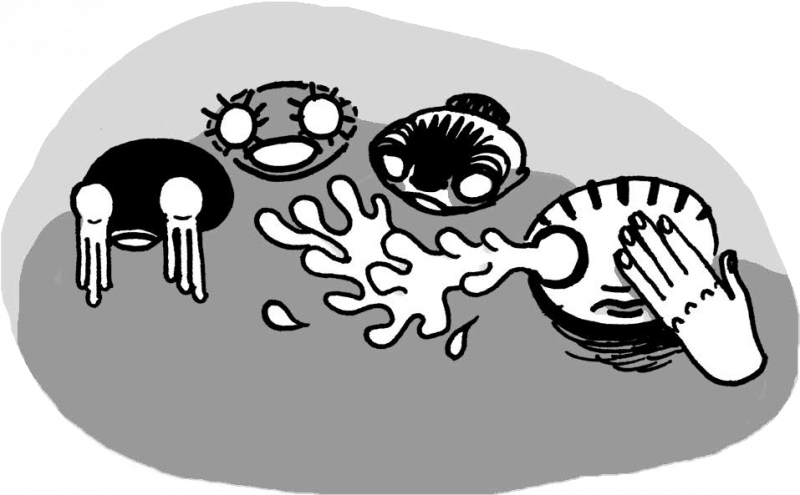Les centres de thérapies brèves sont des lieux de consultations ambulatoires, destinés à accueillir une population en situation de crise psychique, relationnelle, et même sociale. Existant depuis une dizaine d’années sur la région lyonnaise, ces lieux dépendants de la psychiatrie publique, sont souvent interpellés afin de prévenir une hospitalisation, ou à la suite de gestes suicidaires. Les contextes peuvent être familiaux, conjugaux, événementiels, et plus récemment professionnels. Les personnes y sont reçues dans de brefs délais par deux soignants (psychologue, infirmier, médecin). La pluriprofessionnalité dans les entretiens permet à la fois de poser d’emblée quelque chose du tiers, de la diffraction des mouvements transféro-contre-transférentiels, mais plus simplement d’écouter le sujet à différents niveaux dans sa demande : réalité de la gestion du quotidien, mouvements et processus psychiques… Chaque CTB travaille avec la notion de n’être qu’un lieu de passage ; ce qui implique, dans les prises en charge, de tenir compte des ressources des personnes consultantes, mais aussi de penser la séparation pratiquement d’emblée. Nous tentons donc de cibler ce qui fait crise pour la personne, pour l’accompagner vers un dépassement de celle-ci, et l’aider à retrouver un équilibre suffisant. Ainsi, le travail des liens est au centre des préoccupations des soignants du CTB : liens avec l’entourage, le secteur social, les soignants…
Sur un plan plus institutionnel, les CTB se rencontrent régulièrement pour échanger sur les problématiques rencontrées et leurs pratiques. Au cours d’une de ces rencontres autour de la prise en charge des situations traumatiques, nous posions la question de la place du certificat médical attestant de « trauma ». Dans l’échange qui s’en suivi, apparut que cette demande concernait plus fréquemment encore les situations de harcèlement au travail. Il fut alors convenu que le thème de la future rencontre inter-CTB porterait sur les liens entre crise et travail. C’est donc à partir de cette réflexion commune à l’ensemble des CTB de l’agglomération lyonnaise sur la fréquence des demandes émanant de personnes vivant des « crises professionnelles » que je propose la présentation suivante.
Jérôme Dupré-Latour
Le CTB dans lequel j’interviens avait déjà plusieurs fois interrogé cette place particulière que prend le travail chez certains sujets. Nous avons donc, pour approfondir notre réflexion, commencé par définir ce que pouvait représenter la notion de travail. Par ce petit tour historique, chacun s’est aussi situé sur ses propres représentations du travail, en même temps qu’un regard nouveau sur les problématiques des patients du CTB se faisait jour. Voilà l’angle par lequel nous avons entamé notre réflexion.
La notion de travail a beaucoup évolué depuis l’époque à laquelle ce mot qualifiait plutôt des instruments de torture à trois pieux (lat. tripalium), ou encore un dur labeur, ou plus récemment encore était associé à la douleur précédant un accouchement (être en travail). Le mot travail désigne donc soit l’ouvrage lui-même, ou celui qui est à faire.
Kant voit dans cette contrainte qu’est le travail la seule « source pédagogique de la formation de l’être humain ; l’être moral est alors capable ainsi de dépasser une partie de sa nature violente et immédiate, et de construire sa liberté ». Et si l’on se réfère à la Genèse : « tu travailleras à la sueur de ton front ». Dans chacune de ces images ou représentations du travail, il est question d’un lieu d’investissement contraignant.
Mais, la valeur sociale du travail change également. Il y a encore peu, le travail n’était guère un lieu de plaisir, mais une nécessité pour, plus tard, devenir un vecteur d’accomplissement, de réalisation de soi. Depuis la vague des 35 heures, il devient presque secondaire, un lieu « de plaisir/déplaisir » parmi d’autres, obligeant ainsi à une diffraction des lieux d’investissement tant sociaux que psychiques, un remodelage de l’identité et de sa construction, là encore tant du point de vue social que psychique ; et c’est ainsi que la plupart des gens le considèrent aujourd’hui.
À partir de ce déchiffrage psychosocial, nous sont revenues en mémoire les deux histoires suivantes : elles nous semblaient tirées d’une époque pendant laquelle le travail était symbole exclusif de réussite à l’image de Stakhanov, alors qu’elles étaient contemporaines de l’après passage aux 35 heures, signe éventuel d’effet iatrogène des modalités d’investissement du travail.
Jérôme Dupré-Latour
Histoire clinique : Mme L. arrive au CTB suite à une tentative de suicide médicamenteuse grave, peu avant Noël, et explique son geste par une accumulation de tension au travail. Elle travaille dans la même entreprise depuis 30 ans, elle y a gravi les échelons pour arriver à un poste à responsabilités ; mais depuis deux mois un changement de direction amène des conflits avec le nouveau responsable qui la disqualifie dans son travail.
Mme L. âgée de 48 ans, parle de son investissement dans ce travail comme très important, reconnue et soutenue par ses supérieurs, elle ne peut s’en séparer, et évoque le plaisir qu’elle y trouve. Elle emmène du travail chez elle et a du mal à déléguer.
Les propos disqualifiants du nouveau responsable l’envahissent, au point de vouloir mettre fin à ses jours, sont restitués à chaque entretien. En l’interrogeant sur cette répétition, elle répond en nous contant avec émotion une enfance où sa mère n’a jamais aimé ses enfants, sans affection, sans tendresse, sans câlin disant toujours que c’était des bouches à nourrir, une charge pour les parents, percevant dans le discours de son supérieur une répétition de cette expérience peu bienveillante.
Actuellement c’est elle qui s’occupe de cette mère qui vieillit seule, abandonnée par ses autres enfants. Elle parle avec tristesse du fait qu’elle-même n’a pas d’enfant et dit qu’elle ne peut donner ce qu’elle n’a pas reçu.
Au cours des entretiens elle parlera de son impossibilité à dire « non » de peur d’être rejetée, de son manque de confiance en elle face à de fortes personnalités qu’elle définit comme perverses, de sa crainte d’affronter les autres, ne se mettant jamais en colère, refusant tout conflit.
Elle prend progressivement conscience de l’envahissement de sa vie par le travail, sans qu’il n’y ait de place pour le reste, parle du tout ou rien, des limites à trouver, ce qui fait écho pour elle à son attitude face à une mère toute-puissante sans doute idéalisée.
On aborde alors la question de la reconnaissance, du mérite, qu’elle a obtenu dans le travail pendant un temps, comme déplacement dans la tentative de résolution de la relation à sa mère, mais sans doute inopérante du fait de la fragilisation qui suit les changements professionnels, mais aussi par le fait qu’elle n’a pu imaginer avoir d’autres enfants que son travail.
Au terme de la prise en charge CTB, elle organisera sa vie entre travail, qu’elle reprendra à mi-temps thérapeutique, loisirs et vie de couple pour laquelle son mari l’interpellait déjà souvent, sans qu’elle ait pu alors l’entendre.
M. B. vient consulter suite à un accident de travail un an auparavant provoqué par une chute grave dans les escaliers sur son lieu de travail. On note que son épouse un mois plus tôt fait une chute dans sa maison en tombant d’un escabeau et se blesse sérieusement.
M. B. âgé de 57 ans dira « avoir été touché en plein vol ». Directeur de grand magasin, il avait tout investi dans son travail, n’ayant aucune limite et délaissant sa famille. Il se rend compte aujourd’hui qu’il est seul et dit « j’ai perdu mon jouet ». Il décrit son emploi avec passion comme un jeu, une scène de théâtre dans laquelle il aurait un rôle principal.
Le retour à la maison lui est difficile et lui fait dire qu’il est « dans les pattes » de sa femme sans savoir ce qu’il doit faire, se trouvant alors dans une place qu’il n’a jamais occupée, alternant abattement et optimisme.
Il a perdu ses repères physiques, psychiques, se sent vieux, dans l’impossible de faire le deuil de « son » magasin.
De son histoire, il est l’aîné de deux garçons ; son père, qui était également directeur de grand magasin, décède à l’âge de 54 ans d’une crise cardiaque sur son lieu de travail. M. B. pointe le fait qu’il ait presque le même âge que son père lorsqu’il est décédé d’épuisement, dira-t-il.
Il reprend le métier, « son univers », à l’âge de 19 ans, après l’armée alors qu’il était en poste à Paris comme technicien dans une société. Il parle du poids de ce qui lui a été inculqué en ce qui concerne le travail, s’est mis dans les pas de son père, un homme qu’il admirait beaucoup.
Son épouse évoque un changement de patron il y a 6 mois et la pression importante de ce nouveau dirigeant. Elle dit que son mari a accepté d’être autant dévalorisé, voir maltraité ne comptant pas ses heures au travail. Elle souligne la difficulté de son mari à évoquer les événements douloureux, la mort de leur premier enfant à l’accouchement, mort de son père dont il n’a jamais rien dit.
Elle pose la question d’une mise à distance du couple afin qu’elle puisse souffler mais son mari est dans l’incapacité de pouvoir l’envisager au risque d’un effondrement total.
Au bout de deux mois de prise en charge l’amélioration se fait sentir ; M. B. parle de sa vie passée en disant « c’est comme un deuil ».
Dans ces deux situations, le travail apparaît comme un objet d’investissement unique, avec lequel est développé un mode de relation anaclitique : Mme L. dit ne pas pouvoir s’en séparer, ramenant du travail chez elle soir et week-end ; M. B. dit n’avoir eu aucune limite, délaissant sa famille. Pour ces deux situations, le travail a été investi de manière massive, vecteur de reconnaissance, jouant son rôle d’ascenseur social, au moins pendant un temps.
L’appartenance professionnelle est l’identité, comme un tout, remplissant un ensemble de fonction amenant de la satisfaction, de la satiété. Les différents espaces d’affiliation possibles ne semblent pas exister, nous notons peu d’investissements d’espace de liens sociaux autres qu’au travail, de la famille. Ainsi s’instaure un effet miroir entre l’image du professionnel et l’image narcissique. Le métier est alors la seule identité possible, se construisant dans un mouvement de collage identificatoire.
Ainsi, le travail aurait pendant un temps, sans doute à l’image d’une illusion, une valeur structurante, organisatrice, contenante, justement par ce qu’il vient proposer une surface projective globalisante à l’image d’un objet total.
Pour Mme L. le travail a permis de tenter la réparation de manière intersubjective des manques affectifs qu’elle perçoit au niveau intrapsychique. Elle se donne alors les moyens de « pouvoir nourrir les bouches » qu’elle n’a pas, en obtenant l’attention qu’elle s’acharne à avoir comme autre bénéfice !
M. B. évoque un père idéalisé, travaillant constamment, pour lequel on peut sous-entendre une absence auprès des enfants. On peut alors se demander si l’enfant qu’il était n’a pas été intrigué par ce lieu d’investissement, de jouissance exclusif qu’était le travail pour son père, en même temps que les mouvements identificatoires l’amènent à se construire une représentation de l’homme-père comme se réalisant dans cet espace.
Nous pouvons nous interroger sur la fonction d’espace de transitionnalité, lieu de sublimation, dans le travail, permettant de rejouer dans cet espace ce qui est défaillant, peu ou pas structuré dans les investissements primaires et secondaires, dans lequel nos deux protagonistes se sentent avoir une place, un ancrage social « au regard de ». Le travail est le lieu de la reconnaissance sociale et narcissique, reconnaissance qui semble aussi faire défaut dans les liens précoces.
Cette fonction est mise à mal lors de la survenue d’un changement de supérieur (substitut parental défaillant ?) ; changement qui rappelle alors la réalité de cet espace d’investissement, lieu du travail, venant intruser une construction fantasmatique des liens familiaux idéalisés… Il devient alors l’espace de répétition traumatique, sans aboutissement à une élaboration possible. On passe du travail paradis au travail enfer. Le harcèlement, la dévalorisation, les pertes successives amèneront Mme L. à une TS grave, M. B. à une chute sur le lieu du travail.
Face à un excès d’investissement dans le travail, on peut poser la question de la fonction défensive de cet hyper investissement. Le changement dans le travail produit une perte d’étayage, de portage, révélant les carences du handling et du holding préfabriqué, déplacé.
Le travail sans limite, comme quelque chose dans lequel on se noie, qui permet d’entretenir une forme de dénégation par un déplacement sur ce lieu-là, de ce qui ne peut se traiter ailleurs, notamment de façon intrapsychique. Quand le travail fait crise, il fait crise pour le sujet, jouant alors le rôle de révélateur comme en photographie, de ce qui était jusqu’alors tentative de refoulement.
L’identité professionnelle, dans sa valeur de tout, en se fissurant, laisse apparaître un mécanisme de construction en faux-self, mettant à jour un risque d’effondrement proche de la néantisation, effondrement dépressif majeur. Le travail semble alors avoir été mis en lieu et place d’objet transitionnel, mais n’ayant finalement pas rempli sa fonction symbolisante, échouant ainsi dans cette fonction, n’ayant fait que l’ébaucher. Ce qui a pu se sublimer pendant un temps dans le travail n’a pas été intériorisé. Ce type de rapport au travail invite à l’émergence d’autres représentations plus archaïques, le travail « ventre maternel », dans lequel on tenterait de retourner pour s’originer ailleurs que là où ça a déjà été défaillant dans l’histoire du sujet, avec peut-être le fantasme de fabriquer un nouveau roman familial ?
Par ailleurs, ces deux situations cliniques nous permettent de mesurer l’étroitesse des liens entre organisation sociale et vie psychique. Nous savons déjà que les manifestations de la vie psychique utilisent des objets culturels, les supports aux délires ne sont pas les mêmes aujourd’hui qu’il y a 50 ans seulement, et nous voyons par ailleurs se développer une pensée sur la clinique psycho-sociale (cf. Orspere).
Dans l’organisation sociale et professionnelle actuelle, avec ce que nous connaissons des techniques de management, des exigences de l’entreprise, mais aussi en tenant compte des changements importants survenus dans nos représentations du travail et de sa place, nous pouvons interroger l’idée de ce que serait le modèle du salarié aujourd’hui : un Stakhanov serait-il toujours le modèle ouvrier, image de la réussite par et dans le travail ou un patient du CTB, qualifié d’obsessionnel par exemple ? Sans doute que ce questionnement pourrait s’étendre à grand nombre de personnes dont le métier et sa pratique impliquent des investissements importants pour ne pas dire excessifs. Mais pouvons-nous toujours dire quelle est la part de notre identité professionnelle proportionnellement à l’ensemble de nos groupes d’appartenances, de nos affiliations constitutives de notre identité ?